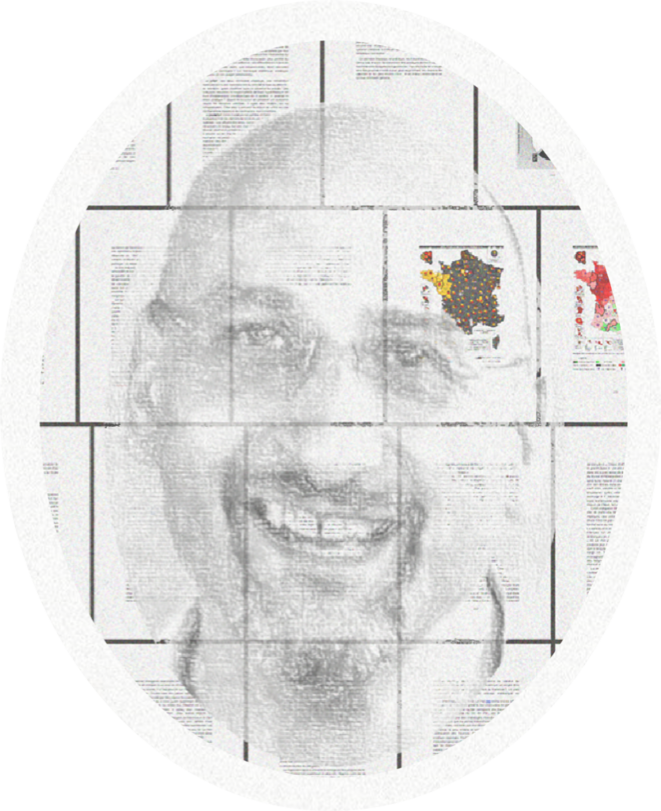Lien vers la vidéo, réellement instructive : https://www.youtube.com/watch?v=mHm6YOIWt4w
Intellectuellement, reconnaître les brutalités de la pacification ne pose aucun problème ; surtout quand, invoquant l'histoire, elles sont démontrées en accord avec les méthodes historiques : causes cherchées dans le passé plutôt que dans l'avenir, restitution du parcours d'un officier responsable plutôt que glose sur les incarnations d'une idée plus ou moins fumeuse, cadrage du sujet sur les violences contre les civils en temps de guerre plutôt que sur le nazisme...
Sauf erreur de ma part, J.-M. Apathie a été sanctionné, puis a donné sa démission. Cela révèle de sa personne une réelle force de conviction, qui se respecte même sans approuver ses approximations historiques. Qu'une radio réprimande en France des formes d'exploitations politiques de l'histoire peut choquer. Encore faut-il bien relever qu'il s'agit d'authentiques instrumentalisations idéologiques, au mépris du minimum syndical de rigueur historique que les enseignants essaient d'inculquer dès le secondaire, voire le primaire. Oui, en histoire, l'événement s'explique par le passé.
Pour le volet idéologique, ce qu'il faut donc comprendre, c'est la complexité des liens entre commémoration et histoire. D'une part, la commémoration doit s'appuyer sur une enquête historique rigoureuse. Imaginons que l'on panthéonise un résistant, et que l'on découvre quelques mois plus tard qu'il a collaboré avec l'ennemi ; cela ferait désordre. Les procédures en canonisation relèvent depuis des siècles de la même logique, avec l'instruction d'un procès. D'autre part, une fois "la vérité" de l'homme faite, du moins raisonnablement admise, la question devient politique. Quelles figures édifiantes les autorités établies souhaitent-elles donner à la communauté pour fortifier sa cohésion et définir son projet de société ?
C'est la réponse apportée par J.-M. Apathie à cette question restée dans l'implicite qui est l'origine du scandale. Dans le service public, ce serait un manquement à son devoir de réserve. Sa hiérarchie pourrait lui reprocher de ne pas agir en fonctionnaire de l'Etat. Dans le privé, cela dépend de la ligne éditoriale du média. Que l'Algérie commémore ses "martyrs", c'est son droit et chacun l'admet sans difficulté. Quand on cherche à imposer les martyrs d'un autre peuple au peuple français, qui plus est dans une démarche de culpabilisation, ce n'est plus une politique souveraine de commémoration, mais une tentative de sujétion morale ; si l'adjectif n'est pas superflu.
Cela n'empêche pas la pacification d'être enseignée au même niveau que les violences de la répression vendéenne, ou celle des troupes napoléoniennes contre les civils ; c'est à dire mal, comme tout le reste, mais aucunement impossible ( Cf https://blogs.mediapart.fr/jrm-morel/blog/271024/deconstruire-le-roman-national-ou-refonder-une-histoire-de-france-populaire ). Ne pas engager une politique d'Etat de commémoration n'interdit pas de faire de cette pacification l'objet de travaux universitaires ou d'oeuvres grand public. Tout au plus les représentants du peuple souverain n'ont pas jugé à ce jour opportun d'ériger des statues aux crimes de la France. Certains mouvements d'opinion ne se satisfont pas qu'il soit possible de les documenter et d'en parler en France : ils revendiquent en des termes outranciers de leur ériger des statues ( au propre ou au figuré ), quitte à faire table rase de celles qui précédaient, cela en fonction de leurs desiderata plutôt que selon un quelconque intérêt général.
Le titre de votre vidéo me paraît tout à fait inapproprié avec le propos censé répondre. Personnellement, à la même question, je cherche plutôt la réponse dans la guerre de décolonisation que dans les brutalités coloniales. On n'écrit pas l'histoire au conditionnel, et nul ne saura jamais si les relations franco-algériennes auraient pu sortir de la crise par le haut en l'absence de crimes de guerre inexpiables de toutes parts durant la période 1954-1962. L'histoire des conquêtes est régulièrement ponctuée des atrocités que vous décrivez ici, et les peuples arrivent souvent à les surmonter. Pour récupérer 1,5 millions d'Alsaciens et Mosellans, la France a perdu presque autant de soldats contre l'Allemagne dans une guerre d'une brutalité inouïe ; sauf à considérer que les corps déchiquetés par les obus soient plus civilisés que les massacres à l'arme blanche. Les deux peuples ont réussi à passer outre, une fois traversé le déchaînement d'une autre guerre ( fratricide ? ).
Quelques souffrances que les peuples algériens aient eu à endurer en période coloniale, l'Etat qui en est issu est plus vaste que tout ce que l'Algérois avait jamais dominé. Les parcours de M. Hadj ( dont la femme française a confectionné le premier drapeau algérien ) ou de F. Abbas laissent croire que tout n'était pas perdu entre les deux rives de la Méditerranée au début des années 1950. A cela s'ajoutent la complexité et l'ambivalence des liens tissés entre populations locales. En revanche, le schisme franco-algérien a ensuite pris des dimensions exceptionnelles aussi bien dans l'histoire coloniale récente qu'au regard de l'effondrement d'empires anciens ; aggravé par l'installation consécutive en métropole, dès les années 1960, de tous les anciens acteurs de cette guerre, de l'OAS au FLN.
Bien sûr, cette décolonisation n'est pas issue de nulle part ( encore qu'il faille élargir le contexte à la Deuxième Guerre mondiale, au-delà des dynamiques internes des sociétés coloniales, pour comprendre la gestion française des revendications d'indépendance ), et c'est pourquoi elle ne saurait être réécrite au conditionnel. Mais pour répondre à la question que vous posez en titre, personnellement, je crois que le noeud gordien se trouve entre 1954 et 1962, voire après, bien plus qu'entre 1830 et 1954.