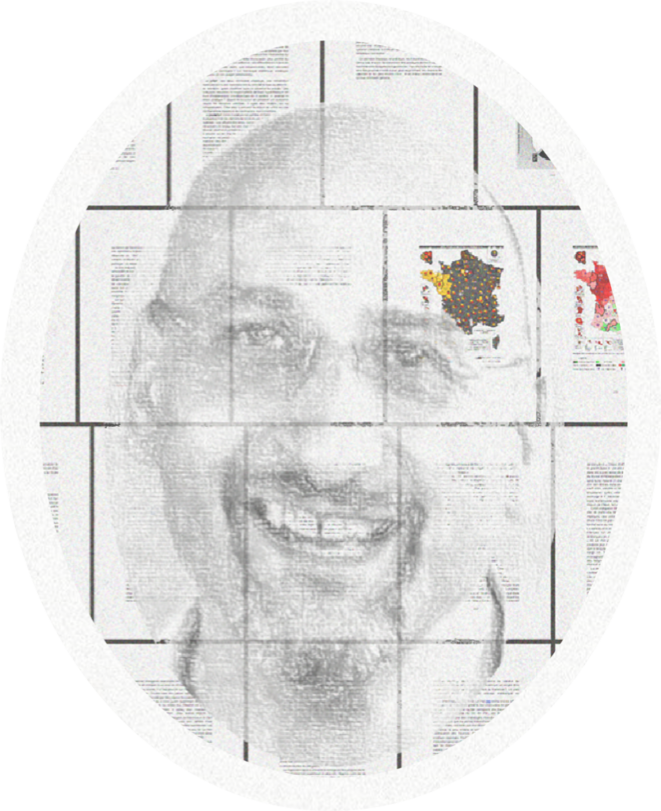* Note : les références historiques ( M. Bloch, R. Brubaker, G. Duby et alii ) sont rapportées de mémoire. Leurs propos n’étant pas au cœur du sujet ( mais au centre de la démarche ), je n’ai pas pris le temps de les référencer ni vérifier de manière adéquate. Je m’en excuse auprès des lecteurs plus rigoureux que je ne le suis pour ce dérisoire billet de blog.
Amorcer une réflexion sur le décès de J.-M. Le Pen en se référant à M. Bloch appelle plusieurs lectures. M. Bloch a été l’historien ayant déploré de ne pas avoir vu le nazisme ( sa montée, sa dangerosité, sa nature ) à force de se détourner du temps court de la politique ; le Français ayant accompli son devoir en servant dans l’armée de la débâcle ; le Juif entré en résistance pour combattre un ennemi existentiel occupant le territoire ; le citoyen qui s’est interrogé au soir de sa vie sur la responsabilité des élites françaises des années 1930 dans les succès hitlériens. Ce dernier point est l’objet d’un ouvrage monumental d’A. Lacroix-Ruiz ( Le choix de la défaite, paru chez Dunod poche en 2024, 1186 p. ) qui inspire la présente analyse de l’extinction et de la postérité d’une génération d’extrême droite. J’espère ainsi réussir mieux qu’un simple jeu de miroirs entre un grand homme panthéonisé et l’héritier d’un passé qui ne passe pas…
Le travail d’historien repose sur un principe premier, incontournable pour tout esprit critique : chaque document versé au corpus renseigne d’abord sur son auteur, ensuite, peut-être, selon la qualité et les buts de l’observateur, sur ce dont il parle. La rubrique nécrologique de ces derniers jours a permis aux uns et aux autres de s’affirmer de gauche ou de droite, d’adopter des postures n’instruisant guère l’actualité considérée. Ce décès pourrait non seulement concrétiser une bascule générationnelle des extrêmes droites, mais encore relancer une dynamique de conquête de pouvoir qui était auparavant entravée par les outrances du fondateur du Front national. A l’instar de M. Bloch dans les années 1930, nous pourrions ne pas voir les ressorts profonds du phénomène, où jouerait de manière déterminante l’incurie ( voire la trahison ) de nos élites actuelles, telle qu’elle a plongé le pays dans l’infamie au début des années 1940.
Une fois cela dit, le fait « décès » pourrait prendre la dimension d’un événement historique si et seulement si l’on pouvait le relier à des transformations socio-politiques décisives, à un faisceau de signifiants le rendant emblématique du devenir de notre nation.
- L’opposition lepéniste dans l’histoire de la Ve République :
J’ai traité ailleurs[1] les données relatives à l’opposition lepéniste, au regard de toutes celles qui ont accédé au second tour des présidentielles. En résumé, si ce billet avait été rédigé il y a un an, il aurait été possible de qualifier cette opposition comme la plus nulle de notre histoire quinto-républicaine. Pourquoi nulle ? Premier critère : la faiblesse des scores au regard de toutes les autres oppositions de second tour. Deuxième critère : l’inexpérience des arcanes de l’Etat.
A l’évidence, ce second critère est de moins en moins recevable, pour deux raisons. D’abord, la présence renforcée au palais Bourbon et dans les collectivités territoriales contrebalance l’amateurisme congénital du lepénisme-père. Ensuite, ceux qui ont dirigé le pays en tant que partis de gouvernement vont de désaveu en dégagisme. Les scrutins de juin-juillet derniers ont accéléré leur discrédit qui va de mal en pis depuis la décennie 1990 ( sauf pour le cycle sarkozysme/antisarkozysme qui en constitue une déclinaison spéciale ) ; décennie 1990 qui avait confirmé la fonction tribunicienne du Front national.
En résumé, après 2024, le lepénisme-fille n’est plus l’opposition la plus nulle de l’histoire de la Ve République, et ce titre peu glorieux tend à revenir au centrisme d’A. Poher ( 1969 ). En effet, même la faiblesse de la nouvelle génération d’extrême droite est de plus en plus discutable. Etablie sur critère numérique, à savoir son assise populaire lors des présidentielles, elle doit aussi être envisagée de manière fonctionnelle. Il s’agit dès lors de la confronter à son poids effectif dans les institutions et dans l’opinion publique, ainsi qu’à la fracture très progressive des « digues républicaines », c’est-à-dire la fin de son isolement partisan et la dévitalisation du front républicain ( pour plus d’information, voir : https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/040125/legislatives-2024-front-republicain-entre-votes-de-temoignage-et-votes ).
Sans pouvoir parler de marée montante comme pour la vague socialo-communiste des années 1970, chacun constate une crue des extrêmes droites qui, en France comme dans le monde occidental, inondent ou irriguent ( selon les partis pris ) des terres de plus en plus éloignées de leur lit originel.
- 2002 côté lepénisme : rupture, ou transposition de sa situation initiale dans un autre contexte ?
Le moment 2002 illustre parfaitement l’idée qu’une nouvelle retentissante peut détourner l’attention de ses conditions socio-culturelles de réalisation. Certes, l’accès de l’extrême droite au second tour est alors inédite. Cependant, ce n’est pas le Front national qui s’est élevé à la finale présidentielle, c’est la présidentielle qui s’est abaissée en marchepied de l’extrême droite. Admettre cet état de fait change totalement la perspective, interroge les stratégies des acteurs politiques et électorats depuis cette date ; voire durant la décennie qui l’a précédée, laquelle est globalement admise par les incompétents comme une période de progression irrésistible de J.-M. Le Pen.
Le mitterrandisme en actes s’est assorti de la première rupture indéniable dans l’histoire des extrêmes droites françaises de la Ve République. Jusque-là, sauf pour la timide percée électorale de J.-L. Tixier-Vignancour en 1965 ( que J.-M. Le Pen considérait comme candidat naturel après plusieurs années de forte couverture médiatique lors des procès de l’OAS ), l’extrême droite était dépourvue de socle électoral conséquent. En 1981, J.-M. Le Pen n’a pas réussi à obtenir les 500 présentations d’élus qui lui auraient ouvert l’éligibilité à la présidence de la République. Sept ans plus tard, il rallie près de 4,5 millions d’électeurs. C’est durant cette période que le clivage idéologique s’est constitué, sur lequel nous reviendrons après avoir brossé à grands traits l’évolution de l’électorat lepéniste.
Pour le total des masses impliquées, c’est simple : il n’y a presque aucun changement de 1988 à 2002 ( vulgarisation des données : https://www.youtube.com/watch?v=noTo8XgAM4A ). Sauf pour les décès et renouvellement nécessaires, sauf pour des variations territoriales sans renversements majeurs, sauf pour les défections mégrétistes globalement compensées au premier tour, sauf pour les quelques centaines de milliers de gains indéniables ; les électeurs de 2002 auraient presque pu être les mêmes que ceux de 1988. Entre temps, le parti de J.-M. Le Pen ne s’est pas imposé comme un prétendant crédible au pouvoir, mais les partis de gouvernement ont perdu beaucoup d’électeurs, dispersés vers des candidatures marginales ou repliés dans l’abstention.
A l’époque, les politologues débattaient beaucoup de la persistance ou non du clivage gauche-droite. Pour ma part, j’ai soutenu que la configuration de 2002 ne constituait pas une tripolarisation authentique de notre vie politique, mais la superposition en décalé de deux clivages : un clivage gauche-droite structurel, articulant l’immense majorité des élus locaux ainsi que les partis aux ressources financières et humaines assurant leur prépondérance dans l’appareil d’Etat ; un clivage idéologique entre lepénisme et anti-lepénisme. Le terme « humaniste » alors accolé à cette idéologie définie en négatif ne constitue pas une catégorie scientifique opératoire, hormis en tant qu’auto-proclamation relayée par toutes sortes de pouvoirs et réseaux partisans.
2002 n’a pas consacré la croissance du lepénisme, mais la déliquescence de ses opposants. Se placer ainsi à l’épicentre du débat idéologique a déstabilisé ses adversaires, dont la crédibilité s’est effritée à force de se positionner de manière réactive plutôt que proactive.
- 2002 côté front républicain : vers un républicanisme incantatoire, échec intellectuel et politique
Entre 1981 et 1988, les partis de gouvernement ont essuyé des remous qui leur ont aliéné des électeurs. A droite, la question européenne a motivé des réalignements et dissensions au moins jusqu’à l’ère chiraquienne. Quant à la gauche, elle a rapidement muté en « gauche brahmane », pour reprendre le concept de T. Piketti, et est passée pour un mouvement viscéralement social-traître. En dernière instance, elle n’est toujours pas sortie de ce cycle, même s’il s’est renouvelé et envenimé avec les modes identitaires.
A propos de celles-ci, R. Brubaker ( Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, Belin, Paris, 1997, 320 p. ) signale que cette percée de l’extrême droite est aussi concomitante du débat sur le service national. Le gouvernement Mauroy a passé en 1983 un accord avec Alger pour permettre aux Franco-algériens ( plus spécifiquement concernés en raison de particularités juridiques qui sortent de la démonstration présente ) d’accomplir leur service national dans le pays de leur choix, strictement individuel, indépendant de toute considération politique de résidence, de naissance…
Depuis lors, le débat s’est enkysté en termes de pluri-nationalité, la conception des droits et devoirs civiques a été inféodée à des considérations identitaires. Cela ruine peu à peu la culture de contrat social au principe de la République française avec l’article 1 de la DDHC, « […] Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Autrement dit, les droits du citoyen qui outrepassent les quatre fondamentaux de l’article 2 ne sont ni naturels, ni imprescriptibles, mais fonction de son mérite, entendu comme devoir de servir l’intérêt général.
Cette réciprocité ( en pratique anéantie ) est étayée en théorie par les articles relatifs à la loi, notamment le 6e qui en fait l’expression de la volonté générale, le cadre de toute action et de toute rétribution symbolique ou matérielle des « vertus » et « talents » des citoyens. La première constitution française, révolutionnaire mais pas encore républicaine, s’inspirait ainsi des modèles antiques d’égalité dite « géométrique », où l’accomplissement de devoirs ouvrait par étape des droits qui leur étaient proportionnels. L’exemple archétypal de tels dispositifs reste le cursus honorum romain ; mais également les comices centuriates…
Le traité de Maastricht de 1992 a conçu un embryon juridique de citoyenneté transnationale. La communauté européenne ayant déterminé ses citoyens par délégation de compétence aux Etats, elle s’est ainsi présentée officiellement comme la première démocratie incapable de définir son peuple ; lequel lui rend la politesse en l’ignorant massivement lors des élections, voire en votant contre elle. Les droits consacrés sont réels, mais peu usités, garantis par une administration mal légitimée, souvent taxée d’inefficacité, entre autres maux. Au fil des années, ce ne sont pas les citoyennetés nationales qui ont insufflé un fort sentiment d’appartenance à la citoyenneté européenne, mais les dynamiques transnationales qui ont sapé l’identification à un peuple souverain, tout en faisant émerger des citoyennetés de castes. Désormais, comme nous le verrons, à l’instar de l’Union Européenne, la France est une République incapable de définir ses citoyens ; surtout si l’on admet que ce devrait être un socle consensuel et efficient de nos institutions, une « masse de granit », selon la formule consacrée.
La loi Jourdan-Delbrel, qui assimilait depuis 1798 le citoyen à un soldat, a été suspendue en 1996. Lorsqu’en 2002 le lepénisme atteint le second tour, la déliquescence des partis de gouvernement exprime une perte de repères quant au contrat social de citoyenneté : quels droits pour qui ? Pour quoi ?... La mobilisation exceptionnelle contre la situation issue des urnes masque mal l’absence de réponse de fond, et l’affirmation de la citoyenneté parmi les préoccupations lancinantes des Français ( Cf travaux d’époque et plus récents d’A. Muxel ). En dernière instance, la défiance populaire dans les critères administratifs et médiatiques de reconnaissance et de pratique civiques traverse en filigrane la majorité des débats de société.
Loin d’avoir obtenu une clarification, cette confusion n’a fait que s’épaissir durant les décennies ultérieures avec toutes sortes de singularismes revendiquant plus qu’un droit de cité, globalement acquis, mais aussi la puissance législative. Ce sont des grenouilles se voulant plus grosses que des bœufs, des détenteurs d’un droit incontesté à l’autonomie qui se revendiquent autocrates. Que ce soit en matière religieuse, sexuelle, alimentaire ou autre, chaque communauté plus ou moins groupusculaire entend faire la loi non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous. L’un des marqueurs les plus évidents pour le grand public en est la prétention à édicter les règles de la langue officielle de la République.
Faute d’élaborer un discours et un programme de cohésion nationale, les partis se complaisent dans des logiques clientélistes qui accentuent la fragmentation de la société. Quant aux médias, il se plaisent à illustrer l’adage de PPDA : « un mauvais journaliste est comme un bon canon : sans recul ». Là où les services publics tentent traditionnellement de contrer les forces centrifuges, les administrations centrales affichent leur complaisance pour une partie de ces singularismes à la mode.
- L’anti-lepénisme, composante majeure du parisianisme :
Pour quiconque a déjà consulté les médias de masse, globalement centralisés dans la capitale, le caractère anti-lepéniste du parisianisme est une évidence. Il frôle souvent la caricature dans les médias par rapport aux réalités des urnes, où il est déjà très prononcé et a suivi une trajectoire politique originale en France.
Le vote parisien se prête volontiers à un exercice de géopolitique électorale, dont quelques traits saillants portent précisément sur notre sujet. Bien entendu, Paris est un territoire de prédilection pour l’étude des rapports de pouvoir sachant que cette ville concentre non seulement l’essentiel du paysage audiovisuel français, mais aussi de nombreux acteurs de l’ombre : hauts fonctionnaires, personnels à hauts revenus dans des secteurs stratégiques pour le monde politique, comme la communication… En résumé, Paris concentre si puissamment les élites que le vote parisien donne un aperçu de leur culture politique.
Les données électorales révèlent un conflit géopolitique entre Paris et le reste du pays ; encore latent en 2002, le mouvement des gilets jaunes l’a rendu patent moins de vingt ans plus tard. En 2002, avec 31,2 % de non exprimés au premier tour, Paris s’abstient sensiblement plus que l’ensemble de la France. Ce n’est pas une exception, mais la règle suivie jusque-là lors des présidentielles. Dans le même temps, les votes en faveur de J.-M. Le Pen atteignent péniblement 6,44 % des inscrits. Ses réserves électorales sont réduites, comme l’attestent les 0,7 % d’inscrits liés à B. Mégret ainsi qu’un score de second tour plafonnant à 8,09 %.
Que ce soit par crainte d’une prise de pouvoir lepéniste ou par gentrification accélérée de Paris intramuros, ces deux facteurs sont compatibles et peuvent avoir contribué aux inflexions ultérieures du vote parisien. Premièrement, les Parisiens se mobilisent désormais beaucoup plus que les autres Français lors des élections, avec 22,88 % de non exprimés en 2022 contre les 27,93 % nationaux. Autrement dit, ils ont identifié dans le lepénisme une menace directe pour leur pouvoir. Deuxièmement, alors qu’à échelle nationale le lepénisme de premier tour a connu une croissance de 143 % entre 2002 et 2022, il est tombé à 4,27 % pour M. Le Pen à Paris. Cependant, ce chiffre implique la forte concurrence locale d’E. Zemmour, pour un total de second tour qui plafonne à 10,33 % des inscrits parisiens ; soit 127 % du score lepéniste de second tour en 2002.
Que l’on prenne parti pour les élites parisiennes ou pour le lepénisme provincial, force est de constater que ce conflit est l’une des fractures politiques majeures du pays ; sans être la seule… En d’autres termes, ayant déjà établi que le lepénisme a longtemps été l’opposition de second tour la plus nulle, puis la plus faible ; sa progression conteste « l’utilité commune » de nos élites, ce qui se cristallise dans le débat récurrent sur leurs « distinctions sociales » jugées disproportionnées. S’il faut envisager avec A. Morelle et tant d’autres Parisiens la prise lepéniste de l’Elysée par les urnes, elle constituerait la preuve de… Quoi ? Au mieux, de leur impuissance, au pire, de leur trahison, avec l’entre-deux de l’incompétence. Bien entendu, cela n’est recevable que si et seulement si l’on considère la souveraineté populaire comme légitime.
En revanche, si l’on reprend l’argument de Mme de Staël qui considérait que les Lumières étaient trop peu répandues dans le peuple pour permettre le transfert de souveraineté amorcé par la Révolution de 1789, si l’on admet avec un évêque du film Le Parrain que « bâtir sur le peuple, c’est bâtir sur la boue » ; alors le renversement de ces élites éclairées serait une injustice, celle de l’obscurantisme au pouvoir. Il est bon de le rappeler, car ce type d’arguments s’ancre de plus en plus dans le paysage audiovisuel depuis, d’une part, l'échec des élites au référendum de 2005, d’autre part, leur radicalisation sur tous les singularismes possibles et imaginables.
- Des années 1980 aux années 2020 : quels héritages pour quel avenir ?
A supposer que la responsabilité des responsables non coupables soit pleine et entière, les mécanismes sociaux ayant engendré une aussi mauvaise sélection des élites gagneraient à être étudiés. Mandarinat ? Népotisme ? Endogamie sociale ? Carriérisme ? Peu importe à ce stade de la réflexion… Tout au plus faut-il se demander si cette France des années 1980 était en devenir ou aux prises avec un destin supérieur, si les élites étaient ou non impuissantes.
Cette décennie a été traversée par une polémique sur la massification de la double citoyenneté, dans un contexte où elle pouvait désormais être exercée de manière effective ; là où les transports des années 1930 ne permettaient guère d’accomplir ses devoirs civiques pour divers Etats. Cette polémique devait-elle inévitablement aboutir à la quasi-disparition de la citoyenneté dans notre droit ? A l’abdication de la prérogative étatique de définir son corps civique et le contrat social afférent ? A transférer à l’individu le soin de s’inventer une citoyenneté dans n’importe quel cadre idéologique ou territorial, au service de n’importe quel pouvoir temporel ou spirituel ?
Cette décennie a également vu la première vague d’attentats islamistes, sous la forme d’ingérences étrangères avec la rue des Rosiers en 1982. L’islamisme devait-il inéluctablement s’enraciner pour fomenter attentats endogènes ? En 1989, l’affaire du foulard portait bien sur un foulard, comme son nom l’indique, et sur son port dans un établissement scolaire ; un tel précédent débouche-t-il invariablement sur la popularisation des burqas dans l’espace public de certains quartiers ? Les premiers incendies de voitures la même année, pour fêter la saint Sylvestre, devaient-ils inexorablement glisser vers des attaques de commissariats avec mortiers d’artifice pour célébrer la fête nationale ? Quant aux lames de fond démographiques, la dénatalité, alors observable depuis une dizaine d’années, devait-elle forcément s’éterniser au point de fragiliser durablement le socle humain du pays, ainsi que la transmission familiale de sa culture, ses valeurs et principes ?
Enfin et surtout, cette décennie marque la financiarisation débridée de l’économie et la conversion de la gauche au néolibéralisme très étudié par ailleurs ( Cf S. Scull, 2024… ). Le sacrifice du monde ouvrier en vue d’une France tertiaire et touristique ( rappelant celle désirée par l’administration hitlérienne, qui faisait de Paris le bordel géant de son « Europe nouvelle » ) était-il une fatalité ? Etait-ce le prix de l’adaptation du pays à la modernité ? Cette politique a directement fait basculer plusieurs millions d’électeurs vers J.-M. Le Pen. Elle est de nos jours remise en cause sans succès tangible à l’échelle statistique.
Surtout, la désindustrialisation ( inachevée mais réellement engagée ) a été symptomatique d’une bureaucratie ayant plaidé pour une bureaucratisation de l’économie. On voit ainsi poindre un certain narcissisme dans une stratégie économique imprudente en termes de souveraineté ( la reconstruction industrielle d’après 1945 avait fait consensus en vue de disposer des moyens de l’indépendance réelle ), et certainement contreproductive dans tous les sens du terme. Ce mépris de classe doublé d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ( soit par nécessité, soit par idéologie, vénalité ou, en un mot, incompétence ) contribue encore à entretenir et à fortifier le lepénisme de deuxième génération, lequel a plus de marges de progression dans les territoires traditionnels de gauche que de droite ( je le montrerai dans l’édition « Chronique électorale – France », mais d’ores et déjà : https://www.youtube.com/watch?v=CxvGvBkAohM ).
En résumé, si « la France de Le Pen père » des années 1980 avait devant elle un champ des possibles très large, elle n’augurerait pour les années 2020 « une France de Le Pen fille » que par défaillance durable des élites parisiennes. Bien entendu, s’il y avait nécessité historique, nos élites ne sauraient être mises en cause. Tout au plus cela interrogerait-il leur « utilité commune », car des acteurs impuissants ne servent par essence à rien et ne devraient être gratifiés d’aucune « distinction sociale ». A cet égard, le débat est vaste entre les logiques libérales et dirigistes pour déterminer où sont les mérites effectifs…
Le décès de J.-M. Le Pen place l’observateur face à l’évidence qu’il a fondé un mouvement transgénérationnel. En cela, il n’est pas forcément indispensable et ne constitue pas un événement historique, en tant que signifiant incontournable de mutations et continuités historiques. Quand on connaît l’histoire des années 1980, pour les plus jeunes, ou quand on se la remémore, pour les plus âgés ; le plus surprenant n’est pas d’entendre le glas pour ce vieil homme, mais que sa fin ait trouvé un tel écho, au point de chercher à l’horizon les signaux d’un commencement.
J.-L. Tixier-Vignancour l’a précédé à tous égards. Sans que son décès en 1989 ne soit passé totalement inaperçu ( https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cac90027216/mort-de-jean-louis-tixier-vignancour ), il n’a pas marqué les foules. L’apogée de sa carrière avait été conjoncturel, porté par l’onde de choc de la guerre d’Algérie. Le personnel politique d’alors joignait le soutien des élites à celui de la majorité de la population, ce qui a étranglé ses débouchés politiques. Il faut néanmoins admettre que gouverner un peuple cadré par toutes sortes d’institutions est plus facile que transfigurer les polémiques d’un peuple atomisé à force de singularismes effrénés.
L’histoire de France est en partie rythmée par des cycles où la synergie entre élites et peuple alterne avec leur neutralisation réciproque ; situation avérée par les dernières législatives. Une édition ancienne de l’histoire de France dirigée par G. Duby avait un chapitre qui s’intitulait, à propos de la charnière entre le XIVe et le XVe siècle, « Paris, tête folle d’un royaume exsangue ». Malgré une période intermédiaire où le capitalisme d’Etat a jeté les bases de la puissance de la France pour les décennies ultérieures ; entre la France des années 1930 dépeinte par A. Lacroix-Riz et notre actualité politique, le génie français risque encore d’inventer de nombreuses variations de l’adage « le poisson pourrit par la tête ».
En définitive, combien d’occasions ont-elles été manquées de reléguer le mouvement lepéniste des années 1980 à une boursoufflure de l’histoire, crevée aussitôt gonflée, oubliée aussitôt soignée ?
J. Morel.
Pour aller plus loin : https://www.youtube.com/watch?v=noTo8XgAM4A&t=8s
[1] J. Morel, « Reports du 1er au 2nd tour 2022 – Emmerder l’autre France : projection électorale et extrapolation sondagière dans les sciences politiques », dans 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 177-222.