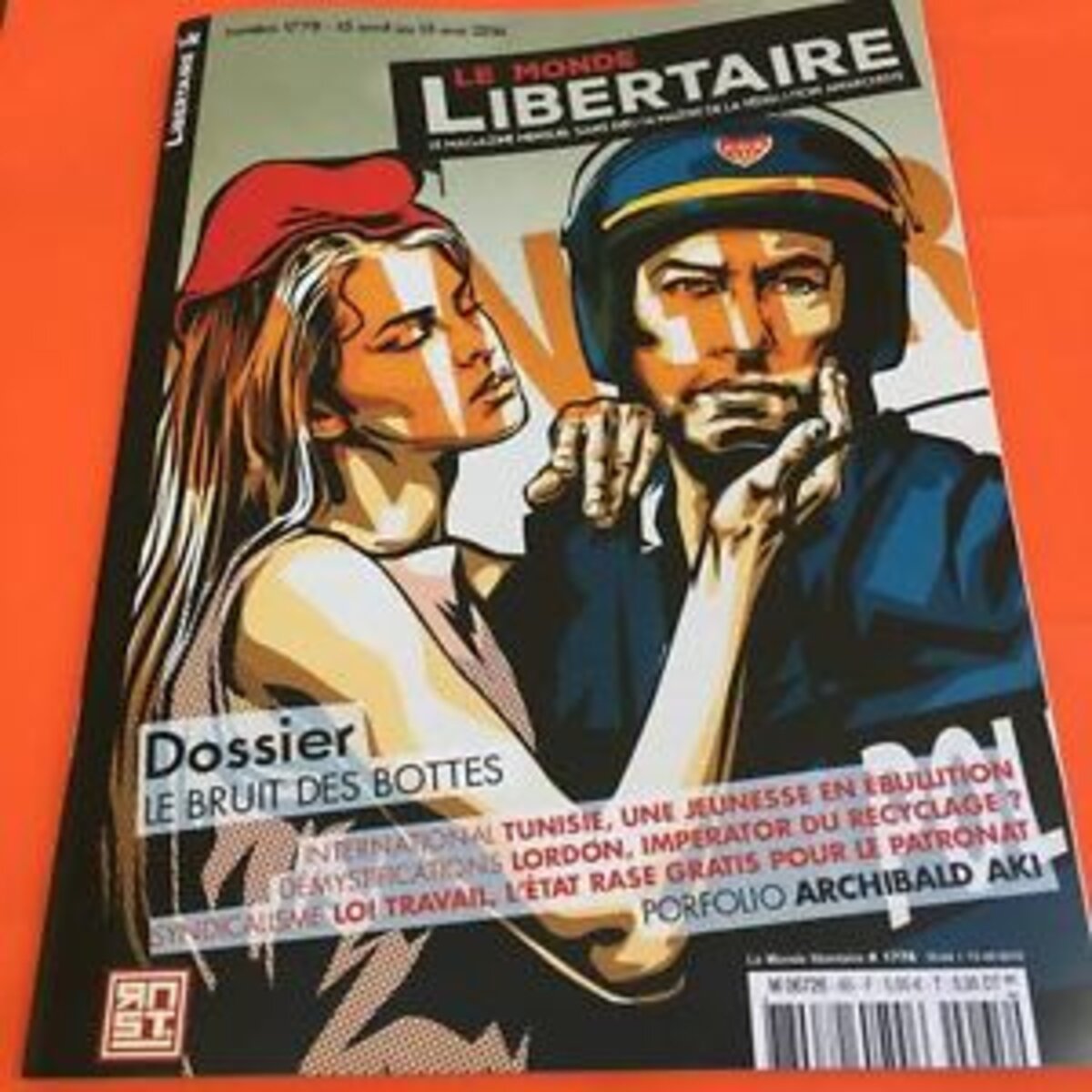
Lordon, Imperator du recyclage ?
Commentaire sur « Imperium »
Par René Berthier
- Extraits d’un texte paru dans Le Monde Libertaire, n° 1778, du 15 avril au 15 mai 2016, pp. 38-45 -
Imperium. Structures et affects des corps politiques de Frédéric Lordon, La Fabrique (2015)
Introduction
Frédéric Lordon est une « icône intellectuelle du moment », le « prince de la vie connectée »[1], un « rebelle médiatique » pour ceux qui ne l’aiment pas. Lui-même se décrit comme un économiste « hétérodoxe ». Il veut rapprocher la science économique de la sociologie. Spinoza, le philosophe du XVIIe siècle, lui sert de fil conducteur, ou de grille de lecture, dans ses travaux.
Le moins qu’on puisse dire est que son dernier ouvrage est dense – un peu trop dense, peut-être, car on en saisit mal le fil conducteur. C’est pourquoi je n’aborderai dans ce commentaire de lecture que quelques aspects des développements de l’auteur, au risque de ne rendre compte que de manière extrêmement partielle de son ouvrage. Dans la mesure où Lordon évoque souvent la « pensée libertaire » – d’une manière singulièrement fragmentaire et déformée – les lecteurs du Monde Libertaire ne s’étonneront pas que je m’attarde un peu sur cet aspect de l’ouvrage.
Ce sont des forces passionnelles collectives qui conduisent les hommes à s’assembler – ce que Frédéric Lordon définit par « imperium », « ce droit que définit la puissance de la multitude ». Lordon remet en cause l’internationalisme, s’en prend à l’« horizontalité », au dépérissement de l’Etat. Il pense que nous sommes condamnés à la « verticalité » et que le pouvoir est voué à être « capté », mais il précise que ce n’est pas une raison pour abandonner le combat pour l’émancipation. Une chose est certaine : Imperium ne servira pas d’ouvrage de référence pour les masses populaires en marche vers leur émancipation, à moins de trouver pour ce livre extrêmement obscur un très bon traducteur.
[…]
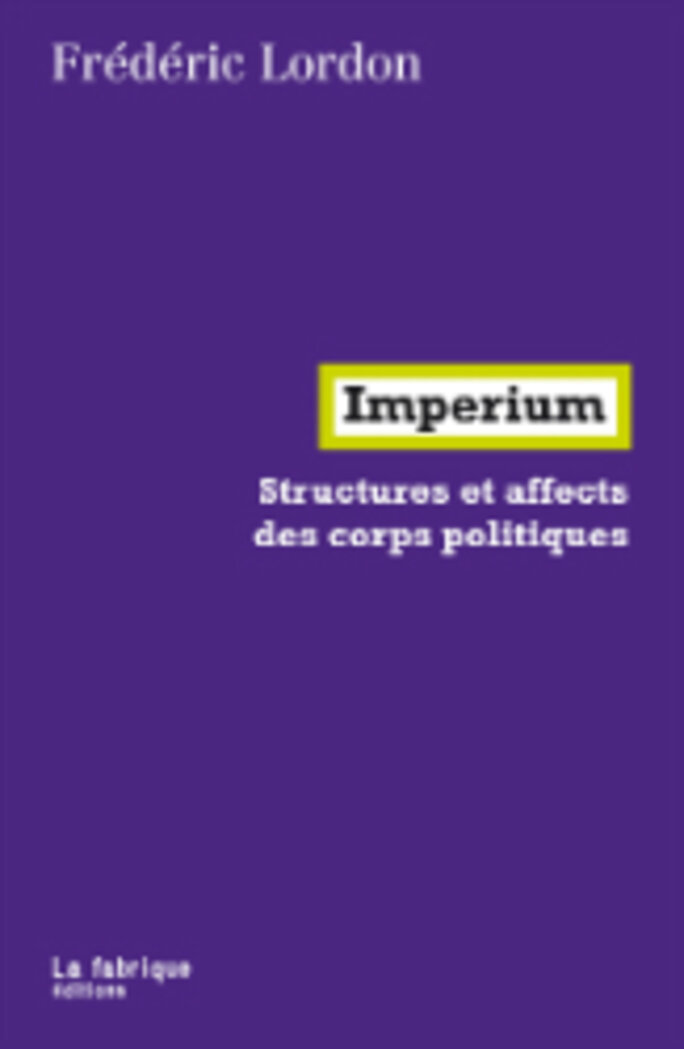
6. Lordon et l’anarchisme
Il y a une relation curieuse entre Lordon et l’anarchisme, pour lequel il semble éprouver une certaine sympathie condescendante, auquel il accorde des « moments de lucidité », mais par rapport auquel il prend soin de se démarquer. La bibliographie à la fin de son livre est significative : un livre de Proudhon (Du principe fédératif) aucun de Bakounine, l’Histoire de l’anarchisme de Préposiet et L’Anarchisme de Daniel Guérin. Imaginons un philosophe parlant du marxisme avec un bagage comparativement aussi pauvre… Il ne serait pas pris au sérieux. L’anarchisme de Lordon est un anarchisme de Reader’s Digest.
L’anarchisme sert en fait de repoussoir à Lordon : son discours est en gros le suivant : « Ce que disent les anarchistes est sympa, mais irréaliste. » Il y parvient assez bien, mais pour cela il lui a fallu faire un tour de passe-passe. Il présente l’anarchisme d’une manière déformée, caricaturale, après quoi il n’a aucun mal à le réfuter.
Lordon est persuadé que l’anarchisme est opposé à tout ce qui est vertical : « La pensée libertaire ne veut pas voir le vertical », dit-il (p. 240)[2]. Il ignore que le fédéralisme, qui est le principe d’organisation libertaire, fonctionne sur un mode pyramidal, ce qui implique une certaine « verticalité » : la question est de savoir comment sont organisés les « flux ». Gaston Leval, qui a formé quelques militants de la génération du « Baby Boom », disait que « s’il y a une base, il y a forcément un sommet ». Il ajoutait : « S’il y a une circonférence, il y a forcément un centre ».
La prise de décision se fait à partir des structures de base de l’organisation et remonte, à travers les instances intermédiaires, jusqu’au sommet où, pour dire les choses sommairement, la masse des informations est traitée. Ensuite le « flux » redescend sous la forme de décisions qui sont mises en application. Proudhon [3] et Bakounine [4] sont d’accord sur ce point. Le reste n’est qu’une question d’organisation pour mettre en place le contrôle des mandats, leur rotation, etc. Ça s’appelle tout bêtement le fédéralisme.

Ça fait longtemps que les anarchistes ont compris que la politique ferroviaire d’un pays comme la France, voire plus, ne sera pas décidée par l’assemblée générale de la gare de Bécon-les-Bruyères, ou que la politique énergétique de la France ne sera pas décidée par les travailleurs de la centrale de Porcheville. Pendant la guerre civile espagnole, les anarcho-syndicalistes ont organisé les chemins de fer de manière tout à fait satisfaisante, malgré les difficultés de la guerre. Parler d’opposition de principe des anarchistes à toute sorte de « verticalité » n’a pas de sens et relève d’une ignorance crasse de ce qu’est l’anarchisme et le fédéralisme – en tout cas le fédéralisme envisagé par les libertaires[5].
Mais sans doute Lordon assimilera les aspects « verticaux » des principes organisationnels anarchistes à des variantes de son « État général », un concept fourre-tout dont on ne sait pas de quoi il est constitué – sans voir en quoi le fédéralisme libertaire est antinomique avec l’Etat. En fait, ce concept flou permet de qualifier tout groupement humain comme relevant de l’Etat, évacuant toute possibilité d’envisager une forme organisée d’anarchisme : dès qu’on s’organise, quelle qu’en soit la forme, on est dans une démarche étatique.
Ce que Lordon doit certainement ignorer, c’est que les débats dans la Première Internationale avaient déjà abordé toutes ces questions.
En cette époque où on « essuyait les plâtres » en matière de concepts, il était fréquent que le mot « Etat » fût employé par des anarchistes dans le sens d’« institution gérant le bien public », en opposition à « institution possédant le monopole de l’action armée ». On trouve ces nuances même chez Proudhon et Bakounine. Il est évident qu’il est nécessaire de tenir compte du contexte avant de s’écrier : « Voyez donc, Bakounine (ou Proudhon) est favorable à l’Etat ».
Au congrès de Bruxelles de l’Internationale, en 1874, la question avait été posée de savoir « par qui et comment seront faits les services publics dans la nouvelle organisation sociale » : l’Etat, ou autre chose ? Et que serait cette « autre chose » ? Les militants de l’Internationale s’étaient posé la question de la désignation de l’organisme qui serait chargé d’administrer la société future. Certains pensaient continuer de l’appeler « Etat », sachant que son fondement serait différent de l’Etat capitaliste. D’autres disaient : puisque le nouvel organisme administratif sera de nature différente de l’Etat capitaliste, il faut éviter des confusions et le nommer autrement. Cela éviterait, dit James Guillaume des « querelles de mots » et de « regrettables équivoques, qui nuisent à la propagande de nos idées plus qu’on ne se le figure ordinairement »[6]. Il y aura donc l’Etat d’un côté, la Fédération des communes de l’autre. Mais personne ne niait que la nouvelle organisation sociale allait être marquée par une certaine forme de « verticalité » inhérente à une organisation complexe s’appliquant à une grande quantité de personnes (une « multitude » ?).
L’institution appelée à remplacer l’Etat ne sera plus une appropriation de la force collective (une « capture » et une « dépossession », dirait Lordon). La question de la force collective et du pouvoir social a été abordée par Proudhon en 1858 dans De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, dans des termes d’une clarté remarquable et d’une surprenante actualité[7].

Un dernier point sur l’inanité des références de Frédéric Lordon en termes d’anarchisme. Les anarchistes, dit-il en substance, ne veulent pas reconnaître que l’Etat revient par la fenêtre à chaque fois qu’on l’expulse par la porte : « Daniel Guérin ne cache rien des hésitations, de l’incohérence même, dont l’“Etat” fait l’objet, par exemple dans la pensée de Bakounine… » Pour illustrer cette « incohérence », Lordon cite un passage de Bakounine extrait de l’anthologie de Guérin : « Je n’hésite pas à dire que l’Etat c’est le mal. » Une telle affirmation péremptoire n’a pas beaucoup de sens hors de son contexte. Or Bakounine est en train d’expliquer que la révolte de l’individu contre la société est plus difficile que la révolte contre l’Etat, car on ne peut pas plus se révolter contre la société que contre la nature. Bakounine ajoute alors : « Il n'en est pas ainsi de l'Etat ; et je n'hésite pas à dire que l'Etat c'est le mal, mais un mal historiquement nécessaire, aussi nécessaire dans le passé que le sera tôt ou tard son extinction complète. »[8] Naturellement, « nécessaire » est pris dans le sens philosophique d’« inévitable ».
L’Etat est né « du mariage de la violence, de la rapine, du pillage, en un mot de la guerre et de la conquête, avec les Dieux créés successivement par la fantaisie théologique des nations »[9]. « L’Etat n’est point la société, il n’en est qu’une forme historique aussi brutale qu’abstraite ». C’est dans ce sens-là qu’il est un « mal ».
On voit d’ailleurs qu’entre Proudhon et Bakounine il y a deux théories de l’Etat : pour Proudhon il est une production « endogène » à la société, il est le résultat de l’accaparement de la force sociale de la société[10] (« L’État… c’est nous ! », dit Lordon). Pour Bakounine il résulte de la conquête[11]. Les deux thèses ne sont pas contradictoires, d’ailleurs, elles relèvent selon moi de la problématique de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide.
Pour appuyer son propos, Lordon fait aussitôt une autre citation de Bakounine, tirée d’un autre texte : « L’Etat doit être radicalement détruit » (p. 232). En fait la citation n’est pas exacte (ce qui est fréquent dans les citations faites par Guérin) parce que le texte original dit : « L'État doit être radicalement démoli et déclaré banqueroute, non seulement sous le rapport financier, mais encore sous le rapport politique, bureaucratique, militaire, judiciaire et policier. »[12] Ce qui fait dire à Lordon : « Aussitôt après avoir renversé le gouvernement établi, les communes devront se réorganiser révolutionnairement, se donner des chefs, une administration et des tribunaux révolutionnaires »[13]. Mais il omet de préciser qu’il s’agit de chefs, d’administration et de tribunaux révolutionnaires « bâtis sur le suffrage universel et sur la responsabilité réelle de tous les fonctionnaires devant le peuple ». Et pour appuyer encore le côté « retour à l’Etat incontournable », il ajoute : « Pour le gouvernement des affaires communes, on formera nécessairement un gouvernement… » – mais Lordon omet de préciser : « …et une Assemblée ou Parlement provincial » (sic).
Le problème est que Lordon veut souligner l’incohérence supposée de Bakounine qui déclare en 1870 que « l’Etat c’est le mal », mais qui dit en 1866 qu’on « formera nécessairement un gouvernement ». Le lecteur ne manquera pas d’être convaincu de la contradiction. Le problème est qu’en 1870 Bakounine était anarchiste, mais qu’en 1866 il ne l’était pas, même si des thèmes précurseurs à son anarchisme se trouvent dans ses textes de cette époque. Mais que Lordon ne se fasse pas hara-kiri pour cela : d’autres auteurs, et pas des moindres, ont fait la même erreur.
Ce qui est irritant, ce n’est pas tant qu’il n’y connaît pas grand-chose en matière d’anarchisme, c’est qu’il n’y connaît pas grand-chose avec autant d’aplomb.
Conclusion
Frédéric Lordon pose des questions essentielles, comme par exemple le fondement de l’Etat – une question à laquelle les libertaires ne sauraient rester indifférents. Le fait qu’il analyse cela à travers le filtre de la pensée de Spinoza est certes intéressant, voire stimulant pour l’esprit, mais il est douteux que, en dehors de quelques généralités, la pensée de ce philosophe né en 1632 puisse servir de « clé » pour décoder la nature de l’Etat en ce début de XXIe siècle. Pour les libertaires d’aujourd’hui les réflexions de Lordon sur l’Etat auraient elles aussi pu être stimulantes ; malheureusement elles sont invalidées par sa propre vision de l’anarchisme, qui relève plus du café du commerce que d’une approche rationnelle.
On peut regretter le recours à un niveau d’abstraction extrême qui conduit finalement à ne percevoir les faits que sous la forme d’essences dématérialisées (comme son « Etat général », en particulier). Il y a en outre quelque chose de parfaitement artificiel à ne considérer les groupements humains que comme des formes potentiellement étatiques.
Si ses analyses sur la « capture » ne manquent pas d’intérêt, force est cependant de constater qu’elles n’ont absolument rien d’original, sa seule originalité étant le vocabulaire employé et la sauce spinoziste qui leur sert d’assaisonnement. Bakounine parlait de « vinaigrette philosophique » pour désigner la philosophie éclectique de Victor Cousin.
Je partage absolument l’opinion de l’auteur d’un compte rendu (dont je n’ai pas saisi le nom) [14] mais qui semble proche d’Alternative libertaire :
« Si les désaccords ne manquaient déjà pas, là où on ne suit plus du tout l’auteur, c’est dans sa volonté de “dégriser” les libertaires. Outre la condescendance face à cette pensée vue par beaucoup comme une éternelle adolescente, il aurait fallu qu’il se documente un peu (beaucoup) plus solidement pour dégriser ces militants anarchistes. »
De fait, j’ai nettement l’impression que Lordon prend les anarchistes pour des cons, ou alors il n’en a jamais rencontré. (Des vrais, je veux dire, pas des anarchistes de salon – ou de comptoir.)
Imperium me fait penser aux textes hermétiques de la gauche hégélienne, rédigés en langage codé, dont les destinataires n’étaient en fait que les autres membres de la gauche hégélienne. L’unique et sa propriété de Stirner est illustratif de mon propos. Ce livre avait passé la censure parce que les fonctionnaires prussiens chargés de la besogne n’y avaient rien compris. D’une certaine manière, certains auteurs contemporains contribuent eux mêmes à se censurer en se rendant difficilement compréhensibles de la masse des lecteurs. On a l’impression que Lordon cherche moins à s’adresser à la « multitude » en quête d’émancipation qu’aux pouvoirs en place, renouant avec ces lignées interminables de philosophes qui, depuis Platon, ont voulu éclairer, conseiller les princes.
Lordon n’est pas le paradigme contemporain de la pensée critique, il est le symptôme de la dégénérescence de la pensée critique.
* René Berthier est militant du groupe Gaston Leval de la Fédération Anarchiste ; syndicaliste aujourd’hui retraité, il a occupé divers mandats au sein de la CGT du Livre (qu'il a rejoint en 1972) entre 1997 et 2003, dont celui de secrétaire du syndicat CGT des Correcteurs ; il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’anarchisme (Proudhon, Bakounine, etc.), l’histoire et la géopolitique (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Berthier_%28libertaire%29); dernier livre publié : Affinités non électives. A propos du livre d'Olivier Besancenot et de Michael Löwy (co-édition Les éditions du Monde libertaire/Les éditions libertaires, novembre 2015, 275 p., voir http://editions-libertaires.org/?p=814)
******************************
Sommaire du n° 1778 du Monde Libertaire, du 15 avril au 15 mai 2016, le premier de la nouvelle formule mensuelle
Terrains de combat
02 Les Affranchis
Par Maurice
04 Syndicalisme ou pratiques alternatives ?
Par Coqs
06 L'État rase gratis pour le patronat
Par Fab
08 Féminismes : histoire et portrait de la diversité
Par Marie-Jo Potier,
Hélène Hernandez
& Élisabeth Claude
13 Féministes sur la bande FM
Par Élisabeth Claude
Zones de chantiers
28 Défendre la Zad
Par Camille
29 Vinci, lâché par ses troupes
Par Anne
30 Les réac-publicains à l'assaut de l'école : Entretien avec Grégory Chambat
Par Thierry
35 Vers une autre école ?
Par Virginie Benito
Le dossier du mois :
Le bruit des bottes
14 Le roi est nu
Par Jean-Jacques Gandini
16 L'étranger et le dilemme identitaire-libertarien
Par Alexis
18 Klaus Mann ou les dangers de l'exil
Par Patrick Schindler
24 Un racisme d'État
Par Loran
26 C'était un temps déraisonnable
Par Bernard d'Aubenas
Secteurs à explorer
38 Lordon, Imperator du recyclage ?
Commentaire sur Imperium
Par René Berthier
Portfolio
50 Traces et traits cicatriques
Par Archibald Aki
Sans frontières
46 Tunisie : révolte de la jeunesse marginalisée
Par Alain Baron
47 Nécessité d'une mobilisation citoyenne face à l'offensive du capital financier
Par Sami Souhili
Domaines cultivés
56 Du cinéma documentaire
Par Christiane Passevant
59 Dégradé de Tarzan et Arab Nasser
Par C.P. et Jean-Pierre Garnier
60 Chala, une enfance cubaine
Par Daniel Pinos
60 Dans les salles
61 Noire de Tania de Montaigne
Par Olivier Bouly
62 Dans la Bibliothèque
65 Je suis Fassbinder,
de Falk Richter & Stanislas Nordey
Par Pierre Sommermeyer
Archipel libertaire
67 De La Sociale à Proudhon... et de Proudhon à La Sociale
71 Agenda militant
74 Les groupes de la Fédération anarchiste
76 Le programme de Radio Libertaire
77 Bulletin d'abonnement
*******************************
Informations pratiques pour se procurer Le Monde Libertaire
* Pour retrouver les points de distribution du Monde Libertaire : www.trouverlapresse.com
* Le Monde Libertaire est également disponible la librairie Publico (145 rue Amelot Paris 11e) : www.librairie-publico.com
* Pour s’abonner : http://www.monde-libertaire.net/?page=abonnement
* Les anciens numéros peuvent être consultés sur le site du Monde Libertaire en ligne : www.monde-libertaire.net
Notes :
[1] Philippe Corcuff, « S’émanciper du "Lordon-roi" ? », 10 février 2016, https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/100216/s-emanciper-du-lordon-roi
[2] Lordon ajoute aussitôt que la pensée libertaire « ne veut pas non plus voir la violence ». Je ne sais pas ce qu’il veut dire par là. Peut-être que les anarchistes de salon qu’il côtoie répugnent à user de violence pour accéder aux petits fours dans les raouts qu’ils fréquentent, mais Lordon semble ignorer que les anarchistes ont participé activement à toutes les révolutions qui se sont déroulées sur la planète depuis le XIXe siècle, à commencer par la Commune de Paris, la révolution russe, la guerre civile espagnole, la révolution chinoise, sans parler de tous les mouvements insurrectionnels de l’Amérique latine. Pour le seul XXe siècle, les victimes anarchistes et anarcho-syndicalistes du capitalisme, du fascisme, du léninisme et du stalinisme se comptent par centaines de milliers.
[3] « ...centralisation de toutes les forces économiques ; décentralisation de toutes les fonctions politiques » écrit-il dans ses Carnets.
[4] « La centralisation économique, condition essentielle de la civilisation, crée la liberté ; mais la centralisation politique la tue, en détruisant au profit des gouvernants et des classes gouvernantes la vie propre et l’action spontanée des populations. » (Bakounine, Œuvres, éd. Champ libre, V, p. 61.)
[5] Pour être honnête, il y a un penseur que je n’ai pas mentionné, qui pourrait être un précurseur de l’« horizontalisme » dont Lordon parle beaucoup. Je pense à Kropotkine. Lui, voyait l’avenir d’une société libertaire sous la forme de communes décentralisées et librement associées – des libres associations contractuelles, dirait Lordon – mais il attribue cette vision à Bakounine.
[6] James Guillaume, L’Internationale, Documents et souvenirs, Second volume, cinquième partie, ch. IX, p. 233.
[7] « Proudhon. – Force collective et pouvoir social », extrait de De la justice dans la Révolution et dans l’Église, 4e étude. L’État. Ch.VII, http://monde-nouveau.net/spip.php?article598
[8] Bakounine, Dieu et l’Etat, Œuvres Stock, p. 287.
[9] Ibid.
[10] « Proudhon. – Force collective et pouvoir social », op. cit.
[11] Voir Franz Oppenheimer, The State (1908), New York 1975, Free Life Editions. La formation de l’Etat islamique en Syrie est une confirmation éclatante de la théorie bakouninienne de l’Etat.
[12] « Principes et organisation de la société internationale révolutionnaire. Organisation ». Mars 1866. Amsterdam, IISG, Archives Bakunin.
[13] Ibid.
[14] https://auprochainchapitre.wordpress.com/2015/10/13/degrisons-frederic-lordon-critique-dimperium/



