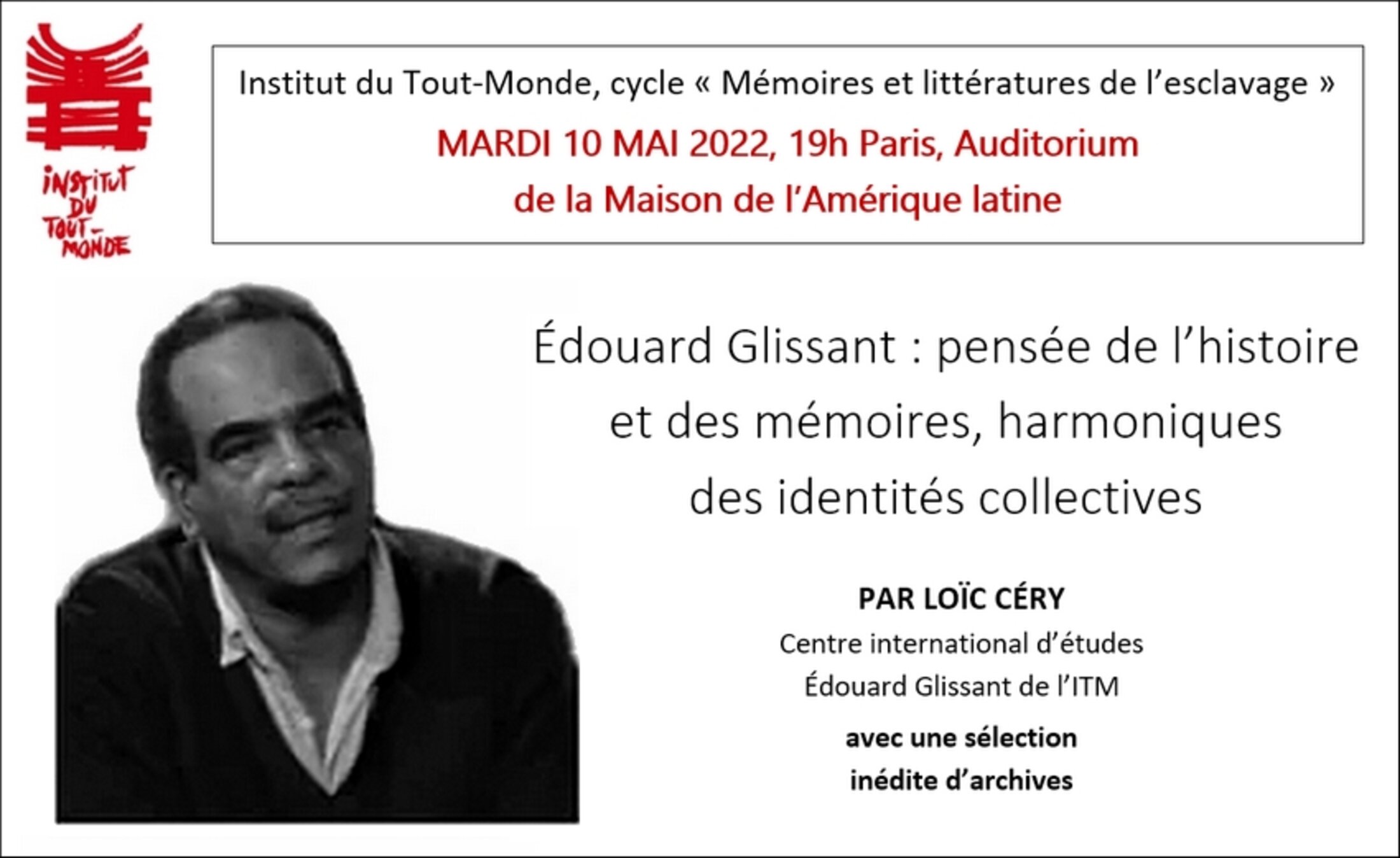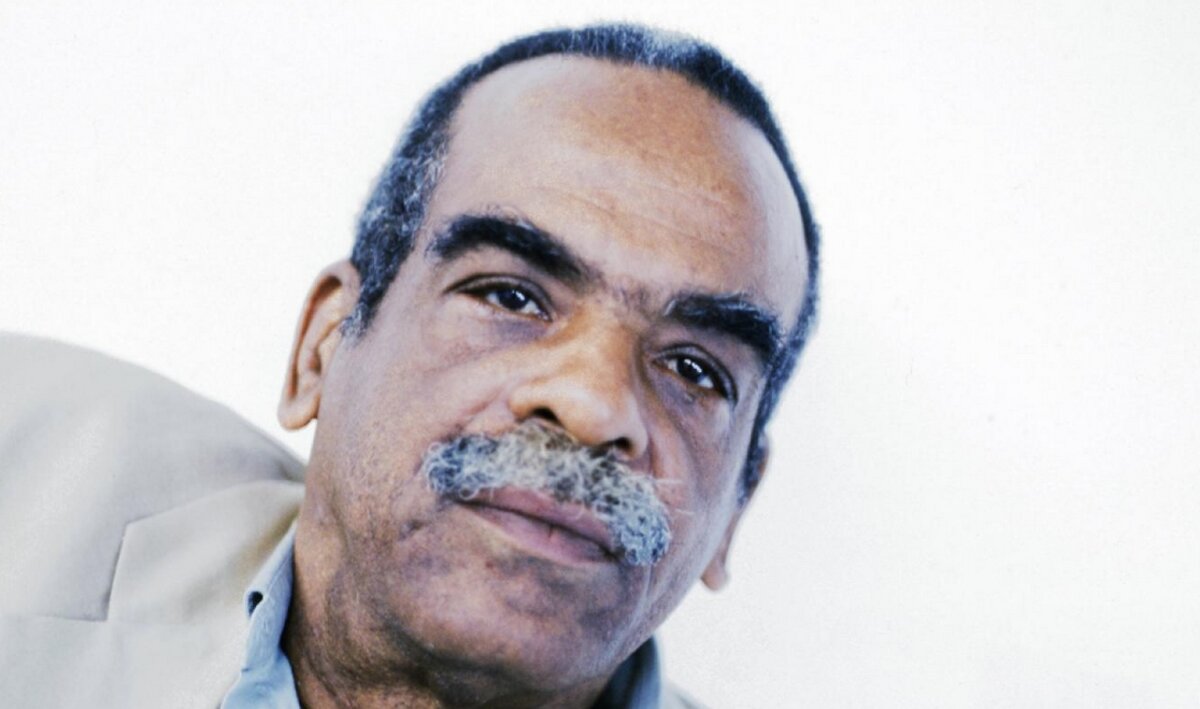
Agrandissement : Illustration 1
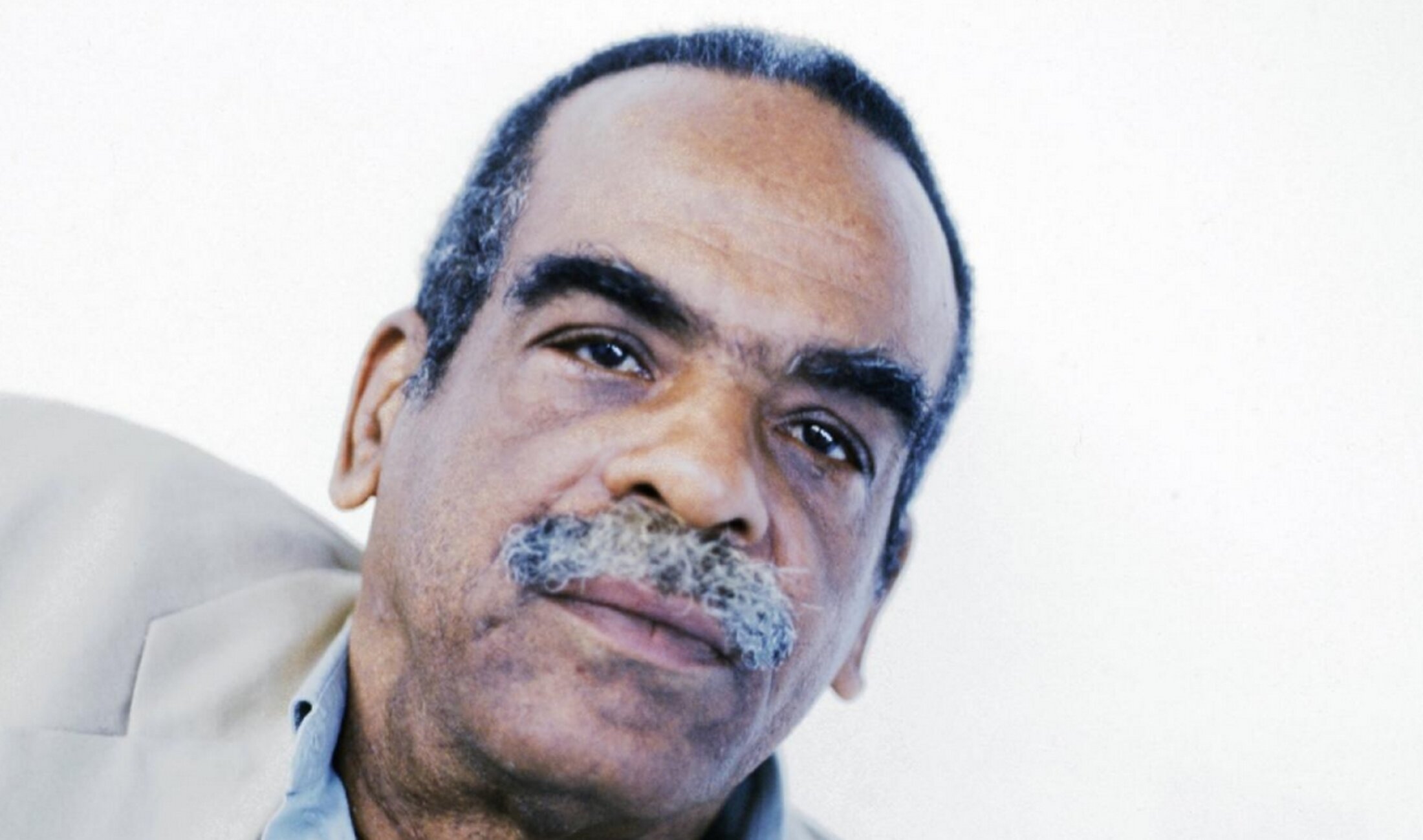
Par la place sans cesse croissante qu'elle occupe dans le débat public et les sciences humaines, la pensée d'Édouard Glissant est plus que jamais l'objet d'interprétations diverses et souvent contradictoires. Au cours de ces deux dernières années, on a encore pu juger en France combien sa vision de la créolisation pouvait susciter un intérêt singulier. Aujourd'hui, appréhender l'œuvre de Glissant par l'une des voies qui permettent le plus sûrement de la considérer comme un tout insécable, cheminer vers elle à la fois selon l'intégralité vivante et dynamique qu'elle désigne et la précision de ses notions, consiste certainement à y distinguer l'une des pensées de l'histoire les plus ambitieuses de la modernité. Une pensée où s'articulent à la fois les désinences de la mémoire (« ses ombres et ses audaces ») et cette acception ouverte et stimulante des identités qui fascine autant qu'elle interroge le dépassement des normes traditionnellement pratiquées en la matière. Si la vision glissantienne nous parle aujourd'hui de perspectives inédites, au milieu des tournants et des impasses qui nous enserrent, c'est aussi parce qu'elle nous incite au gré de nouveaux paradigmes, à une écoute lucide du passé tout en nous projetant dans l'imprévisible des futurs, où la Relation et la trace nous invitent à étreindre le « temps éperdu ».
Cette œuvre autant que ce parcours, méritent certainement d’être mieux et plus précisément diffusés, tout particulièrement en ce moment où la pensée de Glissant semble encore plus qu’auparavant, inspirer les uns et les autres. Car que sait-on vraiment aujourd’hui d’Édouard Glissant, dont on a trop tôt classé les écrits dans l’ensemble indistinct des littératures et études dites postcoloniales, ou qu’on peine souvent à réduire à un triptyque assez mystérieux fait de trois notions clés mais complexes : créolisation, Relation et Tout-Monde ? À vrai dire, Glissant demeure un inclassable, déjouant encore onze ans après sa mort, les étiquettes étroites par lesquelles on chercherait à simplifier une pensée qui fut d’abord celle d’un terreau fondamental, la Martinique de l’après-guerre. C’est de là que partira le jeune étudiant en quête de lui-même, à l’écart de la Négritude césairienne et porteur d’une parole que synthétisera en 1956 le premier essai Soleil de la Conscience au Seuil, avant d’être couronné par le Renaudot en 1958 pour La Lézarde, roman initiatique et politique. Premières années parisiennes de création : création romanesque encore (Le Quatrième Siècle en 1964, par sa remontée généalogique d’une histoire antillaise oblitérée), poétique avant tout (Les Indes, vaste mémorial de la colonisation, après les premiers recueils, Un champ d’îles, La Terre inquiète et avant Le sel noir qui scrute en 1960 les itinéraires de l’oppression), mais aussi conceptuelle (L’intention poétique poursuit en 1969 la trajectoire d’une recherche de la parole juste, accordée aux champs divers de la Relation) et théâtrale, avec Monsieur Toussaint en 1961. Une littérature qui explore et qui revendique, au temps des décolonisations dont Glissant épouse la cause, jusqu’à cofonder en 1961 le Front antillo-guyanais pour l’autonomie, tout de suite dissout par le pouvoir gaulliste. De retour en Martinique, l’écrivain crée en 1967 l’Institut martiniquais d’études, institution privée d’enseignement dans le sillage de laquelle il fonde la revue Acoma, adossée à un groupe de recherche en sciences sociales. L’un des ouvrages phares de Glissant, Le Discours antillais, est publié au Seuil en 1981, moment où l’écrivain, tirant partie de son observation et d’une étude intégrale de la société et de l’histoire antillaise (une période au cours de laquelle il aura publié le roman Malemort, si déconcertant dans sa forme et comme porté par une veine exploratoire). Dans le Discours, Glissant ambitionne de relever la « tâche colossale » d’un « inventaire du réel », pour reprendre les mots de Fanon, c’est dire la vocation exhaustive de cette somme. Un repère considérable dans sa pensée, qui est aussi le moment où il est appelé à la direction du Courrier de l’Unesco, qu'il assumera avec passion jusqu’en 1988, où il entame aux États-Unis une carrière universitaire qui le mènera de la Louisiane (Université de Baton-Rouge, LSU) à New York (NYU) en 1994. La période aura accompagné une sorte de seuil dans son œuvre, à la fois marquée par le roman Mahagony (1987) et l’essai Poétique de la Relation (1990) où sans jamais renier son ancrage premier ni ses schèmes fondamentaux, il affirme l’ouverture au Tout-Monde qu’il inscrit dans son œuvre avec le vaste roman éponyme de 1993. Au tournant du nouveau millénaire, deux romans denses, Sartorius en 1999 et Ormerod en 2003, questionnent comme en un tourbillon du temps, le cheminement des humanités et de ses soubresauts qu’il va examiner au gré de ses essais des années deux-mille, tout en y cherchant inlassablement les voies de la Relation : La cohée du Lamentin (2005), Une nouvelle région du monde (2006), Philosophie de la Relation (2009).
Déjà dans ses dernières années, Édouard Glissant avait été sollicité à plusieurs reprises, pour sa vision autant que son action de médiation, à l’image de ce qu’il avait pu susciter en temps que président honoraire du Parlement international des Écrivains en 1993. Il s’était vu confier en 2006 par Jacques Chirac la tâche de préfigurer les contours d’un centre national des mémoires de la traite et de l’esclavage, qui ne devait déboucher que bien plus tard et après bien des atermoiements des pouvoirs publics. Cette année 2006 aura également marqué la création par Édouard Glissant à Paris de l’Institut du Tout-Monde, qu’il pensait comme un carrefour des cultures du monde, au service d’interculturalités agissantes.
Apprécier aujourd’hui la postérité protéiforme de cette œuvre, exige tout d’abord de la soustraire au vacarme et aux confusions dont l’époque est si éprise. Aussi est-il profondément inutile d’essayer de faire de Glissant un allié des errements de l’heure, quand son projet exigeant de Relation, hors des dichotomies funestes et des simplismes, fut avant tout ancré dans cette pensée de l’histoire et du temps qu’il faut comprendre dans ses questionnements et sa force prospective. Alors oui, l’écrivain peut à bon droit être considéré aujourd’hui comme un visionnaire, quand il réexplore la créolisation comme processus historiquement avéré, quand il envisage comme cardinale la référence au vivant, quand il prône le respect du Divers et considère la nécessité de vivre les interdépendances comme sources de nouvelles solidarités. Une pensée généreuse certes, « humaniste » en un sens certainement inédit et renouvelé qui récuse les anciennes acceptions. Pourtant s’il fallait face aux impatiences, chercher un maître-mot à cette pensée, ce serait certainement celui d’émancipation : pas simplement dans le sens politique auquel on s’attend, mais plus fondamentalement encore, en un sens tant individuel que collectif où il s’agit de s’affranchir radicalement des pensées de système en s’ouvrant aux approches intuitives et créatrices face aux urgences du réel. Point tant de « déconstruction » là que de recherche de nouvelles fondations, dans l’infime d’une « pensée du tremblement », dans l’éthique qu’implique le « droit à l’opacité » ou encore dans la mise en avant des figures de l’archipel – non point celui d’une archipélisation du corps social, mais celui d’une refondation des dialogues par la pensée archipélique.
En des instants tragiques de l’histoire du monde, là où les menaces ont rarement été aussi prégnantes, là où se disloquent des certitudes encore récentes, là où les angoisses nous portent à la torpeur collective, il nous importe de lire et de relire Édouard Glissant. Non pas comme un maître à penser, dont il refusait à tout prix le magistère, mais comme un porteur de questionnements. Et emprunter avec lui, en son conseil, ce qu’il nommait les « écarts déterminants » vis-à-vis de nos voies sans issues, ces écarts qui doivent nous aider à nous protéger des aveuglements que portent l’époque :
« On nous dit, et voilà vérité, que c’est partout déréglé, déboussolé, décati, tout en folie, le sang le vent. Nous le voyons et le vivons. Mais c’est le monde entier qui vous parle, par tant de voix bâillonnées. Ou que vous tourniez, c’est désolation. Mais vous tournez pourtant. » (Traité du Tout-Monde, 1997).
En des temps de résurgence inédite des nationalismes et des discours sectaires, en des temps où à nouveau le monde bascule dans l'innommable, il faut lire et relire Glissant pour de bon. Il faut le lire avec méthode parce qu’il le faut si on veut le comprendre en profondeur, et fiévreusement comme le suggère son verbe prophétique. Le lire non pas en cherchant dans ses écrits l’antidote final aux maux qui nous enserrent, mais y scrutant les mots et la poétique en effet d’une émancipation autant que de l’entrée en « une nouvelle région du monde ». Nous tâcherons d’amorcer ce parcours à Paris, Maison de l’Amérique latine, le 10 mai prochain à 19h.
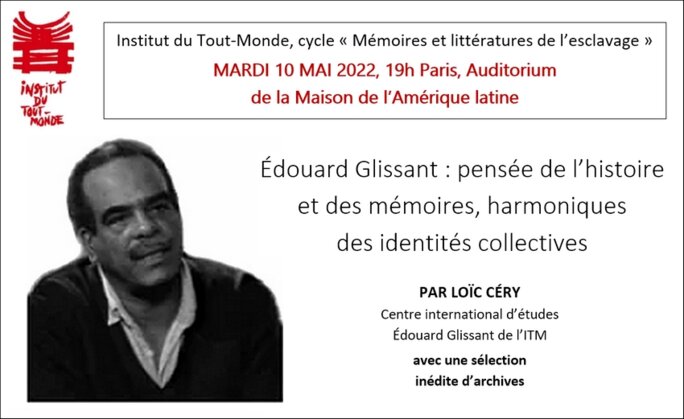
Agrandissement : Illustration 2