Les affaires humaines sont compliquées, parole d’être humain. A la fin de cette séquence « amendement 159 », la sénatrice qui le portait a expliqué devant le Sénat la raison de son combat contre la psychanalyse, incarné pour elle par une rencontre avec un psychanalyste. Enfin, pas elle directement. Elle en a pleuré d’émotion, le trauma toujours là, visible. La colère aussi.
Amendement 159 / Loi centre experts : même combat
L’amendement 159 proposait de définancer tout ce qui touche de près ou de loin à la psychanalyse. La représentante du gouvernement n’a pas désavoué la démarche, le cadre était juste inadapté. Ce n’est donc que partie remise pour trouver le bon cadre... Et c’est la même sénatrice, Mme Guidez, avec d’autres qui soutiendra une proposition de loi en faveur des centres experts, structures qui font du tri, du diagnostic et qui au-delà de leurs recommandations ne s’occupent pas de personne ensuite, dans la durée. Donc un diagnostic dépris de toute relation de soins.
La proposition de loi a été déposée en février 2025 au Sénat. La première lecture aura lieu le 16 décembre prochain. Après l’amendement 159 qui visait à exclure une pratique, ce nouveau projet de loi s’attaque frontalement à l’organisation des soins psychiatriques, nouvelle réforme établie sans la moindre concertation ni avec les usagers, ni avec les syndicats de psys, ni avec les professionnels du terrain. Une pétition vient d’être lancée par l’Evolution Psychiatrique. Ce projet de loi entend faire basculer la psychiatrie vers une vision cérébrologique hégémonique.
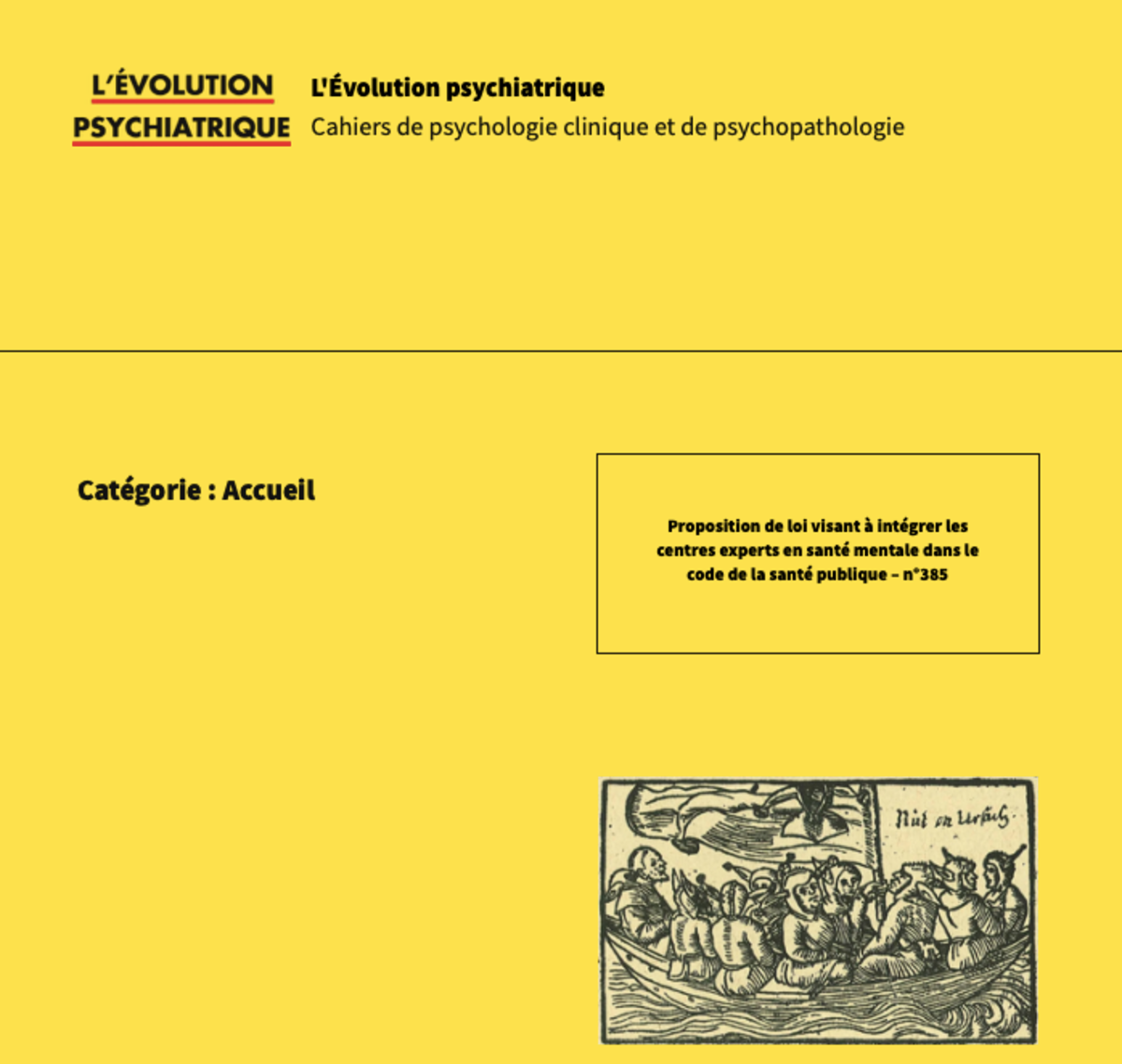
Agrandissement : Illustration 1
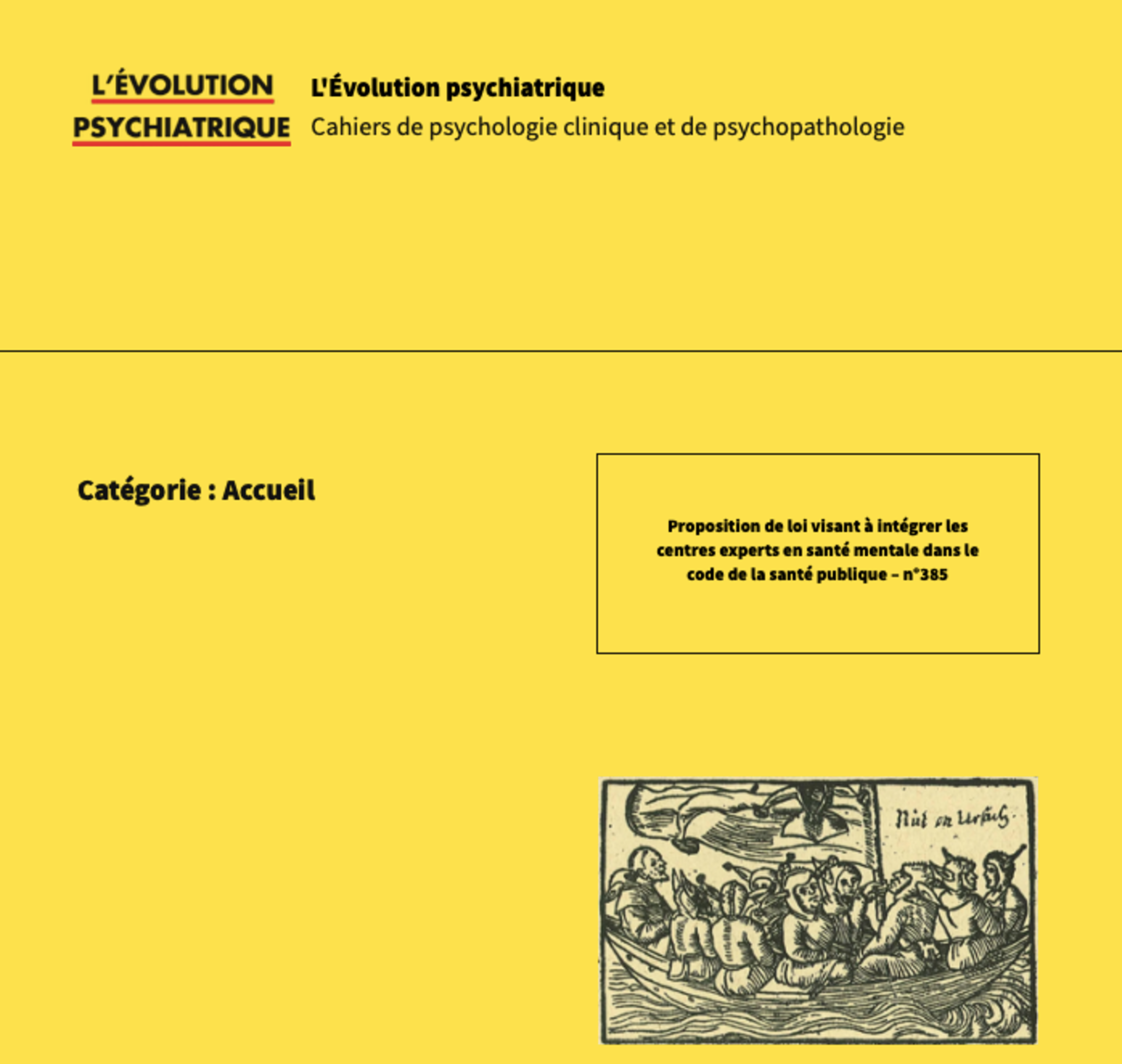
Humilité
Mais revenons sur les motivations de la sénatrice qui se retrouve au croisement des deux textes. Elle a expliqué que sa propre sœur avait eu un enfant atteint d’un syndrome de Rett. Cette maladie génétique rare liée au chromosome X crée un trouble neuro-développemental, au sens strictement neurologique du terme, et non au sens extensif de ce que sont devenus les troubles du neurodéveloppement à partir de 2010 sous la pression du DSM 5 et de la cérébrologie.
L’histoire remonte à trente ans, quarante ans en arrière. Une personne décrite comme psychanalyste aurait eu une attitude inadaptée, des questions blessantes et non ajustées. Et pour finir des propos culpabilisants. La psychanalyse s’est ici incarnée dans ce psychanalyste et la mauvaise rencontre que cela a constitué pour cette famille. Car il y a des paroles qui ne s’oublient pas, qui font mal, qui blessent inutilement. Reconnaissons-le humblement, aucun professionnel, quelque soit son orientation technique n’est à l’abri de cela. Tout comme aucune théorie n’est à l’abri de la culpabilisation voire du renversement de la responsabilité des troubles sur la personne, sur la famille ou sur l’enfant qui ne va pas bien. On peut repenser aux « tares héréditaires », aux « incorrigibles », aux thèses de la « dégénérescence », du « criminel né » et à toutes ces essentialisations qui ont gangrénées l’histoire de la médecine, de la psychologie, de la psychiatrie… Bien avant la psychanalyse.
Débordements
Nous travaillons avec la souffrance humaine et parfois, elle nous impacte tellement que nous développons des contre-réactions. Elle peut tellement nous troubler que nous pouvons dire des choses qui ne vont pas, qui ne vont vraiment pas. Parfois, on s’enferre dans cette mécanique infernale car nous possédons le savoir, en tout cas un certain savoir ou supposé comme tel. Il est des circonstances où nous ne voulons ni être mis en question ni nous remettre en question. On s’abrite derrière ce savoir qui nous protège de nos défaillances bien humaines. Mais en réalité, on s’abrite derrière notre pouvoir, notre pouvoir symbolique, notre pouvoir réel. Notre pouvoir qui peut mettre au silence, qui peut faire taire toute contestation. Et les personnes en face, elles le sentent, elles le voient, ça les sidère car on a déjà dû leur faire le coup un certain nombre de fois. Certaines se glacent, se renferment, d’autres sont hors d’elles, à l’image du hors de nous-mêmes dans lequel nous sommes pris, à l’image de la glace qui s’étend en nous.
Et en fait, notre boulot de soignant, de thérapeute, dans ces cas-là c’est quand même de se retourner sur nous-mêmes et de faire savoir aux personnes que l’on s’est absenté de notre rôle de soignant par connerie, par impatience, par suffisance. Parfois on se fait déborder par l’autre, ses failles faisant écho aux nôtres, on se fait déborder par nos propres vies, par l’institution, par tout un tas de trucs. Parfois on n’arrive pas assez à se retenir. Mais notre boulot, pour ne pas rajouter de la saloperie à la saloperie, pour ne pas être sadique, c’est de reconnaître nos débordements, nos insuffisances, nos conneries plus grandes que nous. Reconnaître notre pathoplastie : comment on peut ajouter de la surpathologie à la pathologie existante.
Primum non nocere
Primum non nocere. L’accueil, l’hospitalité, le contre-transfert, sont premiers dans la construction d’une relation, que l’on se réfère ou non à la psychanalyse. La façon dont le soignant s’adresse pour la première fois à la personne, comment il l’écoute ou non, comment il lui parle, le ton de sa voix, les questions qu’il pose, les réponses qu’il donne ou non. Quand du négatif surgi de cette rencontre, il faut pouvoir le traiter en nous-mêmes, avec nos collègues, en équipe, avec l’institution pour que ça ne retombe pas sur le paleteau des patient(e)s. Avons-nous été ajustés ? Avons-nous fait ce qu’il fallait ?
Les phrases attribuées à ce professionnel et le vécu de violence consécutif racontés par cette sénatrice sont affligeants. Mais la psychanalyse est-elle l’explication totale et finale à cette violence ? Et son éradication la solution définitive ? Je ne crois pas. Par contre, je pense que la psychanalyse peut servir de prêt à porter défensif pour être uniquement « dans la tête » et pour ne pas s’occuper du corps. La psychanalyse peut servir de défense intellectuelle à des thérapeutes amputés de l’affect, du tact et du contact. Tout comme la médecine. Combien d’histoires autour de nous de soignants froids, rigides, imbus d’eux-mêmes, toutes spécialités confondues ? La faute à la psychanalyse à chaque coup ?
D’autres théories peuvent tout aussi bien servir de défenses pour rester à la surface des troubles, voire pour ne pas s’occuper des personnes. « Faites ceci, faites cela ». « Ne me parlez pas de votre famille, de vos problèmes au boulot, le problème c’est en réalité comment vous gérer »… Ici le thérapeute n’est pas bloqué dans sa tête avec ses défenses intellectuelles, il est bloqué dans le faire, dans l’activisme des recettes magiques de court-terme.
Dans toutes ces situations, ce qui se joue c’est un rapport problématique du soignant, des institutions, à l’angoisse. Comment la supporter ? Un rapport aussi à notre propre impuissance. Parfois, on n’y arrive pas et ce n’est pas seulement, voire pas du tout, la « faute » du patient. Par moment, il faut accepter que l’on ne sait pas, que l’on ne sait pas faire, que c’est angoissant. Parfois, il faut supporter cette impuissance, le temps que ça se débloque. Et ne pas projeter la faute sur l’autre.
D’autres récits
Ca me rappelle une histoire personnelle. Des proches ont eu un enfant porteur d’un handicap génétique à la naissance. Les médecins ont prédit une vie très courte à ce bébé, un décès dans les semaines suivant la naissance. Ensuite, les blouses blanches ont culpabilisé les parents de ne pas vouloir faire tel geste médical ayant un risque vital important. L’enfant a survécu. A chaque fois, ces spécialistes avaient des phrases culpabilisantes, arrogantes, prédisant le pire si on ne les écoutait pas. Il a vécu une belle vie jusqu’à un âge adulte. Mais un jour, cet enfant a passé un test de QI, prise en charge standardisée s’il en est. Ce qui a effondré les parents, ce sont les chiffres qui étaient censés résumer l’intelligence de cet enfant. Enfant dont émanait une vie, une joie, une poésie qu’aucun putain de test de QI ne pouvait refléter. Il n’était pas question de psychanalyse ici. Faut-il interdire les tests standardisés ?
Les violences médicales et psychologiques dépassent ces frontières-là. Elles peuvent se faire au nom de la psychanalyse, au nom de la médecine, au nom de la psychologie, au nom du bien des personnes. Elles peuvent se faire en toute bonne conscience sans que l’on s’en rende compte. Elles peuvent se faire au nom de la science. Au nom de n’importe quoi en fait.
Et puis le terme « psychanalyste » est devenu un synonyme générique de « professionnel de santé qui culpabilise les parents ». Cela peut aussi être un pédiatre, un psychologue clinicien ou un psychiatre qui n’est pas forcément orienté par la psychanalyse... Dans l’histoire racontée par la sénatrice, difficile d’en dire plus sans en causer aussi avec les premiers intéressés : l’enfant et ses parents. La sénatrice est la sœur de cette femme, la tante de cet enfant. Il faut prendre soin de distinguer ce qui est rapporté de façon directe ou indirecte. En somme, contextualiser pour tenter de comprendre. Et comprendre n’est pas excusé (Déso Manu Valls). Est-ce que ce professionnel exerçait en institution ? Dans laquelle ? Quelle était l’ambiance institutionnelle ? Quel était l’état des coopérations entre professionnels ? Etait-ce en libéral ? Quel était le parcours préalable à cette rencontre ? Comment s’est fait le choix de ce professionnel ? Etc. etc.
« On te croit »
Le vécu et le ressenti doivent être crus puisqu’un vécu ça ne se discute pas, c’est vrai pour la personne. Le slogan féministe « on te croit » est une boussole. En tant que psychiatre, quand quelqu’un délire, c’est une prise de position : « je te crois ».
Et de rajouter que croire ce n’est pas forcément synonyme d’être convaincu sinon on peut tomber dans un certain nombre de travers qui évacue la densité, la complexité des situations (cf. le livre « Faire Justice » d’Elsa Deck Marceau à la Fabrique). Croire est le premier mouvement d’accueil et d’hospitalité de la parole d’autrui pour qu’un partage puisse se faire. Donc je crois le récit de la sénatrice car il faudrait être drôlement tordu pour inventer une telle histoire à des fins idéologiques. Mais je ne suis pas convaincu par le lien direct, exclusif, qui est fait. Et je suis d’autant moins convaincu que trois semaines plus tard, elle co-signe un projet de loi pour torpiller l’ensemble du système de soins en définançant ce qui soigne pour financer ce qui trie via la loi sur les centres experts (L’embellissement de la communication de FondaMental à coup d'arguments scientifiques de ces centres est paru dans le Monde: ici.)
Diagnostic différentiel
Dans ce cas précis, la sénatrice fait le récit d’un enfant avec un trouble du neuro-développement neurologique et génétique. La neuro-pédiatrie a avancé, les enfants ayant des troubles psys ont systématiquement un dépistage de la possible organicité des troubles.
En 2010, interne dans un hôpital de jour pour enfants ayant potentiellement des troubles du spectre autistique, nous travaillions en concertation avec les neuropédiatres du service voisin. Je me rappelle d’ailleurs le croisement des regards lors de nos consultations communes, cela avait été un moment très formateur pour l’interne que j’étais. Comme j’étais déjà passionné par le travail de l’institution et dans l’institution, nous parlions également des troubles institutionnels que vivait la neuropédiatre dans cet hôpital. Pathologies institutionnelles qui avaient été naturalisés sur le mode : « c’est comme ça, c’est l’évolution de la médecine, on n’y peut rien ». Mais le « c’est comme ça » masquait une construction politique, celle des réformes néolibérales des services publics (les RGPP).
2004, loi Douste Blazy qui avait crée la tarification de l’activité (T2A). 2009, loi Bachelot HPST « Hôpital, Population, Santé, Territoire » sous le mandat du Président des Bracelets Electroniques, pardon de la République (Sarkozy). La neuropédiatre courait dans les services, l’institué T2A la traversait, il fallait que le service soit rentable. Nous en parlions. Elle racontait comment la T2A pressurisait le temps des examens cliniques. Comment, aussi, les jeunes internes étaient mieux formés à prescrire des examens complémentaires qu’à faire de la clinique avec le regard, le toucher et l’écoute. Tous ces échanges étaient riches et soignaient les coopérations, ils bénéficiaient aux enfants et à leur famille pour penser de façon pluridisciplinaire les choses. Peut-être que dans les années 1990, date où la sœur de cette sénatrice et son enfant ont eu affaire à ce psychanalyste, ces coopérations là n’existaient peut-être pas facilement, que les diagnostics différentiels n’étaient pas suffisamment faits.
« Eliminer l’organicité »
Lors de mes études de médecine, nous apprenions de façon automatique une phrase qui pouvait valoir un PNZ (Pas Noté Zéro) : « diagnostic après avoir éliminé l’organicité ». Cela voulait dire qu’avant tout diagnostic psychiatrique, il fallait exclure toute possibilité de diagnostic somatique. C’est d’ailleurs à cette fin qu’un examen somatique est désormais obligatoire avant une entrée à l’hôpital psychiatrique pour les personnes sous contrainte (loi du 5 juillet 2011). Examen clinique, imagerie cérébrale, bilan biologique voire plus afin d’éliminer une étiologie neurologique, vasculaire, métabolique, traumatique, tumorale ou autre. Visiblement, cela n’a pas été le cas dans le récit de la sénatrice.
Mais il suffit de lire le livre de Pauline Chanu « Sortir de la maison hantée. Comment l’hystérie enferme encore les femmes » paru à la Découverte1 pour s’apercevoir que l’élimination de l’organicité peut faire défaut partout même chez les spécialistes du corps. L’autrice raconte qu’une femme qui faisait des paralysies à répétition avait été diagnostiquée hystérique. Elle passait régulièrement aux urgences, le corps soignant n’en pouvait plus. La chaîne de la psychologisation-psychiatrisation permettait de démédicaliser ces troubles vécus. L’affaire dure des années. La personne est déprimée, à juste titre, par cet état de fait. Retraumatisation : la dépression est comprise par ses diagnostiqueurs comme une atteinte de l’humeur telle que décrite dans l’hystérie, personnalité histrionique ou trouble conversif... Jusqu’à ce qu’un interne, visiblement n’ayant pas oublié son PNZ, lui fait un électro-encéphalogramme (EEG). Il avait repris le dossier car il ne s’était pas contenté du « c’est l’hystéro qui revient ». Elle n’avait jamais eu d’EEG. Et là, bingo, diagnostic d’une épilepsie particulière qui expliquait l’ensemble de ces symptômes. Cette patiente a aussi vécu les mots blessants du corps médical. Ce n’était pas le fait de la psychanalyse mais bien de préjugés sexistes, patriarcaux et psychophobes. Faut-il interdire la médecine ? Faut-il jeter le bébé avec l’eau du bain croupi des dominations ?
Personnellement, je l’ai raconté dans un billet précédent, j’ai aussi connu la violence de psychanalystes à la petite semaine qui se servaient de leur place, de leur savoir, pour imposer un pouvoir normatif. Collectivement, dans un lieu où je travaillais, nous avions aussi connu la tentative de silenciation d’abus graves au nom d’un savoir pseudo-émancipateur. Mais j’ai aussi connu des saloperies au nom du cerveau-différents-des-patients, au nom de leurs comportements inadaptés, au nom de leurs déficits cognitifs auxquels on ne peut pas grand-chose. Plusieurs costumes pour un même corps: le corps psychiatrique avec ses relents asilaires…
Le principal problème c’est bien le défaut d’empathie voire de sympathie, de souffrir avec l’autre. Plus que la psychanalyse, c’est la question du tact du professionnel qui est en jeu. Comment, un temps soit peu, se mettre à la place de l’autre, partager son vécu, ses difficultés ? Etre en sympathie, là avec l’autre et ses soucis.
Mots blessants, pratiques délabrantes
Pour autant, je pense qu’il y a une différence entre des mots blessants et des mots meurtriers accompagnés de techniques délabrantes qui amputent le corps de telle ou telle façon. Toujours dans le livre de Pauline Chanu, un rappel sur toutes les formes de « thérapeutiques » exercées sur les femmes : les lobotomies, les privations, les charcutages du corps et de l’âme.
Ici, a priori, ces mots blessants n’ont pas été accompagnés, en plus, de techniques délabrantes. Car avec ou sans psychanalyse, le pouvoir des professionnels du haut de leur savoir, peut mutiler. On se rappellera de la psychiatrie gynécologique du XIXème siècle où les femmes subissaient des mutilations au nom de la science. Il faut lire Carlo Bonomi « L’effacement du traumatisme. Aux origines de la psychanalyse » pour comprendre que soigner par la parole quand c’est possible (« la talking cure »), c’est tout de même moins délabrant que de « soigner » en amputant les femmes et les enfants de tel ou tels attributs, au nom de la science. Le mieux ça serait de ni dire de connerie, ni faire de saloperie mutilante. De toujours reconnaître la personne en tant que personne.
Maintenant, faisons une petite analyse politique de la situation. FondaMental voudrait l’hégémonie depuis une quinzaine d’années. Son argument privilégié: la psychiatrie ne souffre pas d’un problème de moyens mais d’organisation. Un vrai mantra. Maintenant, FondaMental promet de faire une masse d’économie avec les centre experts (embelissement donc…). Parce que le fond du problème, pour eux, c’est « le fardeau économique » que représente la mauvaise santé mentale. Ce fardeau il faut l’alléger, il faut que ça coûte moins cher (et au passage que ça rapporte en terme de légitimité scientifique, de conquête du pouvoir et de prises de données de santé). Pour être convaincu: il faut regarder ce passage de « Un monde sans fou » de Philippe Borrel sur les débuts de FondaMental: entre 56 min 55 et 58min33 notamment.
FondaMental : toujours et encore...
Mais les médias commencent à cerner le problème FondaMental : Le Monde, Le Monde Diplomatique, Charlie Hebdo et d’autres à venir. Déso les gars, les filles, mais l’utilisation problématique de la science, ça commence à se voir, surtout quand la science affichée est troublante.
D’abord madame la sénatrice utilise des vieux trucs (bon, remarque, on est au Sénat) comme arguments scientifiques (le rapport INSERM de 2004). Et en plus, pas un mot sur les potentiels conflits d’intérêts des uns avec les autres.. Sur la vidéo, on voit Alain Milon au premier rang, ancien administrateur de FondaMental de 2011 à 2015. Ce sénateur Les républicains m’avait d’ailleurs invité au Sénat pour parler de la contention. Type sympathique. A cette occasion, il avait raconté une histoire qui sentait bon la psychiatrie de secteur, la vraie, la relationnelle où le lien humain sécurise tour le monde. L’histoire : un « forcené » était retranché dans son appartement. Le sénateur, maire à l’époque, est appelé car le RAID va intervenir. Le psychiatre temporise un peu, il arrive à joindre l’infirmière du CMP qui connaît le gars. Elle arrive, elle dit à tout le monde : « relax, j’y vais ». Les robocops lui disent que ce n’est pas sérieux, c’est un forcené, elle risque de se faire buter. Elle y va. Elle revient avec lui, il accepte de se faire hospitaliser. Moralité : la relation, la parole, c’est quand même pas mal non ? Là, c’est pas un centre expert qui aurait été foutu de faire ça...
Mais il n’empêche que le sénateur Alain Milon est donc lié à FondaMental depuis longtemps. Il suffit de consulter les différents rapports du Sénat dès les débuts de FondaMental (historiquement : le rapport de l’OPEPS en 2009 puis le deuxième rapport « Milon » en 2012). Donc ce n’est pas rien. De même, il faudrait aller voir du côté des députés soutenant mordicus les centres experts. Existe-t-il des conflits d’intérêts? Par exemple, quand un député est un ancien directeur d’hôpital ? Il faudrait des enquêtes journalistiques pour déplier tout cela.
Si le monde qui tient à la psychanalyse se félicite du retrait de l’amendement 159, l’affaire est loin d’être terminée. Et au-delà de la psychanalyse, c’est la question du service public qui est posé avec son démantèlement. Les centres experts lié à l’Institut Montaigne via FondaMental en sont l’une des potentielles figures.
A suivre.
Mathieu Bellahsen, le 27 novembre 2025
Pétition contre le démantèlement de la psychiatrique publique - contre le projet de loi n°385 à signer ici:



