(publication d'un nouveau document d'analyse et de décryptage)
(note d'actualité : la compensation biodiversité est l'un des éléments qui permet aux promoteurs de l'aéroport de Notre-Dame des Landes d'affirmer que leur projet est vert, sans impact sur l'environnement et la biodiversité : tout ce qui sera détruit est en effet supposé être compensé).
Le projet de loi relatif à la biodiversité (consultable ici dans sa dernière version) prévoit la généralisation des « obligations de compensation écologique ». C'est à la fois un des principes cardinaux et l'un des sujets les plus débattus du projet de loi, que ce soit au sein du Parlement, ou dans le débat public. La compensation, prévue dans le cadre de la doctrine « éviter, réduire, compenser » (ERC), n'est pas nouvelle. La loi de 1976 en posait les premiers jalons. Mais ce n’est que récemment que la compensation a été mise en œuvre de manière plus systématique, y compris pour répondre aux critiques croissantes auxquelles les nouvelles infrastructures sont exposées. Là où la loi de 1976 mentionnait la possibilité de compensation sans en préciser les contours, les articles 2 et 33A du projet de loi font du mécanisme de la compensation, et de sa mise en œuvre via les banques de compensation, une disposition centrale des politiques de protection de la biodiversité.

Agrandissement : Illustration 1

Le principe est simple. Il s'applique pour tout nouveau projet qui peut avoir un impact sur la biodiversité : il « implique d’éviter les atteintes significatives à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées » (article 2). Simple et doté d'une certaine force de l'évidence, ce principe – et sa mise en application – n'en est pas moins problématique par bien des aspects.
Ainsi, Notre-Dame des Landes, Sivens, Roybon, et bien d'autres projets ont donné l’occasion à des naturalistes et des experts de démontrer la faiblesse intrinsèque des mécanismes et projets de compensation et leur incapacité à restaurer intégralement biodiversité et territoires dégradés : les surfaces impactées sont sous-estimées, les zones humides sont mal caractérisées et sous-évaluées, la biodiversité présente est minorée (oubli d'espèces, etc). De nombreux travaux scientifiques internationaux soulignent également l’échec des dispositifs de compensation et l’impossibilité de récréation de milieux constitués au fil des siècles (on ne remplace pas un arbre vieux d’un siècle par dix arbres âgés de dix ans ou une prairie naturelle ancienne par un pré saturé en nitrates).
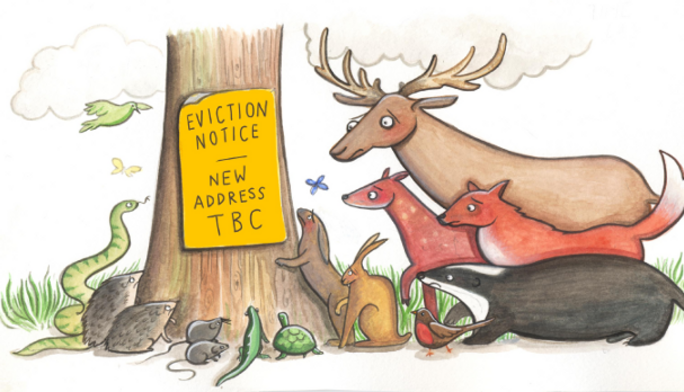
Agrandissement : Illustration 2
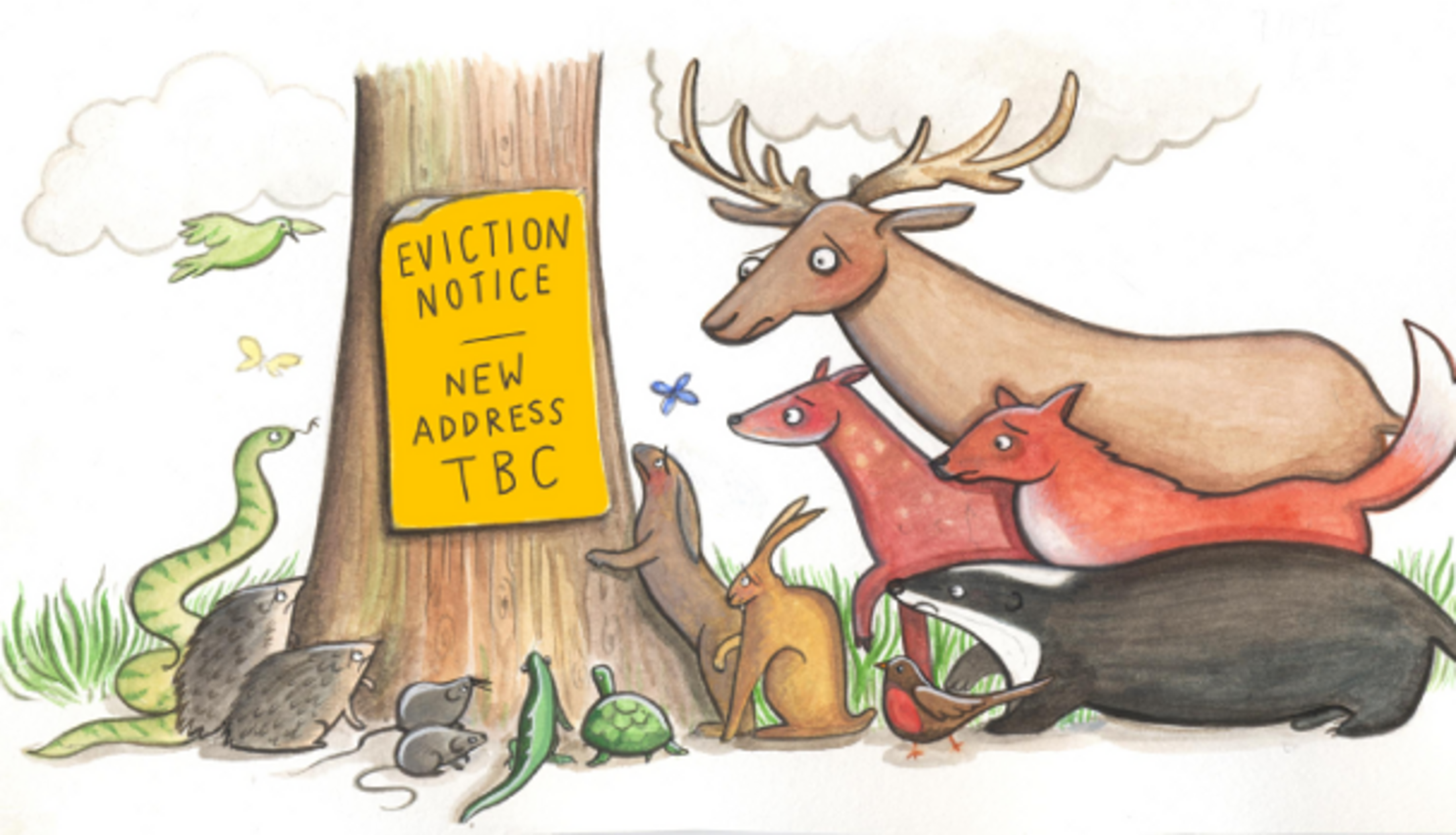
A plusieurs reprises (voir ici et ici par exemple), et sous différentes formes (voir également ce 4 pages de plusieurs associations et cet appel international contre la compensation biodiversité), nous avons rendues publiques ces analyses et nos vives critiques portant sur le principe même de la compensation et sur l'article 33A qui se focalise presque entièrement sur la création de banques de biodiversité. Ces critiques ont porté : que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est notamment autour de nos trois arguments-phare qu'une bonne partie des débats sur le bien-fondé de la compensation et sa mise en application se sont noués :
- la faiblesse intrinsèque des mécanismes de compensation, notamment l'absence d'équivalence écologique et de garantie sur la pérennité des actions menées, les disqualifie ;
- les dispositifs de compensation écologique reviennent à instaurer un véritable droit à détruire, légitimé au nom de la promesse d'une restauration « équivalente » ;
- la création de « réserves d'actifs naturels » conduit à confier une part significative de la protection de la biodiversité à des investisseurs, des banques et des acteurs financiers alors que les expérimentations en cours n'ont pas été l'objet d'une étude indépendante ;
Ces débats n'ont pas été contenus à l'arène parlementaire. De nombreux articles de presse (journaux, radio, TV) et plusieurs tribunes, provenant de représentant.e.s d'ONG ou de chercheurs, ont été publiés pour discuter ces arguments et le principe même de la compensation écologique. Nous ne pouvons que nous réjouir que le débat soit désormais ouvert. C'est parce que nous souhaitons le poursuivre que nous publions un nouveau document de sept pages comme une forme de réponse aux arguments de celles et ceux qui ne partagent pas notre analyse. Puisse-t-il nous permettre d'avancer collectivement vers une meilleure protection de la biodiversité dans le futur.
A TELECHARGER (document .pdf) : La compensation biodiversité instaure un droit à détruire !
Pour information, voici une série d'amendements au projet de loi proposé par des chercheurs travaillant sur ces sujets.
Maxime Combes, économiste et membre d'Attac France.
Auteur de Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition, Seuil, coll. Anthropocène. Octobre 2015
@MaximCombes sur twitter



