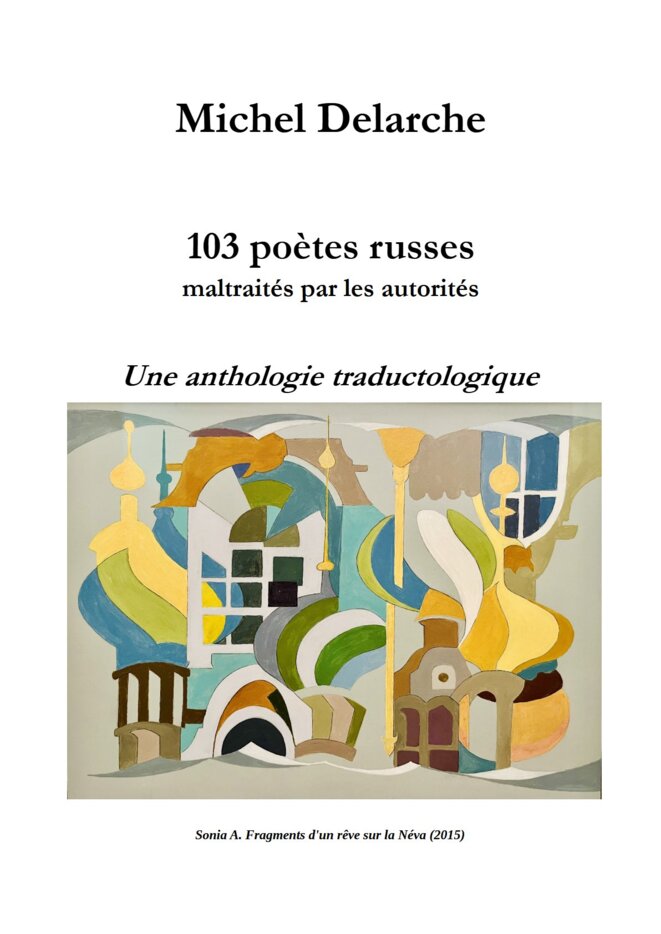La IIIème et la IVème Républiques développèrent, essentiellement en Afrique, un vaste empire colonial français, qui atteignit son apogée vers 1930. Les esprits de nombreux citoyens français restèrent longtemps imprégnés de cette idéologie impérialiste, et en particulier de la « mission civilisatrice » mise en avant par Jules Ferry et les autres initiateurs de l’aventure coloniale (cf. la dernière partie de ce précédent billet) et les écrits de l’époque en expriment bien les préjugés.
En janvier dernier, triant de vieux livres de la bibliothèque familiale, je suis tombé sur un ouvrage intitulé « Voyages et aventures en Afrique française », publié en 1956 chez Berger-Levrault (probablement à compte d’auteur) par un certain Paul Legras, instituteur en retraite habitant Epinal, âgé alors de 80 ans, titulaire des Palmes d’Or d’officier de l’Instruction Publique et Président de l’Amicale Vosgienne des Retraités de l’Enseignement Public. Bref, un représentant typique de l’élite enseignante de « La Communale » sous la IIIème République.
J’ai retrouvé peu d’autres traces de l’auteur, qui était membre d’une famille d’enseignants (son père Emile et son frère Louis, mort au combat en 1916, furent eux aussi instituteurs et son frère cadet Félix devint professeur de mathématiques). Le plus éminent représentant de cette famille fut Jean Legras (1914-2012), fils de Félix, normalien, spécialiste de mathématiques appliquées et pionnier de l’informatique universitaire à Nancy dans les années 1950-60.
Paul Legras était un grand voyageur qui mettait à profit ses vacances d’enseignant puis sa retraite pour voyager à travers l’Europe puis l’Afrique. Son ouvrage décrit ses voyages en Afrique (qui n’avaient rien de bien aventureux, malgré le titre) dont le premier fut réalisé en 1903 en Tunisie à l’occasion d’un congrès d’enseignants. Une fois retraité et déjà très âgé (il était né en 1875), il visita l’Algérie en 1950 puis le Sénégal et le Sahara, le Congo et de nouveau la Tunisie en 1954, et finalement le Cameroun en 1956.
J’ai trouvé intéressant d’analyser ce récit tout imprégné de l’idéologie du colonialisme, précisément parce que son auteur n’était ni un colon ayant des intérêts matériels outre-mer, ni un militaire affrontant les guérillas vietnamiennes, tunisiennes puis algériennes, ni un administrateur colonial représentant localement l’autorité de la France, mais seulement un voyageur sans conscience critique, un touriste ordinaire amateur de destinations exotiques, qui se contentait de reproduire le discours dominant sur les bienfaits de la colonisation.
Le plus frappant aujourd’hui est l’aveuglement qui faisait écrire à notre bourlingueur colonial (dans un style inégal et avec une morphosyntaxe parfois approximative, mais là n’est pas la question) en conclusion de son livre :
« Personnellement, après ces longues excursions à travers notre continent africain, je rapporte la certitude que j’ai renforcé la conviction depuis longtemps acquise, que partout, la France est aimée et respectée, que les indigènes lui sont reconnaissants de tous ses bienfaits à leur égard.
Certes des erreurs ont été commises, tant par nos dirigeants que par les colons, mais il est toujours possible, voire urgent, de les réparer. C’est le meilleur moyen d’imposer silence et raison aux troublions [sic] qui menacent actuellement la paix dans ces pays ».
Ces erreurs si pudiquement évoquées et les trublions ici dénoncés par l’auteur, le lecteur n’en aura guère entendu parler au fil de cet ouvrage. Une telle cécité socio-politique dans un ouvrage publié l’année même de la fin du protectorat français en Tunisie, et à peine quatre ans avant l’indépendance des colonies africaines de la France (six ans pour l’Algérie), doit nous donner à réfléchir : il y a seulement deux générations, cette bonne conscience paternaliste était largement partagée dans la petite bourgeoisie intellectuelle française et cela contribue pour une bonne part à expliquer la lenteur avec laquelle l’opinion publique évolua dans les années 40 et 50.
Pourtant, parmi tous ceux, finalement assez peu nombreux par rapport à la masse de la population métropolitaine, qui avaient l’occasion d’aller voir de près la réalité coloniale, certains étaient plus lucides que d’autres. Ma mère m’a raconté que dès la fin des années 30, un ami de la famille, le jeune capitaine B., avait confié à ses proches au retour d’une période de service en Algérie : « Là-bas, les colons traitent les Arabes ignominieusement. Ils leur font haïr la France et les Français. Tout ça finira très mal. »
Mais revenons au livre de Paul Legras.
Décrivant son premier voyage de 1903, il ne néglige pas de relever l’insécurité dans laquelle vivaient les colons : « Sur notre parcours nous avons le loisir de regarder des fermes de colons. Elles sont toutes construites sur le même modèle. Il n’y a qu’un rez-de-chaussée. Toutes les ouvertures – portes et fenêtres – donnent sur la cour pour raison de sécurité.
Une seule entrée donne sur le dehors : la porte cochère qui est solidement barricadée de l’intérieur dès qu’il fait nuit ; il faut compter avec les rôdeurs toujours à l’affût d’un coup à faire. Habituellement, il y a une famille de bédouins campée sous la tente à l’abri, près des murs de la ferme mais à l’extérieur. C’est de la main d’oeuvre que le fermier a sous la main pour l’aider dans ses travaux et qu’il paie surtout en nature sous forme de nourriture. La ferme est gardée par un ou deux gros chiens qui sont lâchés à l’intérieur de la cour. »
Ce passage qui en dit long sur la réalité de la relation entre colons et indigènes (que j’ai appelée dans de précédents billets le servage colonial) n’appelle pourtant aucun commentaire de notre brave voyageur.
Décrivant la ville fortifiée de Monastir il ne manque pas de relever que « elle a conservé ses remparts construits au moyen âge et qui sont encore en très bon état » sans y voir de contradiction avec son affirmation (typique des stéréotypes coloniaux) à peine quelques lignes plus bas que : « Les Arabes toujours partisans du moindre effort au lieu de se construire des habitations ont trouvé plus simple et beaucoup moins pénibles de creuser des cavernes de troglodytes dans les falaises tendres formées d’agglomérés de sable et de cailloux. »
Il aurait pu comparer ces habitations troglodytiques creusées à flanc de falaise à celles qui existent en France (par exemple au bord de la Loire ou de la Dordogne) et dont certaines étaient encore habitées à l’époque de ses voyages, mais la mentalité coloniale n’accepte pas de faire des comparaisons équitables et par là même éclairantes, elle préfère saisir la moindre occasion de déprécier ce qui à ses yeux relève de l’arriération culturelle des autochtones.
Ainsi note-t-il dans son récit de voyage au Congo : « Certains noirs ont l’air évolué, parce qu’ils ont un chapeau, des lunettes noires et un pantalon comme les blancs. Mais ce n’est que l’enseigne qui a changé, le fond reste le même. »
Le discours colonial, qui se vante pourtant d’apporter le Progrès, est volontiers fixiste dans sa perception des indigènes...
Lors de son deuxième voyage tunisien de 1954, puis au moment de la finalisation de son ouvrage l’auteur n’a pu complètement ignorer l’évolution de la situation politique ni les premiers succès du mouvement indépendantiste tunisien.
Voici comment il en rend compte : « Et pendant ce temps les fellagas faisaient parler d’eux. Ces pauvres bougres ignorants, descendaient de leurs montagnes pour se révolter parce qu’ils étaient payer pour le faire. Il y a des ambitieux parmi les Tunisiens comme parmi tous les autres peuples. Ces ambitieux voudraient jouer un rôle dans leur pays, être ministres ou Président de la République. Ce sont des mouvements politiques qui n’emballent pas la masse. Si on faisait voter librement les Tunisiens au vote secret pour leur demander s’ils sont contents de leur sort, il y aurait 99 % de oui. Depuis 1954, les événements ont marché, les ambitieux ont satisfait en partie leurs désirs ; il n’y a plus guère de fellagas mais la masse du peuple est restée inerte et ce que j’ai dit en 1954 reste vrai. Mes interlocuteurs étaient des ouvriers, des gens du peuple, le compartiment était rempli de voyageurs. Pas un n’a soulevé de critique sur l’état de choses qui existait à cette époque de 1954. »
Dans ce passage, le déni de la réalité des revendications proprement politiques du peuple tunisien est réellement saisissant. On voit aussi que le discours colonial retrouve spontanément les mêmes articulations que tous les autres discours de Droite face à l’agitation sociale :
1°) attribuer l’agitation à une petite minorité d’activistes manipulant une masse ignorante,
2°) jeter la suspicion sur l’origine des ressources financières de la subversion (l’Or de Moscou était alors un refrain à la mode, alors qu’aujourd’hui l’on évoque volontiers des cyber-manipulations russes à propos du mouvement des Gilets Jaunes...)
3°) assurer que si les ambitieux subversifs (on peut supposer qu’il pensait à Bourguiba et ses compagnons du néo-Destour) n’avaient pas manipulé le peuple tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
En conclusion de son ultime voyage au Cameroun, notre vieux voyageur se lâche : « Les anticoloniaux sont des ignorants qui ne sont jamais allés à la colonie, qui ne savent pas ce qui s’y passe ni ce que la France y fait. Ils sont toujours sous l’impression du vieux colonial absinthique, toujours dans une demi-ivresse. C’est une génération éteinte et périmée.
La génération actuelle comprend surtout des jeunes gens. La plupart se sont mariés en France et ont emmené leur jeune épouse à la colonie. Ils sont très actifs, très entreprenants ; ils ont la volonté de se faire une situation plus enviable que celle à laquelle ils auraient pu prétendre s’ils ne s’étaient pas expatriés. »