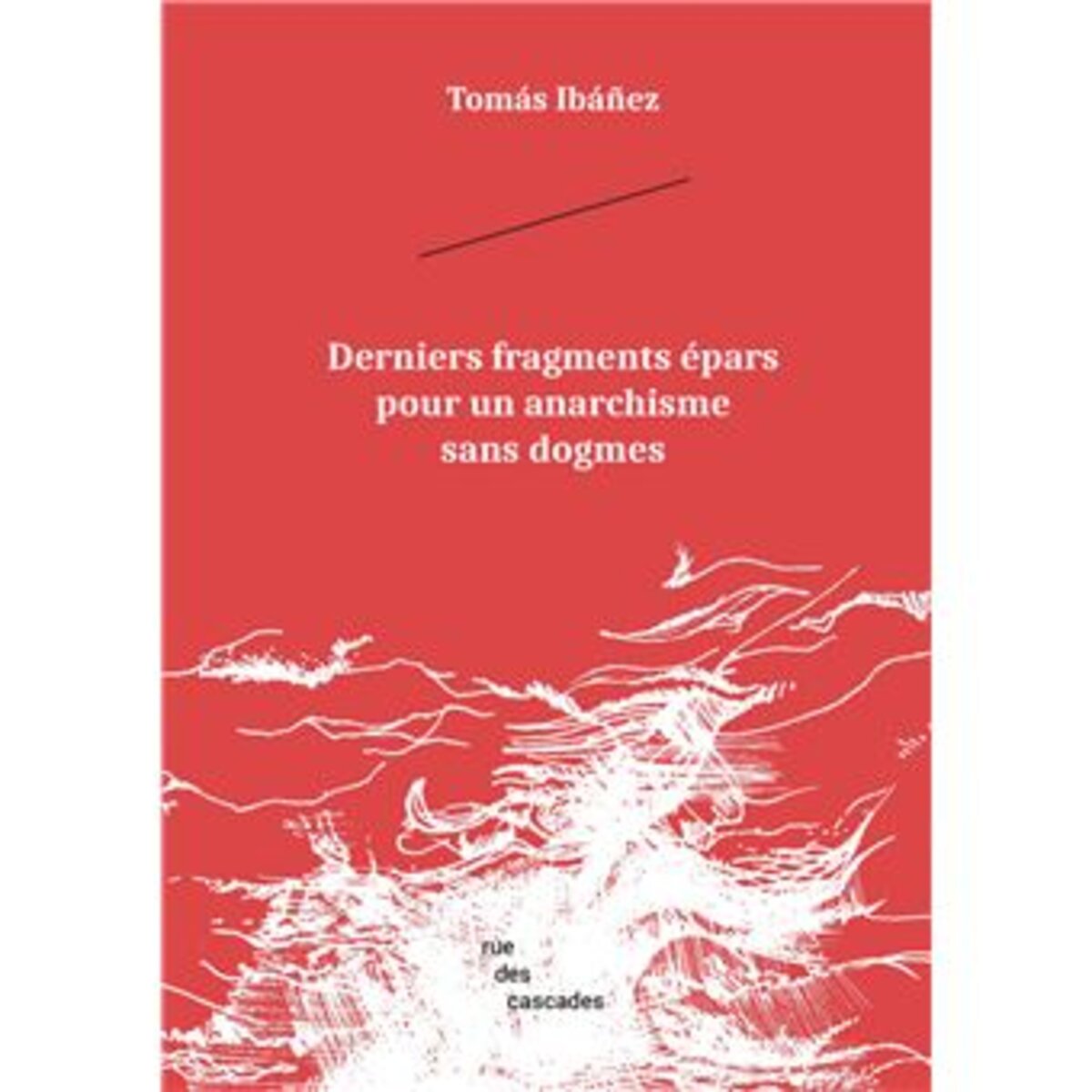
J’ai exposé dans un précédent billet mes convergences et divergences avec l’auteur, qui ne sont pas d’aujourd’hui puisque notre amitié date de soixante ans, de sorte que je tenterai ici de m’attacher aux divergences qui loin de nous opposer ne cessent, je le crois, de raffermir notre attachement à cette culture que je préfère qualifier de libertaire plutôt qu’anarchiste.
Libertaire plutôt qu’anarchiste car en effet, comme je tentais de le dire il y a peu à propos de l’important ouvrage de Catherine Malabou (Au voleur ! Anarchisme et philosophie, PUF, 2022) si Tomás n’a jamais hésité à affirmer “je suis anarchiste”, je ne peux pour ma part, et depuis longtemps, que relever le caractère pour ainsi dire aporétique d’une telle proposition dans la mesure où le prédicat “anarchiste”, comme tout particularisme, s’impose au sujet, le corsette jusqu’à le priver de sa liberté ontologique.
Ceci dit on trouvera dans ce livre constitué d’un recueil d’articles publiés essentiellement dans l’excellente revue “Réfractions” une structuration en cinq grandes sections riches en stimulantes réflexions non seulement sur l’anarchisme mais sur les temps que nous vivons.
Il sera d’abord question dans la première partie intitulée “Variation sur les anarchismes” de l’état de l’anarchisme actuel, de son évolution dans un proche avenir et de ce que l’auteur qualifie d’anarchisme existentiel auquel nous aurons à revenir.
La deuxième partie s’intitule “Tension dans la pensée anarchiste” et traite des thèmes chers à l’auteur c’est-à-dire de l’universalisme, du relativisme, de la “nature (ou non) humaine”, du pouvoir et de la liberté en tant qu’étrange “antagonisme symbiotique”, du concept de “préfiguration” qui m’importe particulièrement. Tout cela enrichi par le rappel du débat opposant Tomás au philosophe Renaud Garcia, qui dans un retentissant ouvrage (Le Désert de la critique, l’Échappée, 2015) osa s’en prendre à l’héritage “derridien/deleuzien mais surtout foucaldien”.
La troisième partie est un rappel historique de la situation à Barcelone depuis le 15-M et une réflexion sur l’implication des anarchistes dans le mouvement revendiquant l’indépendance de la Catalogne alors que la quatrième partie traite du néo-totalitarisme, des pandémies, de la question de l’autonomie, occasion pour l’auteur d’évoquer et de rendre hommage à Cornélius Castoriadis présenté comme le penseur de l’autonomie.
Enfin la dernière partie est une évocation de “l’utopie en exil” depuis la mort de Franco à nos jours, et un vibrant hommage rendu par l’auteur à son camarade Marc Tomsin l’éditeur anarchiste de ses livres, mort accidentellement alors qu’il participait à la libération de l’espace autogéré Rosa Nera en Crète.
Pour ne pas alourdir exagérément ce pensum, je m’en va, comme dit quelque part dans ses Essais mon initiateur en scepticisme Michel de Montaigne, picorer ou même pilloter en si riche matière et quelque peu au hasard de ces pages attentivement lues.
Famille, d’abord car voici que le mot surgit inopinément (p. 80) dans l’expression “un air de famille” dans lequel se reconnaîtraient les (ou des) anarchistes et Dieu sait (ou plutôt Bakounine) si dans la grande famille anarchiste, de Robin à Armand, a été inlassablement problématisée “la question de la famille”, cette famille qui inéluctablement produit un pater ou/et une mater familias dont il convient alors de s’émanciper par une sorte de sursaut libertaire tel celui du papillon de la Métamorphose d’Edgard Morin quittant sa chrysalide pour une envolée vers...la liberté. Ce que je fis voici déjà longtemps, conservant, cependant toute ma fraternelle amitié à celles et ceux persistant dans leur anarchisme.
Car, en effet, l’emploi incessant du signifiant “anarchisme” conduit irrémédiablement à un enfermement exprimé par des formulations telles que “l’anarchisme pense que”...” l’anarchisme sait aussi que...” (p. 30), “au sein de l’anarchisme...” (p.72), “l’âme de l’anarchisme...” (p.74) et à une subjectivation de l’objet anarchisme sans que l’on sache jamais ce que c’est que cet objet (autre qu’une construction socio-historique, p. 74) ni quel est ce “pouvoir” qui décide de ce qu’est l’anarchisme (ah, ces “c’est anar, c’est pas anar” entendus jusqu’à la nausée). Et c’est ainsi que l’anarchisme s’impose comme dogme et interdit, c’est un comble, toute envolée libertaire.
Et je sais enfin ce qu’il en coûte de se séparer de la “'famille anarchiste”, au sein de laquelle se conteste l’institution et la structure de la famille traditionnelle non sans que se reconstitue subrepticement une famille sous la forme de “groupes affinitaires “ dans lesquels surgissent inéluctablement, comme je viens de le dire, les figures du pater familias.
Mais venons-en brièvement aux conceptsà l’analyse desquels l’auteur s’attache depuis longtemps : essentialisme, particularisme, déterminisme, universalisme, relativisme, nature humaine (ou non) ; brièvement car, je l’avoue ces débats qui traversent les siècles, que dis-je les millénaires ont cessé de me préoccuper depuis que ma lecture, fort laborieuse il est vrai, de Spinoza m’a convaincu (peut-être provisoirement) que le libre-arbitre est une pure illusion car :
“les hommes se trompent en ce qu’ils se croient libres ; et cette opinion consiste en cela seul qu’ils ont conscience de leurs actions et sont ignorant des causes par où ils sont déterminés […] Pour ce qu’ils disent, en effet que les actions humaines dépendent de la volonté, ce sont des mots auxquels ne correspond aucune idée car tous ignorent ce que peut être la volonté et comment elle peut mouvoir le corps. (Éthique, scolie de la proposition 35, deuxième partie)”.
Ce que confirme la proposition 48 en ces termes :
Il n’y a dans l’âme aucune volonté absolue ou libre ; mais l’âme est déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre est à son tour par une autre et ainsi à l’infini.
Bref on ne sort pas de cette irritante diallèle, de ce deuxième trope d’Agrippa, celui de la régression à l’infini. De sorte que si l’on ajoute à cela les lectures de Montaigne, toujours aussi laborieuses et celles, déterminantes, de Pierre Hadot, on comprend que ce qui m’importe est ce que Tomás désigne par le terme “existentiel” qualifiant son anarchisme que, pour ma part, je dirais après Hadot “manière de vivre” et par ailleurs ce qu’il désigne comme la question de la fin et des moyens, cette autonomie évoquée à propos de Castoriadis et que, pour ma part je dirais “cohérence”, cette attitude stoïcienne qui n’est pas seulement cohérence avec le “Cosmos” ou si l’on préfère le “Logos”, la “Raison”, l’Être mais cohérence entre ce qui, d’un point de vue militant, se dit et ce qui se fait à moins que l’on ne préfère dire que la fin de tout acte est dans les moyens mis en œuvre pour la réalisation de cette fin ce que l’auteur étudie ici en tant que “préfiguration”.
Et c’est ainsi que je me rallie volontiers à cette espérance libertaire que Tomas exprime par la poétique métaphore de la pollinisation tant il est vrai que la multiplication de ces lieux de vie, d’expérimentation d’un autre mode de vie possible, ces multiples volontés de “bifurcation” de la part de jeunes femmes et hommes bardés de diplômes et contestant en acte l’ordre qui les a produits, autorise à quelque optimisme.
Poursuivant mon petit “pillotage” je ne peux éviter de dire un mot de cet “adieu à Platon” lancé par Tomás dans sa charge contre tout essentialisme pour évoquer le “Platon anarchiste”, cité par Rancière, assurant que “ Le pire des maux est que le pouvoir soit occupé par ceux qui l’ont voulu !”
Et puis cette incessante répétition du signifiant foucaldien “domination” qui m’apparaît alors comme quelque peu “euphémisante”. Car, en effet, après avoir passé dix ans de ma vie, entre 20 et 30 ans à travailler dans l’industrie je crois pouvoir témoigner que le terme qui convient pour caractériser ces situations vécues par la multitude de femmes et d’hommes dans les entreprises quelles qu’elles soient est celui d’oppression. M’évadant de ce monde (grâce à Mai 68 !) pour me faire enseignant j’ai pu mesurer l’écart existant entre une situation de domination et une situation très concrète d’oppression.
Pour en revenir maintenant à la “pollinisation”, je ne vois pas, pour sympathique qu’en soient les intentions comment elles pourraient venir à bout du système d’oppression dont la puissance et la vitalité a fait ses preuves depuis longtemps.
La capacité du capitalisme (avec tous les “néo” que l’on voudra) à intégrer à son fonctionnement les déviances et les contestations les plus radicales paraît, pour l’instant sans limites. De la même manière que le capitalisme du siècle dernier a su intégrer à son fonctionnement le syndicalisme originairement révolutionnaire et en faire un “partenaire social” le néo-capitalisme post moderne intègre toutes les attitudes, les contestations qui furent longtemps considérées comme irrecevables à tout point de vue tels le féminisme, l’égalité des sexes, l’homosexualité longtemps opprimée et aujourd’hui, sous nos latitudes institutionnalisées par le mariage entre personnes du même sexe, jusqu’à “l’autonomie” du travailleur à sa tâche comme le souligne l’auteur sous prétexte de responsabilisation, (pourquoi pas d’émancipation ?).
Non seulement intégration de toutes les anciennes “déviances” mais mercantilisation et spectacularisation de celles-ci faisant appel à une “pédagogie” qui plus qu’une entreprise publicitaire est une propagande de combat qui utilise toutes les techniques et technologies disponibles de manipulation pour “propager” une idéologie consumériste (ce que l’auteur formule par l’expression “produire des subjectivités”) et forger des comportements de consommation frénétiques et addictifs. A-t-on assez remarqué que cette propagande s’est donnée pour objectif de transmuter le terme même de citoyen en celui de consommateur, les médias de toutes sortes ne s’adressant plus à des humains mais à des consommateurs ?
De sorte que si je partage volontiers l’analyse développée ici (p. 44 et suivantes) concernant le danger représenté par le totalitarisme numérique qui est déjà là, je regrette que soit insuffisamment abordée cette autre composante du totalitarisme en l’espèce de la société marchande et spectaculaire, de la fétichisation de la marchandise et de sa spectacularisation dans les “temples de la distribution” et sur tous les écrans disponibles, composante qui conjuguée au totalitarisme numérique constitue dès aujourd’hui et plus encore demain un totalitarisme absolu.A cet égard je tiens à signaler la très riche réflexion d’Anselm Jappe (La société autophage, La Découverte, 2020) sollicitant Marx, bien sûr et Guy Debord dont il est un lecteur érudit et sans doute l’un des commentateurs les plus avisés.
Comment alors s’opposer à cette propagande que l’on peut sans hésitation qualifier de guerrière tant son objectif consiste à annihiler toute tentative d’esprit critique ? Bien entendu comme le dit l’auteur continuer à écrire des textes, à dire et écrire autant qu’il est possible mais, pédagogue pendant trente-cinq ans, militant pédagogiste comme disent ceux que depuis longtemps je nomme les” instructeurs” ignorant que le terme vient de Montaigne louant les enseignants qui osaient se passer de la férule des “instructeurs” de l’époque, je sais les limites de toute pédagogie face au mastodonte de la propagande totalitaire.
L’espoir alors résiderait-il comme le pense Tomás et comme je le pense aussi dans cette “pollinisation” de multiples tentatives de manières de vivre autrement ici et maintenant sans plus attendre et dans les “bifurcations” de ces jeunes diplômés qui se refusent à servir le “système” ? Il se pourrait bien.
Enfin pour terminer (provisoirement) je ne résiste pas à la tentation de revenir en quelques mots sur la question du libre-arbitre et du déterminisme : Tomás et moi sommes des enfants de 1936 (p. 268), de la Guerre d’Espagne et plus précisément de militant(e)s anarchistes de la CNT et de la FAI (Fédération anarchiste ibérique). Qu’aurait-il été de nous si nous étions nés, comme tant d’autres, enfants de militants communistes ? Liberté, liberté...
Vale.



