Enfin, j'y viens, pas sûr – eh! Je ne suis pas devin! Pour référence: «Quand les choses doivent changer, elles changent». Et pour évoquer rapidement la question, l'actualité a ce défaut d'être l'actualité, de masquer la continuité profonde sous les différences superficielles. Un intellectuel, Bruno Latour je pense, nomme ça l'écume des jours: on regarde la mer et ce qu'on en retient est le mouvement des vagues en surface, oubliant l'épaisseur des deux milieux qui provoquent ce mouvement, l'air et l'eau.
L'actualité? Celle du “covid-19”. Et justement, partir de cette actualité peut faire manquer la régularité au profit de la singularité. Le mouvement où s'insère cet événement est ancien, si on va au tout début il a plusieurs millénaires, au moins quatre, plutôt cinq ou six; si on va au début du mouvement ample qui atteint sa fin ces temps-ci, il a au moins cinq ou six siècles, plutôt un bon millénaire, si on va au début de la phase actuelle, il a selon l'analyse qu'on en fait un siècle et demi ou deux siècles et demi. Du fait, l'événement “covid-19” n'a de singulier que sa forme, il n'est que l'apparence transitoire d'un phénomène durable, le “changement de société”. Manière de dire: les sociétés sont inamovibles, éternelles, donc changer de société ou changer la société n'est qu'une apparence, il s'agit plutôt de la maintenir en profondeur et pour cela de la transformer en surface. Comme le dit la sentence proposée par Lampedusa dans Le Guépard, «Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change». On peut en avoir une lecture pessimiste, celle en lien au “pouvoir”, changer les apparences pour préserver les positions acquises ou à l'inverse préserver les apparences et changer les positions, ou optimiste, préserver l'essentiel en changeant l'accessoire, et une lecture, et bien, vous me connaissez là aussi, lectrices et lecteurs fidèles, réaliste: préserver le processus, la société, nécessite de modifier la structure, les institutions.
Quoi doit rester “comme avant”, le processus ou la structure? Les interprétation optimistes et pessimistes s'intéressent à la structure, celles réalistes au processus. Ce qui permet de faire société ce sont les processus, les échanges entre ses membres, le commerce aux deux sens, échanges économiques et échanges culturels, les conditions de réalisation de ces échanges, les infrastructures et superstructures, n'ont aucune importance, importent les échanges eux-mêmes. Disons, tant que les structures favorisent les échanges elles ont de l'intérêt, quand elles les défavorisent elles perdent tout intérêt. Comme tout ce qui participe du vivant une société ne se maintient que par le mouvement, sinon elle meurt, en défavorisant les échanges socialement utiles on ralentit son mouvement profond, vital, y compris quand il s'accélère en surface, cette agitation n'étant précisément pas celle de la société mais celle de l'interface entre elle et le reste du monde. Pour exemple extrême, une société n'est jamais aussi “active” que quand elle est en guerre, mais cette activité la détruit – cela que la fin de la guerre soit la “victoire” ou la “défaite” pour son propre groupe, dans les deux cas la conséquence est un changement de société, donc vaincre revient à installer une société autre que celle qui est entrée en guerre.
Ayant déjà beaucoup abordé la question du temps moyen (qui se compte en siècles) ou long (qui se compte en millénaires) voire “infini” (qui se compte en centaines ou milliers de millénaires) je vais me restreindre ici au temps court, circonstanciel, qui aboutit à la situation concrète actuelle. Comme je le dis, comme il se sait, ou devrait se savoir, la communication structure une société, l'information l'anime, conduit les processus. Fonctionnellement une société est un corps, et comme tout autre corps elle est fluide, sa structure n'a que l'apparence de la persistance, chacune de ses parties ne cesse de se modifier. Un organisme tel que vous et moi se compose d'éléments fondamentaux, qu'on peut nommer “atomes”, les cellules: des atomes car insécables, une cellule qu'on coupe est une cellule qui meurt. C'est “atomes” composent des “molécules”, des groupes de cellules similaires qui forment un tissu ou un réseau, et des groupes de cellules disparates qui interagissent pour pouvoir fonctionner et se maintenir; les cellules ne cessent de se modifier, d'échanger de la matière et de l'énergie avec “le reste du monde”, les groupes de cellules ne cessent de se modifier, au niveau individuel par ces échanges, au niveau collectif car les cellules ne cessent de naître et de mourir; à un niveau supérieur “atomes” et “molécules” constituent des organes et ceux-ci ont cette même caractéristique d'être constants en tant que structures, mouvants en tant qu'objets composites formés d'entités et d'ensembles changeants. Et bien sûr l'organisme dans son ensemble a une structure à la fois constante et mouvante, la structure dans son ensemble permet à l'organisme d'être mouvant, de se déplacer dans le temps et dans l'espace, et le maintien de la structure n'est possible que par le mouvement interne de tous ses composants.
Une société est une sorte de corps, d'organisme, de cette manière même: ses “atomes” sont les individus qui la composent, lesquels ne se limitent pas aux humains, tout ce qui agit ou/et structure cette société, est élémentaire et est insécable, on peut le nommer un individu, à ce titre une plante, un animal ou une machine qui contribue au maintien et au mouvement de la société en est un membre, est un individu. Bien sûr tous ne sont pas égaux, les individus prépondérants dans une société humaine sont les humains parce qu'elle est organisée avant tout à leur profit mais d'évidence, et l'actualité le démontre, ne pas tenir compte de l'intégration effective de tout ce qui est “non humain”, y compris ce qui est “non vivant”, dans la société, c'est commettre une grosse erreur. Pour reprendre le cas des organismes au sens strict, un humain et n'importe quel autre mammifère – on peut l'étendre aux vertébrés et invertébrés, et aux plantes, mais de fait je m'intéresse plutôt aux mammifères, spécialement les humains – est composé d'autant de cellules endogènes qu'exogènes, en nombre il y a autant de bactéries qu'il y a de cellules dans un corps humain, et sans la présence de ces bactéries un organisme humain mourrait. De ce point de vue, les bactéries ne sont pas moins des “individus de l'organisme” que ne le sont les cellules humaines, mais d'évidence le rapport de dépendance vitale va de la partie humaine à celle bactérienne, si en revanche la dépendance fonctionnelle est réciproque ou va des bactéries à la partie humaine: sans les bactéries l'humain mourrait, mais sans l'humain les bactéries ne naîtraient pas – je parle bien sûr des bactéries commensales, celles qui ont coévolué avec leurs hôtes, une part importante de la masse biotique que forment les bactéries constitue un milieu autonome ayant très peu d'interactions avec les autres phylums sinon en tant que substrat, que “nourriture” – eh! Entre l'apparition de la vie sur la Terre et ce jour, les virus et bactéries ont vécu entre les cinq sixièmes et les six septièmes de ce temps (selon qu'on date ces début à environ 3,5 ou environ 4 milliards d'années) sans la présence d'autres formes, que ce soit les eucaryotes ou les individus complexes, proprement les organismes, que forment les eucaryotes; clairement, un eucaryote ou un organisme dépend de l'existence des bactéries pour sa survie, une bactérie non commensale ne dépend pas de leur existence. Bien sûr les bactéries se sont adaptées au contexte nouveau mais a minima, et la disparition complète des eucaryotes et organismes ne mettrait pas en péril leur existence en tant que phylum si du moins elle serait problématique pour les espèces commensales.
Changer la société n'est pas un projet mais un état permanent. Les sociétés changent, les sociétés se changent, et le font continument. Mais il y a ce problème mentionné dans «Quand les choses doivent changer, elles changent», l'inadéquation entre infrastructure et superstructure. Factuellement, une superstructure n'est pas proprement une structure mais la manière d'organiser les processus sociaux dans le cadre de l'infrastructure. On peut dire que l'infrastructure est la partie “communication”, la superstructure la partie “information”, la première structure les “voies de communication”, d'échanges, la seconde organise la circulation de l'information, les échanges proprement dits. Pour une société, les échanges matériels et immatériels sont toujours des “informations” en ce sens qu'ils informent sur “ce qui a du sens” dans le cadre de la société: on n'échange pas des biens matériels sans leur attribuer une valeur, une fonction sociale, l'obsolescence que j'évoque dans «Quand les choses [...]» rend compte de ce qu'un bien, matériel ou immatériel, n'a pas une valeur en soi mais une valeur dans un système de valeurs, un “système de signes et de sens”: est obsolète non ce qui n'a plus de fonction mais ce qui n'entre plus dans le cadre du système de valeurs. Soit précisé, le phénomène est réversible, cas des objets “vintage” et du retour de comportements qui a un moment sortent du cadre pour, à un moment ultérieur, y revenir mais dans un autre statut: on n'achète pas une deux-chevaux ou un disque vinyle proprement pour sa valeur d'échange mais pour sa valeur d'usage, sa valeur subjective, “sentimentale”. Les infrastructures sont mobiles, elles ne cessent d'évoluer, de se déstructurer et se restructurer; paradoxalement les superstructures sont moins mobiles, fonctionnellement la superstructure est du côté du flux, des processus, formellement elle constitue le cadre dans lequel la société se déploie; quand la discordance entre superstructure et infrastructure devient trop importante le cadre institutionnel se désolidarise et constitue alors une société autonome avec sa propre infrastructure, ce qui lui permet de se maintenir mais augmente encore la discordance. Ici intervient la question des ressources et de leur répartition.
Censément, la superstructure n'a pas de ressources propres, la société met à sa disposition ses ressources, charge à elle de les répartir; bien sûr elle dispose pour elle-même d'une partie de ces ressources mais de la “portion congrue”, de la «pension annuelle, calculée au plus juste, que les [percepteurs] étaient tenus de payer aux [attributaires] pour leur subsistance», dans la version ancienne les “gros décimateurs”, c'est-à-dire les percepteurs de la dîme ecclésiastique et les “curés” mais dans une acception élargie les “fonctionnaires” et les “collecteurs d'impôts”. Les taxes et impôts doivent censément être redistribués pour leur plus grande part à toute la société par un système de péréquation qui «prend aux riches et donne aux pauvres», qui répartit ces ressources en fonction des besoins et des mérites, raison pourquoi les “fonctionnaires” sont «réduits à la portion congrue»: ils sont censés ne pas s'enrichir au-delà du nécessaire pour eux et pour la réalisation de leur fonction. Ici interviennent les notions de fonction et de statut: tout membres de la société a un statut qui à la base est égal pour tous et indépendant de la fonction sociale des individus et des groupes; une société de type “démocratique” a pour principe celui énoncé dans l'article premier de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (la DDHC), «Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune», dit autrement, l'inégalité de traitement dépend de la fonction et non du statut des personnes, lesquelles, énonce en premier cet article, «naissent et demeurent libres et éga[les] en droits», le changement de fonction induit celui de traitement puisque ce traitement est lié à la fonction. Vous et moi le savons, ça ne se passe pas vraiment ainsi, ce premier article énonce un principe qui ne se réalise jamais parfaitement, la société doit tendre à cela et se prémunir autant que possible d'une forte discordance entre le principe et les faits. Pour des raisons connues et discutées dans d'autres billets, les sociétés ont une tendance certaine, le temps passant, à confondre statut et fonction: en principe la fonction se perd quand l'utilité commune ayant déterminé son attribution ne se vérifie plus, en fait l'accès à certaines fonctions est souvent réservé aux membres de certains groupes sociaux indépendamment de leur utilité sociale avérée. Tant que c'est un phénomène marginal ça ne pose pas trop problème, quand ça devient un phénomène massif on se trouve dans cette situation où on a une superposition de sociétés faiblement reliées qui fonctionnent pour elles-mêmes et en faveur d'un groupe déterminé, avec une assez faible mobilité sociale. La situation actuelle est de ce type.
Même si c'est plus complexe, on peut simplifier cette situation en posant que la plupart des sociétés contemporaines, probablement toutes mais c'est à vérifier, sont “binaires” avec, pour paraphraser Jean-Pierre Raffarin, «la société d'en bas et la société d'en haut», non plus des sociétés de classes où la position sociale est déterminée par la fonction mais des sociétés de castes où la fonction est déterminée par la position sociale. On peut dire que toutes les sociétés actuelles sont dans ce schéma parce que, de fait, l'ensemble de l'humanité compose une seule société, localement on peut avoir des sociétés secondaires qui préservent autant que se peut une mobilité sociale importante mais au plan mondial l'intégration de toutes les sociétés dans un système “global” réduit la capacité des sociétés locales à préserver cette mobilité. Ça n'est pas un phénomène nouveau et inédit, on peut dire, et beaucoup le disent parmi les historiens les plus sérieux, que la séquence qui va de la première guerre mondiale à la deuxième a pour principale cause une discordance de ce type, et on peut aussi dire que la conséquence en fut, et bien, le rétablissement de sociétés de classes à forte mobilité sociale dans beaucoup de sociétés qui furent parties durant cette séquence allant en gros de 1910 à 1945.
Sans approfondir, les causes immédiates des deux guerres mondiales venaient d'un mouvement déjà ancien, ce que Victor Hugo nomma les “États-Unis d'Europe”, pris en charge principalement par la France au tournant des XVIII° et XIX° siècles, puis par la Prusse ensuite, spécialement dans la deuxième moitié du XIX° siècle, enfin par l'Autriche-Hongrie à partir de la décennie 1920 jusqu'à la fin de la décennie 1940. Ouais, je sais, l'Autriche-Hongrie a précisément disparu à ce moment là, mais il ne faut pas oublier que le mouvement initié par le parti nazi démarre entre Bavière et Autriche et qu'il est un rêve de rétablissement du Saint-Empire romain germanique dont le cœur est là, entre Bavière et Autriche. Enfin, de rétablissement de cet empire, plus ou moins, mais du moins le rétablissement de l'hégémonie de cet empire. Ne pas oublier que dans l'imaginaire nazi, Nuremberg, ville bavaroise proche de la frontière autrichienne, fut «promue par Hitler “capitale idéologique” du Troisième Reich» et que «dès 1933, le régime national-socialiste exploitera le prestigieux passé de l’ancienne ville impériale au profit des gigantesques manifestations et rassemblements» – pour préciser, son “prestigieux passé” dans le Saint-Empire, et non dans l'Empire bismarckien, “prussien”, tous les principaux “hauts lieux” du régime nazi sont en Bavière ou en Autriche, pays natal de leur chef. Toujours est-il, au-delà des imaginaires locaux le but de la France, puis de la Prusse, puis du régime nazi, et même, en partie, du fascisme italien, est quelque chose comme la reconstitution de l'Empire carolingien, moment fondateur pour ces quatre entités. Avec un “petit” problème: les méthodes valables en l'an 800 n'étaient pas adaptée au contexte de 1800, et moins encore à celui du XIX° siècle. Résultat, trois ou quatre échecs successifs en un siècle et demi, pour en arriver dès 1947 et institutionnellement dès 1949, plus nettement encore à partir de 1954-1957, vers une solution adaptée à l'époque, la libre adhésion des États à un projet commun, d'abord avec le Conseil de l'Europe, puis avec la Communauté Économique européenne qui deviendra par après l'Union européenne. Il m'est arrivé de le dire dans divers billets, les six pays fondateurs de la CEE, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, la France et l'Italie, sont le cœur de l'Empire de Charlemagne, dont le point central était alentour de l'actuel Grand-Duché du Luxembourg. Illustration:
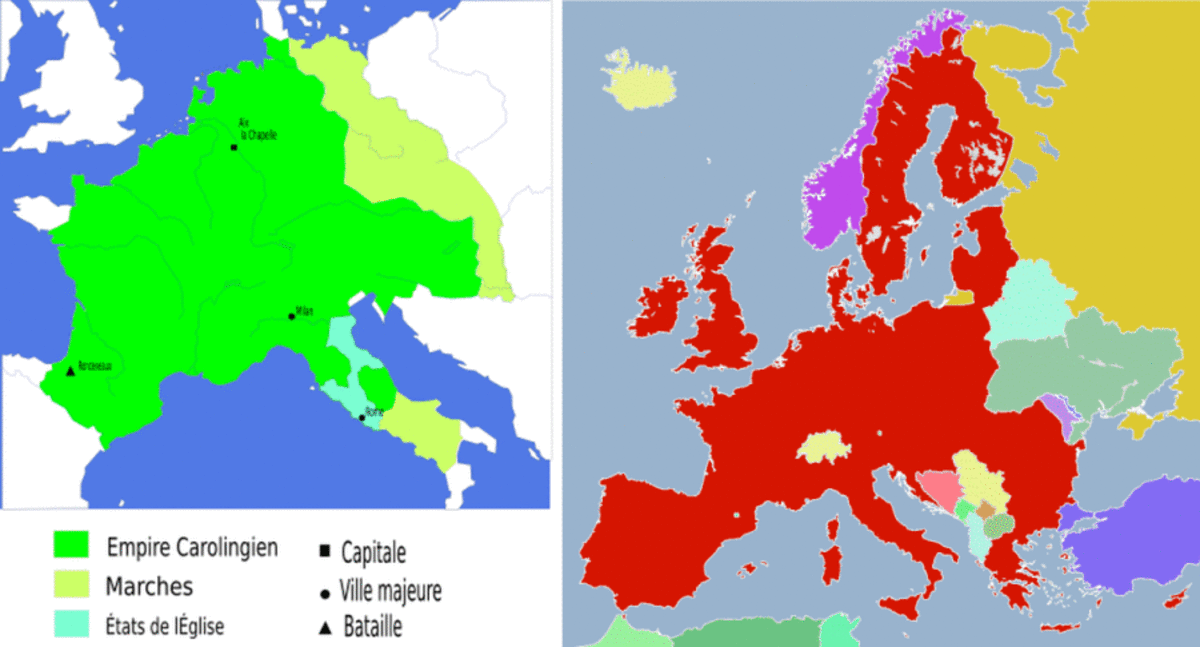
Agrandissement : Illustration 1
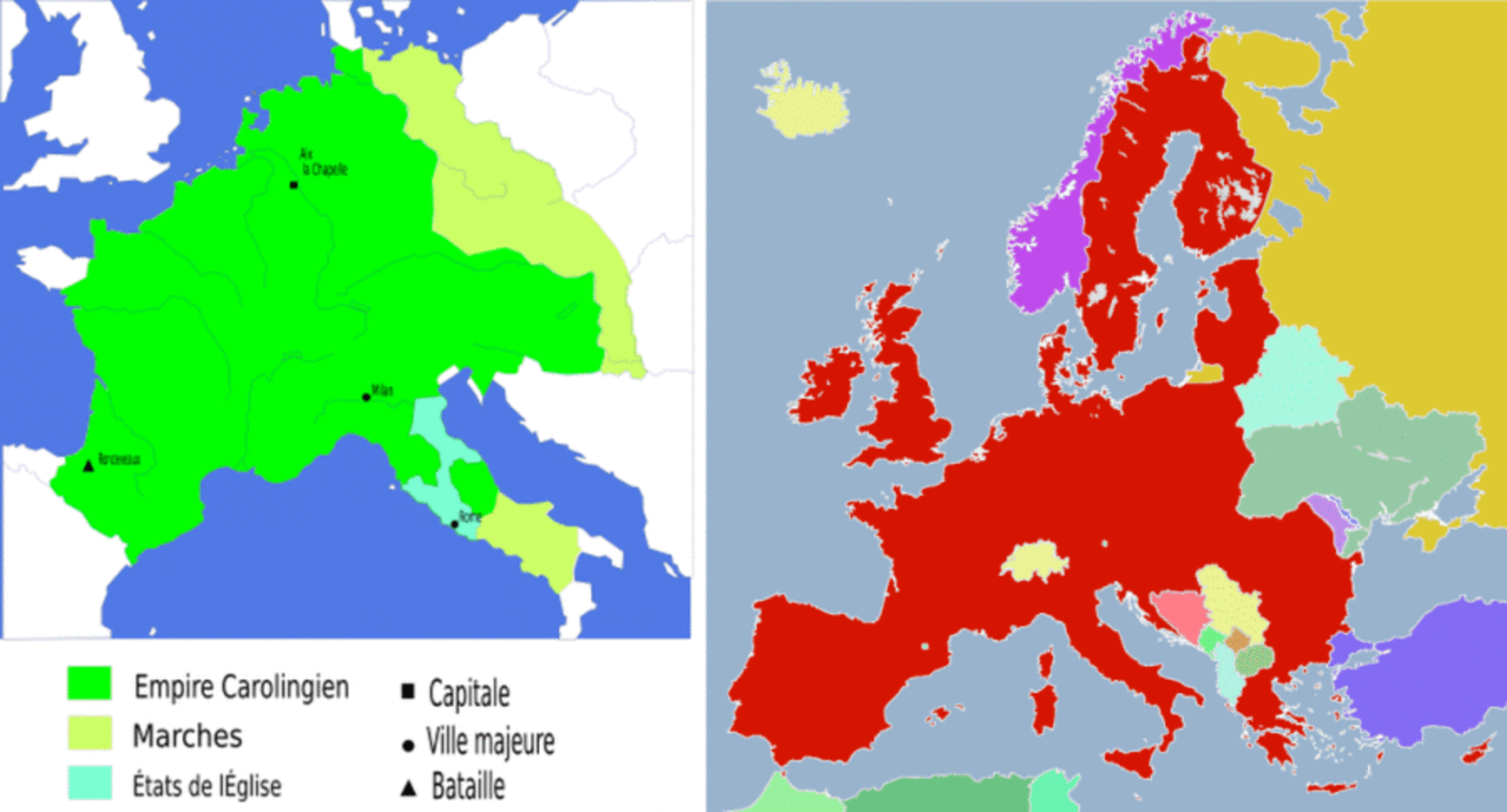
Les capitales de l'Empire furent successivement Metz et Aachen, Aix-la-Chapelle, et Maastricht y fut un important centre culturel et religieux. Au fait, les vieilles rancunes sont tenaces: la partie de la Péninsule italique intégrée à l'Empire carolingien et aux États de son allié “spirituel”, le Pape, correspond à la “Padanie” chère au cœur de la Ligue du Nord, tendanciellement opposée à l'Union européenne, ladite Ligue du Nord se vivant comme héritière des Lombards et de la Lombardie, or «le règne lombard prend fin en 774 lorsque le roi franc Charlemagne conquit Pavie et annexa le royaume d'Italie (principalement l'Italie du nord et centrale) à son empire». C'est ainsi, Charlemagne est un grand homme en Italie aussi mais ça n'induit pas pour cela qu'il y soit particulièrement aimé...
La vie des sociétés n'est pas un long fleuve tranquille, elle est faite de successions de changements, alternativement d'infrastructures et de superstructures. Enfin, alternativement... Tout ça est à la fois simple et complexe, simple dans le processus, complexe dans la réalisation. Dans un texte en cours de rédaction, «Addendum III à “Quand les choses doivent changer...”», j'évoque l'évolution des sociétés comme un mouvement ondulatoire, avec des “hauts” et des “bas” autour d'une ligne médiane, pour l'instant je n'ai pas été vers cette précision dans ce billet, une meilleure représentation serait plutôt donnée par le taìjítú, la “figure du faîte suprême”, le symbole qui représente particulièrement bien la philosophie taoïste et d'autres du même ordre:

J'en donne une version animée parce que c'est ce que symbolise cette représentation, le “mouvement de la vie”. On peut nommer et classer diversement les deux “moments” de ce symbole, communément on les nomme yin et yang, l'un réfère à ce qui est “actif”, l'autre à ce qui est “passif”, ici on dira que le yin correspond au processus, le yang à la structure, mais comme il se sait et se voit, il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin, du processus dans la structure et de la structure dans le processus, et le mouvement naît de ce rapport d'attraction-répulsion entre les deux. Comme dit, l'infrastructure est la partie structurelle de la société, la superstructure sa partie processuelle, mais il y a de l'infrastructure dans la superstructure et de la superstructure dans l'infrastructure. Pour les tenants de la structure, le “haut” est le moment où l'infrastructure domine, le “bas” le moment opposé, et inversement bien sûr pour les tenants du processus. Où les choses se dégradent: quand il y a trop de yin dans le yang ou trop de yang dans le yin, dans le premier cas on va vers l'insuffisance de mouvement, dans l'autre vers son excès. Ça pourrait sembler l'inverse, plus de yin dans le yang c'est plus de processus dans la structure, donc plus de mouvement, et réciproquement. Ce n'est pas le cas: la structure ralentit le processus, le processus accélère la structure Déplacer le processus vers la structure n'accélère pas la structure mais ralentit le processus par manque de ressource, inversement pour l'autre partie. Pour le dire mieux, si la superstructure tente d'accélérer l'infrastructure elle n'y parvient pas car le mouvement propre de l'infrastructure est indépendant de la quantité de processus qui traverse l'infrastructure, on n'accélère pas la transmission de l'information en ayant des tuyaux “plus énergétiques”, en ce cas l'énergie va vers le tuyau et non vers le destinataire à l'autre bout du tuyau, et bien sûr ajouter de la structure à la superstructure ne la structure pas plus, ça ne fait que disperser plus de processus sans effet structurant. Ce qui nous ramène peu à peu à l'actualité. Mais avant, quelques considérations. Sur les a révolutions, ou inversions de phases, ou bascules, que j'évoque dans «Addendum III [...]»..
Structure et processus changent en même temps, et séparément, et concurremment, et complémentairement. Est--ce que les protons, les neutrons et les électrons d'un atome sont séparables? Non, tant qu'il reste cohérent. Est-ce qu'ils sont inséparables? Non, car c'est leur séparation dans leur union qui fait leur cohérence. Structure et processus sont inséparables mais séparés, cohérents mais divergents, s'attirent et se repoussent. Dans le mouvement d'une société, l'infrastructure et la superstructure sont toujours en mouvement car l'ensemble est en mouvement mais tantôt elles sont en équilibre, tantôt l'une prévaut, a “plus de mouvement”, tantôt l'autre. L'autre représentation que j'utilise est celle des saisons en zone tempérée: au cours d'une année on a deux équinoxes et deux solstices les moments d'équinoxes sont très similaires, ceux de solstices très opposés, le solstice d'hiver est “yang”, d'été “yin”; quand on passe les solstices le moment le plus “en opposition” a lieu après, environ un mois plus tard, ce qui correspond à la représentation du taìjítú, la partie la plus large de chaque composant est légèrement après le point le plus avancé, et c'est aussi la partie qui contient le plus d'opposé, chaque saison “va son erre” et ne régresse ou progresse, ne ralentit ou accélère, qu'un peu après son point de bascule. Une année est une révolution, c'est-à-dire un mouvement qui, au bout d'une certain temps, fait qu'un objet est dans la même situation qu'au début du mouvement, c'est l'application originale du terme, il désigne un «mouvement en courbe fermée autour d'un axe ou d'un point, réel ou fictif, dont le point de retour coïncide avec le point de départ». Un terme «emprunté au bas latin et [au] latin chrétien revolutio “révolution, retour (du temps); cycle, retour (des âmes par la métempsychose)”». Si la compréhension actuelle du terme est assez différente quand elle s'applique aux mouvements politiques et sociaux, pour les “révolutionnaires” de 1776 aux États-Unis, de 1789 en France, pour eux la référence est la même, la République romaine ou la démocratie athénienne: en finir avec la monarchie ce n'est pas “aller de l'avant” mais “revenir aux sources”, au point de départ, achever un cycle, une révolution. Ce qui n'est pas faux. Et n'est pas vrai. On revient à la même situation formelle mais non au même point, tous les ans les saisons se succèdent à l'identique mais chaque an diffère du précédent.
Dans le mouvement de la société, les “équinoxes” sont les moments où l'un des éléments du couple structure-processus arrive à maturité; la phase qui suit conduit à un acmé, un “solstice”; au-delà cet élément commence à régresser mais en un premier temps se renforce encore; la suite est un affaiblissement progressif de cet élément, jusqu'au point d'acmé de l'autre. Tout ça, en théorie. En pratique les sociétés sont moins prévisibles que les saisons, l'élément qui domine à un instant donné a quelque difficulté à renoncer à cette domination, ce qui crée des perturbations. Le problème fondamental vient de ce que cet élément suppose agir “pour le bien”, celui de la société. C'est bête à dire mais les membres de la superstructure ont tendance à croire que le moteur de la société est la superstructure, et de même ceux de l'infrastructure pour l'infrastructure. Ce qui est vrai. Et faux. La société ne peut se mouvoir sans la superstructure, et ne le peut sans l'infrastructure. Donc c'est l'interaction entre les deux qui la meut. Mais quand on est dans le processus ou la structure on a tendance à voir l'autre partie comme un adjuvant, donc si elle cherche à dominer, comme un opposant, car ce qui est second ne doit pas être premier. Cette opposition en forme de rivalité est permanente mais rares sont les situations où elle est problématique. Non que dans les autres situations tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes mais l'ensemble des forces en interaction, ou sont à-peu-près en équilibre, ou ont un tel écart que l'élément en position dominante est indiscutable, contesté mais indiscutable. Les moments problématiques se produisent vers les “équinoxes”, moment où l'élément en déclin est aussi dans sa pleine puissance, celui en ascension dans sa plus grande faiblesse puisqu'il est au bord de se “réaliser”, de changer pleinement. Le futur dominant est donc particulièrement fragile, l'actuel dominant particulièrement fort. Il se trouve que la force du fort ne vient pas de lui mais de la faiblesse du faible. C'est bête à dire là aussi mais qui maîtrise la communication contrôle l'information, qui maîtrise l'information contrôle la communication. Si la superstructure domine et si l'infrastructure est mûre, elle l'est au service de la superstructure, et réciproquement. Il suffit d'observer le contexte actuel pour le comprendre. Bon ben,j'y viens, du coup, à la situation actuelle.
Ça commence, et bien, ça commence en 1872. Enfin non, ça commence en 1838. Ah non! Ça commence en 1849. Bon... ça commence entre 1500 et 1550, au moment où on atteint les limites de l'univers. Mais ça se réalise au niveau de l'infrastructure entre 1838 et 1872. Au XVI° siècle une question est résolue de manière incontestable: le monde est fini, il n'y a plus d'au-delà envisageable “sur cette Terre”, notre planète est une sphère et l'au-delà se déplace d'un hypothétique paradis, ou enfer, atteignable par voie de terre ou de mer, à un hypothétique au-delà “dans le ciel”. Après ça tout s'enchaîne et l'univers prend rapidement de l'extension, devient copernicien ou plutôt, galiléen, puis newtonien. Mais savoir et comprendre sont deux choses. Durant les trois siècles suivants s'accomplit un long processus d'adaptation de l'infrastructure à la réalité nouvelle, avec comme aboutissement la période allant de 1838 à 1872, la conception puis de la réalisation des câbles sous-marins de télécommunication. L'année 1872 est celle de la pose du du dernier câble intercontinental, entre Hong-Kong et l'Australie – entre la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne. Et le début de la fin de cette séquence. Vous n'ignorez pas, je suppose, que ce moment est aussi celui du commencement d'une nouvelle configuration du processus de diffusion de l'information, d'abord avec la mise au point de la téléphonie cette même décennie 1870, la décennie suivante la mise au point du film photographique, qui permettra une décennie plus tard celle du cinématographe, dans la même période plusieurs inventeurs proposent ou réalisent des procédés d'enregistrement du son; dans la décennie 1890 commencent les travaux sur la radio-transmission, qui débouche au début du XX° siècle sur la première TSF, la télégraphie sans fil, en 1902, puis sur la seconde, la téléphonie sans fil, la radio (la première transmission radio de la voix est antérieure à la télégraphie sans fil mais la mise au point sera plus longue pour déboucher à des applications concrètes après la première guerre mondiale); ensuite le cinéma sonore, puis la télévision. Ce qui nous situe vers 1940 environ. Même si ces évolutions reposent sur des inventions techniques il n'y a pas changement substantiel dans les vecteurs mais combinaison des principes et procédés élaborés entre 1830 et 1900, réalisés pour l'essentiel entre 1860 et 1905.
La décennie 1940 est le moment d'une évolution substantielle dans l'infrastructure avec les débuts de la communication “numérique” ou “digitale” et de l'extension de l'espace social au-delà des limites de la Terre, la première de fait, la seconde encore potentielle. J'ai une date pour le moment où l'accès à l'univers au-delà des limites de la planète a lieu de fait, le 4 octobre 1957, et une date pour le moment où l'espace social des humains franchi ces limites, le 12 juillet 1962. La première date est celle de la mise en orbite du premier Spoutnik, la seconde celle de la mise en orbite de Telstar 1, premier satellite de télécommunication. Ce qui fait la société est la communication, tout être ou objet capable de communication vers d'autres êtres ou objets est donc dans l'espace social où se fait cette communication. La suite, c'est l'unification de l'ensemble des moyens de communication à distance, le passage de la télécommunication “analogique” à celle “numérique”. De tous les moyens de communication en fait, mais la question ici est la cohésion sociale, pour cela il faut que tout point d'un ensemble soit atteignable dans un délai raisonnable, immédiatement ou en quelques heures pour celles immatérielles, en deux ou trois jours pour celles matérielles. Même si c'est encore imparfait, l'unification de tous les réseaux de communication dans le monde est réalisée au début des années 1980 et finalisée vers 1995. La principale cause de l'effondrement du système soviétique n'est pas la politique de Reagan, mais ça on le sait, ni une faiblesse structurelle, mais l'impossibilité de maintenir un tel système dans un contexte de communication intégrée au niveau mondial, ce type de régime ne peut fonctionner que s'il est fermé. Sauf à mourir, il est impossible pour une société de ne pas adapter son infrastructure aux moyens de communication les plus efficients, et il est impossible à un régime politique “totalitaire” de survivre dans un système de communication ouvert, l'exemple de la Corée du Nord ou celui de l'Érythrée montrent assez je crois qu'une entité politique de type totalitaire peut se maintenir très longtemps dès lors qu'elle fait le choix de rester fermée.
La situation actuelle... Et bien, depuis environ trois décennies l'infrastructure de la société mondiale est arrivée à maturité, donc il est temps de changer de superstructure au niveau mondial. Les participants à cette superstructure en ont conscience depuis aussi longtemps et même depuis bien avant mais ça n'est pas aussi simple de faire évoluer la superstructure que l'infrastructure. Le problème est que les membres de la superstructure sont dans leur majorité incapables d'imaginer un changement qui modifie la structure même de leur organisation donc de percevoir qu'elle a déjà changé pour la simple raison que la structure de la superstructure est l'infrastructure. On peut dire que depuis environ trois décennies les membres de la superstructure tentent de réaliser ce qui s'est déjà réalisé, donc agissent de fait contre le changement en promouvant le changement puisque le changement est advenu.
Les membres d'une société se confrontent à un paradoxe: le changement de l'infrastructure est perceptible mais non significatif, celui de la superstructure imperceptible mais significatif. Factuellement, la société nommée France est autre que celle qui portait ce nom il y a trois siècles, entre les deux elle s'est transformée cinq ou six fois tant dans sa structure que dans son processus et a connu plusieurs variations d'extension; les changements dans l'infrastructure sont sensibles: en 1720 la France est un Empire qui a de vastes colonies outremer, pour l'essentiel dans les Amériques, plus quelques possessions dans l'Océan Indien et quelques comptoirs sur les autres continents ; en 1804 elle a perdu presque toutes ses possessions outremer mais est en train de construire un empire continental en Europe, ce qui lui réussit assez mais sera interrompu brusquement en 1815; elle se trouve alors réduite pour l'essentiel à sa métropole; en 1830 elle commence à se reconstituer un empire d'outremer mais cette fois il sera inverse du précédent: de vastes territoires sur tous les continents excepté les Amériques où elle ne possède plus que quelques îles et un territoire continental limité, moins de 100.000 km²; un siècle plus tard, en 1930, elle dispose du second plus vaste empire jamais constitué, le premier étant celui contemporain de la Grande-Bretagne, à qui d'ailleurs est arrivée une aventure similaire: en 1720 sa plus grande zone coloniale est en Amérique du Nord, deux siècles plus tard sa possession canadienne est certes nominalement encore britannique mais dotée d'une autonomie qui équivaut à une indépendance, en revanche elle s'est emparée d'énormes entités partout ailleurs, tout spécialement en Asie et en Afrique. En 1962, la France est de nouveau presque réduite à son seul territoire métropolitain mais a entretemps intégré une structure au niveau continental, la CEE, qui moins d'un demi-siècle après sa création intègrera presque toute l'Europe à l'ouest de l'Ukraine et de la Russie, un empire européen d'une nouvelle sorte, peut-on dire. Durant ces trois siècles sa superstructure fut profondément modifiée quatre ou cinq fois et moins profondément mais significativement autant de fois ou plus. On peut donc dire que l'entité France de 2020 n'a presque plus rien de commun avec celle de 1720. Mais autant ces changements sont évidents pour l'infrastructure, autant il ne le sont pas pour la superstructure. C'est que, quand la superstructure connaît une changement radical les positions de ses membres sont fort peu modifiées, le processus est différent mais ceux qui y agissent sont les mêmes et pour réaliser le plus souvent les mêmes fonctions qu'auparavant. Alors que le changement de l'infrastructure modifie visiblement la structure et la manière dont le processus se réalise, donc les positions des acteurs.
Quel est le problème actuel de la superstructure? Ne pas disposer des moyens anciens pour se transformer. En tout premier, la guerre, celle à l'ancienne donc, la mobilisation générale, les armées opposées, les massacres de soldats et de populations civiles. Non que ça n'existe plus mais depuis environ un demi-siècle, exception faite de l'URSS puis de la Russie plus aucun État en capacité de mener une guerre très meurtrière sur un temps court ne l'a fait, et en cette année 2020 un tel cas est inenvisageable. Personnellement je trouve ça plutôt bien mais quand il s'agit d'adapter la superstructure ou parfois l'infrastructure c'est un problème: à la fin des années 1930 la solution pour débloquer la situation fut la deuxième guerre mondiale, très regrettable en tant qu'événement mais qui eut pour conséquence une évolution radicale et plutôt intéressante de la superstructure et dans la foulée, de l'infrastructure. Pour parler encore du cas que je connais le mieux, celui de la France, ce pays est en état de guerre depuis le début de la décennie 1990, précisément depuis le 2 janvier 1991, et l'est continument depuis le 6 octobre 1995; dix ans plus tard, en juillet 2005, le “niveau d'alerte” est maximal, “rouge”, et à partir de cette date ce niveau ne baisse plus, ce qui conduit «à l’abandon du code couleur le 20 février 2014», dit autrement, à la prise en compte du fait qu'il est devenu désormais impossible de faire baisser ce niveau d'alerte. Abandon heureux puisque depuis, et bien, le niveau d'alerte a été renforcé, c'est dire que la France est désormais au-delà du maximum. Étrange, non? Vous vivez en France ou y avez vécu même occasionnellement? On ne croirait pas que c'est un pays en guerre. Enfin si, on le croirait, ne serait-ce que parce que notre gouvernement le répète tous les jours ou presque. Enfin non, on ne le croirait pas. Euh... C'est compliqué... Je n'y crois pas mais je le constate. Possible que vous y croyiez sans le constater. Quand on est en état de guerre sans que la guerre soit effective ça ne peut être qu'une question de croyance: je constate que nous sommes en état de guerre mais ne crois pas qu'il y ait guerre. Ou alors, on m'a toujours menti en ce qui concerne la guerre. Finalement, les négationnistes sont-ils dans le vrai? Possible...
Vous est-il arrivé de vivre dans un pays en guerre? Moi si. Et bien, c'est curieux mais on a du mal à le voir. On a beau le savoir, difficile de le voir. Pas toujours ni partout mais du moins, la plupart du temps et dans la plupart des lieux il est difficile de le voir. Une guerre est avant tout affaire de discours. Pour la deuxième guerre mondiale c'est un peu différent mais pour la première sur la quasi-totalité du territoire français et la totalité du territoire allemand il n'y eut pas de conséquences directes observables; pour les autres pays concernés, exception faite, peut-être, de la Belgique, il y eut très peu de et le plus souvent aucunes conséquences directes sur le territoire national. Hormis les guerres civiles c'est un cas courant. Comme vous le savez désormais si du moins vous l'ignoriez auparavant, dans la période 1914-1920 il y eut plus de morts causées par la “grippe espagnole” que par la guerre puisque le nombre estimé de victimes de la guerre est de moins de 19 millions, alors que la grippe espagnole «a fait de 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur, et peut-être jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations récentes». On peut éliminer la valeur basse car pour des raisons politiques les pays parties au conflit ont délibérément sous-estimé l'incidence de cette pandémie et dans bien des parties du monde les statistiques de santé n'étaient pas très développées, en toute hypothèse 50 millions est un ordre de grandeur plus vraisemblable que 20 millions. Si on y ajoute que dans certaines entités politiques les morts recensées ne furent pas proprement dues à la guerre, sinon de manière indirecte – cas notamment de l'Empire Ottoman, de la Serbie, de la Grèce, du Portugal, rares parties au conflit où le nombre de morts civils dépasse beaucoup ou énormément le nombre de morts militaires, ces décès ayant, pour l'Empire ottoman et le Portugal tout spécialement, une cause interne plus ou moins liée au conflit, ou résultant d'un conflit secondaire. Si on retire du compte l'essentiel des 4,2 millions de morts civils de l'Empire ottoman, dont on sait que pour l'essentiel ce sont des populations massacrées sur ordre de l'appareil d'État, en tout premier les Arméniens, ça ramène le nombre de morts de la guerre en-dessous de 15 millions. D'ailleurs, l'exemple de l'Empire ottoman, ou plus tard ceux du Cambodge, du Ruanda, illustrent parfaitement mon propos: les guerres civiles ou internes touchent souvent beaucoup plus profondément un territoire que les guerres interétatiques ou internationales. Cela dit, même les guerres entre États son souvent des sortes de guerres civiles, elles apparaissent un “bon” moyen pour les autorités de résoudre un problème interne. D'ailleurs, quand on y réfléchit les morts “militaires” des deux guerres mondiales sont souvent des morts civiles déguisées puisque l'essentiel des soldats sont des appelés, des non militaires qui par la magie de la mobilisation deviennent des militaires, mais brièvement en général, juste le temps de se faire tuer ou gravement blesser..
Ne prenez pas au sérieux ma plaisanterie douteuse sur les négationnistes, c'est juste pour pointer le fait que toute guerre civile, interétatique ou mixte peut aisément susciter un “négationnisme”, rapport au fait que ce sont des périodes favorables à la diffusion de fausses nouvelles. Les négationnistes sont dans le faux mais souvent ne font que rajouter du faux au faux. En tout cas, quand vos autorités lancent la machine à propagande, à bourrage de crâne, soyez certains d'une chose, l'essentiel des nouvelles sont des fausses nouvelles.
Donc, la France en état de guerre permanent depuis 1995 et en alerte maximale ou au-dessus de maximale depuis 2005, sans pour cela qu'elle se soit engagée dans un conflit qui la concerne directement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en possibilité de le faire, de faire une “bonne” guerre, une guerre militaire avec mobilisation générale en bonne et due forme, ni même une guerre de type impérialiste, “coloniale”, à l'ancienne – de fait, tous les conflits dans lesquels la France s'est engagée, y compris ceux actuels, ont une fort aspect “colonialiste”, mais ça n'a rien à voir avec ceux d'avant 1962, se sont des guerres limitées avec un faible engagement et où les troupes françaises ont une fonction auxiliaire, certes primordiale dans un contexte où les troupes locales seraient incapables de tenir longtemps sans soutien extérieur, mais secondaire cependant. Sans vouloir dire du mal, dans certains de ces conflits (je pense notamment au Mali et à la Centrafrique) on peut se demander si l'intervention française n'a pas autant pour fonction de dissuader les troupes locales de ne pas agresser leur propre population civile que de les seconder dans la lutte contre un ennemi plus ou moins déterminé. Et pour la Centrafrique, on peut même dire qu'il s'est agi plutôt d'une opération de police que d'une intervention militaire à proprement parler: quoi qu'on puisse penser de sa légitimité, au Mali il y avait malgré tout un gouvernement avec lequel dialoguer...
La France ne peut plus, dans le contexte de cette année 2020, susciter une mobilisation générale même informelle de manière durable et répétée. Il n'y a pas si longtemps, une vingtaine d'années environ, c'était encore possible. Mais justement, il y a une vingtaine d'années environ on a basculé dans un “nouvel ordre mondial”. Il y a un quart de siècle plutôt. Je l'écrivais plus haut, le changement de l'infrastructure est perceptible mais non significatif, et de ce fait quand a lieu une bascule elle se répand très vite et presque sans heurts. La raison en est que les réseaux de communication sont invisibles et que ce qu'ils transportent, l'information, est de la même nature quel que soit le moyen, un ordinateur, un téléphone mobile, une tablette, ne véhicule aucune information inédite dans la forme ou dans le fond par rapport à ce que les vecteurs antérieurs véhiculaient, c'est toujours du texte, du dessin, du son, de l'image, de l'image animée, bref, des systèmes de signes connus depuis aussi longtemps que les humains s'échangent des informations. La période qui va en gros de 1960 à 1995 est une phase de préparation de la bascule, comme dit aussi il s'agit de convertir les réseaux de télécommunication au numérique et de les unifier, ce qui est à-peu-près réalisé vers 1990, mais le moment décisif est le milieu de la décennie, lorsque la téléphonie mobile s'intègre à son tour dans ce système global de télécommunication numérique.
En 1995, rares sont les possesseurs d'un téléphone mobile; en 2000, rares sont les membres des sociétés développées qui n'en possèdent pas un; en 2020, rares sont les lieux du monde où l'on ne peut disposer d'un téléphone mobile. Certes, dans une large partie du monde ce sont des téléphones comparables à ceux du tout début du siècle, des téléphones “2G”, mais ça implique que presque en tout lieu du globe un humain peut se relier presque instantanément à n'importe quel autre humain en n'importe quel autre point du globe, et même au-delà – et oui, on peut aussi communiquer avec des extraterrestres, certes des extraterrestres humains, mais une personne qui se trouve à bord de la station spatiale internationale ou dans une fusée spatiale en orbite est “hors de la Terre”, est extraterrestre. Pour me répéter, dès lors qu'on a mis en orbite des satellites de télécommunication l'espace social s'est élargi jusqu'à 36.000 kilomètres en altitude et même au-delà mais pour l'essentiel les satellites artificiels sont à cette altitude ou en-dessous. Factuellement l'extension est bien plus large car les satellites d'exploration lointaine ont récemment atteint les limites de l'héliosphère mais bon, la communication avec ces engins est limitée, intermittente, aléatoire, très lente (environ 17 heures pour le plus lointain) et à sens unique, pour l'essentiel les engins qui ont été au-delà de 36.000 km se sont limités à la banlieue (la Lune) et aux voisins proches, surtout Mars et Vénus, et les plus lointains extraterrestres.avec lesquels on a communiqué n'étaient pas beaucoup plus loin que l'orbite de la Lune. Paraît qu'il y en aura bientôt sur Mars mais je suis dubitatif, on a déjà du mal à en envoyer sur la Lune, alors sur Mars...
Trêve de moqueries, ce changement du milieu des années 1990 explique pourquoi il est devenu difficile d'envisager une guerre internationale, mais aussi une guerre civile, dans une large partie du monde. Généralité ne vaut pas totalité, je n'ignore pas les situations de guerre, internationales ou/et civiles, dans le monde, ni même les mobilisations de type pogroms, constater que, peut-on dire, le “niveau de violence” tend à se réduire n'induit pas que la violence a disparu, la société française de 2020 est tendanciellement moins violente que celle de 1970, que celle de1920, que celle de 1870, mais il y a toujours de la violence en France. En tous les cas, une guerre entre entités politiques en Europe à l'ouest de l'Ukraine comme les deux qui eurent lieu au siècle passé est peu envisageable. La raison en est le contrôle de l'information. Le bourrage de crâne requiert un accès à l'information très inégal entre membres de la superstructure et de l'infrastructure et que la superstructure locale puisse significativement empêcher d'autres superstructures de communiquer en direction de l'infrastructure locale. Vous ne l'ignorez pas, nos responsables politiques et nos médiateurs s'inquiètent beaucoup de ce qu'ils nomment en français contemporain les “fake news”, et de cette notion étrange, la “post-vérité”: qu'y a-t-il au-delà de la vérité? Probablement la vérité, celle d'après. Ou alors le mensonge, celui d'après. Disons, après la vérité il y a la même chose qu'avant la vérité, la vérité ou le mensonge. Les “fake news”? Un vieux truc, qui a un nom en français ancien, le même mais avec d'autres mots: les fausses nouvelles. Il y a même un article de Wikipédia sur cette expression commune, la “diffusion de fausses nouvelles”, qui est le miroir de cette autre pratique, le “bourrage de crâne”, toutes deux ressortant d'un concept plus récemment nommé, la “désinformation”. Voici comment Wikipédia les définit:
- Désinformation: «Ensemble de techniques de communication visant à tromper des personnes ou l'opinion publique pour protéger des intérêts (privés ou non) ou influencer l'opinion publique. L'information fausse ou faussée est à la fois “délibérément promue et accidentellement partagée”. Elle est parfois employée dans le cadre des relations publiques. Le sens de ce mot, apparu au dernier quart du XXe siècle et proche des termes propagande, canular et rumeur, connaît des variations selon les auteurs»;
- Diffusion de fausse nouvelle: «En droit français, la diffusion de fausse nouvelle est une infraction pénale consistant à publier, diffuser ou reproduire, par n'importe quel moyen, des informations fausses, des pièces fabriquées, falsifiées voire mensongères et basées sur la mauvaise foi, du moment que celles-ci ont été reconnues comme de nature à troubler l'ordre public»;
- Bourrage de crâne: «Si l'expression est restée utilisée par la suite pour désigner la propagande ou l'endoctrinement, elle est particulièrement en usage pendant la Grande Guerre.
Le bourrage de crâne est la conséquence de la censure, de l’esprit cocardier de la rédaction des principaux organes de presse et d’une volonté de maintenir le moral de l’arrière. Les communiqués laconiques des autorités masquant les revers de l’armée ne permettaient pas de satisfaire les besoins d’informations du public. Les journalistes sont donc contraints à l’invention»;
Le bourrage de crâne se distingue de la diffusion de fausses nouvelles principalement par la source, dans un cas elle vient des autorités, dans l'autre non. Le bourrage de crâne n'est pas strictement de la propagande d'État mais l'État crée les conditions de sa mise en place en limitant l'accès à l'information et en diffusant des nouvelles incomplètes, inexactes ou fausses. Et dans les deux cas le vecteur de diffusion: les médias, la presse d'abord puis par après la radio, le cinéma (les “actualités filmées”), la télévision. La désinformation n'est pas le tout de la propagande mais un de ses instruments. Le problème actuel est simple: la “mobilisation générale” nécessite, pour fonctionner, le monopole du contrôle de la diffusion de l'information par la superstructure et ses relais, or c'est devenu impossible, désormais toute personne physique ou morale est en capacité de diffuser ou recevoir de l'information hors du contrôle de n'importe quelle superstructure si elle a un accès au système mondial intégré de télécommunication. Ça ne signifie pas que les superstructures n'ont plus la capacité d'exercer ce monopole, on en a l'exemple dans beaucoup d'entités politiques, en revanche l'insertion forte dans le système global d'échanges induit l'impossibilité d'un monopole strict, même une entité où ce contrôle est fort, comme la Chine, se voit obligée à une auto-limitation si elle souhaite une insertion forte dans ce système global.
Bien sûr cette situation de rupture de monopole est plus ancienne mais elle prend un autre caractère dans le dernier quart de siècle. Le moment significatif est l'apparition de la radiodiffusion du son, la radiophonie, mais pendant longtemps, tant pour des raisons techniques que légales la radiophonie et la télévision restent des monopoles de la superstructure, pas nécessairement des monopoles d'État mais les médias sont des éléments de la superstructure et de ce fait tendent à la maintenir pour se maintenir eux-mêmes. Dès lors que les moyens de télécommunication forment un ensemble intégré, que tout participant est à la fois émetteur et récepteur et que tout participant peut se relier à tout participant il n'y a plus de monopole de diffusion de l'information. C'est là le point crucial, car le bourrage de crâne, la désinformation et plus largement la propagande ne fonctionnent que s'il y a un nombre restreint et identifiable d'émetteurs de fausses nouvelles, ou plus largement d'émetteurs de nouvelles, vraies ou fausses. Bien sûr ça ne suffit pas pour casser le monopole car il y a l'autre aspect, le système de communication.
Quand on ne peut plus s'assurer du monopole de l'information on peut s'assurer, cela plus aisément, du monopole de la communication. Toujours le même principe: le réseau de communication, l'infrastructure, est invisible, on sait qu'il existe, on sait en faire usage, mais on se pose rarement la question de son organisation, de sa structuration. On met souvent en doute les diffuseurs d'information en tant que diffuseurs, rarement les opérateurs des réseaux de communication en tant qu'opératzurs. Non qu'il ne coure beaucoup de rumeurs, parfois fondées, sur ces opérateurs, mais au plan de leur accès aux contenus diffusés, on s'interroge sur leur capacité, et leur volonté, de contrôler ou de modifier les contenus, les informations, mais pas vraiment sur leur manière d'organiser cette diffusion. Je l'évoque plus longuement dans d'autres billets, ce système global de télécommunication peut s'organiser de deux manières, en toile ou en réseau.
Un réseau, un rets, un filet, est un système de connexion point à point, chaque point se relie à chaque point proche et l'information, les échanges, circulent de point à point; une toile a la même structure formelle mais comporte deux sortes de points, ceux passifs, de simples relais, et ceux actifs, des concentrateurs, il s'agit ici de toiles de la forme toile d'araignée, de webs comme on dit en anglais, avec un centre, des rayons, et des nœuds secondaires reliant ceux répartis sur les rayons; quel que soient les chemins que suivent les informations, toutes partent du centre ou y vont; quand un contenu n'est pas passé par le centre les points secondaires fonctionnent comme de simples relais les dirigeant vers d'autres points jusqu'à les amener au centre; une fois passés par ce centre ils intègrent une information nouvelle permettant au point visé de les identifier comme lui étant destinés. Je simplifie mais le principe général est celui-là. La toile est une organisation superstructurelle, le réseau une organisation infrastructurelle. Les deux étant indéfectiblement liées un système de diffusion des échanges est toujours à la fois réseau et toile, mais les membres de l'infrastructure tendent à privilégier le réseau car c'est le moyen le plus efficace de constituer et de maintenir une structure, ceux de la superstructure à privilégier la toile car c'est le moyen le plus efficace ce contrôler et diriger le processus.
Dans une société idéale, donc impossible – les sociétés ne sont pas des idées mais des faits –, les deux organisations se complètent sans s'opposer; dans une société assez équilibrée elles s'opposent modérément et des mécanismes sont prévus pour corriger les excès dans l'un ou l'autre sens: si la structure prend le pas, ça tend à ralentir l'ensemble, quand c'est le processus, à l'emballer. Une société est une sorte d'écosystème et comme telle, un système auto-correcteur, c'est-à-dire un système qui tend vers un certain état et dispose de régulations lui permettant de ralentir ou accélérer le système quand il s'en écarte trop. Dans son article «La cybernétique du “soi” une théorie de l'alcoolisme», partie «L'épistémologie de la cybernétique», Gregory Bateson en fait une description assez pertinente:
«Ce qui est à la fois nouveau et surprenant, c'est qu'aujourd'hui nous avons des réponses (du moins partielles) à certaines de ces questions. Des progrès extraordinaires ont été réalisés, au cours de ces vingt-cinq dernières années (note: Cet article a été publié pour la première fois en 1971), dans la connaissance de ce qu'est l'environnement, de ce qu'est un organisme et surtout de ce qu'est l'esprit. Ces progrès sont dus précisément à la cybernétique, à la théorie des systèmes, à la théorie de l'information et aux sciences connexes.
A l'ancienne question de savoir si l'esprit est immanent ou transcendant, nous pouvons désormais répondre avec une certitude considérable en faveur de l'immanence, et cela puisque cette réponse économise plus d'entités explicatives que ne le ferait l 'hypothèse de la transcendance: elle a, tout au moins, en sa faveur, le support négatif du “Rasoir d'Occam”.
Pour ce qui est des arguments positifs, nous pouvons affirmer que tout système fondé d'événements et d'objets qui dispose d'une complexité de circuits causaux et d'une énergie relationnelle adéquate présente à coup sûr des caractéristiques ”mentales”. Il compare, c'est-à-dire qu'il est sensible et qu'il répond aux différences (ce qui s'ajoute au fait qu'il est affecté par les causes physiques ordinaires telles que l'impulsion et la force). Un tel système“traitera l'information” et sera inévitablement auto-correcteur, soit dans le sens d'un optimum homéostatique, soit dans celui de la maximisation de certaines variables.
Une unité d'information peut se définir comme une différence qui produit une autre différence. Une telle différence qui se déplace et subit des modifications successives dans un circuit constitue une idée élémentaire.
Mais ce qui, dans ce contexte, est encore plus révélateur, c'est qu'aucune partie de ce système intérieurement (inter) actif ne peut exercer un contrôle unilatéral sur le reste ou sur toute autre partie du système. Les caractéristiques “mentales” sont inhérentes ou immanentes à l'ensemble considéré comme totalité.
Cet aspect holistique est évident même dans des systèmes auto-correcteurs très simples. Dans la machine à vapeur à “régulateur”, le terme même de régulateur est une appellation impropre, si l'on entend par là que cette partie du système exerce un contrôle unilatéral. Le régulateur est essentiellement un organe sensible (ou un transducteur) qui modifie la différence entre la vitesse réelle à laquelle tourne le moteur et une certaine vitesse idéale ou, du moins, préférable. L'organe sensible convertit cette différence en plusieurs différences d'un message efférent: Par exemple, l'arrivée du combustible ou le freinage. Autrement dit, le comportement du régulateur est déterminé par le comportement des autres parties du système et indirectement par son propre comportement à un moment antérieur.
Le caractère holistique et mental du système est le mieux illustré par ce dernier fait, à savoir que le comportement du régulateur (et de toutes les parties du circuit causal) est partiellement déterminé par son propre comportement antérieur. Le matériel du message (les transformations successives de la différence) doit faire le tour complet du circuit: le temps nécessaire pour qu'il revienne à son point de départ est une caractéristique fondamentale de l'ensemble du système. Le comportement du régulateur (ou de toute autre partie du circuit) est donc, dans une certaine mesure, déterminé non seulement par son passé immédiat, mais par ce qu'il était à un moment donné du passé, moment séparé du présent par l'intervalle nécessaire au message pour parcourir un circuit complet. Il existe donc une certaine mémoire déterminative, même dans le plus simple des circuits cybernétiques.
La stabilité du système (lorsqu'il fonctionne de façon auto-corrective, ou lorsqu'il oscille ou s'accélère) dépend de la relation entre le produit opératoire de toutes les transformations de différences, le long du circuit, et de ce temps caractéristique. Le régulateur n'exerce aucun contrôle sur ces facteurs. Même un régulateur humain, dans un système social, est soumis à ces limites: il est contrôlé à travers l'information fournie par le système et doit adapter ses propres actions à la caractéristique de temps et aux effets de sa propre action antérieure.
Ainsi, dans aucun système qui fait preuve de caractéristiques “mentales”, n'est donc possible qu'une de ses parties exerce un contrôle unilatéral sur l'ensemble. Autrement dit: les caractéristiques “mentales” du système sont immanentes, non à quelque partie, mais au système entier.
La signification de cette conclusion apparaît lors des questions du type: “Un ordinateur peut-il penser?”, ou encore: “L'esprit se trouve-t-il dans le cerveau?” La réponse sera négative, à moins que la question ne soit centrée sur l'une des quelques caractéristiques “mentales” contenues dans l'ordinateur ou dans le cerveau. L'ordinateur est auto-correcteur en ce qui concerne certaines de ses variables internes: il peut, par exemple, contenir des thermomètres ou d'autres organes sensibles qui sont affectés par sa température de travail; la réponse de l'organe sensible à ces différences peut, par exemple, se répercuter sur celle d'un ventilateur qui, à son tour, modifiera la température. Nous pouvons donc dire que le système fait preuve de caractéristiques “mentales” pour ce qui est de sa température interne. Mais il serait incorrect de dire que le travail spécifique de l'ordinateur – la transformation des différences d'entrée en différences de sortie – est un “processus mental”. L'ordinateur n'est qu'un arc dans un circuit plus grand, qui comprend toujours l'homme et l'environnement d'où proviennent les informations et sur qui se répercutent les messages efférents de l'ordinateur. On peut légitimement conclure que ce système global, ou ensemble, fait preuve de caractéristiques “mentales”. Il opère selon un processus “essai-et-erreur” et a un caractère créatif.
Nous pouvons dire, de même, que l'esprit est immanent dans ceux des circuits qui sont complets à l'intérieur du cerveau ou que l'esprit est immanent dans des circuits complets à l'intérieur du système: cerveau plus corps. Ou, finalement, que l'esprit est immanent au système plus vaste: homme plus environnement.
Si nous voulons expliquer ou comprendre l'aspect “mental” de tout événement biologique, il nous faut, en principe, tenir compte du système, à savoir du réseau des circuits fermés, dans lequel cet événement biologique est déterminé. Cependant, si nous cherchons à expliquer le comportement d'un homme ou d'un tout autre organisme, ce “système” n'aura généralement pas les mêmes limites que le “soi” — dans les différentes acceptions habituelles de ce terme.
Prenons l'exemple d'un homme qui abat un arbre avec une cognée. Chaque coup de cognée sera modifié (ou corrigé) en fonction de la forme de l'entaille laissée sur le tronc par le coup précédent. Ce processus auto-correcteur (autrement dit, mental) est déterminé par un système global: arbre-yeux-cerveau-muscles-cognée-coup-arbre; et c'est bien ce système global qui possède les caractéristiques de l'esprit immanent.
Plus exactement, nous devrions parler de (différences dans l'arbre) - (différences dans la rétine) - (différences dans le cerveau) - (différences dans les muscles) - (différences dans le mouvement de la cognée) - (différences dans l'arbre), etc. Ce qui est transmis tout au long du circuit, ce sont des conversions de différences; et, comme nous l'avons dit plus haut, une différence qui produit une autre différence est une idée, ou une unité d'information.
Mais ce n'est pas ainsi qu'un Occidental moyen considérera la séquence événementielle de l'abattage de l'arbre. Il dira plutôt: “J'abats l'arbre” et il ira même jusqu'à penser qu'il y a un agent déterminé, le “soi”, qui accomplit une action déterminée, dans un but précis, sur un objet déterminé» (Gregory Bateson, «La cybernétique du “soi” une théorie de l'alcoolisme», dans Vers une Écologie de l'esprit, tome I, Le Seuil, 1977).
Je ne cite le dernier alinéa que pour lancer une pique à un de mes auteurs préférés: la compréhension non holiste et non cybernétique de la réalité n'est pas l'apanage de l'Occidental moyen et se rencontre un peu partout dans le monde.
Une société ressortant du vivant a les mêmes caractéristiques, c'est un objet homéostatique qui tend donc «à maintenir ou à ramener les différentes constantes [...] à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale», tenant compte du fait que la “normale” est un état évolutif qui évolue dans le temps à court, moyen et long termes, pour exemple la “normale” de température est plus ou moins haute selon que l'organisme est en veille ou en sommeil, et de même, pour les individus qui pratiquent l'hibernation les constantes sont très divergentes en été et en hiver, et plus largement les individus adaptent leur comportement selon les variations des conditions du milieu, enfin entre sa naissance et sa sénescence un individu connaît une évolution qui fait que la “normale” est assez différente selon son âge. Pris dans son entier un objet du vivant, dont un écosystème, ne tend pas proprement à l'équilibre, il tend vers une moyenne qui évolue dans le temps et selon les conditions, c'est une entité adaptative qui évolue en fonction des contextes. De même une société. Dire d'une société que la communication la structure et l'information l'anime n'est rien dire de plus que: une société est vivante. Ne pas communiquer avec le milieu externe et dans le cadre du milieu interne, et ne pas s'informer sur l'état de ces milieux, c'est perdre la capacité de s'adapter aux contextes.
Les humains ont une capacité rare à exercer un contrôle important sur les contextes. Non pas unique mais rare, et en outre éminente. Cette capacité est une force quand on en use avec modération, une faiblesse quand on en use sans modération. C'est que, adapter les contextes a un coût énergétique et que l'énergie disponible est limitée, à quoi s'ajoute que le contexte globale, “universel”, tend à l'entropie, au désordre, donc mettre de l'ordre dans l'univers est toujours un processus limité dans le temps et l'espace, on peut avec ruse tricher un peu mais quand on triche à l'excès on peut être assuré de ceci: la police de l'entropie vous attrapera au tournant et vous fera payer cash l'infraction. L'univers est un juge intransigeant, avec lui pas de remises de peine.
Ce qui nous ramène au contexte actuel. D'évidence, par les temps qui courent la superstructure domine. C'est logique: au sortir de la deuxième guerre mondiale, après quelques péripéties malheureuses où la superstructure tenta de préserver sa prédominance au-delà du possible eut lieu un changement assez brusque où l'infrastructure prit le pas. Pas très bien mais assez nettement. Le mouvement commence avant – toujours le même principe, le moment où l'un des deux ensembles prend le pas est contemporain du moment où l'autre est à son acmé, donc le changement débute dans la décennie qui précède mais ne se concrétise qu'à la fin des années 1940 – et s'achève alentour de 1970; à partir de là, commence le mouvement de bascule en faveur de la superstructure, ce qui là aussi logique: quand la nouvelle structure est en place le processus s'adapte et se transforme. Le point de désaccord le plus grand entre la structure et le processus est celui du contrôle: pour l'infrastructure il doit être préalable, pour la superstructure il doit s'exercer a posteriori. C'est encore une fois assez logique: un processus n'est vérifiable qu'une fois achevé, une structure n'est valide qu'avant usage, vous imaginez ça, une personne qui installe votre système électrique et qui ne vérifie qu'après si ça fonctionne ou non? Un électricien doit savoir par avance si ce qu'il installe sera en état de rendre le service prévu; en revanche un service immatériel, une prestation, n'est vérifiable qu'une fois réalisée. On suppose bien sûr qu'un prestataire de service immatériel sait ce qu'il fait mais il y a des impondérables.
En droit on détermine deux obligations, l'une s'applique plutôt aux prestations matérielles, l'obligation de réussite, l'autre à celles immatérielles, l'obligation de moyens. Il n'est pas si aisé de séparer les deux types de prestations, ce que par exemple illustrent les contentieux qui se sont multipliés au cours des dernières décennies contre le corps médical: dans un état antérieur, en gros jusqu'au milieu du XX° siècle, les processus vitaux étaient mal connus, on peut dire que la médecine considérait les processus organiques comme une gestalt, comme une «structure à laquelle sont subordonnées les perceptions», la part processuelle formant donc un tout inanalysable, de ce fait toute action médicale était aléatoire et les médecins n'avaient qu'une obligation de moyens; les progrès importants dans la connaissance fine des processus que les évolutions importantes de l'infrastructure ont permises a transformé cet état de choses, a en quelque sorte transformé l'organisme non plus en un tout mais en un complexe de réseaux, une sorte de machine, et la médecine non plus en art mais en technique, de ce fait les patients ont peu à peu considéré que le corps médical avait une obligation de résultat. On trouvera des exemples inverses bien sûr, comme le cas des logiciels: tous leurs concepteurs font figurer dans leur contrat une mention qui précise qu'ils ne peuvent être tenus responsables des problèmes causés par leur programmes, ce qui les met du côté des arts libéraux et indiquent qu'ils n'ont qu'une obligation de moyens. Sans développer, ici est en question la responsabilité: est-elle en amont, du côté des prestataires, ou en aval, du côté des usagers?
Cette opposition a bien sûr une cause plus profonde, l'ancienne opposition entre le corps et l'esprit. Le logiciel est “l'esprit de l'ordinateur” et de ce fait est du côté de la prestation immatérielle; jusqu'à récemment la médecine “guérissait par l'esprit”, c'est tardivement que les chirurgiens entrèrent dans la classe des médecins, plus tard encore les oculistes et les dentistes – qui en intégrant le cursus médical ont changé de nom pour devenir des orthodontistes, des stomatologues, des chirurgiens-dentistes et des ophtalmologues –:; en se mettant à “guérir par le corps” elle a gagné en efficacité et perdu en prestige, on a donc cet autre paradoxe: plus la médecine se révèle efficace plus elle réussit dans son entreprise de soin, et plus on lui reproche ses échecs.
Pour revenir au sujet, le principal problème quand on en est au moment où la superstructure doit se transformer vient de cette question du contrôle: la logique propre à la superstructure est de considérer que quand les choses semblent aller mal, la solution est de contrôler plus et mieux. Or, elles vont mal parce que l'infrastructure a créé les conditions permettant de réduire le niveau de contrôle en aval. On a donc une infrastructure assez fiable pour qu'on puisse réduire considérablement les contrôles en aval, et une superstructure qui redouble l'infrastructure pour contrôler au niveau du processus ce qui l'a déjà été en amont; comme ça crée des perturbations sans augmenter la fiabilité les tenants de la superstructure analysent la situation en tant qu'elle révèle une insuffisance de contrôle et mettent en place une structure de contrôle de la structure de contrôle de l'infrastructure. Comme il se sait, certaines entités politiques ont géré cette pandémie de 2020 bien plus efficacement que d'autres. Pas toutes de la même manière ni avec le même genre d'efficacité mais du moins s'accorde-t-on sur celle-ci. Ou presque: les responsables des entités politiques les moins efficaces ont une forte tendance à se prétendre les plus efficaces., d'où un avis assez différent sur qui est ou n'est pas efficace. Toujours est-il que ces entités efficaces ont ceci en commun: assurer le contrôle au niveau de l'infrastructure. Des sociétés qui répondent oui à la question «Est-tu le gardien de ton frère?»; des sociétés qui approuvent cette proposition, «La liberté des uns commence où commence celle des autres». Je souligne “commence” car la sentence la plus courante est «La liberté des uns finit où commence celle des autres». Liberté et contrainte sont des deux côtés d'une même médaille, d'un même symbole, dans la formule courante on peut lire «la contrainte des uns commence où commence la liberté des autres», ce qui sous un aspect est recevable mais porte en germe la rupture d'égalité et la dissension, ce qu'incarnent les tenants d'une inégalité entre membres de la société qui depuis quelques temps ont restauré cette notion qui sous-tendait les idéologies les régimes les plus autoritaires et totalitaires apparus du milieu de la décennie 1910 au milieu de la décennie 1930, «majorité fait loi»: les partis actuellement au pouvoir en Hongrie, en Pologne, au Brésil, aux États-Unis, ont adopté une interprétation fallacieuse de la démocratie dans laquelle toute décision qui émane de “la majorité”, c'est-à-dire la fraction du peuple qui les a portés au pouvoir, et qu'ils sont censés incarner, vaut parce qu'elle est la majorité, ce qui implique que la liberté des minorités est limitée par celle de la majorité. Postuler que la liberté de tous vaut pour tous implique que la contrainte s'applique à tous: ce qui limite la liberté des minorités doit limiter la liberté de la majorité.
Pour revenir aux sociétés qui ont montré une bonne capacité de gestion de cette pandémie “covid-19”, que ce soit de manière autoritaire ou libérale elles ont ceci en commun d'avoir délégué à tous et chacun la capacité de réguler et limiter en interne la diffusion du virus. Presque toutes ont pris des mesures de contrôle au niveau de la superstructure pour réguler et limiter sa diffusion externe, notamment en restreignant ou interdisant le trafic aérien et maritime pour le transport de passagers, en instaurant des quarantaines, etc., mais en interne l'essentiel de la régulation était confié à tous et chacun. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, et de plusieurs manières: je le garde de moi, je lui demande de me garder de lui, et j'en suis le gardien tant pour le secourir que pour le rappeler à l'ordre voire le punir s'il manque à respecter son semblable. Et bien sûr, si ma liberté commence où commence celle des autres, comme dit ma contrainte commence où commence celle des autres: ce qui assure notre liberté réciproque est notre capacité à nous contraindre également dans les actes qui peuvent restreindre notre liberté. Porter un masque, limiter ses déplacements, sont des contraintes, mais si tous nous nous contraignons, il en résulte plus de sûreté, donc plus de liberté, ou plus exactement un niveau de liberté supérieur à celui qu'on aurait sans ces quelques contraintes, sans ces contraintes collectives prises en charge individuellement, seuls les plus forts, les moins en risque d'être atteints gravement par cette pandémie, verraient leur niveau de liberté individuelle augmenter légèrement mais la baisse de la liberté collective réduirait in fine leur propre liberté. C'est bête à dire mais être plus libre dans une société plus contrainte c'est acquérir un semblant de liberté. Pour préciser, ça n'implique pas que la société dans son entier est libérale, de ce point de vue le cas de la Chine est significatif, une société où la superstructure exerce un fort contrôle et limite les libertés publiques mais elle le fait avec discernement, son contrôle direct est limité et elle délègue aux niveaux intermédiaires et à l'infrastructure l'essentiel du contrôle des individus; de ce fait, à un niveau individuel il y a un niveau de liberté relativement élevé à la condition qu'il ne contredise pas les limites définies par la superstructure; il y a donc une tolérance assez grande aux activités illicites ou illégales pour autant qu'elles ne déstabilisent pas la superstructures: la corruption est acceptable sauf si elle contribue à affaiblir la superstructure, et en certaines circonstances, notamment quand les plus hautes instances décident de faire évoluer le corps de doctrine, corruption et délinquance sont des adjuvants, leur présence permet d'incriminer et d'éliminer sélectivement les membres de la superstructure qui freinent ou combattent les mesures décidées dans les plus hautes instances.
L'épisode “covid-19” est le plus récent dans une longue série. Non une longue série de pandémies, ce sont des événements récurrents et ordinaires, il se passe rarement plus de trois ans entre deux pandémies et rarement plus de dix ans entre deux pandémies assez meurtrières, cette pandémie “covid-19” a un niveau de morbidité équivalent aux pandémies grippales ordinaires les plus délétères et, à ce qu'il en semble, est beaucoup moins meurtrière que les épisodes de grippes les moins ordinaires. Ça ne signifie pas que cette maladie n'est pas inquiétante, de l'autre bord on a probablement affaire ici non pas à une singularité de cette pandémie mais à une singularité de traitement de ce cas: la majeure partie des pandémies sont anciennes et connues quant à leur cause, leur vecteur, de ce fait il n'est pas certain que l'on connaisse toutes les conséquences sur la santé des virus, bactéries et autres vecteurs microbiens voire “macrobiens” – les parasitoses par exemple – précisément parce qu'ils sont connus. Là-dessus, il est possible que certains symptômes réputés être causés par ce virus y sont simplement corrélés, quand l'organisme est touché par un vecteur virulent il est affaibli en peut induire un affaiblissement du système immunitaire favorisant la morbidité d'autres vecteurs – on sait entre autres que dans nombre de cas mortels il s'agit de comorbidité, que le virus affaiblit la personne mais n'est pas la cause directe du décès. La singularité de cette pandémie est qu'un nombre énorme d'équipes et d'institutions se sont mobilisées en un temps très court pour recueillir toutes les informations disponibles et les traiter, ce qui constitue une quantité phénoménale de données en un temps très court; cela donne l'impression d'un cas particulièrement délétère, reste que certaines maladies endémiques sans caractère pandémique – limitées à certains pays, certains continents pour l'essentiel des cas – tuent plus et depuis plus longtemps, cas de la tuberculose par exemple avec 1,2 millions de décès en 2019, et en toute hypothèse il en sera de même pour 2020. Et bien sûr, il y a cette maladie déjà mentionnée, la grippe, qui selon les années a un caractère épidémique ou pandémique, et qui selon les estimations les plus récentes est la cause principale de 300.000 à 650.000 décès, hors pandémies encore plus virulentes (grippe espagnole, grippe de Hong-Kong...). Il se peut que la relative moindre mortalité liée au “covid-19”, environ 250.000 morts en un an, soit liée à la mobilisation mondiale pour en contenir les effets, il se peut aussi que le suivi de cette maladie a permis une meilleure évaluation de son incidence et de sa mortalité que si ça n'avait pas eu lieu – il est d'ailleurs notoire que dans les pays où le suivi fut moindre au début de la pandémie et où la maladie s'est assez fortement diffusée, le nombre de morts attribuées à cette maladie fut extrêmement plus bas.
Cet épisode n'est donc pas très singulier en ce qui concerne les pandémies mais appartient à une autre série, la Grande Menace Mondiale. J'ai passé les soixante ans en 2019, autant dire que ma vie est déjà longue, à quoi s'ajoute la mémoire de mes ascendants et celle d'époques encore plus anciennes mais qui me restent perceptibles. J'en parle ailleurs, la mémoire d'une personne s'étend quatre à six générations avant lui, deux ou trois générations présentes, les humains encore vivants, et deux ou trois générations antérieures, car les générations encore présentes sont porteuses de la mémoire de celles qui étaient vivantes au début de leur vie. Pour exemple, ma grand-mère maternelle est née en 1912, sa propre grand-mère et ses contemporains sont nés vers le milieu du XIX° siècle et par l'entremise de ma grand-mère j'ai reçu la mémoire de ces générations qui ont vécu entre, en gros, 1860 et 1960, donc je suis porteur de la mémoire des personnes qui ont vécu un siècle avant ma naissance. Outre cela, je me suis cultivé en disposant de documents divers, pour l'essentiel de documents écrits, certains illustrés, portant sur ces époques, essais, documentaires, fictions, etc. Ma culture concerne des époques bien plus anciennes et des territoires bien plus distants que ceux auxquels je suis relié par mes ascendants mais ça n'est pas le même type de mémoire même si dans mon cas ça s'en approche, disons que je n'ai pas un rapport aussi large avec ce qui n'est pas un héritage direct. Ceci pour dire que j'ai une idée assurée sur certains processus sociaux qui persistent d'une génération l'autre. L'un d'eux est la Grande Menace Mondiale. Son aspect change parce que le monde change mais le principe est toujours le même: un événement catastrophique menace le monde est s'il advient, celui-ci sera détruit. Tout ça est vrai. Entre ma naissance et ce jour ça s'est produit deux fois et il semble que ça doive se produire de nouveau. Si je vis aussi longtemps que ma grand-mère, morte à 103 ans, ou même un peu moins longtemps, disons, jusqu'à quatre-vingt-quinze ans, j'y assisterai une fois de plus. C'est statistique, le monde est détruit à-peu-près tous les trente ans, avec une incertitude de dix ans par excès ou par défaut. Les moyennes sont ce qu'elles sont, des moyennes, sur le long terme c'est en moyenne tous les trente ans, dans un contexte donné ça peut s'accélérer ou se ralentir. C'est dans ce billet que je cause des cycles? Ah non! Je les mentionne mais n'en parle guère. Ça se trouve dans le billet non encore publié «Addendum III à “Quand les choses doivent changer...”», à ce qu'il semble – en tout cas je mentionne ça dans ce billet-ci. Bon, je vérifie. Ça semble bien le cas, «Addendum III [...]» en traite. Je discute cependant de ça ici mais de manière cursive, cependant ma description des évolutions récentes au cours des deux derniers siècles donne bien l'indication de changements tous les trente ans en moyenne, plus ou moins dix ans pour chaque phase.
Quand on tente de rationaliser le processus il a quelque chose d'apparemment prémédité, une sorte de complot visant à “détruire le monde” qui s'oppose à un autre complot visant à le préserver. Ce n'est pas le cas, je veux dire: ce n'est pas prémédité et ça n'a rien d'un complot ou d'une concurrence entre deux complots, ou deux ensembles de complots, ceux “préservateurs” s'opposant ensemble à ceux “destructeurs”, mais les divers complots de chaque tendance s'opposant entre eux, car ils ne veulent pas détruire ou préserver les mêmes choses ou le faire de la même manière. Remarquez, parmi ces divers groupes certains sont proprement complotistes, pour prendre un cas indiscutable le parti nazi constituait un groupe complotiste qui visait à s'emparer du pouvoir par tous les moyens afin de détruire la société allemande telle qu'elle s'est établie juste après la première guerre mondiale et instaurer à sa place une tout autre société. En général les complots, les vrais, échouent, c'est le contexte très particulier de la société allemande de l'époque qui permit à un projet invraisemblable conçu par une bande de pieds nickelés de parvenir à ses fins, et de mener une politique qui, si elle avait été à son terme, serait arrivée à réaliser son projet, détruire réellement la société, provoquer la mort de toute la population allemande. C'est que, vouloir “restaurer la pureté de la race“ dans un territoire à la croisée des chemins de toutes les populations d'Eurasie ne peut avoir qu'un résultat: la destruction de toute la population. Pour précision, quand je dis que les “vrais” complots échouent, ça ne signifie pas que des groupes complotistes n'arrivent jamais à la première étape, prendre le pouvoir, mais une fois au pouvoir ils laissent tomber le projet supposé et s'adaptent à la situation. Pour le dire mieux, rares sont les groupes complotistes pour qui le projet est la fin, en général c'est le moyen, la fin étant la prise de pouvoir. J'ai mon idée quant à la raison pour laquelle les nazis se sont trouvés dans la sale situation de devoir tenter de réaliser effectivement leur projet mais ça importe peu.
Le processus n'a rien de rationnel donc le rationaliser c'est faire une analyse erronée. Personne, sinon des illuminés et des groupes marginaux, ne souhaite la Fin du Monde, mais qu'on la souhaite ou non elle doit advenir, de ce fait la Grande Menace Mondiale apparaît spontanément. Je vais écrire une chose que j'écris souvent parce qu"elle est vraie, le principe est simple, à quoi j'ajoute: tellement simple qu'il en devient incompréhensible pour beaucoup. Cela parce que la réalité est complexe. En ce qui concerne les structures ça ne pose guère problème à beaucoup que, aussi complexes soient-elles, leur usage soit simple , en ce qui concerne les processus il en va autrement, on a souvent des difficultés à considérer qu'un processus formellement complexe puisse être fonctionnellement simple. Même s'ils les savent formellement complexes, les gens utilisent des instruments comme une automobile, un ordinateur ou un téléphone portable en considérant cet usage simple, pas nécessairement facile ni aisé, mais simple. En revanche, les processus leurs paraissent presque toujours complexes et imprévisibles, même quand ils ne le sont pas particulièrement. Voici comment se constitue la Grande Menace Mondiale.
Le départ de sa constitution est le moment où l'on passe d'une situation où la superstructure domine à celui où l'infrastructure le fait. Souvent, avant de passer d'une situation à l'autre a lieu une catastrophe réelle, guerre civile ou/et internationale, effondrement de l'appareil d'État, dérèglement des institutions, suite à quoi “les choses se rétablissent”. Ce qui est faux: après cette catastrophe la société est différente, elle a du s'adapter au contexte nouveau, la société précédente a été détruite pour laisser place à la société nouvelle, la Fin du Monde a eu lieu. Comme ça ne change pas grand chose au contexte large ni d'ailleurs à la société en tant que structure et que processus pour les membres de cette société ça n'apparaît pas tel, j'évoquais cela pour la France: entre 1870 et 2020 le pays s'est métamorphosé six fois, trois fois au plan de l'infrastructure, trois fois au plan de la superstructure, avec des durées disparates, entre environ 15 et 45 ans, parfois avec une grande violence, parfois plus souplement, et à l'issue de ces transformations la société ne fut plus vraiment la même, mais à la différence d'un organisme une société succède à une autre sans que ses composantes élémentaires disparaissent pour laisser la place à d'autres: en tant qu'ensemble humain la société de 1880 diffère peu de celle de 1860, en tant que régime politique elle n'ont plus rien en commun, en tant que structure il y a peu de variation, en tant que processus il y eut une transition importante mais progressive. Le changement suivant se passant au plan de l'infrastructure est plus visible, d'autant qu'il s'est finalisé à l'occasion d'une guerre longue et destructrice, mais comme ce qui détermine le plus la perception d'une société est la superstructure, celle de 1920 semble moins différente de celle de 1910 que ne le semblent celles de 1875 et de 1865.
Au passage et avant de revenir à la Grande Menace Mondiale, dans ce billet ou dans un des autres en cours de rédaction ou récemment publiés, je mentionne le fait qu'assez souvent des sociétés fusionnent ou se coalisent, ou que des sociétés intègrent d'autres sociétés, et que le plus souvent quand cela se produit ces sociétés ne sont pas synchronisées, telle se dirige vers un changement structurel, telle vers un changement processuel; c'est d'ailleurs un des motifs voire une des causes de ces alliances ou intégrations, l'une a réalisé un changement récent qui lui donne un ascendant sur l'autre qui, soit aspire à un changement similaire, soit n'est pas en situation de refuser cette alliance ou cette intégration. Cette position différente dans leurs évolutions induit un plus ou moins long processus durant lequel les diverses sociétés initiales s'accordent plus ou moins harmonieusement, et plus ou moins durablement: l'exemple de la phase impérialiste de l'évolution de la France montre que cette adaptation mutuelle ne se réalise pas toujours au mieux quand la position des entités concernées est trop défavorable pour l'une des deux, quand Nicolas Sarkozy a voulu promouvoir «le rôle positif de la colonisation», sur un plan objectif il n'avait pas tort mais les rapports entre sociétés sont d'ordre subjectif, si au même Sarkozy on avait proposé de promouvoir “le rôle positif de l'Occupation”, je suppose qu'il aurait poussé les hauts cris et pourtant, d'un point de vue objectif elle eut un rôle positif en facilitant le changement dans la superstructure en France, qui aurait de toute manière eu lieu mais probablement moins vite et moins fort, reste que les rapports entre un occupant et un occupé sont à évaluer subjectivement et sur ce plan ça ne fut pas vraiment positif pour l'occupé, pas vraiment... Pour l'occupant non plus cela dit, mais la différence est que l'occupant a chois de se foutre dans la merde, l'occupé n'a pas choisi qu'on l'y foute. Enfin, ça n'est pas si simple mais du moins, quand une société en position nettement favorable décide d'en intégrer une en position faible, dans l'immédiat ou à terme celle faible en aura du ressentiment. Pour autre exemple, quand les États-Unis ont contribué à la libération de la France, au départ les Français lui en ont su gré mais après quelques années de présence de “troupes d'occupation”, librement acceptées cette fois-là, le mot d'ordre dominant fut «U.S. go home!»: quelque favorable qu'elle puisse être d'un point de vue objectif, nulle société n'apprécie durablement de se voir imposer sa “way of life.”.
Donc, la Grande Menace Mondiale. Comme exposé, durant une phase l'élément dominant est assez stable, celui dominé assez mouvant, ce qui génère une discordance entre superstructure et infrastructure; plus on tend vers le moment de bascule où la position relative des deux éléments s'inversera, plus cette discordance s'accentuera. D'un point de vue objectif encore cette discordance est essentiellement une illusion, processus et structure évoluent en même temps, mais donc les rapports sociaux sont avant tout subjectifs, l'élément formellement stable apparaît de plus en plus en discordance avec celui mouvant, ce qui induit un dérèglement, une dérégulation, et au moment de bascule la société tend à l'anomie (sens 2 – les sociétés ne deviennent pas des genres de mollusques, enfin, n'en deviennent pas toujours...), à l'«absence de normes ou d'organisation stable; [au] désarroi qui en résulte chez l'individu» – l'acception 2, «contestation de la société, soit par refus de toute société, soit par désir de la réformer», décrit la conséquence de la situation que définit l'acception 1: quand on ressent la situation présente comme “sans normes” et “instable” on aspire à un rétablissement de la norme et de la stabilité, soit en revenant à un état stable antérieur, soit en instaurant un nouveau corpus de règles adaptées au contexte nouveau. De fait, la seule possibilité réelle est la seconde, mais restaurer de la stabilité sera perceptivement ressenti comme un “retour à la norme”, ce qui explique pourquoi la transformation d'une société en une nouvelle société n'est pas contradictoire avec le sentiment que celle d'après est “la même“ que celle d'avant – comme disait l'autre, c'est «le changement (réel) dans la continuité (perceptuelle)». Pour les jeunes et les oublieux, «Le changement dans la continuité» fut le slogan de campagne de Georges Pompidou durant la campagne présidentielle de 1969. Au passage, en recherchant une référence sur ce slogan (j'avais eu un doute, slogan de Pompidou en 1969 ou de Giscard en 1974?) je suis tombé sur ce papier publié par CAIRN.INFO, l'éditorial de la revue Savoir/Agir n° 40 de février 2017, «Le changement dans la continuité» par le sociologue Frédéric Lebaron. Un texte très intéressant qui montre que quand on s'intéresse plus aux processus qu'aux structures on peut avoir très vite une lecture consistante de la réalité: dès juin 2017 un analyste sérieux de la société pouvait décrypter les éléments expliquant pourquoi le pouvoir tout nouvellement élu sur une campagne axée sur “le changement” était résolument dans la continuité, poursuivant une orientation politique dans le droit fil de celle mise en place dès 1983 et perpétuée depuis par tous les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur politique affichée. Macron et son équipe n'avaient pas encore vraiment gouverné que l'itinéraire de cet exécutif et de ses godillots du pouvoir législatif était déjà évident. Je découvre cette revue et sens que je vais m'y intéresser. Revenons au sujet, en mentionnant au passage que le slogan de 1969 correspondait à l'inverse de ce dont je discute: le changement perceptuel (ou discursif) dans la continuité réelle (ou effective).
Les sociétés changent, et changeant elles induisent du désarroi, un désarroi perceptif et cognitif. En phase ascendante cette distorsion entre croyance et constat est modérée et dispersée, on constate ou on croit constater non pas un changement mais une multitude de changements, ce qui de nouveau est à la fois vrai et faux: une société ne change pas d'un bloc, elle le fait localement et partiellement, mais chaque petit changement impacte l'ensemble. Comme les changements dans l'infrastructure sont plus faciles à décrire je reprends le cas de l'évolution des moyens de télécommunication: dès 1962, dès le moment où l'on commence à mettre en place des satellites de télécommunication, la diffusion est “digitale”, numérique, électronique; en revanche les terminaux sont “analogiques”, ce qui oblige les prestataires à mettre en place des systèmes qui font de la modulation-démodulation, qui convertissent un signa analogique en signal digital depuis l'émetteur, puis un signal numérique en signal analogique depuis le récepteur. Selon les systèmes émetteurs et récepteurs il peut y en outre y avoir un système secondaire qui prend en charge la conversion pour une diffusion analogique-analogique, c'est entre autres le cas de la radio: les émetteurs et récepteurs initiaux et terminaux émettent et reçoivent un signal “analogique”, d'où la nécessité de relais qui réalisent la conversion. De même pour la téléphonie. Pour la télévision c'est encore plus complexe: émetteur et récepteur convertissent un signal analogique en signal numérique mais ils reconvertissent ce signal numérique en signal analogique, le relais côté émission le convertit de nouveau en signal numérique et le relais côté réception le convertit en signal analogique. Il faudra un demi-siècle environ pour que l'ensemble des réseaux soit “numérique” et que tous les terminaux intègrent un composant qui prenne en charge la conversion. Enfin non, pas tous les terminaux et pas strictement tous les réseaux, côté réception la radio fonctionne toujours selon le schéma des années 1960, du moins la radio hertzienne: les sociétés changent mais elles préservent les sous-ensembles quand ils sont plus efficaces en fonctionnant selon un schéma ancien, le gain d'efficacité est nul et même négatif avec la radio hertzienne numérique, le réseau existant est fonctionnel et de faible coût, l'intégration d'un récepteur radio analogique dans un terminal “numérique” de coût presque nul, ce qui explique pourquoi on peut écouter la radio par voie analogique avec un téléphone portable ou une tablette, donc des terminaux numériques.
Les réseaux de télécommunication sont donc “numériques” depuis le début des années 1960 mais la conversion de l'ensemble des réseaux et des appareils ne fut finalisée que vers 2010 et même un peu plus tard pour certains – l'abandon du téléphone analogique, du “réseau téléphonique commuté”, a commencé en France en 2018 mais ne sera définitif qu'en 2023. Pendant une longue période cette évolution n'eut pas un impact direct important sur les pratiques sociales et sur la partie visible de l'organisation de la superstructure, et dans cette phase la “menace électronique” fut principalement un motif d'arguments pour la fiction, spécialement la science-fiction, la politique-fiction et les récits d'espionnage. Ce n'est que dans la décennie 1990, d'abord avec l'apparition de l'Internet grand public puis avec l'irruption de la téléphonie mobile puis, au cours de la décennie 2000, de la convergence des deux, que cette “menace” devint un sujet de société et très vite une nouvelle Grande Menace Mondiale. En 1990, la principale Grande Menace Mondiale était la Bombe – la “menace nucléaire” –; une décennie plus tard ou guère plus, cette Grande Menace avait pratiquement disparu des radars médiatiques pour être remplacée par la “menace électronique”. Il y a une logique à ça, bien sûr: la précédente bascule eut lieu au plan de l'infrastructure, donc la Grande Menace Mondiale dominante était matérielle; celle actuelle se produit au plan de la superstructure, donc la Grande Menace Mondiale est immatérielle.
Matérielle, immatérielle, manière de dire. Toujours cette question de la perception d'un état des choses. Infrastructure et superstructure son inséparables, si l'une évolue, l'autre évolue, les réseaux de communication sont à la fois matériels et immatériels, ce sont des structures et des instruments de diffusion de l'information. Dans la première phase, celle qui va en gros de 1965 à 1995, l'essentiel du changement est infrastructurel, mais si la structure se modifie le processus doit évoluer pour rester compatible avec la structure; à partir de 1995 l'infrastructure continue d'évoluer mais marginalement, les réseaux sont de plus en plus efficaces dans leur capacité quantitative de diffusion sans que leur structure soit modifiée: en 2000, l'essentiel du trafic vers les récepteurs terminaux numériques a un débit inférieur à 100 kilo-octets, en 2020 l'essentiel de ce trafic a un débit supérieur à 2 méga-octets, en revanche les voies de diffusion sont structurellement les mêmes. Dans la deuxième phase, celle actuelle, la gestion du processus s'est considérablement modifiée: en 2020, un terminal numérique, quel qu'il soit, peut indifféremment transporter de l'image, du texte, de la voix, de l'image animée, etc. Je peux utiliser mon ordinateur en tant que téléphone ou que téléviseur, et puis utiliser mon téléphone pour regarder un film, lire un document PDF, faire des photos et les visualiser, consulter le Web, etc. Et puis utiliser mon téléviseur en tant que téléphone ou qu'ordinateur s'il est connecté à un boîtier ADSL. La communication et l'information organisent les sociétés, donc toute évolution qui les concerne modifie l'organisation des sociétés. Le monde de 2020 n'est plus le monde de 1990, la bascule infrastructurelle a eu lieu il y a trente ans, la bascule superstructurelle doit donc avoir leu maintenant. Mais elle a déjà eu lieu, ne reste qu'à en prendre compte, en prendre conscience. Problème: le moment de bascule est aussi un moment d'anomie, perceptivement “il n'y a plus de règles”, ce qui est inexact bien sûr, les règles qui structurent la société de 2020 sont les mêmes que celles qui structuraient celle de 1960, les mêmes que celles qui structuraient n'importe quelle société de n'importe quel époque, sinon de tout temps au moins depuis trois millénaires, plutôt six ou sept. L'anomie n'est pas l'absence de règles mais l'absence des “clés de lecture” des règles.
J'en reviens à une proposition antérieure: quand des sociétés se coalisent, s'agrègent, s'intègrent, le principal problème est leur coordination. La cause profonde d'une situation anomique est la discordance, que ce soit en 2020, en 1920, en 1720, en 1520, en 1220, que ce soit en Europe, en Asie, dans les Amériques, en Afrique, les règles sociales essentielles sont les mêmes, celles du Décalogue le figurent bien:
«Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude.
Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements.
Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain; car l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.
Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu, t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu: c’est pourquoi l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le jour du repos.
Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne.
Tu ne tueras point.
Tu ne commettras point d’adultère.
Tu ne déroberas point.
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain» (Deutéronome, 6, 6-21).
Je préfère cette version à celle qui figure en Exode, 20, 2-17, parce que les quelques variations me conviennent mieux, notamment le dernier de ces commandements, qui en Exode est:
«Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain».
Ici “la femme de ton prochain” est dans la liste de “ce qui appartient à ton prochain”, dans l'autre on peut lire la femme comme n'appartenant pas à cette liste donc à son mari. En outre le décalogue en Exode est nettement plus cul-bénit.
La majeure partie de ces commandements vaut dans la majorité des sociétés: ne pas tuer son prochain, voire ne pas tuer même son lointain, ne pas voler son prochain et parfois son lointain, ne pas faire de faux-témoignage, honorer ses père et mère, ne pas convoiter ce qui est attaché à son prochain ou auquel il s'attache, ménager sa peine et la peine des êtres dont on a la charge, c'est universel. Reste une question: qui est mon prochain? Dans ce texte ou dans ceux plus récents comme par exemple la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, le “prochain“ désigné se limite à la seule part masculine de la société, dans son extension maximale; en outre dans le Décalogue il ne semble pas certain que les serviteurs soient des “prochains”, et les autres textes de la Torah comme du Nouveau Testament évoquent les esclaves, qui ne sont à coup sûr pas des “prochains”. Même un texte tel que Galates, 3, 28,
«Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ»,
offre la contradiction d'affirmer ce qu'il nie en nommant des classes d'humains: “en Jésus-Christ” il n'y a plus tout ça, mais en dehors? Ce qui a d'ailleurs conduit à une lecture restrictive de ce message et des débats sans fin pour déterminer si telles catégories d'humains sont ou ne sont pas des “prochains”, et des classifications entre “prochains”. Si par exemple, suivant la leçon en Exode, les femmes, les serviteurs et les servantes appartiennent aux hommes, leur statut de “prochain” n'est pas assuré ou n'est pas entier, d'ailleurs dans bien des sociétés se rattachant à la tradition hébraïque (Juifs, chrétiens, musulmans) les femmes et les serviteurs ou au moins les esclaves avaient des droits civils et civiques limités ou nuls, et souvent leur témoignage ne valait que la moitié ou le tiers de celui d'un homme libre, voire n'étaient pas recevables, manière claire de dire qu'ils étaient au plus en partie “prochains”.
C'est la question: qui est mon prochain, qui est mon frère? Répondre oui à la question «Est-tu le gardien de ton frère?» n'a pas la même valeur selon que les femmes, les serviteurs, les esclaves, les étrangers, sont ou ne sont pas des prochains. Dans le Décalogue chacun est “le gardien” de son serviteur et sa servante mais au titre de biens et non de prochain, au même titre que l'âne et le bœuf, de même «l'étranger qui est dans [les] portes» des membres du peuple de Dieu, d'évidence n'est pas un prochain. Aujourd'hui, dans la majeure partie des entités politiques l'ensemble des humains majeurs appartenant à une société entre dans la classe “prochain”, la question des étrangers étant diversement résolue, rares sont ou furent les sociétés où les étrangers sont des prochains, il y eut bien une courte période, de mémoire entre 1789 et 1793, peut-être un peu moins ou un peu plus, où en France tout résident mâle était un “prochain”, une personne éligible au statut de citoyen sans nécessairement devenir un “national”, il y eut même quelques Représentants du peuple non nationaux. Clairement, les constituants étaient beaucoup plus héritiers de la tradition hébraïque telle que revue par celles chrétienne et musulmane que des héritiers des traditions romaine et grecque antiques et avaient une approche universaliste de la notion de prochain, même si assez vite cet universalisme eut une moindre extension, d'abord en excluant les étrangers de la citoyenneté, puis en rétablissant, sous le Consulat, l'esclavage, ce qui excluait une partie des nationaux de la citoyenneté, et en tout cas il n'était pas dans l'optique des révolutionnaires de 1789 ni de leurs successeurs jusqu'en 1944, d'accorder à la moitié des nationaux le droits civiques, ni même l'entièreté des droits civils jusqu'au tournant des décennies 1960-1970: jusqu'à cette période en France une femme mariée était, sous certains aspects, une mineure aux yeux de la loi, subordonnée à son mari pour certains actes civils. Bref, la “prochainitude” n'a pas une réponse aussi simple que celle énoncée dans l'article premier de la DUDH, la Déclaration universelle des droits humains:
«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits».
Le reste de cette déclaration en tient d'ailleurs compte dans certains articles qui font référence aux libertés “nationales” et dans le cadre d'un État, ce qui instaure en creux une droit différencié, “inégal”, selon qu'on soit citoyen d'une entité politique ou non. C'est que, l'universalisme de 1948, certes beaucoup plus étendu que dans d'autres déclaration antérieures de cet ordre dans son article 2, alinéa 1:
«Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».
Mais l'alinéa 2 mentionne déjà les entités politiques et une possible distinction, non plus personnelle mais collective:
«De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté».
Souligné par moi. Si un territoire a une souveraineté limitée, nécessairement ses ressortissants sont “un peu moins égaux” que ceux pleinement souverains. Les humains naissent libres et égaux, mais, suivant la maxime d'Orwell dans La Ferme des animaux qui s'applique à ses héros, «Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres». Ceci appliqué aux humains.
Le contexte de 1948 explique les précautions des rédacteurs de cette déclaration: l'institution dont elle émane n'est pas le gouvernement mondial ou le Parlement mondial mais l'Organisation des Nations unies; parmi ces nations quatre des cinq principales, “plus égales que d'autres“, quatre des membres permanents du Conseil de sécurité, sont des puissances impérialistes (par après la cinquième en deviendra une), toutes quatre possèdent des territoires qui ont une souveraineté limitée et dont les ressortissants ne sont pas tous des citoyens, toutes quatre ont des mandats sur des protectorats, trois d'entre elles ont des colonies, deux d'entre elles ou les quatre (à vérifier) ont des traités inégaux avec des entités censément autonomes mais qui par ces traités ont une souveraineté limitée, des “nations liges”, des obligées. Raison pourquoi il était nécessaire de tenir compte des cas ou un «pays ou territoire [est] sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté», ce qui était le cas d'une large partie, pour le dire, de la plus grande partie des pays et territoires, en cette année 1948: même si le processus commença avant même la fin de la deuxième guerre mondiale, ce n'est qu'après 1948 que le long et tumultueux mouvement de restauration de la souveraineté des territoires “sous tutelle”, d'ailleurs toujours en cours, débuta réellement.
Le principe fondamental de toute société est simple: en négatif absolu, tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne veux pas que ton prochain te fasse, en positif relatif, tu feras à ton voisin ce tu tu souhaites qu'on te fasse pour autant qu'il y consente. Comme on le sait par ces temps, le consentement est une question cruciale, fondamentale, et elle a ses limites. On ne peut agir envers autrui sans son consentement mais ce consentement ne permet de faire à autrui n'importe quel acte, d'abord parce que ce consentement doit être libre et éclairé, ensuite parce que toute société détermine des limites parmi les actes, il en est qu'elle interdit. Sans chercher parmi les actes considérés localement, en ce temps et en ce pays, monstrueux ou infâmes, il est un commandement sans le respect duquel une société ne peut se maintenir, «Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain». Un autre fondement de la société est la confiance, accuser faussement sape ce fondement, l'interdit du faux témoignage protège certes les personnes mais il protège avant tout la société, en alléguant faussement on lèse des personnes mais, plus grave encore, on agit contre la loi, donc contre la société.
Dans une société qu'on dira d'orientation démocratique tout humain qui en est membre ou hôte est un prochain; il y peut y avoir des limitations ordinaires des droits civiques mais sauf circonstances exceptionnelles et sauf pour une catégorie particulière d'humains, ceux réputés mineurs, il ne peut y avoir de limitation des droits civils. Pour les droits civiques, les mineurs par exemple ne disposent pas du droit de vote ni d'élection dans le cadre global de la société, les étrangers aussi ont une restriction partielle ou totale en ce qui concerne les élections; pour les droits civils c'est plus complexe, à la base tout résident réputé majeur en dispose intégralement mais certaines décisions de justice peuvent, pour un temps ou définitivement, suspendre certains droits civils, et parfois certains droits civiques. J'écris, réputé majeur ou mineur, parce que d'une part on ne devient pas majeur d'un coup pour tout, de l'autre certaines personnes ayant atteint l'âge où on devient majeur en toute question peuvent être considérée totalement ou partiellement mineures. Le second cas est évident en son principe sinon en toutes ses applications, le premier ne l'est peut-être pas, même si on le sait abstraitement, on a souvent l'idée fausse que la majorité, en France, est tout uniment acquise à 18 ans, or aux yeux de la loi on devient majeur en certains domaines bien avant ou bien après, je veux dire, on devient pénalement responsable très tôt, selon les cas entre dix et quinze ans, on accède en revanche à la totalité des droits civiques en matière électorale seulement à 24 ans. Puis il y a les humains ni résidents ni ressortissants d'une entité politique: ce ne sont pas des prochains.
La discordance dans un ensemble en cours d'intégration découle en tout premier de cela: chaque entité a son propre bloc de règles et sa propre manière d'identifier un “prochain”, un membre de sa propre société. Tout concourt ou peut concourir à déterminer si une personne est ou non un prochain, depuis l'apparence jusqu'aux plus subtiles comportements. L'intégration se fait diversement, depuis l'assimilation jusqu'à l'agrégation d'ensembles qui chacun garde ses singularités. On a, pour exemples, deux voisins qui ont opté pour un de ces extrêmes: la France où l'on vise à une assimilation poussée, et la Suisse, la Confédération helvétique, ou chaque entité anciennement indépendante conserve à un haut degré ses singularités. Pour le décrire plus précisément, en France l'intégration procède principalement au niveau de la superstructure, chaque nouvelle entité intégrée doit adopter l'ensemble de règles définies par la plus dominante des entités, par la “métropole”, la μητροπολις (mètropolis), la «“ville-mère”, “ville qui a fondé, ou colonisé d'autres villes“», en Suisse il n'y a pas proprement de métropole, une des entités, un des cantons, réunit les institutions fédérales mais n'est donc pas pour cela une métropole, chaque canton conserve une large autonomie, autant que se peut les règles communes, non nécessairement contraignantes (certaines doivent faire l'objet d'un vote cantonal dans chaque entité pour être adoptées), sont adoptées par consensus, il n'y a pas de chef de l'État mais un conseil fédéral de sept membres parmi lesquels est désigné pour un an un président qui a principalement un rôle symbolique, une sorte de “président de séance” et de “chargé de la communication”, bref, une entité politique extrêmement décentralisée où le consensus et le libre consentement sont la règle. Entre ces extrêmes on a tous les cas imaginables, et donc imaginés, le cas le plus courant étant la fédération avec métropole, tendance libérale (large autonomie des entités agrégées) ou tendance impériale (primauté des règles de la métropole sur celles des entités agrégées). Ceci fait que la concordance, l'harmonisation, n'est pas toujours aisée: quand on agrège des entités aux traditions politiques opposées et ni concordantes entre elles, ni toujours concordantes avec le principe fondateur au niveau global, ça requiert de très nombreux ajustements à tous les niveaux et autant dans la structure que dans le processus.
L'Union européenne est assez illustrative de la complexité du processus. Ce sont les «États-Unis d'Europe» auxquels aspiraient déjà certains penseurs du XIX° siècle, notamment Victor Hugo, sinon l'inventeur du moins le propagateur de l'expression, mais contrairement aux États-Unis d'Amérique on part d'une situation où les entités agrégées ont une tradition nationale très ancienne et très disparate. Formellement, tous les États-membres sont ce qu'on a nommé tardivement “État-nation”, factuellement ça n'est pas si évident. Un État-nation, nous dit ce document PDF, se constitue de plusieurs manières:
«L'État préexiste à la nation : Exemple de la France. Dans ce cas, l’État va chercher à développer un sentiment national par l'imposition d'une langue officielle nationale, d'un service national, la création d'une école gratuite et obligatoire, la mise en place de symboles forts de la nation (drapeau, hymne national, emblème, devise).
La nation préexiste à l’État : Exemples de l’unité de l’Allemagne, de l’Italie. Des individus se reconnaissant d'une même nation (d'une “nation ethnique” ou culturelle) manifestent leur volonté de vivre ensemble, en se dotant d'un État.
L’État et la nation sont dissociés : Exemples nombreux.
♦ Une nation peut ne pas être dotée d'un État. ex le nationalisme palestinien, kurde…
♦ Un État peut englober plusieurs nations. Ce fut le cas de l'Empire austro-hongrois, c'est aujourd'hui le cas du Royaume-Uni où Anglais,Gallois, Écossais et Irlandais du Nord sont des nationalités différentes.
♦ Une nation peut englober plusieurs ethnies. C'est aujourd'hui le cas de la Turquie qui contient sur son sol une nation constituée par des ethnies différentes (turcomans, albanais, arabes…).
♦ Un État peut être créé sans véritable base nationale, ce qui est souvent le cas des pays issus des empires coloniaux. C'est par exemple le cas de certains États d'Afrique avec des frontières tracées à la règle (ex Lybie)».
Je ne sais pas qui a copié qui mais ce document et l'article de Wikipédia ont beaucoup en commun. Probable que les deux ont puisé à une même source. Pour une rare fois je préfère citer une autre source que Wikipédia car ce document rend mieux compte de la réalité conceptuelle. De fait, seuls les deux premiers cas définissent proprement ce qu'est un “État-nation”, donc soit une nation qui se constitue en État, soit un État qui constitue une nation. Les autres cas ne ressortent pas de l'un ou l'autre, et à coup sûr celui «Une nation peut ne pas être dotée d'un État» ne ressort pas de ce concept: ce qui détermine l'existence d'un État-nation est l'association des deux. Les concepts d'État et de nation en tant qu'eux-mêmes font que les trois autres cas cités ne rendent pas compte de l'association d'un État et d'une nation dans une entité politique, mais les mots composés sont rarement l'association des notions initiales, soit dès l'origine (une pomme de terre n'est pas une pomme constituée de terre, on associe ici deux proximités, de forme et de localisation, pour nommer un objet qui n'a pas les qualités des deux notions initiales) soit à l'usage (au départ le concept d'État-nation s'applique à des entités européennes existantes en tant que nations ou/et qu'États, et une entité comme l'Autriche-Hongrie appartient à une autre classe, les empires; par la suite le concept est employé pour tout État tendant à l'homogénéité au plan de la superstructure, donc le caractère de “nation” devient facultatif).
Les deux derniers cas ne rendent pas compte d'une “différence de nature” mais d'une différence dans l'épaisseur historique: la Turquie, les entités issues de l'Empire austro-hongrois et les États africains post-coloniaux sont des entités jeunes, elles ont un demi-siècle à un siècle et demi, les entités politiques antérieures de ces territoires furent démantelées, par les colonisateurs en Afrique, suite à la défaite des “Empires centraux” en 1918, et recomposées en nouvelles entités déterminées par le colon ou par le vainqueur. Factuellement, la France et l'Allemagne ne diffèrent pas, pour leur constitution, de ce qui eut lieu et a encore lieu dans les anciennes colonies ou dans les Empires démantelés, la France métropolitaine est “tracée à la règle”, certes une règle molle qui dessine des contours sinueux, reste qu'au départ ce territoire est peuplé d'une grande diversité de “nations” qui n'ont pas la même langue, la même culture, les mêmes institutions politiques, et dont les frontières sont déterminées par des conquêtes successives de la métropole qui s'annexe ces territoires. Ce n'est que tardivement, à la fin de l'Ancien Régime et surtout après, qu'il accède à une certaine unité superstructurelle, que la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse» (DDHC, article 6), verticalement (abolition des privilèges associés au “rang social”) et horizontalement (un seul corps de lois pour tout le territoire), plus tardivement que l'unité infrastructurelle est atteinte, et ce n'est qu'après le milieu du XX° siècle que les deux convergent. Dans les années 1960, parmi les personnes de plus de cinquante ans vivant dans des parties du territoire le plus tardivement intégrées dans l'infrastructure globale, notamment les zones de montagne, on trouvait une proportion non négligeable de personnes ne parlant pas français, et pour qui, souvent, le monde qu'elles pouvaient se représenter n'allait pas au-delà de leurs montagnes. Ça n'en faisait pas des imbéciles ou des attardés, mais du moins leur perception de ce qu'était un prochain avait une bien moindre extension que celle admise au niveau global. Cela dit, an niveau global beaucoup de personnes ne percevaient pas vraiment ces “attardés”, ces exclus du système global, comme des prochains... Pour le redire, communication et information constituent la société: le désir d'unification de la France est ancien, il remonte de manière certaine au milieu du XV° siècle, moment où l'on commence à basculer d'un système décentralisé, la “féodalité”, à un système centralisé, la “monarchie absolue”, mais il faudra cinq siècles et bien des péripéties pour parvenir à un état de concordance entre infrastructure et superstructure à même de réaliser pleinement cet ancien projet.
Pour l'Allemagne c'est plus complexe, et pour l'essentiel ça alla dans l'autre sens. Comme le mentionne la page citée, «des individus se reconnaissent d'une même nation [et] manifestent leur volonté de vivre ensemble, en se dotant d'un État». Sauf que ce n'est pas si simple: au moment où la France commence son long chemin d'unification “par le haut”, les territoires qui constitueront l'Allemagne ne se perçoivent nullement comme “une nation”, ils ont une certaine unité structurelle mais de type impérial: on ne requiert pas des entités agrégées de s'unifier, de faire une seule nation, au sein du Saint-Empire romain germanique, on parle presque toutes les langues d'Europe centrale et occidentale, on a des coutumes et des corpus de règles différents, souvent divergents, parfois contradictoires, et une large autonomie au niveau des entités agrégées; si pour l'essentiel les territoires de la future Allemagne ont des dialectes germaniques ils sont assez divers et entre ceux du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, l'intercompréhension n'est pas toujours là. Ce n'est qu'à la toute fin du XV° siècle et au long du XVI° qu'une certaine unité linguistique et culturelle se produit au niveau de la superstructure, qui ne touche pas nécessairement les plus hautes élites – la langue commune des élites dirigeantes en Allemagne comme ailleurs en Europe était à l'époque plutôt le français, qui avait commencé sa normalisation dans la superstructure bien plus tôt, et gardera ce statut de “langue des élites” jusqu'au début du XIX° siècle, et plus longtemps encore dans certaines entités, et la langue commune des élites de second rang était plutôt le latin. C'est que, cette unification part surtout de l'infrastructure, et accompagne la diffusion de l'imprimerie, donc de la littération. Le “sentiment national” est autant une construction dans les territoires de la future Allemagne que ce le fut en France, et ne s'établit effectivement qu'au début du XIX° siècle, la brève mais rapide et forte construction du Premier Empire napoléonien ayant été un puissant moteur dans l'établissement d'un “sentiment national” en Europe: on n'est jamais autant uni que face à un adversaire commun. L'Allemagne à venir de 1815 est encore en cours d'unification et ça ne s'achèvera que vers 1870, avec les victoires successives de l'Empire prussien en construction, d'abord contre l'Empire “frère“ autrichien en 1866, ensuite contre l'encombrant voisin français, en 1871. De fait, les guerres sont un moyen efficace pour susciter ou renforce le “sentiment national”. Il en va de même, avec un demi-siècle de décalage, en Italie: ce n'est que vers 1865 que l'aspiration déjà ancienne d'un “Risorgimento” commence concrètement, après une phase informelle puis formelle mais peu effective entre 1849 et 1861 pour l'essentiel., mais c'est encore à la faveur d'une guerre, celle de 1914-1918, que commence à s'établir un véritable “sentiment national” que suit une progressive unification infrastructurelle et superstructurelle. Qui en cette année 2020 n'est pas complètement achevée, cela dit.
Ceci pour illustrer qu'en Europe au tournant des XVIII° et XIX° siècles il en va comme en Afrique à partir du mouvement de décolonisation et même un peu avant: les États sont créés sans véritable base nationale et tantôt la superstructure suscite cette “nation”, tantôt l'infrastructure la construit, en général les deux y concourent, parfois en convergence, parfois en divergence. De fait, en Afrique post-coloniale, sinon toujours du moins souvent les États furent créés sans véritable base nationale, mais de fait encore, en ce début de XXI° siècle beaucoup d'entre eux se sont constitués en nation dans le cadre de ces États, tantôt sur une base multiethnique, tantôt (plus rarement) en élaborant une nation unifiée, “monoethnique”.
Toujours est-il, la forme État-nation, formellement celle de beaucoup d'entités politiques, s'est rarement réalisée. La forme la plus courante est la réunion d'entités politiques dans une entité plus large, et même pour les États-nations, si on considère que la forme d'une entité politique est déterminée par celle de l'entité de plus haut niveau, beaucoup sont intégrés à une entité qui parfois est elle-même partie d'une entité. Une société est une matriochka, un objet fractal, un emboîtement de sociétés. Il m'est arrivé de l'écrire, la moindre société doit comporter au moins trois membres, la majeure toute l'humanité; une société de six membres est donc susceptible de former l'agrégation de deux sociétés ou la combinaison de jusqu'à douze sociétés, une société de sept milliards d'humain peut à la fois composée cette société unique et un nombre fini mais énorme de combinaisons de sociétés de trois membres et plus. Les entreprises commerciales sont nommées “sociétés” parce que ce sont des sociétés, et certaines d'entre elles savent avec art tirer parti de cette possibilité de combinaison pour monter des opérations formellement légales qui ont tout de l'escroquerie. Un jour je suis tombé par hasard sur une profession assez discrète, on ne peut même pas dire proprement ue c'est une profession même si l'on doit disposer d'un certificat professionnel pour l'exercer, celle de liquidateur judiciaire. Dénotativement ça désigne le fait de convertir les avoirs d'une entreprise en liquidités, de la “liquéfier”, mais on peut aussi lire le nom de manière triviale, il s'agit de “liquider” une société, de la faire mourir. Un liquidateur judiciaire est
«nommé [...] en remplacement des précédents dirigeants [...] des entreprises placées en redressement judiciaire [qui] ne parviennent pas à être redressées. [Le] liquidateur judiciaire [...] doit soit vendre tout ou partie de la société, soit “réaliser l'actif”, c'est-à-dire récupérer toutes les sommes qu'il pourra retirer de l'entreprise, afin de payer les créanciers».
La logique voudrait donc que ce mandat soit bref, que l'entreprise soit entièrement liquéfiée / liquidée ou que, en réalisant une partie des actifs ou en vendant une partie de l'entreprise (ce qui est aussi une manière de réaliser des actifs), une fois son travail fait le liquidateur doit rendre son mandat. Et non, pas du tout: un liquidateur judiciaire peut conserver son mandat pendant parfois plusieurs décennies. Ce qui démontre de fait que l'entreprise est redressée et profitable, donc le mandat du liquidateur caduc. Le fait n'est pas le droit, et les liquidateurs ont une particularité, si tous ne le sont pas dans leur majorité ce sont de comptables, plus précisément des experts-comptables, et à ce titre des “auditeurs”, des personnes qui procèdent à des “audits”, entre autres des entreprises en cours de redressement ou de liquidation.
On a Dupont, Martin, Durand, Moreau, Dupuis et Martin, un deuxième Martin (le nom le plus courant en France), qu'on nommera par après Martineau. Quoique, je n'ai pas vraiment besoin de les nommer par après. Les six sont des experts-comptables, et les six ont la capacité de liquidateur. Comme on ne peut pas être auditeur d'une société dont on est le liquidateur, le principe assez évident déjà pour vous, je suppose, est de créer autant de cabinets d'experts-comptables que de larrons, chacun des six dirige l'un et intègre comme associés deux des cinq autres; les trois responsables de l'une auditent les entreprises en liquidation tenues par les trois autres. Par ailleurs ils sont sociétaires d'entreprises commerciales en relation d'affaires avec les entreprises en cours de liquidation, et captent par l'entremise de ces entreprises commerciales l'essentiel des profits, ce qui laisse les entreprises à liquider dans une situation financière précaire, à la limite du dépôt de bilan. Soit dit en passant, il arrive assez souvent que les dirigeants évincés des entreprises en cours de liquidation soient des associés dans les entreprises intermédiaires captatrices de leurs revenus.
Dans une page de commentaires récente j'en discutais, et dans un message privé en lien avec cette discussion je mentionnais un de mes principes sur le sujet, celui du “complotisme” et des “complots”, les complots je n'y crois pas mais je les constate. Les liquidateurs judiciaires ne sont ps des complotistes mais en tant que groupe constituent une société dont le projet diverge de la société globale, ici la France, mais ailleurs et sous d'autres noms on trouvera des cas similaires. Leur profession fait partie des professions protégées ou professions réglementées, l'accès n'y est pas libre et la détention d'un titre professionnel ne suffit pas pour l'exercer, il faut auparavant être approuvé par les membres actuels de la profession. C'est moins formel que pour celles qui ont un “ordre” mais le principe est le même: ne peut être et demeurer liquidateur qu'une personne admise par ses pairs. Si les liquidateurs judiciaires ne forment pas proprement un complot, un «dessein secret, concerté entre plusieurs personnes, avec l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution», ou dans une acception plus neutre, un «projet quelconque concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes», mais dans leur souci de protéger une profession tirant part de certaines failles de la législation pour obtenir un profit indu mais “légal” ils en arrivent à des pratiques convergentes et consensuelles qui “forment complot”. Soit dit en passant, le souci du gouvernement actuel et des deux précédents de libérer l'accès aux professions réglementées ou du moins à certaines d'entre elles me semble un souci honorable, sauf qu'ils s'y sont pris de la mauvaise manière, ouvrir l'accès à une profession fermée élargit le nombre d'accédants mais n'en fait pas une profession ouverte, donc procéder ainsi n'est pas en capacité de réduire les problèmes que posent à la société la fermeture de ces sociétés, les nouveaux accédants ont toute chance de reconduire les pratiques de ceux en place puisque si l'accès est plus large, la réglementation de la pratique reste la même...
Il est temps de conclure. La situation actuelle? La superstructure actuelle est consciente en tant que groupe que les choses doivent changer mais en tant qu'ensemble d'individus se révèle incapable de trouver une solution qui mette radicalement en question l'organisation de la superstructure, en discours elle prône “la réforme”, en pratique elle se contente de modifier un peu le processus interne sans remettre en cause la structure interne de la superstructure et au contraire en la renforçant. On a échoué? Alors on va corriger en faisant la même chose mais en plus gros.



