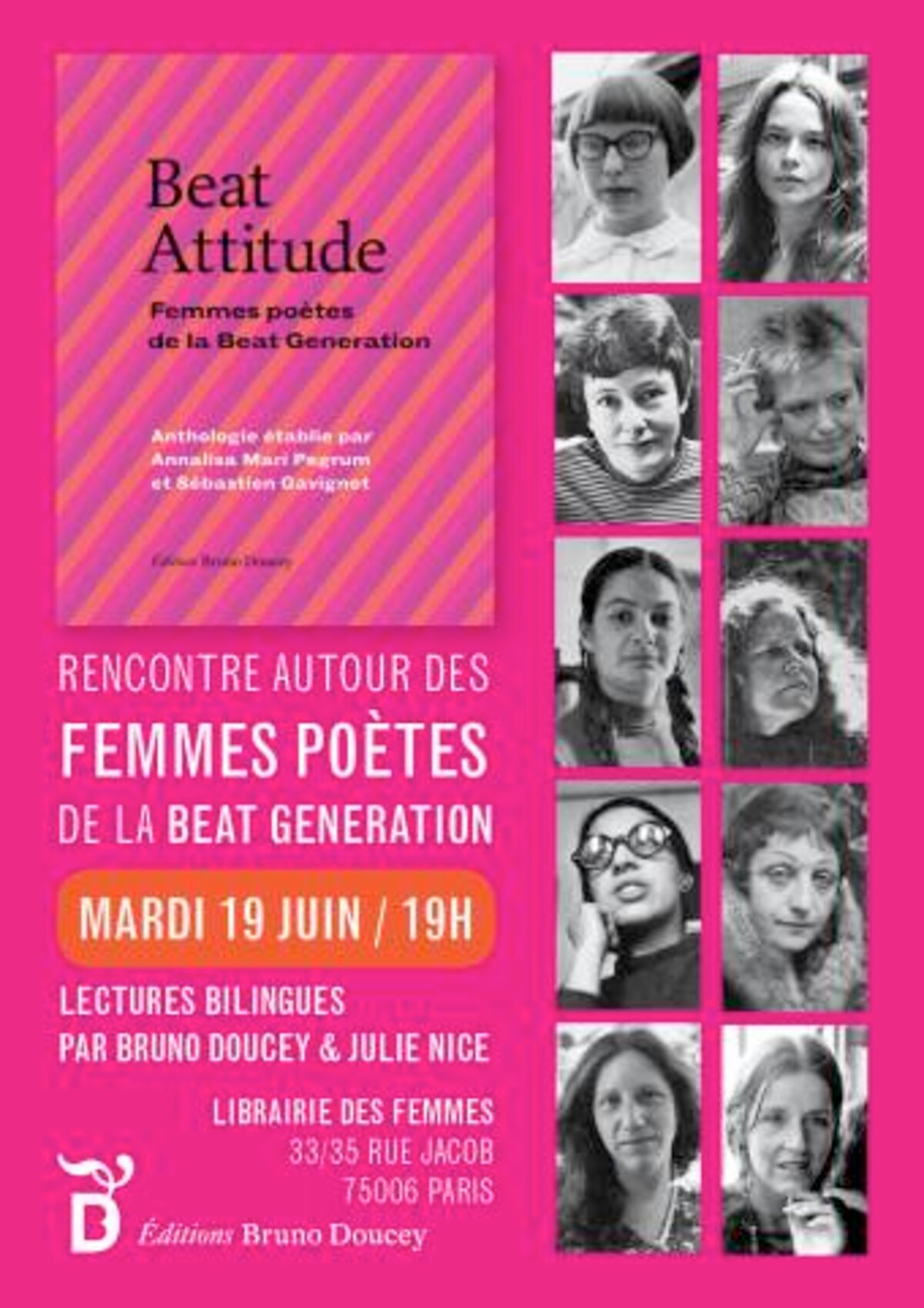
Elles ont à n’en pas douter cette « Beat Attitude » que leur prêtent Annalisa Marí Pegrum et Sébastien Gavignet, les auteurs de l’anthologie qui les réunit. Ces « femmes poètes de la Beat Generation », dont on découvre pour beaucoup les poèmes dans cet ouvrage, n’ont qu’un comportement – « qui est en soi une solution », affirme Hettie Jones –, dans la vie privée comme dans la vie publique, devant le « dilemme » que leur pose la société qui les entoure, et surtout la place qui leur est dévolue dans cette société. C’est qu’elles ont fait partie, pour quelques-unes dès les années 1950, de cette mouvance d’artistes de la Beat Generation qui allait tant influencer les modes de vie.
À cet égard, leur révolte en tant que femmes faisant valoir leurs droits, et les angoisses personnelles, quotidiennes qu’elles relatent, sont d’autant plus saisissantes qu’à l’exception de Denise Levertov, qui fait office de figure tutélaire, toutes étaient du premier cercle de la Beat Generation : Elise Cowen, Anne Waldman et Lenore Kandel étaient intimement liées à Allen Ginsberg, Hettie Jones et Diane di Prima, à LeRoi Jones (devenu Amiri Baraka), Joanne Kyger, à Gary Snyder…
Ce poème (« Chanson pour Baby-O, à naître ») de Diane di Prima, quittant New York et les ennuis avec la police pour San Francisco et la revue Beatitude de Bob Kaufman, les dépeint assez bien :
Mon ange
quand tu sortiras
tu trouveras
une poète ici
pas tout à fait le choix idéal
Je ne peux pas te promettre
que tu n’auras jamais faim
ou que tu ne seras jamais triste
sur ce globe
détruit
brûlé
mais je peux t’apprendre
mon chéri
à aimer assez
pour te briser le cœur
à jamais
Les autres « femmes poètes » présentes sont Janine Pommy Vega, Mary Norbert Körle – qui a été particulièrement soutenue par Denise Levertov – et ruth weiss (elle écrit ses prénom et nom sans majuscule initiale), dont les poèmes sont sans doute les plus étonnants. Comme ici ces vers stupéfiants en forme d’happening existentiel, cet « événement » qui traduit bien la disposition de la Beat Generation devant la vie, et devant la poésie…
tout est vrai
comme tu l’es
qui que tu sois
au moment de conter
celui qui raconte
est le dernier à y croire
Comme si à une présence révélée ex nihilo ne pouvait coïncider que la possibilité d’une histoire ayant pour seul espoir sa reprise par un autre, faisant fi de toute autre trace, et aussi de trouvailles dans l’art qui excèdent le simple fait d’en passer par des mots que l’on instrumentalise. On voit ici se dessiner les principales objections qui seront faites à la Beat Generation, aux États-Unis mêmes.
Mais toutes ces femmes poètes doivent être lues pour elles-mêmes, pour leurs poèmes-messages, leurs lettres-poèmes qui témoignent de l’étendue, voire de la profondeur, comme a pu l’écrire Yves Buin dans sa préface à l’édition in Quarto/Gallimard de Jack Kerouac, de la secousse que fut la Beat Generation dans la « géologie » sociale des États-Unis.
Remettant radicalement en cause la place assignée aux femmes, elles font dans tous les cas le lien avec la culture de l’engagement d’un Amiri Baraka pour les Noirs américains, des féministes et des mouvements pacifistes et antinucléaires des années 1960. C’est cette implication qui justifie la présence à leurs côtés dans cette anthologie d’une poète importante comme Denise Levertov, qui a eu le souci de faire s’épanouir le poème en dehors de tous cercles élitaires.

Agrandissement : Illustration 2

Si Denise Levertov en particulier échappe à quelque assignation poétique que ce soit, « beat » ou autre, elle le doit d’abord au chemin d’exil qui fut le sien. Elle est à l’instar de Mina Loy une Américaine de construction quittant l’Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Son héritage n’en est pas moins fécond : la notion d’inscape (paysage intérieur) de Gerard Manley Hopkins et celle de « l’ouvert » rilkéen ne cesseront de hanter sa recherche d’une expression trouvant à animer, dans l’écriture, son incroyable capacité de perception des choses, du monde (ce qu’elle nommera dans ses essais la « forme organique » du poème).
Poète étatsunienne, Denise Levertov le devient par l’intense relation qu’elle a entretenue avec William Carlos Williams, dont l’œuvre (les poèmes courts surtout) la marque profondément, tout autant que l’émeut son écoute. Elle suscite une égale reconnaissance de la part des poètes objectivistes, George Oppen notamment, dont les années 1960 sonnent en quelque sorte le retour créatif.
C’est dans ces années que « la meilleure femme poète depuis H.D. et Marianne Moore » (dixit Serge Fauchereau, dans sa pionnière Lecture de la poésie américaine) publie par exemple ce poème, intitulé « The Crack » (La fêlure), et traduit par Serge Fauchereau dans l’ouvrage susmentionné :
Tandis que la neige tombait nonchalamment
flottant indifférente en tourbillons
d’air sur le toit, encerclant
les mitres noires des cheminées,
une nuit de printemps pénétra
en moi à travers la fenêtre bien close,
portant
une lâche chemise russe de
soie légère.
C’est pour cela
qu’il reste cette ligne
de biais, cette fêlure, le carreau
jamais remplacé.
Son attention au vers est maximale : « Je crois que le contenu détermine la forme, et cependant ce contenu ne se découvre qu’en forme », insiste-t-elle. Aussi Denise Levertov sera-t-elle très proche des poètes de la Black Mountain Review et notamment de Robert Duncan qui enseigna au Black Mountain College, ce lieu d’expérience artistique (selon John Dewey) et d’enseignement unique aux États-Unis, qui tint ses portes ouvertes dès 1933 jusqu’en 1956, à Asheville, en Caroline du Nord.
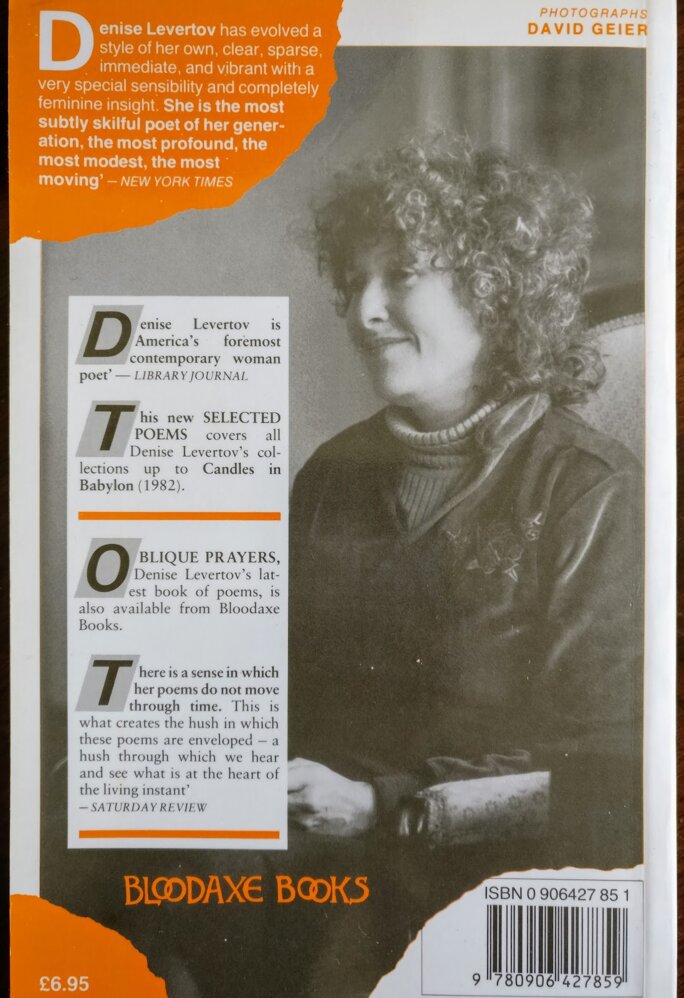
Agrandissement : Illustration 3
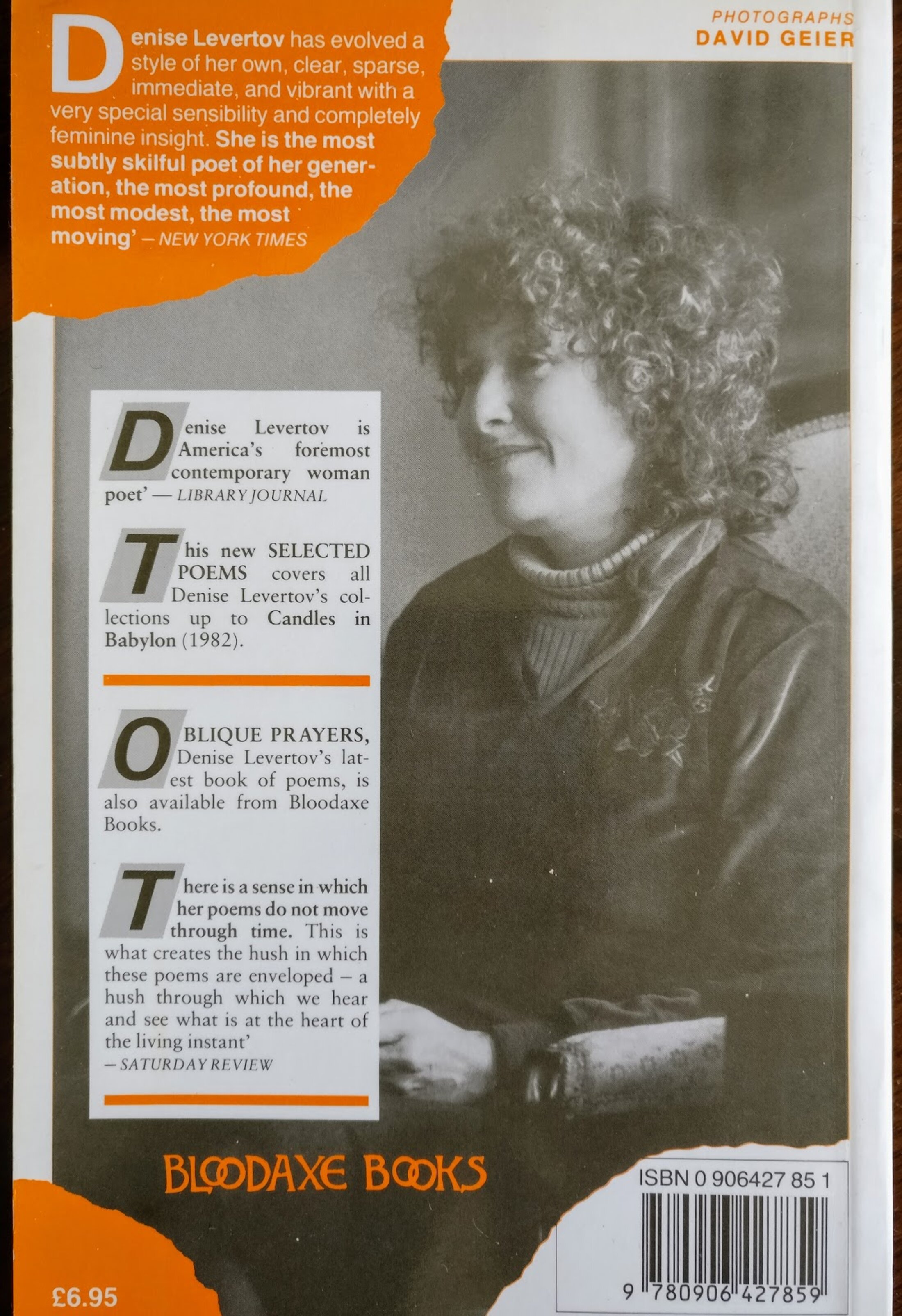
C’est l’autre aventure poétique étatsunienne majeure à laquelle se rattache Denise Levertov, à travers les œuvres de Charles Olson, Robert Creeley. Elle sera quasiment de tous les numéros de la revue du collège entre 1954 et 1957. Mais elle est à ce point passagère, presque « clandestine », de la poésie étatsusienne de son temps, en dépit de sa renommée, qu’elle ne figure pourtant pas dans le numéro que la Black Mountain Review dédie à la « Beat Generation ». Alors que dans le même temps, elle est omniprésente dans les revues « beat » de l’époque.
Denise Levertov a écrit une masse considérable de poèmes. On pourrait citer par exemple celui-ci du début des années 1960. Il s’intitule « Une fenêtre » et est traduit par le poète Jean Joubert :
Parmi cent fenêtres qui luisent
faiblement sur la haute façade
d’un immeuble anonyme, plus vaste qu’un palais
une seule brûle
depuis des années, chaque nuit
comme si la pièce à l’intérieur était en feu.
Quelque défaut du verre
se combine avec la distance précise et
ma vue imparfaite pour provoquer
cette illusion ; je le sais –
et pourtant je suis prête à croire que peut-être
quelques existences
frémissent et s’embrasent, quatre rues plus loin
au-delà des toits qu’obscurcissent la suie
et le soir,
avec plus d’intensité que les autres,
derrière les autres fenêtres,
et que l’éclat particulier de ces vies
se manifeste par des flammes séraphiques ou démoniaques
que seuls peuvent voir des yeux faibles et lointains.
Sa grande affaire, objet de ruptures avec ses amis et soutiens « littéraires » les plus proches, fut son engagement contre la guerre du Vietnam. Elle s’est toujours défendue d’être une « protestataire professionnelle », asservissant son langage au regard de quelque cause. Il faut lire son magnifique poème « What were they Like ? » (« Comment étaient-ils ? ») paru dans l’hebdomadaire The Nation, où elle fait place aux « gens du Vietnam » dans un jeu de questions et réponses (« Quand les bombes écrasèrent les miroirs/il n’y eut guère de temps que pour crier »).
Dans un de ses essais, Denise Levertov a eu ces mots qui définissent parfaitement son « attitude » de poète : « Dans la mesure où elle crée des structures autonomes qui sont imprégnées d’existence et qui intensifient l’existence de ceux qui les perçoivent, la poésie, dans sa manifestation comme dans son essence, est intrinsèquement affirmative. »
Se faisant par là l’alliée objective, si précieuse, des « femmes poètes de la Beat Generation »…
*
Beat Attitude –Femmes poètes de la Beat Generation, anthologie établie par Annalisa Marí Pegrum et Sébastien Gavignet, édition bilingue (langues américaine et française), ouvrage paru aux éditions Bruno Doucey, 206 p., 20 euros.
Figurent dans cette anthologie par ordre d’apparition : Denise Levertov / Lenore Kandel / Elise Cowen / Diane di Prima / Hettie Jones / Joanne Kyger / ruth weiss / Janine Pommy Vega / Mary Norbert Körte / Anne Waldman.
L’éditeur convie à une lecture-rencontre autour de ces « femmes poètes de la Beat Generation » à la librairie des Femmes, mardi 19 juin, à 19 heures.
Denise Levertov a été publiée dans de nombreuses revues en France (Action poétique, In’hui…) ; deux livres d’elle notamment, un de poèmes, Le jour commence, et un recueil d’essais, La Forme organique, ont été réédités par L’Atelier des Brisants en 2002 (traduits par Jean Joubert). Elle figure aussi par exemple dans l’importante édition bilingue de Vingt Poètes américains parue en 1980 aux éditions Gallimard (pour sa part, dans des traductions de Claude Roy). Concernant son poème engagé sur la guerre du Vietnam, je me réfère à l’ouvrage établi par Walter Lowenfels, 89 Poètes américains contre la guerre au Vietnam, Éditions Albin Michel (1967).
Voir aussi le remarquable ouvrage consacré au Black Mountain College – Art, démocratie, utopie (dir. Jean-Pierre Cometti et Éric Giraud), paru aux Presses universitaires de Rennes en 2014.



