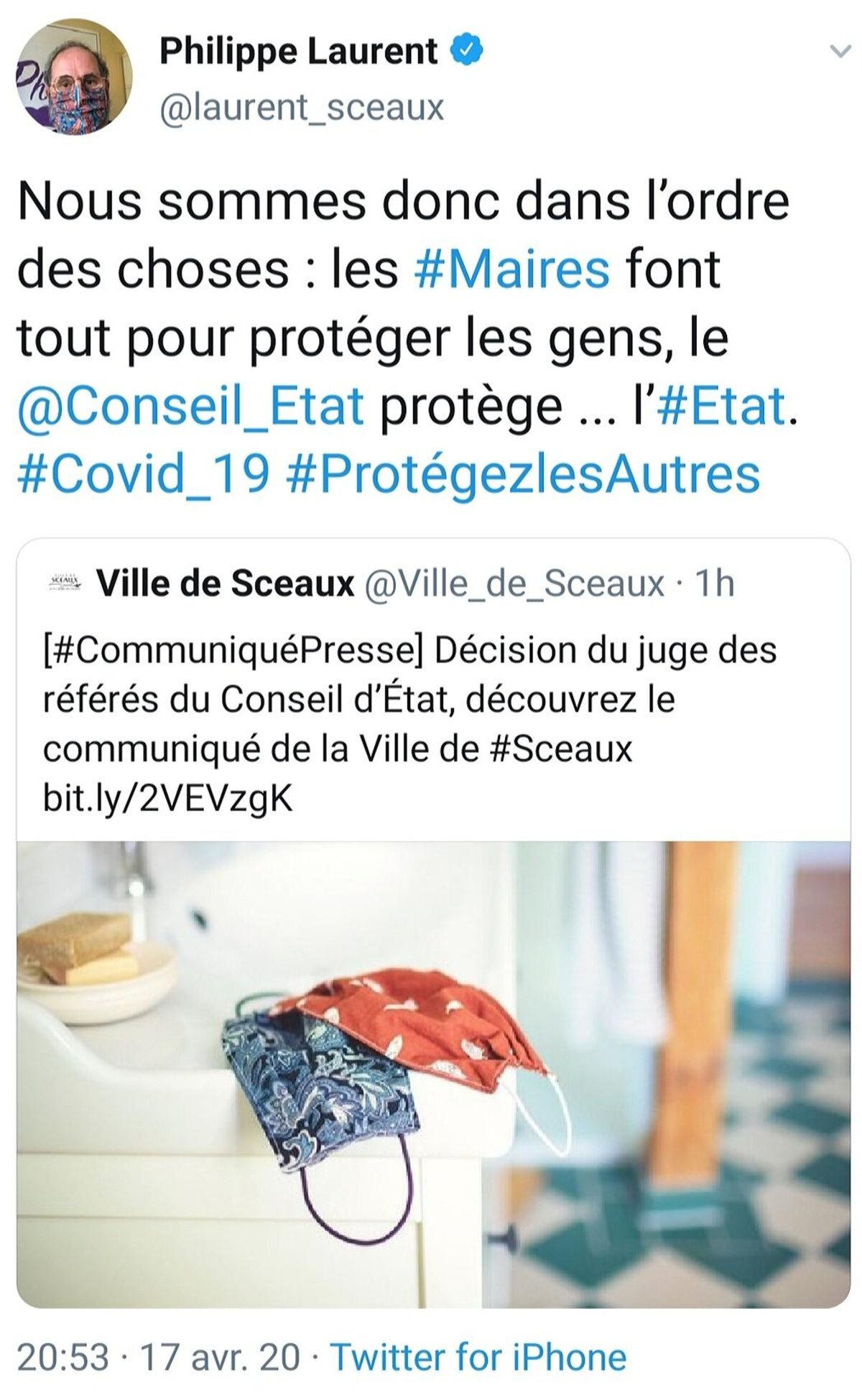
Agrandissement : Illustration 1
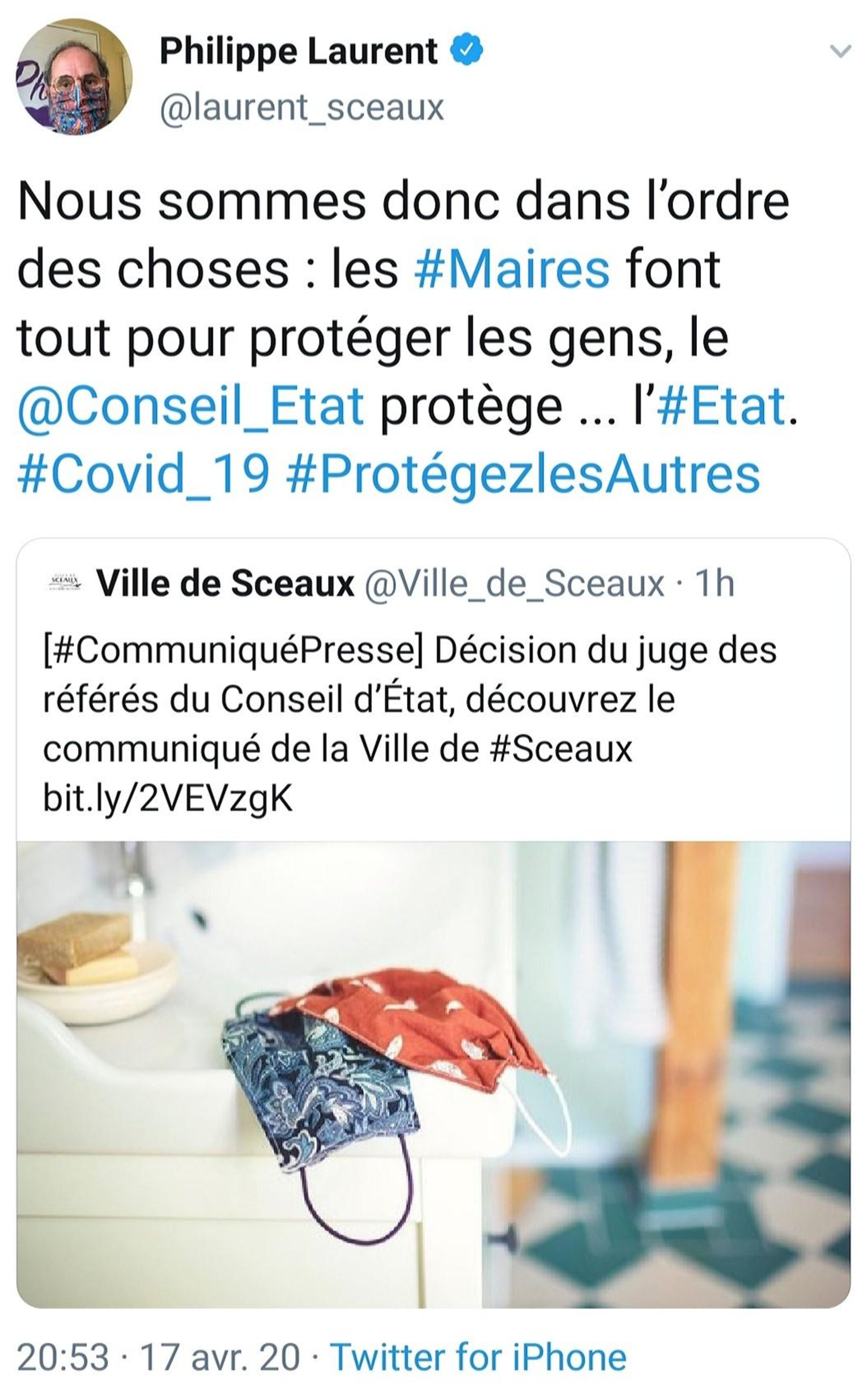
En obligeant, par son arrêté très médiatisé du 6 avril 2020, toute personne circulant dans sa commune à se masquer bouche et nez, le maire de Sceaux a eu sanitairement raison, mais juridiquement tort.
Sur le terrain sanitaire en effet, il a suivi les recommandations de l’Académie nationale de médecine telles qu’établies par un communiqué du 2 avril 2020 : « en France, le port généralisé d’un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur ».
Ces recommandations sont cependant diamétralement opposées au sens des politiques publiques énoncé par le président de la République dans Le Point du 15 avril 2020 par lesquelles il a « refusé aujourd'hui de recommander le port du masque pour tous » (v. déjà son allocution télévisée du 13 avril 2020 annonçant que ce port ne sera pas rendu universellement obligatoire en déconfinement : « pour les professions les plus exposées et pour certaines situations, comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique »), ce dont il faudra évidemment se souvenir dans quelques semaines. Certes, le président de la République navigue à vue en la matière, et comme il l'a fait pour les personnes âgées à l’égard desquelles il avait annoncé une prolongation discriminatoire du confinement dans son discours du 13 avril (« Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps ») avant de se raviser quatre jours plus tard en se bornant désormais à en appeler « à la responsabilité individuelle », il est susceptible d’imposer demain le port généralisé du masque, s’ils sont enfin largement disponibles. Mais dans l’attente de ce changement de « stratégie » de lutte contre le coronavirus, la réglementation nationale relative à l’état d’urgence sanitaire n’oblige pas au port du masque.

Agrandissement : Illustration 2

Sur le terrain juridique, il ne faisait aucun doute que l’arrêté, pris sur le fondement de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, était manifestement irrégulier : en l’absence de circonstances particulières à cette belle commune des Hauts-de-Seine de 19 000 habitants dont l’espace public peut parfaitement être organisé pour répondre aux règles nationales de « distanciation sociale » en vigueur depuis le 17 mars 2020 ainsi qu'en témoigne la photo ci-contre prise le 18 avril en fin d'après-midi devant l'entrée du supermarché du centre-ville, son maire, en sa qualité d'autorité de police administrative locale, ne peut adopter une mesure restrictive des libertés qui n’est pas nécessaire au regard de spécificités propres à la commune.
Or, non seulement le maire de Sceaux ne se prévalait d’aucune circonstance communale dans la motivation de son arrêté du 6 avril, mais, de fait, il existe à l’égard de la lutte contre la pandémie une parfaite identité de situation entre cette ville et – notamment – celles qui lui sont limitrophes. En pratique, durant les quelques heures pendant lesquelles l’arrêté a été en vigueur (l’interdiction prenait effet le 8 avril mais son exécution a été suspendue dès le 9 avril par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise), chacun devait avoir une protection nasale et buccale dans l’espace public scéen sauf à risquer une contravention de 38 euros, mais pouvait la retirer aussitôt après avoir franchi les limites de la commune de Sceaux.
Le sort juridique de l’arrêté municipal scéen a en réalité été scellé à l’occasion de la déclaration présidentielle du 13 avril, où M. Macron s’est exclamé, à propos du florilège d’arrêtés municipaux plus ou moins loufoques adoptés par certains maires au nom de la lutte contre la pandémie (Camille Polloni, « Confinement: des maires et des préfets plus royalistes que le roi », Mediapart, 13 avril 2020) : « je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, d’aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-feux ont été décidés, là où c’était utile. Mais il ne faut pas rajouter d’interdit dans la journée pour notre vie quotidienne ». Déjà, le 9 avril, à l’occasion de son audition devant la mission de l’Assemblée nationale sur le coronavirus, le ministre de l’Intérieur faisait savoir qu’il avait demandé aux préfets de « prendre langue avec ces maires pour qu’ils retirent leurs arrêtés pendant toute la période du confinement », car ils ne seraient « pas cohérents par rapport à l’exigence qu’implique le confinement parce que cela peut laisser penser qu’on peut sortir si on a un masque ».

Agrandissement : Illustration 3
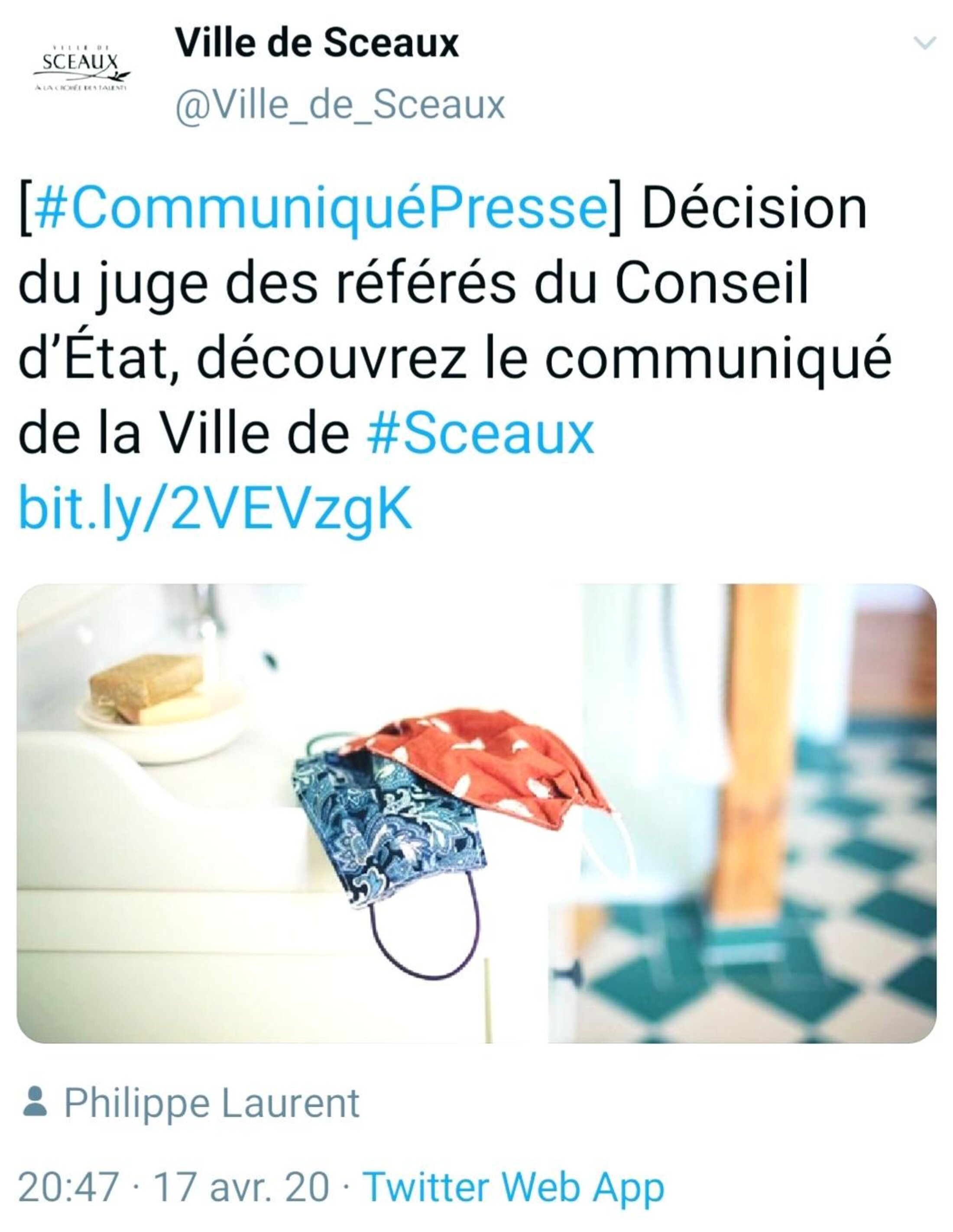
On va leur voir, par son ordonnance Commune de Sceaux du 17 avril 2020 (n° 440057), le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a donné à ce sentiment ministériel la force d’une décision de justice.
Ce « copié-collé » n’allait pourtant pas de soi.
Il faut en effet se souvenir qu’il y a à peine trois semaines, le même juge des référés du Conseil d’Etat, par sa première ordonnance relative à la pandémie de coronavirus, avait jugé, appliquant une jurisprudence constante relative à l’imbrication entre les pouvoirs de police administrative dite générale (sans objet matériel pré-déterminé) des autorités nationales et locales, que « les représentants de l’Etat dans les départements comme les maires en vertu de leur pouvoir de police générale ont l’obligation d’adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient » (CE, réf., 22 mars 2020, Syndicat Jeunes médecins, n° 439674 ; et déjà dans le même sens, à propos du pouvoir réglementaire propre du Premier ministre en matière de circulation automobile : CE 15 octobre 2015, Automobile club des avocats, n° 375027, considérant 2 ; CE 24 juillet 2019, Ligue de défense des conducteurs, n° 421603, considérant 3).
Mais dès le lendemain de cette ordonnance, était publiée la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui crée un « état d’urgence sanitaire » avec des pouvoirs de police administrative attribués à ces autorités nationales que sont le Premier ministre (article L. 3131-15 du Code de la santé publique : « Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique... ») et le ministre de la Santé, chaque préfet étant habilité à en accroître la rigueur en fonction d'éventuelles particularités départementales (article L. 3131-17 du Code de la santé publique, tel que mis en oeuvre par le III de l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020).
Dans son ordonnance Commune de Sceaux, le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que l’état d’urgence sanitaire constitue une police administrative dite cette fois spéciale (ayant un champ d'application matériel pré-déterminé), ce qui implique, là encore en application d’une jurisprudence quasiment constante depuis 2011, que les prérogatives nouvellement confiées au Premier ministre par la loi du 23 mars 2020 viennent en quelque sorte « geler » le pouvoir de police administrative générale des maires. Concrètement, ces derniers ne doivent en principe plus utiliser ce pouvoir, sauf pour faire face à une extrême urgence, ainsi d’ailleurs que le prévoit l’article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, selon lequel : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». C’est la substance de cet article que le juge des référés du Conseil d’Etat a restitué en subordonnant l’intervention en état d’urgence sanitaire d’un arrêté de police générale du maire relatif à la catastrophe sanitaire à la condition « que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable » (v. précédemment en ce sens : CE 6 novembre 2013, Goin, n° 349245, considérant 2).
Par cette condition déjà, le maire de Sceaux, en sa qualité d’autorité de police administrative générale, ne pouvait alors légalement imposer le port d'un masque pendant la durée de l’actuel état d’urgence sanitaire. Si le juge des référés du Conseil d’Etat en était resté là et avait constaté pour ce seul motif une atteinte à la liberté d’aller et de venir et à la liberté personnelle, son ordonnance aurait été d’une parfaite orthodoxie juridique – chacun étant libre de l’apprécier subjectivement en opportunité.
Hélas ! Accentuant en état d'urgence sanitaire sa déférence naturelle envers les politiques publiques étatiques, le juge des référés du Conseil d’Etat a choisi d’ajouter une seconde condition, cumulative à la première, à la légalité des arrêtés de police municipaux pris en période de catastrophe sanitaire : outre la nécessité pour le maire d’établir une raison impérieuse locale, les restrictions aux libertés qu’il impose ne doivent au surplus « pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat ».
Cette seconde condition est sidérante (v. aussi : Mathieu Touzeil-Divina, « Quand le Conseil d’Etat n’avance plus masqué pour réaffirmer qu’il est, même en juridiction, le Conseil 'd’Etat' et non 'des collectivités' », journal-du-droit-administratif.fr, 18 avril 2020).

Agrandissement : Illustration 4

Elle l'est par sa formulation, qui présume de manière irréfragable « la cohérence » comme « l’efficacité » de la politique gouvernementale en état d’urgence sanitaire, là où tout démontre le contraire : le président de la République lui-même concède - il ne peut en aller autrement au regard de l'ampleur inédite de la crise - que des erreurs ont été commises par l'exécutif, à rebours de la « cohérence » évoquée par le Conseil d'Etat ; sa volte-face sur un confinement spécifique aux personnes âgées en est une manifestation supplémentaire, en attendant celle à venir sur les tests qui devront évidemment être systématisés très au-delà des seules personnes présentant des symptômes du coronavirus. « Comme vous, j’ai constaté des ratés, encore trop de lenteurs, des procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique », a-t-il assuré le 13 avril ; « comme nous » peut-être, mais pas comme le Conseil d'Etat qui jusqu'à présent n'a remis en cause aucune des actions ou inactions de l'exécutif. Cinq jours après ce discours du 13 avril, les services de Matignon ont fait savoir le 18 avril que lors de sa conférence dite « de presse » (avec une seule journaliste présente, cela s'appelle une interview) du lendemain, le Premier ministre « ne présentera pas le plan de déconfinement mais exposera les principales options qui seront à trancher ». L'efficacité se fait attendre.
Elle l'est par son existence : la condition disciplinaire créée par le juge des référés exige donc que l’action des maires relative à la lutte contre une catastrophe sanitaire s'inscrive dans l’exact sillage de celle du gouvernement, là où l’article 72 de la Constitution prévoit pourtant que les collectivités territoriales bénéficient d’une autonomie de compétence à leur échelon, y compris comme en l'espèce dans le champ des polices administratives spéciales dès lors qu'il existe des circonstances impérieuses propres à la commune. Elle réduit les maires au rôle de « préfets sanitaires » en état d'urgence sanitaire. Si dans une affaire Sté Les Films Lutetia du 18 décembre 1959 connue de tous les juristes, le Conseil d’Etat a validé, au nom des particularités municipales, l’interdiction par le maire de Nice de diffusion d’un film autorisé par le ministère de la Culture, sous l’empire de la jurisprudence Ville de Sceaux, même en conséquences de raisons locales impérieuses, une telle interdiction municipale ne serait plus possible d’être lors qu’elle ne correspond pas à la politique ministérielle.
Pour comprendre la portée de cette seconde condition, il faut revenir au contexte du litige.
Le recours en référé contre l’arrêté du maire de Sceaux n’avait pas été formé par un habitant ou une personne physique susceptible de se rendre dans cette ville, mais par la Ligue des droits de l’homme, au nom des valeurs qu'elle s'est donné pour mission de défendre. Elle soutenait qu'en posant une restriction supplémentaire à l’accès à la voie publique scéenne, l’arrêté litigieux portait une atteinte manifestement irrégulière à la liberté d’aller et de venir ainsi qu’à la liberté personnelle.
Comme il arrive rarement (on peut trouver un précédent avec le contentieux des arrêtés municipaux anti-burkini à l'été 2016), le ministre de l’Intérieur s’était associé aux conclusions de la Ligue des droits de l’homme, mais pour des motifs diamétralement opposés : l’arrêté du maire de Sceaux était critiqué car il favoriserait les déambulations sur la voie publique scéenne, en violation de la contrainte générale de confinement posée par le décret du Premier ministre du 23 mars 2020.
C’est cette position ministérielle que le Conseil d’Etat consacre à travers l’action contentieuse de la Ligue des droits de l’homme, le juge des référés considérant, comme en écho aux propos précités tenus par le ministre de l’Intérieur devant le Sénat, que « en laissant entendre qu’une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé, l’arrêté (litigieux) est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par ces autorités ».
Or, le juge des référés n’aurait en aucun cas dû procéder à cette juridictionnalisation de la position ministérielle, pour une raison de procédure contentieuse : en référé-liberté, il est normalement interdit au juge administratif d’innover. Le juge du référé-liberté doit se borner à appliquer une jurisprudence constante ; lorsque, comme dans l’affaire Ville de Sceaux, il lui arrive de ne pas le faire, il rend des décisions politiques sous couvert d’objectivité juridique – ainsi que l’a montré le précédent de la validation le 9 janvier 2014 par le juge des référés du Conseil d’Etat de l’interdiction préfectorale des spectacles de Dieudonné, au nom d’un prétendu risque de mise en cause de la « cohésion nationale » résultant de certains propos contenus dans ces spectacles.
On l’a dit, il suffisait, pour constater l’illégalité manifeste de l’arrêté scéen, de relever par application d’une jurisprudence constante que son édiction n’était pas rendue indispensable par des circonstances locales propres à la ville de Sceaux et en lien avec le coronavirus.
Le Conseil d’Etat statuant en référé a cependant choisi d’inventer une seconde condition à la légalité des arrêtés de police municipaux pris au cours de l’état d’urgence sanitaire, tirée de leur parfait alignement avec les politiques publiques nationales relatives à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Il s’est montré exigeant à l’égard des communes, alors que sa position en référé est très attentive aux arguments communicationnels du gouvernement (v. « Le Conseil d’Etat et l’état d’urgence sanitaire : bas les masques ! », 11 avril 2020), lesquels sont en contentieux administratif l'équivalent pour l'état d'urgence sanitaire de ce que les notes blanches des services de renseignement étaient tout au long de l'état d'urgence sécuritaire, entre novembre 2015 et octobre 2017.
En clair, cette seconde condition implique qu’en état d’urgence sanitaire, les autorités nationales pourront le moment venu imposer le port du masque sans attenter à la liberté d’aller et de venir ni à la liberté personnelle, alors que cette mesure est mécaniquement hors de la portée des maires, quelle que soit la situation propre à la commune et même si dans telle commune il serait possible d'établir la nécessité impérieuse de porter des masques, tant qu’elle ne correspond pas à la « stratégie » nationale de lutte contre le coronavirus.
La décision Ville de Sceaux illustre que le Conseil d’Etat est, au cas d'espèce contre les collectivités locales, le « bouclier du gouvernement » en état d’urgence sanitaire (comp. : Patrick Roger, « La ligne de crête du Conseil d’Etat en temps de crise du coronavirus », lemonde.fr, 15 avril 2020 : « Nous ne sommes pas devenus le bouclier du gouvernement, assure M. Lasserre, vice-président du Conseil d’Etat. Nous fonctionnons toujours avec notre ADN, qui est de protéger les libertés. Nous sommes en réalité sur une ligne de crête »). Pourtant, en période de crise, il serait plus que jamais nécessaire d'avoir des contrepouvoirs face à un exécutif à la fois trop puissant et dont la compétence doit toujours être questionnable, y compris dans les contentieux relatifs aux arrêtés de police des maires.
Merci à Christian Creseveur pour le dessin.



