La première suspension, très médiatisée, d’une assignation administrative par le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat le 22 janvier 2016 est l’occasion de revenir sur cette mesure de police administrative prise en application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée, dont le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution dans sa décision du 22 décembre 2015.
L’assignation administrative est formalisée par un arrêté du ministre de l’Intérieur, dont la motivation constitue un « copié/collé » des informations rassemblées sur l’individu assigné, Halim A., annexées à l’arrêté sous forme de « note blanche », informations contenues dans un document Word non signé et non daté (v. un exemple concret ci-dessous), qui sont celles pour lesquelles le ministre a « des raisons sérieuses de penser que le comportement de [l’assigné] constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». En l’occurrence, il était reproché à l’intéressé : d’appartenir à la mouvance islamiste radicale et de fréquenter un lieu de culte radical depuis 2007 ; d’avoir été signalé le 13 mai 2015 aux abords du domicile du directeur du journal Charlie-Hebdo faisant l’objet d’une protection particulière, alors qu’il paraissait prendre des photos de ce domicile et du dispositif policier mis en place ; d’avoir été a été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale. Lire ces informations « brutes », jamais étayées par un commencement de preuve et présumées vérifiées par les services de police, donne de toute évidence une image négative de l’intéressé, qui paraît en effet relever du champ très large de l’assignation administrative défini par la loi. Comme le soulignent des journalistes du Monde : « sur le papier, le père de famille de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) avait tout pour inquiéter ». On peut comprendre que le tribunal administratif de Melun n’ait pas cru possible de suspendre cette assignation administrative et – petit clin d’œil à la juridiction judiciaire – il est probable que si un magistrat judiciaire (procureur ou juge du siège) avait été saisi préalablement au placement sous assignation administrative, il aurait donné son accord au vu du dossier établi par le ministère de l’Intérieur.
Cette affaire souligne une nouvelle fois l’importance des « notes blanches » dans la décision d’assigner un individu, et la difficulté pour l’intéressé de rapporter la preuve contraire. Or, après une enquête rapide, les journalistes du Monde n’ont eu aucun mal à découvrir que la note blanche était « une collection d’exagérations, d’imprécisions et d’informations non fondées ». Pis encore, en indiquant dans la « note blanche » que l’intéressé avait été entendu par la section antiterroriste du Parquet de Paris le 14 mai 2015, comme cela avait d’ailleurs été relaté dans la presse, sans préciser cet élément essentiel selon lequel aucune poursuite n’avait été retenue à son encontre à l’issue de cette audition, les services de police créent eux-mêmes, de manière biaisée, les éléments permettant de caractériser le « comportement constitutif d’une menace » à la sécurité et l’ordre publics.
Voici une autre « note blanche » (anonymisée) relative à l’un des 400 assignés à résidence depuis le 14 novembre 2015 :

Agrandissement : Illustration 1
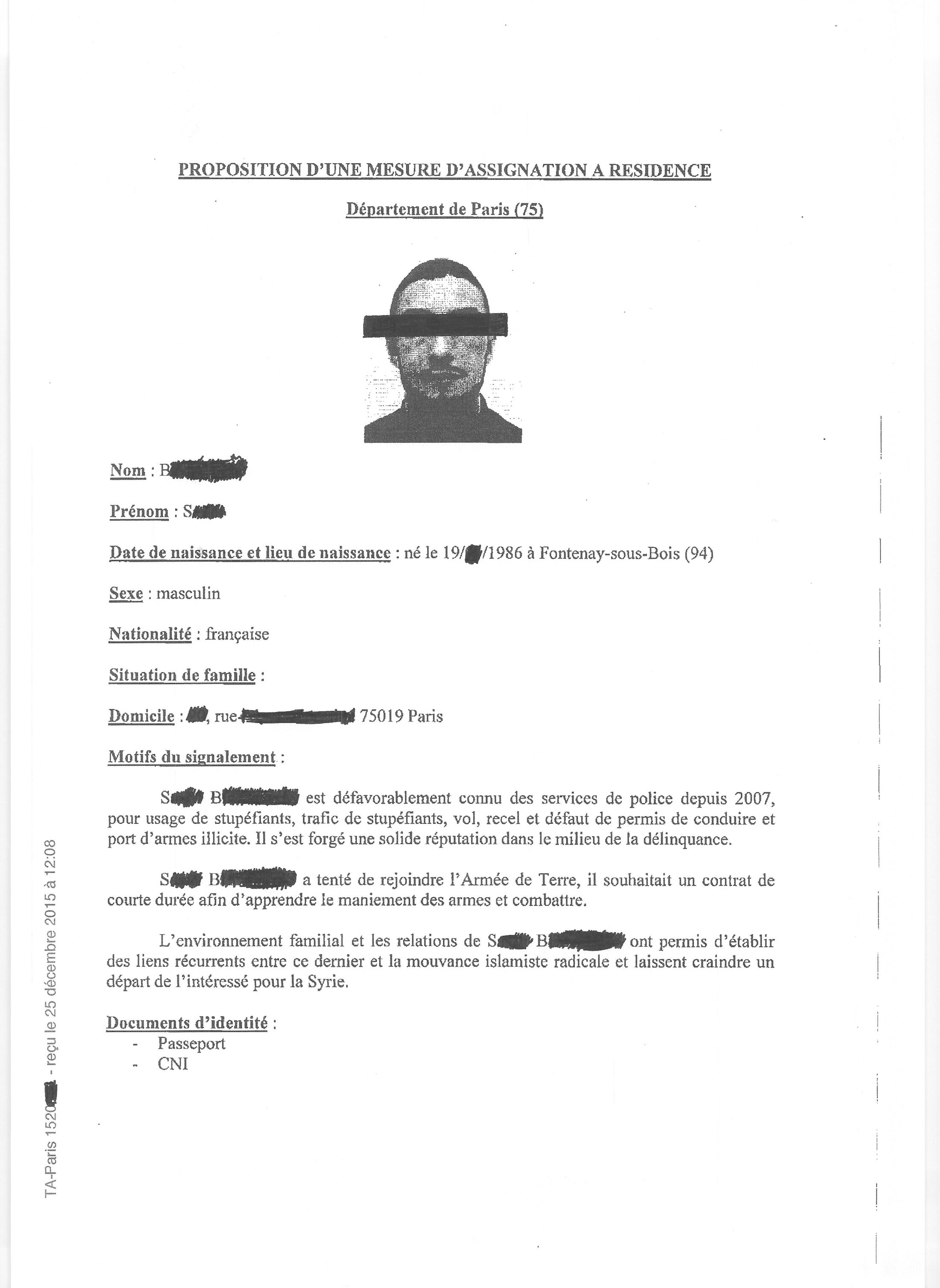
L’intéressé a contesté cette assignation. Par une ordonnance n° 1520961 du 26 décembre 2015, la juge du référé-liberté du tribunal administratif de Paris a balayé les trois motifs qui avaient conduit à assigner M. B., considérant qu’ils étaient soit inexacts (l’intéressé n’a jamais voulu intégrer l’Armée de terre), soit trop anciens (2007), soit dépourvus de lien avec le terrorisme (conduire sans permis…). Hélas pour l’assigné, celui-ci a une famille et la juge des référés a estimé qu’un élément ne figurant pas dans la « note blanche », à savoir le fait que l’intéressé avait eu un contact « Skype » en août 2015 avec son frère parti en Syrie et qu’il avait attendu la mi-septembre pour avertir en les autorités, justifiait la mesure restrictive de liberté prise à son encontre : « le récit fait au cours de l’audience publique par le requérant des relations qu’il a entretenues avec son jeune frère et le caractère très peu circonstancié des conditions dans lesquelles il a été amené à signaler les agissements de ce frère aux autorités compétentes, d’ailleurs assez tardivement par rapport au déroulement des événements de l’été 2015, et alors même que le requérant ne dément pas que son frère avait été en lien avec une mouvance islamiste radicale, suffit à établir que son environnement familial constitue une raison sérieuse de penser que le requérant menace actuellement la sécurité et l’ordre publics » (l’obligation de « pointage » au commissariat sera toutefois modulée).
Revenons à l’affaire jugée par le Conseil d’Etat. Il aura fallu deux audiences au juge du référé-liberté du Conseil d’Etat pour faire voler en éclat les éléments de fait avancés par le ministre : l’appartenance à une mouvance islamiste radicale n’était pas démontrée et Halim A. ne se rendait plus à la mosquée évoquée par la « note blanche » depuis 2005; l’assigné avait été entendu comme simple témoin dans l’affaire des voitures volées, close en décembre 2015 ; et l’audience aura permis à l’intéressé de démontrer, gestes à l’appui, qu’il ne prenait pas de photos avec son téléphone portable tenu à bout de bras, mais parlait à sa mère en mode haut-parleur, laquelle réside tout à côté du domicile (légitimement) surveillé par la police. Autrement dit, sur le terrain de la technique juridique, l’arrêté était basé sur une erreur matérielle relativement aux faits reprochés à l’intéressé (il ne s’agit donc pas d’un contrôle de proportionnalité de la mesure de police qui, comme il a été dit dans un autre billet, joue plus pour les modalités de l’assignation que pour son principe).
On voit bien ici l’effet de l’état d’urgence sur les libertés : tenir un téléphone portable à la main dans la rue est un comportement absolument banal et permis par la loi, même s’il peut (légitimement ici aussi) alerter les forces de sécurité en fonction du contexte dans lequel il se produit ; ce même comportement peut tout à coup, dans le cadre de l’état d’urgence, en considération de la couleur de peau ou de la religion de l’intéressé, conduire à une assignation à domicile pendant plusieurs semaines voire mois avec obligation de pointage trois fois par jour au commissariat…
Au surplus, ce sont des comportements antérieurs à l’adoption de la loi du 20 novembre 2015 modifiant celle du 3 avril 1955 qui sont appréhendés par l’état d’urgence : cela est-il compatible avec le principe de non-rétroactivité des lois ? On rappellera à cet égard la célèbre maxime de Portalis, que l’état d’urgence semble méconnaître : « L’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. [...] Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? ».
Au cours de la seconde audience tenue le 21 janvier 2016, la représentante du ministre de l’Intérieur s’est appuyée sur un argument d’autorité, heureusement balayé par le juge des référés : « Si les services de renseignement ont écrit tout ça, c’est que c’est vrai. Ils ne se lèvent pas le matin pour écrire de fausses notes blanches. (…) Que faut-il attendre, un nouvel attentat ? ».
Voilà toujours la même phraséologie « sécuritaire », fondée non sur la raison mais sur l’émotion et sur l’agitation de la peur, constamment reprise par le président de la République et le Premier ministre, en dernier lieu pour justifier la probable prorogation de l’état d’urgence au-delà du 26 février 2016.
Faisons l’effort de la prendre au sérieux. La question est alors de savoir en quoi une assignation à domicile, éventuellement doublée d’une obligation de se présenter aux services de police, éventuellement triplée d’une remise du passeport à ces services, éventuellement quadruplée d’une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, comme le permet l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, empêche avec certitude l’assigné de commettre un attentat ? Au cas d’espèce, à supposer, ce qui n’était heureusement pas le cas, que Halim B. ait effectivement eu une intention criminelle, cette mesure restrictive de liberté de circulation aurait-elle empêché qu’il puisse passer à l’acte ?
Cherchons le secours des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 20 novembre 2015 pour tenter de répondre objectivement à cette question. Qu’apprend-on en les lisant ? Pas grand-chose, au fond : que l’assignation à résidence, déjà prévue dans la loi version originelle de la loi du 3 avril 1955, « vise à s’assurer que la personne assignée à résidence respecte l’obligation qui lui est faite sans mobiliser à l’excès les forces de l’ordre dans un contexte de forte activité de ces dernières » (Assemblée nationale, rapport n° 3237, p. 24), ce qui reprend au mot près les arguments figurant dans l’exposé des motifs du projet de loi présenté par le gouvernement (le projet « adapte et renforce le dispositif d’assignation à résidence prévu à l’article 6 de la loi de 1955, afin de le rendre plus efficace et opérationnel, en appliquant un régime comparable à celui prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les étrangers représentant une menace pour l’ordre public, assignés à résidence dans l’attente de leur éloignement du territoire. Ce dispositif de l’article 6 vise en effet à restreindre la liberté de circulation des personnes auxquelles il est appliqué et à limiter leur capacité à se mettre en relation avec d’autres personnes considérées comme dangereuses, dans un contexte où les forces de l’ordre sont très fortement mobilisées ») ; puis, nous assure-t-on, « ce régime vise à répondre avec efficacité aux nécessités immédiates de la lutte contre la menace terroriste ». Soit… mais n’est-ce pas un peu tautologique, comme justification ?
Regardons du côté des explications données par le Sénat. On nous y rappelle, ce qui était déjà dans l’exposé des motifs précités du projet de loi, que le dispositif tel que rénové par la loi du 20 novembre 2015 s’inspire des dispositions de l’article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, applicables aux étrangers en situation irrégulière ne pouvant faire l’objet d’un éloignement car dans l’impossibilité de regagner leur pays d’origine ou aux étrangers condamnés pour des faits de terrorisme mais ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’expulsion (Sénat, rapport n° 177, p. 38). Cette filiation, qui procède en réalité de la transposition de l’article 9 de la directive « Retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière » du 16 décembre 2008 de l’Union européenne, est intellectuellement stimulante, mais ne permet toujours pas de répondre à la question posée : est-ce qu’une procédure de retenue administrative visant initialement à éviter le risque de fuite d’étrangers en situation irrégulière permet utilement, dans le cadre de l’état d’urgence, de « brider » un individu déterminé à commettre un trouble à l’ordre et à la sécurité publics ? quel bilan positif ou négatif peut être tiré de sa mise en œuvre pour les étrangers en situation irrégulière qui servirait d’enseignement pour l’état d’urgence ?
Bref, après près de deux mois d’état d’urgence, on ne comprend pas en quoi une assignation administrative est utile à la prévention d’un attentat terroriste, soit dans l’agglomération dans laquelle l’individu est assigné, soit au-delà si l’obligation de pointage ou l’obligation de demeurer à domicile n’est pas respectée.
On le comprend d’autant moins que de manière plus générale, comme le relève un agent des services de renseignement interviewé par Libération le 24 janvier 2016, l’état d’urgence « n’empêche en rien qu’un nouvel attentat à 150 morts soit perpétré dans un mois en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que les deux attaques majeures, Charlie et le 13 Novembre, ont été organisées depuis la Belgique [les armes d’Amedy Coulibaly et probablement celles des frères Kouachi viennent de Charleroi, ndlr], zone sur laquelle l’état d’urgence français n’a aucune prise ». Sans commentaire...



