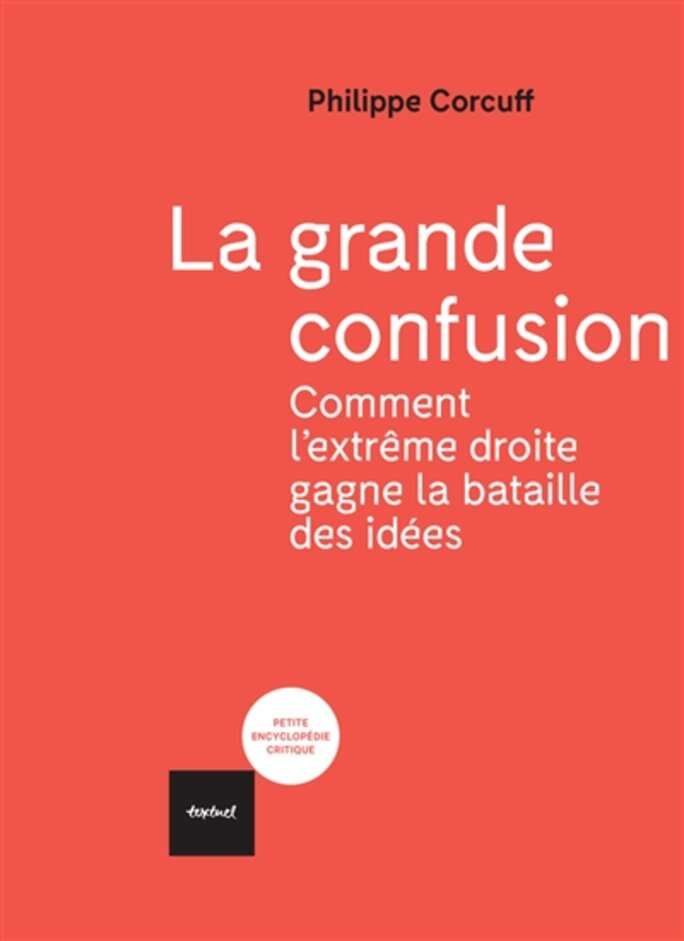Après un premier billet partant d’une chanson de Robert Charlebois, un nouvel éclairage inédit sur le livre La grande confusion, empruntant cette fois les sentiers accidentés du roman noir américain.
Michael Connelly contre le salaud unique

Agrandissement : Illustration 1
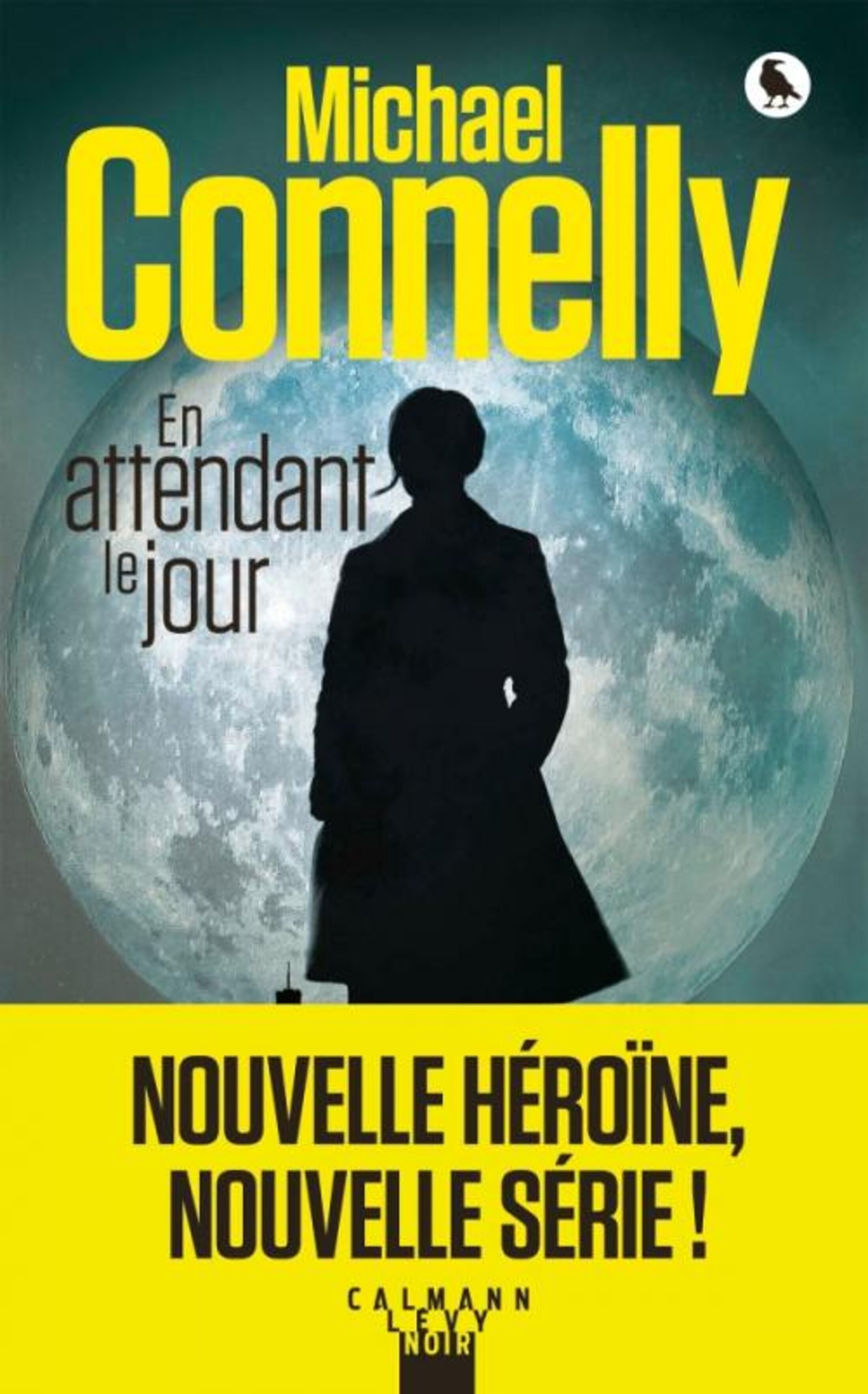
Dans En attendant le jour (Calmann-Lévy, 2019 ; 1ère éd. américaine sous le titre The Late Show en 2017), une nouvelle héroïne apparaît chez Michael Connelly : Renée Ballard, inspectrice au LAPD, la police de Los Angeles, comme un autre héros récurrent de Connelly, Harry Bosch. En paraissant en 2017 aux États-Unis (et donc écrit avant), ce polar a précédé de très peu l’ère #MeToo.
Renée, trentenaire, a été placardisée au quart de nuit du commissariat d’Hollywood pour avoir porté plainte contre le lieutenant Olivas, son chef, pour agression sexuelle. Les « affaires internes » du LAPD n’ont finalement pas donné de suite à la plainte. Renée vit dans un van ou dans une tente sur la plage, et, hors travail, s’épuise en pratiquant le paddle. Née à Hawaï, les cheveux blonds et la peau mate, elle est solitaire avec sa chienne Lola, principalement attachée à sa grand-mère Tutu de 82 ans. Son père a disparu en mer sur une planche de surf alors qu’elle était jeune. Ses enquêtes l’occupent bien au-delà des heures légales de boulot et des consignes de sa hiérarchie. Dans En attendant le jour, elle va suivre en même temps trois affaires : un cambriolage avec vol de carte de crédit, un massacre dans une boîte de nuit et le tabassage d’un.e prostitué.e transgenre. Les choses s’embrouillent. Son ex-coéquipier, Ken Chastain, va être assassiné. Le lecteur, comme Ballard elle-même au départ, aimerait bien qu’un fil transversal unisse les différentes affaires : l’attente d’un Mal unique ou principal qui nous simplifie la vie. Toutefois l’expérience de maux pluriels complique inévitablement nos existences.
Á un moment elle se retrouve seule face à Olivas :
« - Pourquoi mentez-vous ? lui renvoya-t-elle. Il n’y a que nous ici. Ne me dîtes pas que vous vous êtes raconté ça si souvent que vous en êtes arrivé à le croire !
- Ballard, vous…
- Nous savons tous les deux très exactement ce qui s’est passé. Vous m’avez clairement fait comprendre, et plus d’une fois, que ma trajectoire dans le service dépendait de vous et que j’allais devoir "assurer" pour ne pas me faire virer. Et, à la fête de Noël, vous me coincez contre un mur et essayez de me coller votre langue dans la gorge. Et vous croyez que me mentir en face va me convaincre que ça n’est jamais arrivé ? »
Sur la base de l’hostilité légitime de Renée vis-à-vis d’Olivas, Connelly va produire un leurre narratif qui va attirer tant Renée que le lecteur : et si le lieutenant harceleur avait aussi une responsabilité dans plusieurs meurtres ? Plusieurs salauds en un seul ? Hypothèse tentante, mais fausse piste ! Les complexités du monde vont faire exploser cette interprétation unifiante. C’est un autre flic corrompu qui est dans le coup. Des maux et des salauds ! Et Renée elle-même est affectée par les dérèglements auxquels son travail la confronte. La docteure Carmen Hinojos, la patronne de l’unité des sciences du comportement du LAPD, lui dit à ce propos :
« Votre boulot vous immerge dans les abîmes les plus sinistres de l’âme humaine. […] Plongez dans les ténèbres et c’est aussitôt en vous qu’elles plongent, elles aussi. »
Reconnaissant ses capacités d’investigation, Olivas lui propose de revenir dans son unité. Le sens de sa propre dignité rivé au corps, elle refuse :
« Lieutenant, dites à la face du monde ce que vous m’avez fait, reconnaissez-le et je reviendrai travailler avec vous. »
Olivas n’en a pas l’intention : il est bien un salaud… mais pas LE salaud intégral qui ferait converger tous les fils du Mal.
Á l’hypothèse simpliste de l’unité du Mal et des salauds, Connelly oppose un autre démenti dans un roman qui voit Renée Ballard et Harry Bosch conjuguer leurs efforts. Ainsi dans Incendie nocturne (Calmann-Lévy, 2020 ; 1ère éd. américaine sous le titre The Night Fire en 2019), Harry ajoute à la pluralité des maux nos défaillances devant la part d’incertitude du réel :
« Bosch savait que dans une affaire de meurtre, dans n’importe quelle affaire, d’ailleurs, il restait toujours des questions sans réponse. »
Mais que peuvent bien avoir à faire Renée Ballard et Harry Bosch dans un billet sur un livre de théorie politique, La grande confusion ? L’enquête se poursuit…
Une légende de gauche : le néolibéralisme comme Mal principal ou unique
La critique du néolibéralisme économique constitue un acquis de la gauche radicale. J’ai participé à sa généalogie, alors que nous étions très peu nombreux (dans les médias on nous qualifiait d’« albanais » en référence au régime totalitaire communiste de l’Albanie de l’époque !) au sein du mensuel En jeu dirigé par Didier Motchane situé dans la galaxie de ce qui constituait le principal courant de gauche du Parti socialiste, le CERES, dans l’opposition à « la parenthèse de la rigueur » du gouvernement Mitterrand-Mauroy en 1983, qui se révèlera être un tournant social-libéral. Puis, lors du grand mouvement social de l’hiver 1995, j’ai été un des animateurs de « la pétition Bourdieu » de soutien aux grévistes et aux manifestants (voir Julien Duval, Christophe Gaubert, Frédéric Lebaron, Dominique Marchetti et Fabienne Pavis, Le « décembre » des intellectuels français, Liber-Raisons d’agir, 1998). Cependant, au fil du temps et de l’écho grandissant de la critique du néolibéralisme économique, cette critique a connu un écueil : la diabolisation du néolibéralisme, par ailleurs dangereusement amalgamé (par exemple, par le philosophe Jean-Claude Michéa ou l’économiste Frédéric Lordon) au libéralisme politique et à ses acquis.
Cette tentation de la diabolisation du néolibéralisme économique apparaît implicitement adossée à une politique quasi-théologique du Mal, au sens de la religiosité sommaire des vulgates religieuses et non des riches traditions d’interrogations théologiques. Dans nombre de discours publics des secteurs critiques de la gauche, « le néolibéralisme » apparaît ainsi comme un monstre attrape-tout à têtes proliférantes. « On veut des légendes, des légendes », chante Eddy Mitchell avec Johnny Hallyday… La focalisation sur un Mal supposé principal ou même unique (« le néolibéralisme »), parfois omniprésent et omniscient, dans des schémas à pentes conspirationnistes (« les lobbys », « Davos », « les médias »…), agissant à travers des incarnations elles-mêmes diabolisées (« Sarkozy salaud ! », « Hollande salaud ! », « Macron salaud ! »…), empêche de se coltiner politiquement une pluralité de maux, d’intensité et de dangerosité variables, ayant seulement des interactions et des intersections entre eux (le néolibéralisme et ses dégâts sociaux, mais aussi les dangers écologiques, qui ne sont pas que dérivés de ce dernier, l’extrême droitisation, l’islamophobie, l’antisémitisme, la négrophobie, la romophobie, les islamoconservatismes légalistes et les djihadismes meurtriers…). Cette tentation contribue, par ailleurs, à l’attention obsessionnelle contemporaine à penchants complotistes sur des « personnalités », en dégradant la critique sociale structurelle des mécanismes impersonnels contraignant nos vies et nourris par de multiples intentionnalités allant dans des directions diversifiées ; critique sociale structurelle portée historiquement par l’anarchisme et le marxisme et aujourd’hui par de larges pans des sciences sociales.
Associée à la diabolisation du néolibéralisme, le langage des gauches critiques revêt souvent des tonalités virilistes en se concentrant sur le vocabulaire para-militaire du « combat », des « adversaires » et des « rapports de force ». Certains dans la gauche radicale, comme la philosophe belge Chantal Mouffe théoricienne du « populisme de gauche », ont été jusqu’à aller chercher chez un juriste allemand antisémite devenu nazi, Carl Schmitt (1888-1985)(1), l’appréhension de la politique à travers la grille extrêmement nuancée de… l’opposition « ami/ennemi ».
Une notion puisée dans l’œuvre du philosophe Maurice Merleau-Ponty peut nous aider à insérer le vocabulaire du « combat » dans un cadre plus large susceptible de l’hybrider avec le vocabulaire de « l’exploration » et de « la création » dans une problématique de l’émancipation : adversité. Le terme adversité apparaît dans le titre d’une conférence de Merleau-Ponty du 10 septembre 1951 : « L’homme et l’adversité » (2). Pour caractériser l’adversité, il y associe l’inertie, qui freine, voire paralyse, notre action transformatrice et créatrice, et la contingence historique (ce qui n’est pas nécessaire et inclus des aléas, se coltine l’incertitude). Le philosophe va apporter davantage d’éclaircissements sur la notion dans des entretiens radiophoniques qui ont été enregistrés après la conférence (3). Il y distingue la notion d’adversité de celle d’adversaire :
« J’ai appelé "adversité" dans cette conférence ce qui s’oppose en effet à la réalisation, comme vous disiez, de l’harmonie, de l’accord avec soi-même et avec autrui, mais ce qui s’y oppose sans être un adversaire que l’on puisse précisément nommer. » (4)
L’adversité ne renverrait pas alors au couple « vainqueur »/« vaincu », mais à « cette espèce de mouvement sournois par lequel les choses se dérobent à notre prise » (5). Dans l’adversité, il y a donc aussi la façon dont « les ténèbres plongent » en Renée Ballard et la palette des sources impersonnelles des maux qui nous assaillent quotidiennement. Dans cette configuration, on pourrait réinsérer les adversaires, en tant qu’incarnations plurielles de ces maux, comme une composante, mais une composante seulement, de l’adversité.
C’est ici que les polars de Connelly peuvent croiser une théorie politique critique du « côté obscur de la force idéologique » actuelle et surtout de la façon dont les gauches apparaissent désarmées intellectuellement face à lui.
Notes :
(1) Sur la pensée de Carl Schmitt, voir le juriste Olivier Jouanjan, « "Pensée de l’ordre concret" et ordre du "discours juridique" nazi : sur Carl Schmitt », dans Y. C. Zarka (éd.), Carl Schmitt ou le mythe du politique, Paris, PUF, collection « Débats philosophiques », 2009, et « Et si l’on ne faisait rien de Carl Schmitt ? », revue Philosophiques [Société de Philosophie du Québec], volume 39, n° 2, automne 2012.
(2) Maurice Merleau-Ponty, « L’homme et l’adversité » [conférence du 10 septembre 1951 aux Rencontres Internationales de Genève], reprise dans Signes [1e éd. : 1960], Paris, Gallimard, 1987, pp. 284-308.
(3) Maurice Merleau-Ponty, « L’homme et l’adversité », entretiens radiophoniques animés par Jean Amrouche, diffusés les 15 et 22 septembre 1951, repris dans Entretiens avec Georges Charbonnier et autres dialogues, 1946-1959, Lagrasse, Verdier, 2016, pp. 62-71.
(4) Ibid., p. 63.
(5) Ibid.
***************************************
La grande confusion
Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées
Par Philippe Corcuff
Paris, Éditions Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 10 mars 2021, 672 pages, 26 euros, https://www.editionstextuel.com/livre/la_grande_confusion
ISBN : 978-2-84597-854-6
1) Nouvelles interventions dans les médias à propos du livre :
* « Le livre travaille les impensés de mes propres engagements », entretien avec Pablo Pillaud-Vivien, "La Midinale", site du magazine Regards, 11 mars 2021 (environ 43 mn)
https://www.youtube.com/watch?v=8c3oq4DQBhQ
* « Interdit d'interdire », n° 194, entretien avec Frédéric Taddéi, RT France, 11 mars 2021 (introduction et premier invité : jusqu’à 25 mn 40 environ)
https://www.youtube.com/watch?v=xSUDVhS5mng&t=48s
* « Philippe Corcuff : le confusionnisme, une "trame idéologique en expansion" », entretien avec Pauline Graulle et Lucie Delaporte, Mediapart, 17 mars 2021
* « Confusionnisme, une affaire de réseaux ? », entretien avec Sylvain Bourmeau, « La suite dans les idées », France Culture, 20 mars 2021
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/confusionisme-une-affaire-de-reseaux
* « Philippe Corcuff : "Légitimer le conspirationnisme, c’est renforcer l’ultraconservatisme" », entretien avec la rédaction, Conspiracy Watch (site de l’Observatoire du conspirationnisme), 22 mars 2021
2) Le sommaire détaillé du livre :
Introduction : Vers une théorie politique critique de la confusion aujourd’hui
Liaisons dangereuses dans l’air du temps : Julliard, Lordon et Bock-Côté
Jacques Julliard, de « la deuxième gauche » à la focalisation « républicaine » sur la nation
Frédéric Lordon ou la fétichisation de la nation au sein de la gauche radicale
Mathieu Bock-Côté, un ultraconservatisme nationaliste venu du Québec
Des convergences rhétoriques et idéologiques paradoxales
Un retour soft de Maurice Barrès, entre ultraconservatisme, gauche modérée et gauche radicale ?
Une interrogation quant aux tendances confusionnistes et ultraconservatrices de l’air du temps
Bricolages idéologiques ultraconservateurs et confusionnistes
Inquiétude merleau-pontienne
Une théorie politique critique à horizon émancipateur engagée dans l’époque
Théorie politique et théorie critique
Engagement dans l’époque et contextualisation
Une théorie politique au défi de « l’inquiétude du négatif »
Dans le brouillard idéologique : de l’utilité d’une boussole
La boussole ou comment pragmatiser le rapport à l’éthique et à la politique
De la controverse Merleau-Ponty/Sartre au présentisme
« Dérision de nous, dérisoires »
Penser aussi contre mes propres impensés politiques
Vers une gauche d’émancipation
L’émancipation en peau de chagrin d’Emmanuel Macron
Des Lumières tamisées en héritage
Critique de Mark Lilla
En partant de Roger Martelli
Plan d’un ouvrage aux musicalités merleau-pontiennes et foucaldiennes, mitchelliennes et souchoniennes
Partie I : Dérèglements de la critique sociale dans les temps confus actuels
* Chapitre 1 : Jalons conceptuels et méthodologiques face au brouillard idéologique présent
L’identitarisme et ses complications actuelles
Des identitarismes
Des résistances à l’analyse de l’espace des identitarismes
Concurrences victimaires et ressentiment
Paniques identitaires
Jean-Claude Kaufmann et l’ouverture-fermeture des identités contemporaines
Tropismes manichéens de « la question identitaire »
Risques « postfascistes » et dynamiques ultraconservatrices
Fascisme ou « postfascisme » ?
Ultraconservatisme plutôt que « populisme »
Brouillard idéologique, confusionnisme et extrême droitisation
De la métaphore de l’aimantation et de sa reformulation sous un angle tactique
Thomas Schelling et les points focaux
François Hollande aimanté
Emmanuel Macron aimanté
La Commission européenne aimantée
Désaimantation conjoncturelle
Politisations conspirationnistes
* Chapitre 2 : De quelques laboratoires de l’ultraconservatisme et de l’hypercriticisme confusionniste : de Benoist, les « néoréacs », Chevènement, Les Guignols de l’info, Halimi, Ardisson, Sarkozy, La Manif pour tous, Jour de colère…
Alain de Benoist : essentialisme culturaliste et amalgames confusionnistes chez un intellectuel curieux
L’espace des « nouveaux réactionnaires » décrypté par Daniel Lindenberg
Autour d’une des vies de Jean-Pierre Chevènement : la galaxie nationale-républicaine
Les Guignols de l’info ou la critique confusionnée
La critique manichéenne des médias, de la gauche radicale à l’extrême droite
De Thierry Ardisson à la Ligue du LOL : la critique transgressive
« Le sarkozysme » ou l’accélération du brouillage des repères politiques
La Manif pour tous ou la critique ultraconservatrice du « libéralisme »
Jour de colère, 26 janvier 2014, ou la convergence antisémite de haines hétérogènes
* Chapitre 3 : Le couple critique sociale-émancipation et la gauche resitués dans l’histoire
Les liaisons historiques de la critique sociale et de l’émancipation : un pilier intellectuel de la gauche
Problématisation moderne du couple critique sociale-émancipation
Repérages historiques-1 : de la critique sociale
Repérages historiques-2 : de l’émancipation
La gauche, du XXe siècle à aujourd’hui
De la fragilisation actuelle des liens critique sociale-émancipation
Pierre-André Taguieff ou la tentation de la déconstruction conservatrice de l’émancipation
« Politiquement incorrect » et « critique du ressentiment » dans l’hypercriticisme aujourd’hui
Conclusion de la Partie I
Post-scriptum à la Partie I : Extrême droitisation, néolibéralisme économique… COVID-19
Du néolibéralisme, de droite à gauche
Le néolibéralisme comme une des sources de la vague ultraconservatrice
Écueils de la diabolisation du néolibéralisme à gauche
Post-scriptum au post-scriptum (octobre 2020) : brèves hypothèses au cœur de la crise de la COVID-19 quant au néolibéralisme et à l’ultraconservatisme
Du recul symbolique du néolibéralisme et de quelques autres conséquences positives possibles de l’épidémie
Ultraconservatisme nationaliste et confusionnisme complotiste : le vent en poupe ?
La foire présentiste aux prophètes
D’un monde d’après composite
Partie II : Déplacements confusionnistes en cours, de l’extrême droite à la gauche
* Chapitre 4 : Quatre figures de l’extrême droite idéologique : Alain Soral, Éric Zemmour, Renaud Camus, Hervé Juvin
Alain Soral et Éric Zemmour : deux variantes de l’ultraconservatisme idéologique à la française
Traits transversaux soralo-zemmouriens
De l’imbrication du racisme, du sexisme et de l’homophobie
Postures cognitives et formes narratives supportant l’ultraconservatisme
Renaud Camus et le fantasme conspirationniste du « Grand Remplacement »
« Le Grand Remplacement » selon Renaud Camus
Échos politico-idéologiques du « Grand Remplacement »
Hervé Juvin ou « la séparation écologique » des « ethnies » et des cultures
Une biologisation des relations sociales
Un identirarisme anti-« libéral »
La singularité et la diversité tronquées
* Chapitre 5 : Critique de l’hypercriticisme conspirationniste
Deux pôles de la trame narrative conspirationniste
Les sciences sociales contre le conspirationnisme
Face aux illusions conspirationnistes d’un doute illimité : ressources philosophiques
Dérapages conspirationnistes à gauche
« L’affaire Strauss-Kahn » comme vecteur conspirationniste en milieu socialiste
Du climatoscepticisme au complotisme : le cas de Claude Allègre
Michel Onfray ou James Bond en philosophie politique
La France insoumise et le conspirationnisme tactique au sein du champ politicien
« Affaire Benalla » : interférences confusionnistes
Complotisme chez les hackers « anti-système »
Le paradoxe de critiques des théories du complot… complotistes
De l’anticonspirationnisme sélectif et du complotisme intermittent en milieu ultraconservateur : Alexandre Devecchio et Mathieu Bock-Côté
Fiammetta Venner et Yann Barte : le complot des conspirationnistes vu de gauche ?
Des antifas centrés sur « les infiltrations » de l’extrême droite
Quand la critique du conspirationnisme est relativisée par des figures intellectuelles de gauche
Luc Boltanski : de la critique de la narration conspirationniste à une impraticable critique sociologique du conspirationnisme
Des chercheurs en sciences sociales contre la mise en place de dispositifs pédagogiques de critique du conspirationnisme
Frédéric Lordon ou la délégitimation de la critique du complotisme
Conspirationnisme et « affaires »
* Chapitre 6 : Les « gilets jaunes » : un mouvement social composite surmédiatisé en contexte confusionniste
De l’hétérogénéité d’un mouvement social : les « gilets jaunes » existent-ils ?
Les « gilets jaunes » entre hétérogénéités socio-politiques et unifications symboliques
Sur quelques tendances globales parmi les « gilets jaunes »
De quelques contradictions socio-politiques au sein des « gilets jaunes »
Dérapages minoritaires et confusionnisme rampant
Dérapages ultraconservateurs
Conspirationnisme et confusionnisme
Une hypothèse à propos du bain idéologique ultraconservateur et confusionniste
Les « gilets jaunes » et le succès de l’extrême droite aux élections européennes de mai 2019
La question de l’antisémitisme
Chronique non exhaustive d’un antisémitisme en « gilet jaune »
Le cas d’un tweet antisémite médiatiquement invisible
Un antisémitisme militant très minoritaire, mais persistant
L’auto-illusionnisme chez les intellectuels critiques et dans la gauche radicale
Un zoo académique à gauche ?
Légendes d’une gauche radicale désorientée
Mediapart : un moment d’égarement ?
Conclusion de la Partie II
Post-scriptum à la Partie II : De la droite extrême à la gauche : l’élection de Donald Trump en 2016 comme occasion d’épaississement du brouillard idéologique en France
Trois énoncés idéaux-typiques du confusionnisme des gauches trumpisées
Ignacio Ramonet trumpisé précoce
Laurent Bouvet trumpisé
Jean-Luc Mélenchon trumpisé
Emmanuel Todd maxitrumpisé
Jean-Claude Michéa trumpisé tardif
Post-scriptum au post-scriptum (novembre 2020) : Arnaud Montebourg trumpisé ultratardif
Partie III : En partant de la gauche : polarisations politiques, ankyloses intellectuelles et intersections confusionnistes
* Chapitre 7 : Manichéismes publics concurrents : laïcité, islamismes-djihadismes, antisémitisme/islamophobie
Dérives laïcardes de la laïcité et caricatures décoloniales de la laïcité
De la tolérance propre à la loi de 1905 à la focalisation actuelle sur l’islam
La laïcité contre l’islam et contre… la loi de 1905 : Laurent Bouvet et Natacha Polony
La laïcité caricaturée par certains antiracistes
Des amalgames aux défaillances à gauche face aux islamoconservatismes
Islamismes et djihadismes : mieux appréhender les différences et les intersections
Amalgames essentialistes et Marche contre l’islamophobie
De François Burgat à Judith Butler : de la complaisance répétée au défaut ponctuel de vigilance à l’égard des islamoconservatismes
De la minimisation des islamoconservatismes aux carences émancipatrices
De la compétition entre combats contre l’antisémitisme et contre l’islamophobie à l’enrayement de l’antiracisme
Islamophobie
Antisémitisme
Antisémitisme et « antisionisme »
Engrenages délétères
De la dénégation à l’islamophobie soft dans la gauche « républicaine »
Une « extrême gauche » antisémite ?
Délégitimation de la critique de l’antisémitisme actuel chez Frédéric Lordon et d’autres
Des appels contre l’antisémitisme dotés d’ambiguïtés
Complaisances à l’égard du PIR
Des résistances face à la minoration de l’antisémitisme
Le cas Mélenchon : jeux nationaux-républicains ambigus avec les frontières de l’islamophobie et de l’antisémitisme
Un appel international en faveur de Tariq Ramadan, entre ambiguïtés quant à un supposé « complot sioniste » et disqualification de la critique de l’islamophobie
De la situation de l’islamophobie et de l’antisémitisme aujourd’hui en France aux possibles convergences antiracistes
* Chapitre 8 : Des indices de pénétration du confusionnisme à gauche
Des pensées tourneboulées venant de la gauche
Houria Bouteldja ou un « essentialisme inversé »
Déplacements essentialistes et conspirationnistes d’une variante « politiquement incorrecte » de la pensée décoloniale
L’oppression postcoloniale comme contradiction principale, l’identitarisme communautaire et la marginalisation de l’individualité
Laurent Bouvet ou « l’insécurité culturelle » comme identitarisme d’extrême centre gauche
Juan Branco ou la pensée critique people
Étienne Chouard : un passeur confusionniste entre gauche radicale et extrême droite
Christophe Guilluy ou le « populaire » embrouillé, entre manichéisme territorial et préjugés conservateurs
géographe ou idéologue ?
De Fractures françaises (2010) à La France périphérique (2014)
Un échantillon de critiques ciblées
Des répercussions à gauche
Alain Finkielkraut/Norman Ajari : retours vers l’essentialisme
Finkielkraut, de Levinas à l’identitarisme
Ajari ou la promotion de « l’essence noire »
Incursions confusionnistes localisées
De la décroissance de l’émancipation au nom de « la nature » : de Vincent Cheynet en Pièces et Main d’Œuvre (jusqu’à Limite)
Vincent Cheynet ou la nostalgie naturaliste de la famille patriarcale
Le collectif Pièces et Main d’Œuvre : contre « le capitalisme technologique », pour le sexisme et l’homophobie
La revue Limite ou l’écologie de La manif pour tous
Vers des Lumières vertes ?
Un conservatisme intellectuellement euphémisé chez Nathalie Heinich
Émotions xénophobes chez Jean-Luc Mélenchon
Michel Onfray : du confusionnisme localisé au confusionnisme global
Le coronavirus comme delirium philosophiquement très mince
Un personnage composite en évolution
Un saut confusionniste qualitatif
Bref attrait pour le « politiquement incorrect » transgressif chez Daniel Schneidermann (et Élisabeth Lévy)
Romophobie gouvernementale et islamophobie soft chez Manuel Valls
Quatre terrains glissants
Nationalisme économique
De Kant et Marx à l’altermondialisme
De « protectionnisme » en « démondialisation » et « solution nationale »
Vers d’autres accrochages émancipateurs entre national et mondial ?
L’extrême droite relativisée
Une relativisation pionnière de l’extrême droite : Élisabeth Badinter
Le second tour de 2017 et certaines de ses suites politiques
Des intellectuels de gauche comme coproducteurs de brouillard idéologique : Lordon, Mouffe, Ramaux, Hazan, Bégaudeau, Onfray, Agamben…
Une forme extrême : le « doriotisme » light et partiel de Jacques Sapir
Un écho confusionniste dans des secteurs plus larges de la population
Trouble et résistances autour des migrants dans les gauches critiques
Les Lumières de Charlie Hebdo divisées
* Chapitre 9 : Adhérences confusionnistes au sein de deux pensées critiques en vogue : ambiguïtés de Jean-Claude Michéa et de Chantal Mouffe-Ernesto Laclau
Michéa : des zones ultraconservatrices dans une politique socialiste d’émancipation
De la prétendue unité du libéralisme, du dénigrement des droits et de l’individualisme
L’unité « logique » du libéralisme et ses défaillances
De « la logique » à « la tradition »
La dévalorisation des droits, de l’individualisme et des Lumiéres
De la disqualification de « la gauche »
Une « gauche » diabolisée aux origines extravagantes
Une vue déréglée de l’histoire et du présent
Critique sociale, émancipation et libéralisme politique, d’aujourdhui à Jaurès
Ambivalences de Michéa et ricanements de Lordon
Mouffe et Laclau : apports « post-marxistes » et impensés conservateurs dans le « populisme de gauche »
Hégémonie et stratégie socialiste (1985)
Déplacements « populistes » de Laclau
Déplacements « agonistiques » de Mouffe
Le « populisme de gauche » de Mouffe
Une piste alternative
Convergences verticalistes : Monod et Lordon
Promotion de la figure du « chef démocratique » par Jean-Claude Monod
Le verticalisme politique ambivalent de Frédéric Lordon
Conclusion de la Partie III
Post-scriptum à la partie III : L’adversité mieux que l’adversaire, avec Maurice Merleau-Ponty
L’émancipation, c’est d’abord « avoir des couilles » ?
La dialectique des adversités et des émancipations : en partant de Merleau-Ponty
Ouverture : De l’extinction confusionniste des Lumières aux lueurs mélancoliques de l’émancipation ?
Lanceur d’alerte idéologique
Confusionnisme ou recomposition ?
Potentialités émancipatrices et crise de la politique organisée
Vers une nouvelle boussole émancipatrice ?
Une balade mélancolique rythmée par Maurice Merleau-Ponty et Michel Foucault, Eddy Mitchell et Alain Souchon