
Ariane Chemin, Yvon Quiniou et la tendre ironie critique
La journaliste du Monde Ariane Chemin a consacré six articles, du mardi 16 août au dimanche 21-lundi 22 août 2016, à « Jean d’O » (voir http://www.lemonde.fr/journaliste/ariane-chemin/). L’ironie constitue le moteur de ce portrait critique, dévoilant le travail d’auto-construction mondaine d’une figure aujourd’hui largement consensuelle et pourtant aseptisée de « grand écrivain ». La journaliste a toutefois semé par ci par là quelques graines de tendresse à l’égard de l’ancien directeur du Figaro (1974-1977), en évitant ainsi les pièges du cynisme. C’est peut-être cet adoucissement humaniste de la critique qui a trompé l’œil habituellement plus sagace du philosophe marxiste Yvon Quiniou sur son blog de Mediapart (1).
Yvon Quiniou voit étrangement dans ce second degré démythologisant « un panégyrique », une « apologie » et de « la complaisance ». Est-ce que ne sont pas pointés plutôt, avec l’air de ne pas y toucher, des mécanismes traversant le champ économique, le champ journalistique, le champ politique et le champ intellectuel pour édifier de son vivant la statue d’un « écrivain national », selon l’expression d’Ariane Chemin ? Une statue qui apparaît assez bien adaptée à l’air du temps national-étatiste qui fait des progrès de l’extrême droite à la gauche sociale-libérale, du sarkozysme à la gauche radicale.
En m’arrêtant sur le 22 février 1969, alors que Jean d’Ormesson (né le 16 juin 1925) est intervenu dans le débat qui a suivi une conférence de Michel Foucault (15 octobre 1926-25 juin 1984) à la Société française de philosophie sur le thème « Qu’est-ce qu’un auteur ? » (2), je voudrais prolonger l’interrogation ironique. D’Ormesson a alors 43 ans et Foucault 42.
Qu’est-ce qu’un auteur selon Foucault ?
La conférence de Michel Foucault nous offre un outillage méthodologique majeur nous permettant de nous déplacer par rapport à l’histoire traditionnelle des idées. Elle ouvre une interrogation radicale quant à un présupposé prégnant dans l’histoire des idées, de la philosophie et de la littérature : « l’unité première, solide et fondamentale, qui est celle de l’auteur et de l’œuvre » (p. 820) Elle questionne cette évidence : « Parmi les millions de traces laissées par quelqu’un après sa mort, comment peut-on définir une œuvre ? » (p. 822) Elle identifie alors une fonction à la notion d’auteur :
« un nom d’auteur n’est pas simplement un élément dans un discours (qui peut être sujet ou complément, qui peut être remplacé par un pronom, etc.) ; il exerce par rapport aux discours un certain rôle : il assure une fonction classificatoire ; un tel nom permet de regrouper un certain nombre de textes, de les délimiter, d’en exclure quelques-uns, de les opposer à d’autres. » (p. 826)
Cette fonction de classification des idées autour de la notion moderne d’« individu » postule alors de l’unité : « L’auteur, c’est également le principe d’une certaine unité d’écriture […] un point à partir duquel les contradictions se résolvent » (p. 830). La même année, Foucault parlera dans son livre L’archéologie du savoir, à propos justement de notions comme « auteur » et « œuvre », de « synthèses toutes faites » et de « continuités irréfléchies » (3).
Questionner les notions d’« auteur » et d’« œuvre », casser leur évidence, interroger leur fonction ne suppose pas nécessairement les abandonner. Il écrit encore dans L’archéologie du savoir :
« Ces formes préalables de continuité, toutes ces synthèses qu’on ne problématise pas et qu’on laisse valoir de plein droit, il faut donc les tenir en suspens. Non point, certes, les récuser définitivement, mais secouer la quiétude avec laquelle on les accepte » (4).
Ce qui permet aussi d’envisager, dans l’enquête historique, d’autres découpages des idées que ceux organisés autour d’« auteur » et d’« œuvre ».
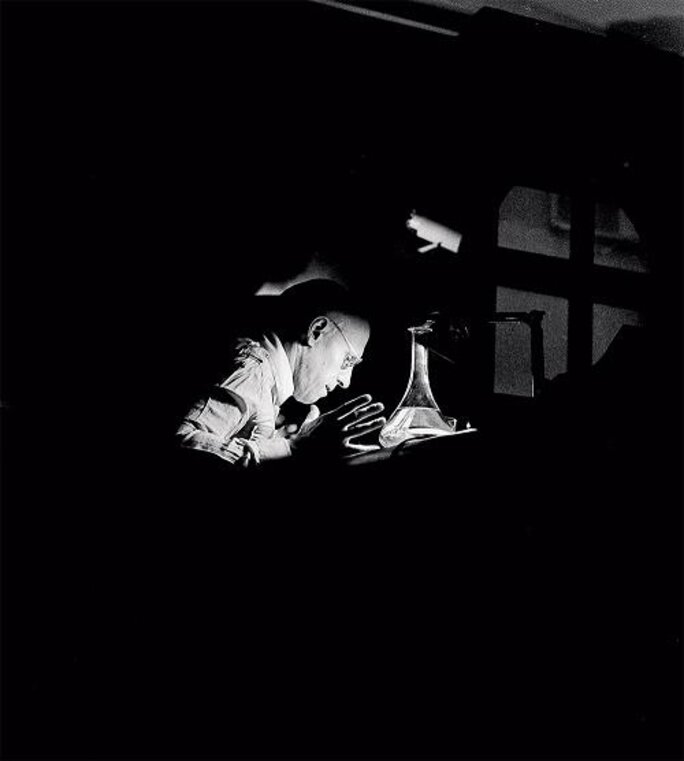
De la force intellectuelle du Champomy ou d’Ormesson interrogeant Foucault
Face à l’association de la rigueur et de l’audace intellectuelles chez Foucault, d’Ormesson, pourtant normalien et agrégé de philosophie, incarnera la superficialité condescendante du genre « je n’ai rien compris, je n’ai rien à dire, mais je le dirais quand même, car je suis Jean d’Ormesson… » Il prend alors la parole le premier après la conférence de Foucault. C’est le moment Champomy de la Société française de philosophie ce jour-là, après la discussion redeviendra sérieuse. Il lance donc avec l’impétuosité du méconnaissant de la Haute :
« Dans la thèse de Michel Foucault, la seule chose que je n’avais pas bien comprise et sur laquelle tout le monde, même la grande presse, avait mis l’accent, c’était la fin de l’homme. Cette fois, Michel Foucault s’est attaqué au maillon le plus faible de la chaîne : il a attaqué, non plus l’homme, mais l’auteur. Et je comprends bien ce qui a pu mener, dans les événements culturels depuis cinquante ans, à ces considérations : "La poésie doit être faire par tous", "ça parle", etc. Je me posais un certain nombre de questions : je me disais que, tout de même, il y a des auteurs en philosophie et en littérature. On pourrait donner beaucoup d’exemples, me semblait-il, en littérature et en philosophie, d’auteurs qui sont des points de convergence. Les prises de position politique sont aussi le fait d’un auteur et on peut les rapprocher de sa philosophie.
Eh bien, j’ai été complètement rassuré, parce que j’ai l’impression qu’en une espèce de prestidigitation, extrêmement brillante, ce que Michel Foucault a pris à l’auteur, c’est-à-dire son œuvre, il le lui a rendu avec intérêt, sous le nom d’instaurateur de discursivité, puisque non seulement il lui redonne son œuvre, mais encore celle des autres. » (p. 840)
D’Ormesson n’a pas compris pourquoi et comment Foucault interroge la notion d’auteur. Trop compliqué pour une intelligence bornée, surtout fascinée par le miroitement des apparences ! Mais ça ne lui plaît pas. Surtout que l’ambition d’être un jour reconnu comme « un grand auteur » a peut-être déjà commencé à germer en lui, si l’on suit le portrait d’Ariane Chemin. Un certain « esprit français » voit beaucoup les choses intellectuelles à travers un filtre narcissique !
Et comme le rigoureux lui semble impénétrable, c’est de ses propres travers que le futur académicien (à partir de 1973) affuble Foucault (« prestidigitation, extrêmement brillante »). Car « l’esprit français » entendu en un sens d’ormessonien, c’est bien l’hégémonie du brillant sur le rigoureux, jusqu’à même l’élimination du second.
Par ailleurs, le futur directeur général du Figaro n’oublie pas de glisser subrepticement un petit rappel codé quant à « la menace communiste » : « La poésie doit être faire par tous ». Brrr ! Le collectivisme est à nos portes…On est juste après mai 1968, et la frayeur de l’arrivée des chars soviétiques à Paris fait encore frissonner les salons mondains.
Enfin, il achève son ridicule par une pirouette censée effacer d’un trait d’esprit la conférence de Foucault : « ce que Michel Foucault a pris à l’auteur, c’est-à-dire son œuvre, il le lui a rendu avec intérêt, sous le nom d’instaurateur de discursivité, puisque non seulement il lui redonne son œuvre, mais encore celle des autres ». Un bon mot remplace un raisonnement !

Foucault répond gentiment mais fermement
L’arrogance d’aristo de la conceptualisation en trompe l’œil n’impressionne guère Foucault. Mais il demeure civil dans une réponse qui cherche simplement à remettre le problème sur les rails de la discussion théorique initiale. La pause Champomy, c’est fini !
Il rappelle tout d’abord : « je n’ai pas dit que l’auteur n’existait pas » (p. 845). Et il reprécise :
« Et ce que j’ai essayé d’analyser, c’est précisément la manière dont s’exerçait la fonction-auteur, dans ce qu’on peut appeler la culture européenne depuis le XVIIe siècle. […] Définir de quelle manière s’exerce cette fonction, dans quelles conditions, dans quel champ, etc., cela ne revient pas, vous en conviendrez, à dire que l’auteur n’existe pas. » (p. 845)
Dans cette rectification bienveillante, l’humour n’est pas nécessairement l’ennemi de la rigueur :
« Il ne s’agit pas d’affirmer que l’homme est mort, il s’agit, à partir du thème – qui n’est pas de moi et qui n’a cessé d’être répété depuis la fin du XIXe siècle - que l’homme est mort (ou qu’il va disparaître, ou qu’il sera remplacé par le surhomme), de voir de quelle manière, selon quelles règles s’est formé et a fonctionné le concept d’homme. J’ai fait la même chose avec la notion d’auteur. Retenons donc nos larmes. » (p. 845)
Et face à « Jean d’O », retenons nos rires !
De la bêtise d’un certain « esprit français »
« L’esprit français » qu’exprime presqu’à la perfection d’Ormesson face à Foucault le 22 février 1969, c’est la prétention sans la raison, la fatuité sans l’argumentation, la légèreté sans le concept, la rebellitude de salon avec le conformisme. Ce sont des bulles de champagne pétillantes qui diraient à la fois un style de vie et une intelligence préférant éviter de se coltiner le réel. Dans la variante « Jean d’O » l’humour conservateur apparaît hésitant et gentillet, ce n’est pas du Sacha Guitry…
Le grand écrivain autrichien Robert Musil a perçu dans ce type de rapport aux choses intellectuelles une nouvelle forme supérieure de « bêtise », distincte de ses modalités classiques :
« Entre cette bêtise honnête et l’autre, la supérieure, la prétentieuse, le contraste n’est souvent que trop criant. Cette bêtise là est moins un manque d’intelligence qu’une abdication de celle-ci devant des tâches qu’elle prétend accomplir alors qu’elles ne lui conviennent pas » (5).
Et d’ajouter :
« Elle peut affecter jusqu’à la plus haute intellectualité ; car, si la bêtise authentique est une artiste paisible, la bêtise intelligente, qui contribue à la mobilité de la vie de l’esprit, entraîne surtout son instabilité et sa stérilité. » (6)
Foucault, c’est bien autre chose. C’est l’intelligence critique la plus discutée aujourd’hui de par le monde en philosophie, sciences humaines, études littéraires et cinématographiques, etc. Une pensée-boîte à outils mouvante, ouverte et composite, qui s’est certes forgée dans un cadre français mais à travers d’incessants échanges internationaux. Pas grand-chose à voir avec le fameux « esprit français » encensé par les nationalistes et les politiciens en quête de gauloiseries !

De d’Ormesson à Zemmour : le vide en marche forcée
Vous me direz que, pourtant, entre le vide intellectuel incarné ici par Jean d’Ormesson et celui d’un Eric Zemmour aujourd’hui, il y a un écart abyssal, non ? En tout cas, si l’on demeure dans la zone conservatrice balisée par Le Figaro. Oui, il y a bien des degrés très variables dans « la bêtise intelligente ». « Jean d’O », c’est à la fois une élégance et le maintien de repères humanistes minimaux. Zemmour, c’est un aboyeur piétinant la dignité de ses frères humains. D’Ormesson, c’est seulement du vide intellectuel ; Zemmour, c’est une infection destructrice tout à la fois du raisonnement et d’êtres concrets qui sont nos semblables.
Notes :
(1) Y. Quiniou, « Le Monde et Jean d’Ormesson », Mediapart, 24 août 2016, https://blogs.mediapart.fr/yvon-quiniou/blog/240816/le-monde-et-j-dormesson.
(2) M. Foucault, conférence « Qu’est-ce qu’un auteur ? » suivi du débat, publiée initialement dans le Bulletin de la Société française de philosophie en juillet-septembre 1969, repris dans Michel Foucault, Dits et écrits I, 1954-1975, Paris, Gallimard, collection « Quarto », 2001, pp. 817-849.
(3) M. Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 32 et 36.
(4) Ibid., p. 37.
(5) R. Musil, De la bêtise (conférence de mars 1937), Paris, Éditions Allia, 2000, p. 45.
(6) Ibid., pp. 45-46.



