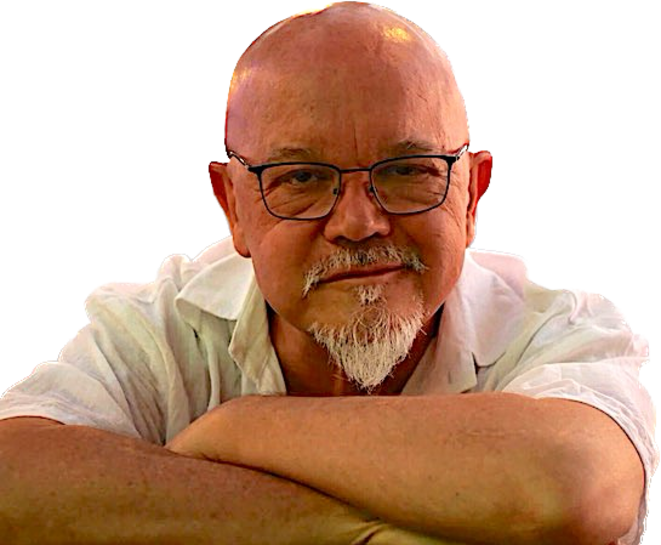De quoi parle t-on ?
La quasi totalité des formations dans le Primaire, se fait en dehors des heures de cours. Les enseignants du premier degré sont tenus d’assurer l’ensemble de l’année scolaire un service de 24 heures par semaine. À cela s’ajoutent 108 heures annuelles (soit 3 heures par semaine en moyenne) pour accomplir d’autres missions dont notamment la formation en présentiel ou à distance.
Cette interpellation concerne donc essentiellement l’enseignement secondaire. Les enseignants peuvent être concernés par des formations proposées par le Rectorat dans le cadre d’un Plan Annuel de Formation (PAF) ou bien encore de moments destinés à se coordonner quand ils sont conseillers pédagogiques et qu’ils accueillent des stagiaires ou des étudiants. Le ministre évoque aussi les réunions pédagogiques. Au sein des établissements ce sont les conseils de classe, les réunions de coordinations disciplinaires et autres discussions nécessaires à la vie de l’établissement, etc. A cela, il faut rajouter les convocations des professeurs pour les différents examens et concours pour lesquels ils sont membres de jurys.
Gabriel Attal met tous ces différents éléments dans le même sac alors qu’ils obéissent à des logiques différentes. Et, alors qu’il déclare toujours à la Réunion qu’il présentera un « plan global de reconnaissance du métier d’enseignant » (16/08), il laisse donc entendre dans le même mouvement que les enseignants ne travaillent pas assez et qu’ils n’ont pas besoin de formation...
Ne pas tout confondre
En premier lieu, le chiffre donné en pâture à la presse de plusieurs « millions d’heures » peut et doit être questionné et relativisé. Certes, on estime à un tiers des heures d'absence qui le sont pour cause "institutionnelle" (formation, concours etc) mais cela ne doit pas faire oublier que les autres absences le sont parce qu’il n’y a pas de remplaçants (15,4 millions d’heures selon le ministère). Et on peut douter que le dispositif des remplacements de courte durée par le « Pacte » soit la solution tant la composition des emplois du temps rend complexe ce dispositif. Et d’ailleurs, c’est aussi ce qui explique que les absences dans le second degré soient moins préjudiciables aux élèves puisqu’il ne s’agit de quelques heures éparpillées dans une semaine.
Pour revenir sur les différentes causes d’ « absences », il faut rappeler que les réunions pédagogiques, conseils de classe ou d’administration, commissions diverses, etc., se déroulent déjà hors du temps de présence devant les élèves.
Les absences pour cause d’examens et de jurys se concentrent surtout sur la fin de l’année et rendent la reconquête du mois de juin difficile. Au passage, on soulignera que les épreuves anticipées du bac placées en mars n’ont pas arrangé les choses.
Les convocations pour formation étaient à l’origine de 1,5 million d’heures non remplacées en 2020-2021, selon le ministère, soit moins de 10 % des 15,4 millions qui n’étaient pas assurées Le temps moyen de formation dans le second degré ne s’élève cependant qu’à 1,6 jour par an par enseignant. L’OCDE dans ses différentes analyses du système éducatif pointait d’ailleurs le faible volume de la formation des enseignants alors que c’est une des clés de l’évolution de l’École.
Sortir des ambiguïtés
Dans aucun métier, la formation professionnelle ne se déroule hors du temps de travail, puisqu’elle est justement considérée comme partie intégrante de celui-ci. C’est ce que prévoit le code du travail.
Une première ambiguïté vient du fait que le temps de travail des enseignants comprend deux dimensions : le temps devant élèves et le temps hors élèves. Celui-ci est difficile à mesurer mais les données recueillies par le service statistique du Ministère (la DEEP) montrent que les enseignants travaillent déjà en moyenne 43 heures par semaine dans le primaire, et 42 heures dans le secondaire, soit bien plus que la durée légale.
La deuxième ambigüité réside dans la confusion entre congé des enseignants (qui sont les mêmes que pour les autres salariés et vacances scolaires. J’ai déjà souligné que cette distinction était difficile à faire entendre aux enseignants et qu’elle rendait difficile la perception du temps de travail des professeurs par l’opinion publique. Dans un contexte de crispation et de perte de pouvoir d’achat, la question des vacances est un sujet sensible et joue dans le peu d’attractivité du métier qui reste. Toucher aux vacances c’est s’attaquer une fois de plus à une profession bien malmenée. Comme je le disais dans dans un précédent billet de blog, je suis sûr que si les enseignants étaient bien payés, avec des conditions de travail correctes, la question de la réduction des vacances (des élèves) serait vue différemment. On peut cependant rappeler que les enquêtes montrent également que les enseignants du second degré déclarent travailler en moyenne près de 20 jours pendant leurs congés, à raison d’un jour et demi pendant chaque période de vacances et de 8 jours pendant les grandes vacances.
Le temps de travail des enseignants français est donc déjà important et comparable à celui des autres pays. Pourquoi vouloir les faire travailler plus ?
Une triple erreur
Vouloir s’attaquer à la formation des enseignants en la basculant sur les vacances et les jours où il n’y a pas cours est une triple erreur.
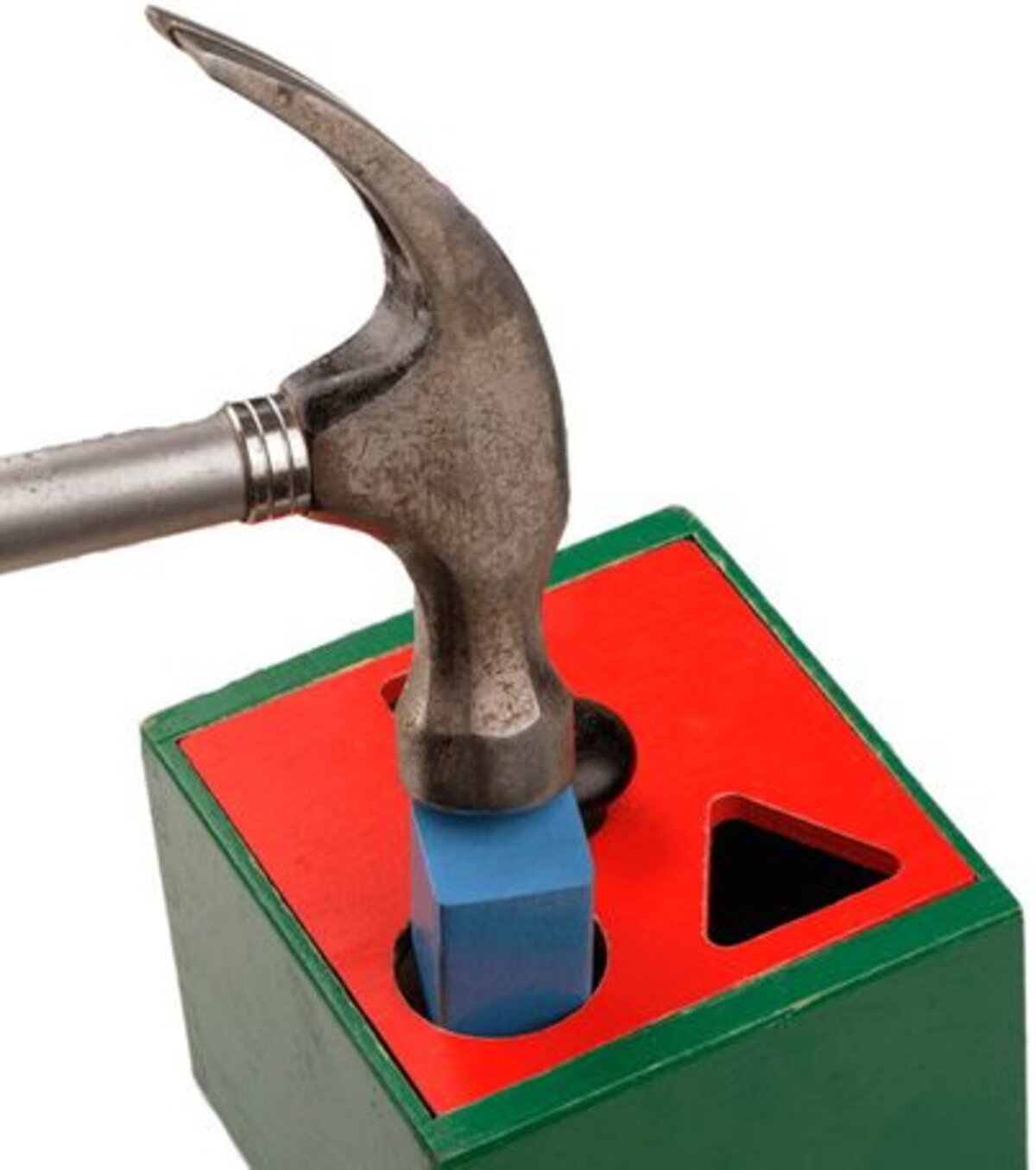
C’est d’abord une erreur organisationnelle qui montre la méconnaissance du terrain. Dans le second degré, la complexité des emplois du temps empêche d’organiser des temps de formation pour tous dans les conditions actuelles. Sans compter le temps des formateurs (à moins de vouloir des formateurs sans élèves…). On peut douter qu’il y ait beaucoup de candidats pour des formations dans ces conditions impossibles. A terme, cela risque d’aboutir à leur suppression
C’est d’ailleurs pour cela que c’est aussi une erreur en termes de ressources humaines. Comme nous l’évoquions plus haut, les études internationales montrent que la France est très en retard en matière de formation des enseignants. Il faudrait plutôt augmenter le temps de formation et en revoir les contenus (ce pourrait être le sujet d’un autre billet de blog)
C’est enfin une erreur de communication et une erreur politique. Gabriel Attal, pourtant présenté comme un grand communicant commence son mandat par un message ambigu auprès des enseignants. laissant entendre qu’ils n’ont pas besoin d’être formés et qu’ils ne travaillent pas assez. On fait mieux comme « reconnaissance du métier d’enseignant » !
L’erreur politique consiste aussi à mettre la barre très haut sur les attentes concernant les remplacements des enseignants. Les promesses étaient fortes puisque le président Macron a affirmé à Nouméa qu’« il y aura un professeur devant chaque classe à la rentrée » et semble vouloir faire de l’«absentéisme» des enseignants une cause nationale. On peut émettre les plus grands doutes sur le dispositif choisi (« pacte ») en l’absence de recrutement d’enseignants pour y parvenir.
Le front ouvert par Attal sur les heures « perdues » pour cause de réunions et de formations va dans le même sens et risque de se heurter aux mêmes limites.
Tout cela sera scruté à la rentrée et risque de créer de la déception quand on se rendra compte qu’il ne suffit pas d’un claquement de doigts pour faire changer des choses. Alors qu’une réelle connaissance du terrain aurait permis de prendre la mesure de la complexité.
La leçon politique c’est de ne jamais promettre ce qu’on ne peut tenir !