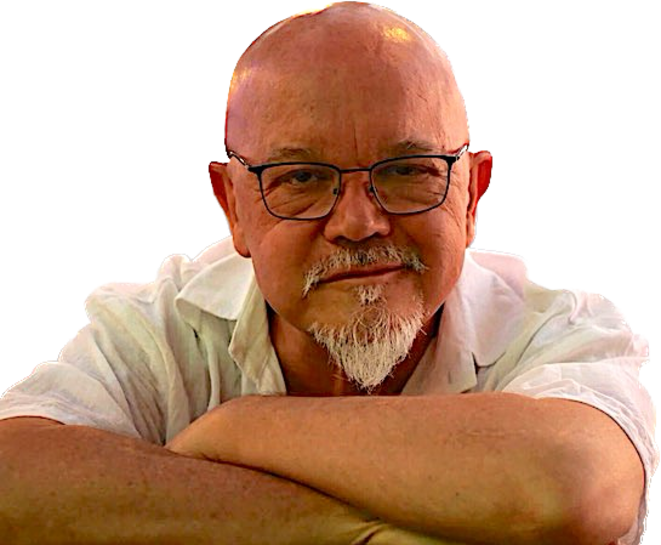Dans sa visite à Marseille, Emmanuel Macron a consacré une grande partie de son temps au sujet de l’École avec un Ministre muet à ses côtés. Le 27 juin il a questionné la durée des vacances scolaires. « On a des enfants qui ont parfois deux mois et demi de vacances, quelques-uns près de trois mois », s'étonne le chef de l'État. « On doit rouvrir un débat sur le temps scolaire dans l'année, qui est une des autres grandes hypocrisies françaises », exige Emmanuel Macron.
« Quand on a des vacances de trois mois, l'inégalité revient. ». A la rentrée de septembre, énonce le Président, les élèves « reviennent avec les compétences qu'ils avaient un mois à un mois et demi avant l'arrêt des cours: on détruit en quelque sorte de l'apprentissage collectif. » Selon lui, « la conséquence de cela, c'est qu'on bourre les semaines de nos enfants, qui arrivent crevés tous les soirs ». Il veut aussi qu’ils restent plus longtemps au collège mais on n’est pas à une contradiction près...
Sur les effets des vacances, il s’appuie notamment son raisonnement, semble t-il, sur une note d’information d’avril 2023 de la DEPP, le service statistique du Ministère de l’Éducation Nationale. Celle ci montre qu’« alors que l’année de CP permet de réduire les écarts de performances entre secteurs de scolarisation, les vacances scolaires les accentuent ». L’étude analyse les résultats en Français et en Mathématiques . En début d’année, l’écart entre les résultats des élèves en zone d’éducation prioritaire et des autres est de 20 points. Cet écart se réduit pendant l’année (13 points en calcul, 5 points en écriture) Toutefois, après les grandes vacances, les inégalités de niveau se creusent à nouveau, (16 points et 7 points) car tous les élèves ne sont pas accompagnés de la même manière pendant les vacances.
Gesticulation et détournement d’attention
Cette analyse semble fondée même s’il ne s’agit que d’une seule étude portant sur le Cours Préparatoire. Mais que le président s’en empare n’est pas dénué d’intentions politiques.
Il faut rappeler qu’Édouard Philippe avait remis ce sujet dans l’actualité au début du mois de juin dans des termes assez voisins. Avec une perspective différente, Yannick Jadot avait lui aussi posé la question des rythmes scolaires dans la campagne présidentielle.La parole présidentielle peut donc se lire comme un moyen de border son ancien premier ministre.
Mais tout cela est surtout à envisager dans la volonté présidentielle de rebondir sur d’autres sujets après la « séquence » des retraites. La traduction de cette déclaration peut être plus ou moins celle ci : « je veux faire diversion sur plein de sujets pour que la colère sociale se disperse au lieu de continuer à ne pas digérer la réforme des retraites »
Mémoire courte
Comme à son habitude, Emmanuel Macron, consulte peu. Que ce soit sur les vacances scolaires ou sur le temps de présence dans les établissements, ses propos d’estrade se font sans concertation et sur un mode péremptoire.
S’il reconnait volontiers que ce débat ne se règle pas en un jour ni en un an, il oublie qu’il a déjà eu lieu et il en néglige la complexité.
Rafraichissons la mémoire du président et de tous ceux qui commentent de manière immédiate. En juin 2010, le Ministre Luc Chatel installe un comité de réflexion sur les rythmes scolaires. Ce comité co-présidé par Christian Forestier, et Odile Quintin auditionnera les syndicats, parents d'élèves, lycées, autorités religieuses, professionnels du tourisme et des scientifiques. Parallèlement une consultation nationale était mise en place par le biais de débats dans les académies, collèges et lycées. On y aborde toutes les dimension des rythmes : journée, semaine et année.
Mais le premier ministre est (excessivement ?) prudent face aux différentes contraintes et reporte à 2014 (après les élections !) l’application des recommandations. Pourtant du côté des syndicats, des collectivités territoriales et des associations, un consensus semble se dessiner. Il est exprimé dans l’appel de Bobigny (2010-2011).

Agrandissement : Illustration 1
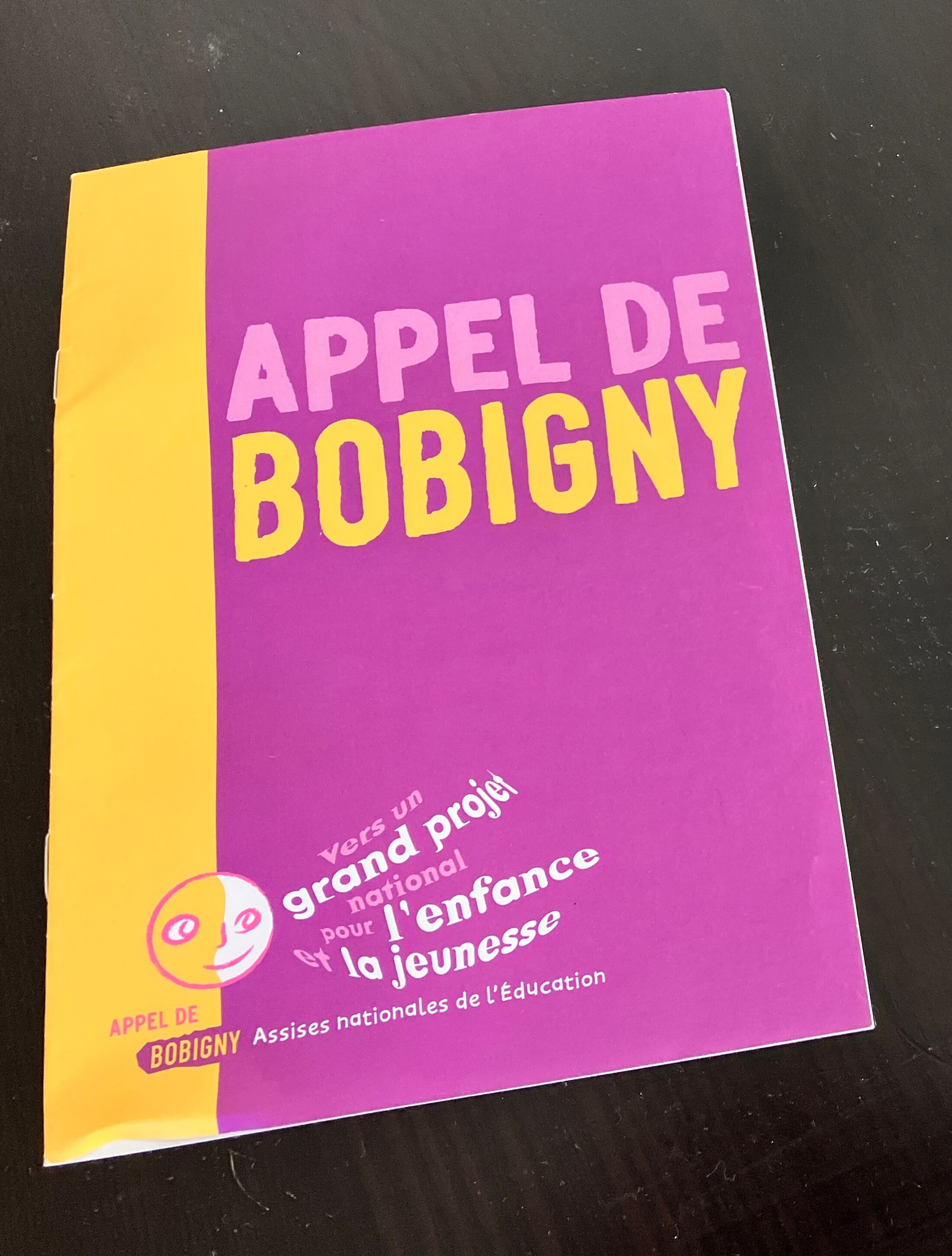
Celui porte sur un projet global de l’enfance mais la question des rythmes y a une place importante. Il milite pour un allègement de la journée de travail et son adaptation aux temps favorables aux apprentissages. Il mériterait d'être relu aujourd'hui
En 2012, le nouveau ministre de l’éducation va dans ce sens. En s’appuyant sur les travaux de 2010 et sur une concertation durant l’été, on s’achemine vers une semaine de cinq jours et un rééquilibrage de l’année avec des petites vacances toutes les sept semaines.
Mais le consensus s’effrite assez vite. C’est d’abord le produit de la pusillanimité du Premier Ministre Jean-Marc Ayraut qui recule devant les réticences de certaines communes. Celles ci craignent des dépenses supplémentaires et des problèmes d’organisation. Il y a aussi une instrumentalisation politique. On la retrouve aussi dans la posture de certains syndicalistes qui voient là l’occasion de se positionner dans des débats internes et de remettre sur le tapis la question de la revalorisation (une matinée en plus ce sont des dépenses supplémentaires).
Progressivement, les villes vont repasser à quatre jours. L’arrivée de Jean-Michel Blanquer va mettre fin à cette expérience sans qu’on en tire le bilan. Comme souvent dans les débats sur l’École, les décideurs ont la mémoire courte et oublient les travaux précédents. Les débats sur l’École sont un éternel recommencement...
De multiples contraintes contradictoires
Ce petit rappel historique nous montre bien la complexité de ce dossier. La proposition simpliste et réductrice de réduction des vacances d’été oublie de nombreux autres paramètres qui étaient pourtant au cœur des propositions précédentes : journée, semaine, année mais aussi rôle des enseignants et des collectivités territoriales.
Car le rythme scolaire en France est paradoxal. Il est marqué par la densité. Il y a 864 heures de cours (contre 769 h en moyenne ailleurs) mais 144 jours de classe contre 185 à 190 dans les autres pays de l’OCDE ! D’autres pays ont plus de vacances que nous ! Il y a donc en France 36 semaines de classe et 16 semaines de vacances dans le Primaire. Il ne s’agit pas de faire plus mais mieux. S’agit-il de rester plus longtemps le derrière assis sur une chaise pour mieux apprendre ? Peut-on négliger la question des programmes (encyclopédiques) et de la manière dont on enseigne. L’obsession des « fondamentaux » semble réduire toutes réflexions pédagogiques.
S’il est vrai que la durée des vacances crée des inégalités, les moyens de les résoudre ne se limitent pas à des solutions quantitatives et encore moins en tenant à l’écart l’enfant de sa famille et en négligeant les associations complémentaires. C’est pourtant ce que laisse entendre Emmanuel Macron avec sa proposition d’augmenter le temps de présence au collège comme avec l’allongement de l’année scolaire.
Il y a aussi une tension entre l’intérêt et les besoins de l’enfant et les contraintes familiales (parents divorcés, enfants à différents niveaux de scolarité), les contraintes économiques (l’industrie du tourisme), les questions d’organisation des établissements.
Il ne faut pas non plus négliger les nouvelles contraintes climatiques qui pèsent sur le bâti scolaire qui est peu adapté aux fortes chaleurs.
Vacances des élèves et congés des enseignants
Une autre contrainte est évidemment celle du temps de travail des enseignants.
Celui-ci est défini par les Obligations réglementaires de service (ORS). Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 108 heures annuelles de formation et de concertation et d’aide au travail personnel.
Pour les personnels du second degré les maxima de service dépendent des grades et statuts (certifiés, agrégés, profs doc, CPE…) sur une base hebdomadaire. Dans les enquêtes réalisées, les profs du second degré déclarent travailler plus de 40 heures par semaine en moyenne. Les enquêtes montrent également que ceux ci travaillent pendant au moins la moitié des vacances des élèves.
Lors du débat sur la pseudo revalorisation des enseignants, on a souvent entendu la réplique « oui, mais il y a les vacances… ! » Pour la bonne compréhension du débat, il faudrait distinguer les vacances scolaires (des élèves) et les congés des enseignants Ces derniers sont théoriquement les mêmes que pour les autres salariés. Cette subtilité est difficile à exprimer auprès des enseignants. Et il est tentant pour les adeptes du « prof bashing » de laisser entendre que c’est un sacré avantage dont bénéficieraient ces faignants de profs. Je ne suis pas sûr que cette dimension de remise en cause soit absente du débat relancé par le président de la République.
Dans un contexte de crispation et de perte de pouvoir d’achat, la question des vacances est un élément de négociation. Toucher aux vacances c’est s’attaquer une fois de plus à une profession bien malmenée. Cette question ne peut être évacuée au nom d’un intérêt de l’enfant qui mériterait d’être envisagé d’une manière bien plus large comme j’ai essayé de le montrer. S’il doit y avoir une discussion, il faut que ce soit dans le cadre d’une remise à plat globale.
Je suis sûr que si les enseignants étaient bien payés, avec des conditions de travail correctes, la question de la réduction des vacances (des élèves) serait vue différemment. Mais là, ces «vacances » sont un des éléments du deal et jouent dans le peu d’attractivité qui reste !
La question des vacances scolaires est un sujet trop sérieux pour être décidé par le seul président. Cela ne peut pas se limiter à des propos de tribune destinés à détourner l’attention d’autres enjeux.
C’est un sujet qui mérite de tenir compte des nombreux travaux des spécialistes et de l’intelligence collective déjà produite dans les concertations qui ont eu lieu avec tous les acteurs. On doit aussi tenir compte des différentes contraintes légitimes qui pèsent sur ce dossier. Sinon, ce ne sera que de la gesticulation politicienne.
Philippe Watrelot
le 29 juin 2023