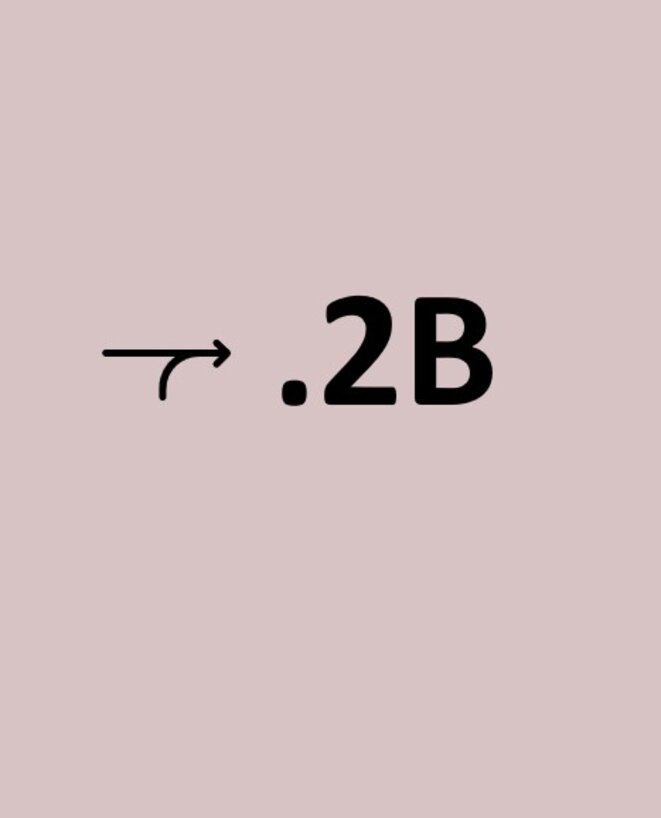Le coup d’Etat au Niger du 26 juillet dernier a amené les commentateurs sollicités par Mediapart[i] à utiliser des grilles de lecture qui toutes mentionnent le concept de Françafrique. Ce mot valise, d’abord utilisé dans un sens positif, a été popularisé par F.-X. Verschave dans une acception qui souligne le caractère néocolonial et en partie occulte des relations établies entre la France et les Etats de son ancien pré carré africain[ii]. C’est une réalité historique indéniable mais qui fait l’objet d’un refoulement polymorphe et sophistiqué de la part des institutions françaises[iii]. La fin de la Françafrique est une arlésienne bien connue du discours des responsables français. Faire et ne pas reconnaître est un habitus usuel des hommes politiques, surtout quand ils dirigent des Etats qui ont l’ambition de conserver leur rang dans la hiérarchie des puissances. Les divergences d’analyse sont presque plus étonnantes, tout en restant prévisibles, s’agissant des intellectuels qui disposent tous d’une documentation très riche mettant en évidence les turpitudes françafricaines, toujours d’actualité. Pour les uns, la Françafrique est morte depuis longtemps, et les événements du Niger ne font que le confirmer[iv] ; pour les autres, ces mêmes événements entrent dans l’histoire longue d’un cadre néocolonial qui en a vu bien d’autres, comparables[v].
Pour se faire une opinion, peut être faut-il d’abord s’entendre sur ce qu’est la Françafrique. Il faudrait alors se défaire d’une vision caricaturale d’un système tout puissant qui aurait permis de maintenir l’empire français comme si rien n’avait changé depuis les indépendances. La Françafrique c’est d’abord une politique étrangère impérialiste et occulte, masquant son emprise sous le masque de la coopération et de l’aide publique au développement. L’important est de comprendre que ce système connaît des succès et des revers depuis ses origines. Une fois posé ce cadre, comment analyser les événements du Niger ? Comme un revers, assurément, qui confirme la période de difficulté, voire la crise finale[vi], que traverse la diplomatie française en Afrique de l’Ouest, mais pas la fin d’une politique qui caractérise l’Etat profond français. De ce point de vue, on ne peut que donner raison à Amzat Boukari-Yabara qui souligne la continuité françafricaine, tendance néo-sarkozyste dans son volontarisme d’une maladresse insigne, des quinquennats Macron, allant adouber Mahamat Idriss Déby au Tchad et condamnant le putsch des généraux au Niger[vii].
La Françafrique subit des revers, doit composer avec la colère des peuples et l’instrumentalisation de cette colère par des putschistes dont on peut douter de la réelle volonté de changer la gouvernance de leur pays[viii]. Elle doit lutter contre les autres impérialismes pour garder son rang et ne se gêne pas pour instrumentaliser à son tour l’épouvantail russe ou le péril chinois afin de masquer ses propres turpitudes[ix]. Mais elle garde des points d’appui sur le continent, des réseaux et des alliés et surtout, elle continue d’être le paradigme d’un Etat profond qui ne veut pas faire son deuil d’un statut de puissance qu’il n’a plus les moyens d’incarner et auquel beaucoup de citoyens, bien informés de son coût humain et politique[x], ne veulent plus qu’il s’accroche.
[i] Voir la une du 7 août qui s’ouvre sur deux dossiers, portant sur la Françafrique pour le premier et sur le Niger pour le deuxième : Mediapart - Actualité, enquêtes et dossiers d’investigation en toute indépendance !
[ii] Sur la genèse du concept, voir Thomas Borrel et al., dir., L’empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Seuil, 2021, « ‘Françafrique’ : le destin méconnu d’un néologisme », p. 22. L’empire qui ne veut pas mourir est une somme indispensable sur la question. Il est toujours utile de se référer à l’ouvrage pionnier et toujours de référence de F.-X. Verschave, Françafrique. Le plus long scandale de la république, Stock, 1998.
[iii] Ibid., « Introduction. Françafrique, la mort lui va si bien », p. 9-22. Voir également le dossier « La Françafrique. Un néocolonialisme français », à paraître prochainement dans les Cahiers d’Histoire. Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique (openedition.org)
[iv] C’est l’avis tranché de de Rahmane Idrissa : « Je ne crois pas en la pertinence du concept de Françafrique, mais, dans la mesure où il voulait dire quelque chose – je suppose une certaine collusion malfaisante entre élites dirigeantes en France et en Afrique –, cela a depuis longtemps cessé d’être une réalité opératoire. », dans « Une “politique africaine” zombie, sans boussole politique et éthique » | Mediapart . Dans une perspective plus nuancée qui souligne surtout l’instrumentalisation de la colère des peuples, voir l’entretien d’Elgas : « La France devient pour beaucoup l’exutoire tout trouvé » | Mediapart
[v] Sur l’Afrique, Emmanuel Macron « fait du neuf avec du vieux » | Mediapart, entretien avec Amzat Boukari-Yabara, un des quatre coordinateurs de Un empire qui ne veut pas mourir, op. cit.
[vi] La fin de « l'armée d'Afrique » ?, par Philippe Leymarie (Les blogs du Diplo, 2 août 2023) (mondediplo.net)
[vii] Amzat Boukari-Yabara, article cité plus haut.
[viii] Adamou Gado Ramatou, « Niger : le coup d’Etat augure des lendemains incertains pour le pays », The Conversation, 4 août 2023.
[ix] Aveugle, sourde aux critiques et inaudible : les trois handicaps de la France au Niger | Mediapart
[x] Le premier trimestre de 2023 au prisme de l’héritage colonial | Le Club (mediapart.fr)