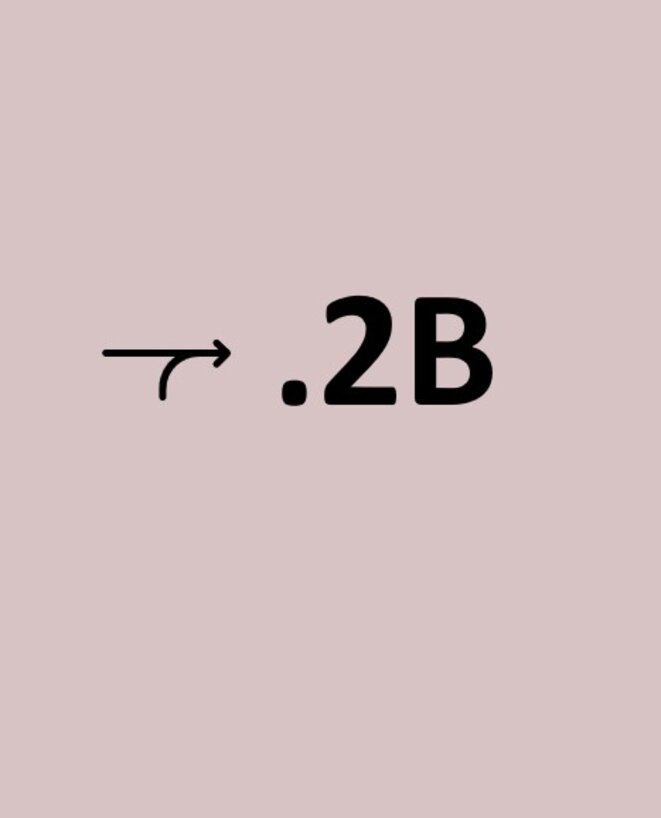Professeur à l’université de Chicago, Mearsheimer rappelle dans cet article[i] que l’on distingue deux courants de pensée principaux s’agissant des relations internationales. Le libéralisme les conçoit comme la convergence souhaitée, voire inévitable dans une vision messianique de la géopolitique, des Etats du monde vers le modèle démocratique, capitaliste, occidental. Ce courant offre une vision occidentale très autocentrée de la marche du monde. Au contraire, le courant réaliste envisage le fonctionnement des Etats comme un jeu sérieux, dont il faut comprendre les règles qui s’imposent à tous ses participants. Dans une démarche que l’on pourrait qualifier de structuraliste[ii], il dégage les principes élémentaires qui régissent le comportement des Etats. J’en donne ici un petit vadémécum :
1- Les Etats cherchent à satisfaire leurs propres intérêts.
2- Ils entrent en compétition, ce qui n’exclut pas des formes de coopération quand ces dernières sont possibles et ne vont pas à l’encontre des intérêts.
3- Dans un monde où il n’y pas d’organisation supranationale apte à régler les conflits et où les forces militaires sont capables de détruire l’adversaire, la peur de disparaître est le moteur basique de la conduite des affaires.
4- Tout pays en capacité de le faire, aspire à devenir la puissance régionale de son hinterland. Les puissances régionales rivalisent à leur tour pour devenir la puissance hégémonique à l’échelle mondiale.
5- Tous les Etats étant engagés dans cette structure qui s’impose à tous les acteurs, les démocraties ne se comportent pas différemment en réalité des systèmes autoritaires, dans leurs relations internationales. Elles vont en revanche avoir tendance à justifier la défense de leurs intérêts au nom de valeur qualifiées d’universelles.
6- Dans ce cadre, les instances multilatérales ne sont pas inutiles mais elles ne peuvent au mieux, qu’atténuer les rivalités.
7- Ces rivalités se concentrent sur des zones géostratégiques (l’Ukraine aujourd’hui, comme le notait déjà Brzezenski dans un ouvrage qui fit date[iii]).
Cette grille de lecture semble la plus opératoire pour comprendre la marche du monde, entre l’effondrement de l’URSS en 1991 et la nouvelle guerre froide qui oppose le bloc occidental au duopole Chine – Russie, sous l’œil désabusé du Sud global. Elle donne à comprendre les deux formes d’errement des occidentaux durant la période : le volontarisme forcené des faucons néoconservateurs qui a prévalu sous G. W. Bush et celle plus habituelle du double discours prônant une ingérence occulte. Pour qui a travaillé longuement sur la Françafrique[iv], l’ingérence permanente, clandestine ou à visage ouvert, des puissances dans les affaires des pays incapables de défendre leur souveraineté, ne saurait être une source d’étonnement. Les erreurs accumulées, des guerres du Golfe à l’Ukraine en passant par la Libye, dessinent le scénario monstrueux qui a conduit à la situation actuelle, qui se caractérise par une tension extrême et un risque grave de conflagration à partir de Kiev ou de Taipei.
Et maintenant ? Les « dés sont jetés » comme l’écrit Mearsheimer. Il était nécessaire de savoir comment on en est arrivé là, mais il faut maintenant réfléchir à comment s’en sortir. Dans une perspective réaliste, on ne peut qu’espérer à court terme le retour d’un dialogue où chaque camp négocie avec ses peurs et celles de ses rivaux. Comme toujours en pareille situation et maintenant que la guerre est engagée, les conditions de ce dialogue sont fortement corrélées à la situation sur le terrain militaire. C’est tout le tragique de la séquence actuelle où les erreurs accumulées depuis 1991 débouchent sur un cadre de décision incertain, dépendant du brouillard de la guerre. A long terme, la période que nous vivons plaide une fois de plus pour le renforcement et la redéfinition des instances multilatérales, comme mécanismes de régulation de la rivalités des Etats. C’est leur dévoiement par les forces occidentales au Moyen-Orient, en Libye et en Europe qui est en grande partie responsable de la situation actuelle.
Incidemment, il serait souhaitable que le débat intellectuel se défasse des anathèmes faciles qui assimilent tout chercheur réaliste à un valet de Poutine[v], et tout penseur libéral à un agent de la CIA.
[i] Pourquoi les grandes puissances se font la guerre, par John Mearsheimer (Le Monde diplomatique, août 2023) (monde-diplomatique.fr)
[ii] C’est le grand intérêt de la pensée de Mearsheimer qui dépasse le simple postulat de l’égoïsme ontologique des dirigeants : « Le réalisme peut se décliner de plusieurs façons. Selon la théorie dite « classique », énoncée par le juriste américain Hans Morgenthau, le désir de pouvoir est inhérent à la nature humaine. Les dirigeants, disait-il, sont mus par un animus dominandi, une pulsion innée qui les pousse à dominer leur prochain. Chacun peut se faire sa propre théorie à ce sujet. Dans la mienne, la force motrice de la compétition entre États se situe avant tout dans la structure ou l’architecture même du système international. C’est celle-ci qui motive les États — et plus encore les grandes puissances — à se livrer une compétition féroce. Ils sont, à cet égard, prisonniers d’une cage de fer. » (article cité plus haut).
[iii] Le Grand Échiquier - Zbigniew Brzezinski - Élucid (elucid.media)
[iv] Voir la une de Mediapart du dimanche 6 août dernier : La Une de Mediapart du 06/08/2023, « La Françafrique, vieille histoire, nouvelles questions », et notre billet : Ce que le coup d’Etat au Niger dit de la Françafrique | Le Club (mediapart.fr)
[v] Je pense à Emmanuel Todd, penseur que l’on peut critiquer mais qui est d’une rare honnêteté intellectuelle, qui se rattache à la tradition empirique anglo-saxonne et qui s’est fait l’écho de Mearsheimer. Voir Notamment Emmanuel Todd, Eloge de l’empirisme. Dialogue sur l’épistémologie des sciences sociales, CNRS Editions, 2020.