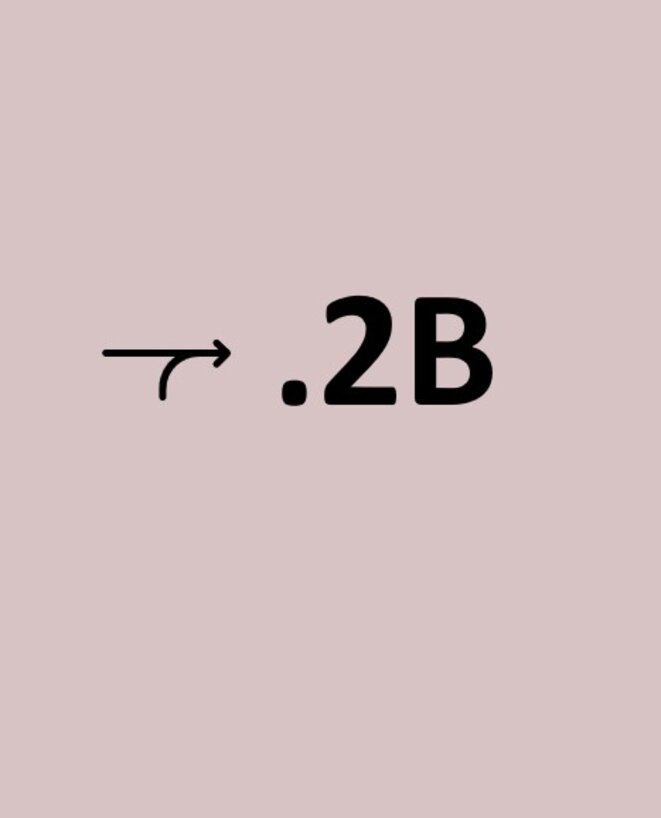Il est nécessaire d’établir une première répartition des groupes humains selon leur rapport à la nature. Philippe Descola distingue les peuples qui ne font pas de différence entre la « nature » et eux (peuples à représentation animiste ou totémique) et ceux qui installent une séparation entre eux et leur environnement[i]. L’histoire avec un « H », celle archivée par les chroniqueurs des civilisations de l’écrit, est celle de ce second groupe qui enclencha la dynamique de la modernité. Le premier groupe correspond à des petits effectifs à l’échelle planétaire, Amérindiens d’Amazonie, Aborigènes d’Australie..., qui survivent tant bien que mal aux assauts de la modernité, mais pourraient montrer des capacités de résilience supérieures en cas d’effondrement généralisé des systèmes mondialisés.
Une fois cette première distinction opérée, le planisphère apparaît avec son maillage de territoires dessiné par les Etats. A ce maillage bien connu se superposent des regroupements invisibles en aires anthropologiques nécessitant des études pour les mettre en évidence. J’entends par aire anthropologique, des espaces intra ou internationaux regroupant des individus partageant des traits culturels communs qui expliquent en partie leurs comportements collectifs.
Emmanuel Todd a perçu très tôt l’importance des structures familiales comme soubassement anthropologique majeur des choix opérés collectivement par les sociétés[ii]. L’étincelle fut la superposition mentale qui s’est opérée dans son esprit entre le système communiste et les aires de familles communautaires, dans le monde. Le système communiste, vertical, autoritaire et égalitaire ne s’est durablement implanté que dans les aires où la structure familiale traditionnelle inculquait dès l’enfance ces choix organisationnels : l’égalité et l’autorité du système communiste faisaient écho à l’égalité entre les frères et à l’autorité quelque peu tyrannique du père dans la famille communautaire. Cela permettait d’expliquer non seulement la répartition eurasiatique du système communiste à l’échelle du monde, mais également les anomalies régionales telles que le Limousin en France ou le centre de l’Italie[iii].
A partir de cette première corrélation, Emmanuel Todd a réalisé un travail complet de cartographie des systèmes familiaux, des valeurs structurantes qu’elles véhiculent et des corrélation avec les grands choix collectifs : rapport à la modernité[iv], à la religion, à la politique, à l’économie[v] (la meilleure clé de compréhension pour comprendre les inégalités de développement ou la diversité des capitalismes...), aux immigrés[vi], etc.
Il ressort de cette recherche, monumentale et étalée sur plusieurs décennies, la diversité essentielle des groupes humains et la profondeur de leurs traits culturels. La famille souche par exemple, autoritaire et inégalitaire, permet de comprendre bien des aspects de l’histoire de l’Allemagne ; ses difficultés pour s’entendre avec la France, diverse sur le plan familial mais dont le moteur a longtemps été la famille nucléaire- égalitaire à l’opposé de la famille souche ; ou bien sa ressemblance étrange avec le Japon, lui aussi porteur des valeurs de la famille souche[vii]. Emmanuel Todd a tiré de cette cartographie anthropologique des conclusions politiques fortes, comme l’amateurisme qui a présidé à la construction européenne, obnubilée par l’après-guerre de 39-45, mais aveugle à l’histoire longue des peuples[viii].
Après avoir cartographié les structures familiales et modélisé les systèmes anthropologiques, Emmanuel Todd s’est interrogé sur les ressorts de cette géographie[ix]. Il a alors utilisé des concepts qui vont nous être utiles afin de réfléchir sur la crise multidimensionnelle qui nous préoccupe ici. Le premier concept, tiré de la linguistique, est le conservatisme des zones périphériques dans la répartition des aires culturelles. A l’échelle planétaire, la répartition des systèmes familiaux présente en effet un vaste centre eurasiatique dominé par les familles complexes, communautaire et souche, et une conservation en périphérie, extrême ouest de l’Europe et Amériques, des systèmes nucléaires (structures familiales centrées sur le couple de parents plus enfants, avec de nombreuses variantes). Cette répartition suggère l’ancienneté, contre-intuitive, des structures familiales nucléaires et l’émergence progressive de structures familiales de plus en plus complexes et patriarcales à partir notamment du Moyen-Orient antique.
A une échelle plus régionale, des phénomènes de diffusion et d’acculturation positive ou négative ont pu jouer pour troubler les corrélations globalement remarquables entre structures familiales et choix collectifs. Typiquement, deux aires familiales différentes peuvent partager un même trait culturel si l’une, dominante, a réussi à le diffuser ; inversement, deux aires familiales similaires peuvent connaître des traits culturels différents si l’une d’elles rejette la domination de l’autre et s’adonne au mécanisme d’acculturation négative dissociative : « j’ai toutes les raisons anthropologiques d’avoir les même traits culturels que toi, mais je veux me distinguer et adopte les traits culturels opposés, alors même qu’ils sont dans une relation dysharmonique avec les valeurs véhiculées par mon système anthropologique. »
Tous ces faits ont des implications importantes dans la crise multidimensionnelle que nous vivons. Ils rappellent la diversité du monde et permettent de comprendre en profondeur les difficultés souvent inconscientes des Etats à coopérer efficacement pour résoudre les problèmes. Les mots peuvent se traduire mais ils ne véhiculent pas le même sens profond dan les différents systèmes anthropologiques.
De plus, les différents aspects de la crise multidimensionnelle aggravent les mécanismes de dissociation par le réflexe de repli identitaire. Face à la raréfaction des ressources, à la concurrence économique exacerbée, aux défis environnementaux à relever, aux tensions géopolitiques anciennes non réglées, la communauté internationale rêvée après 1945 ne montre pas un surcroit de solidarité mais au contraire un réflexe de repli sur soi des Etats[x]. La tribune de l’Assemblée générale à l’ONU ou les COP pour le climat montrent un monde disparate, enlisé dans ses divisions ; des divisions d’intérêts bien sûr, mais des divisions d’intérêts qui apparaissent insurmontables du fait d’une incompréhension au soubassement anthropologique.
Pire encore, la période exacerbe les mécanismes d’acculturation négative dissociative. L’exemple qui saute aux yeux est celui de la Russie qui pouvait être perçue comme en voie d’occidentalisation dans un premier temps de l’ère poutinienne et qui aujourd’hui valorise tous les traits culturels qui montrent que les Russes ne sont pas des occidentaux. L’Occident (dans une délimitation géographique restreinte associant les pionniers démocratiques de l’aire familiale nucléaire, soit L’Angleterre, la France et les Etats-Unis), valorise-t-il la liberté d’expression, la démocratie, le féminisme, la liberté pour chaque individu de choisir sa sexualité, voire son sexe ? La Russie se définit alors comme un régime fort (entendons autoritaire) et défenseur des valeurs familiales traditionnelles. La Russie développe une aversion pour l’homosexualité, les transgenres, et le féminisme qui va au-delà de sa nature profonde et révèle un rejet dissociatif de l’Occident explicite, conçu également comme un levier revendiqué d’une dynamique de regroupement du Sud global, par ailleurs bien plus divers que ne semblent le penser les autorités russes ou Chinoises[xi]. Ces traits culturels sont en partie engrenés dans le socle anthropologique russe et se voient renforcés par une logique d’acculturation négative, de rejet pour le dire plus simplement, de l’Occident après que ce dernier a cherché à museler sa puissance par une politique vécue comme un encerclement de son territoire[xii]. Dans une boucle de rétroaction, l’Occident voit dans la Russie poutinienne un repoussoir bien pratique. Enlisée dans un cycle de décomposition sociale depuis le tournant néolibéral des années 80, en proie à une dérive oligarchique de plus en plus violente, nombre de piliers du monde occidental, dont la France et le Royaume-Uni, développent un bellicisme de réaction qui trahit surtout leur incapacité à résoudre leurs problèmes internes[xiii].
Le conflit israélo-palestinien intègre sans doute également une double dynamique d’acculturation négative dissociative. Le peuple israélien, composite sur le plan anthropologique, vivant dans une société profondément inégalitaire ne prédisposant pas à la cohésion, trouve dans son alter ego palestinien un repoussoir qui lui permet de définir son identité, fondée sur son statut de rescapé de la Shoah et une mentalité de peuple assiégé au sein du monde arabe[xiv]. Le processus de colonisation qui a concrètement donné naissance à l’Etat d’Israël n’a pu que développer chez les Palestiniens une identité fortement marquée par un phénomène d’acculturation négative dissociative. D’autant que le socle anthropologique du peuple palestinien (la famille communautaire endogame, marqueur du monde arabe) prédispose peu à la constitution d’Etats fonctionnels, comme en atteste toute l’histoire du Moyen-Orient. Le déficit de structure étatique dans un contexte colonial violent n’a pu que renforcer une identité fondée sur le rejet de la puissance coloniale, renforçant tous les traits culturels opposés à Israël. La fanatisation religieuse des deux côtés en est l’expression la plus visible. Il en résulte une situation où les deux peuples sont gouvernés par des formations politiques qui nient l’existence de l’autre, stade ultime de la dissociation. L’attaque du 7 octobre a montré la profondeur de la haine du Hamas à l’égard des Juifs. La réaction israélienne en est le pendant dans les paroles et dans les actes ; à cette différence près, essentielle, qu’Israël a les moyens de basculer dans une politique de purification ethnique et qu’il est passé à l’acte[xv].
Le parallèle a pu être fait entre la situation coloniale qui oppose les Israéliens et les Palestiniens avec celle qui prévalait en Algérie opposant les pieds-noirs et les indigènes principalement arabes et berbères. Dans les deux cas, le caractère paroxystique de la haine et le déchainement d’une violence niant l’humanité de l’autre, suggère une piste anthropologique. En Algérie, une communauté de colons, inégalitaire et composite, mais issue du fonds anthropologique européen exogame a été confrontée dans son projet colonial à des populations appartenant au socle anthropologique arabe marqué par la famille communautaire dans sa variante la plus endogame. Ces deux systèmes anthropologiques n’ont jamais pu ou su fusionner ; concrètement le taux de mariages mixtes est toujours resté marginal. Une dynamique dissociative, enclenchée dès la conquête marquée par les pires exactions[xvi], a amené les deux populations, coloniale et indigène, à un affrontement d’une violence que seule la négation réciproque de l’humanité de l’autre peut générer[xvii]. Le parallèle avec la situation prévalant aujourd’hui entre Israéliens et Palestiniens paraît encore plus troublant quand on mobilise la clé anthropologique et les précédents coloniaux. Comme dans l’Algérie coloniale, la dissociation religieuse cache une fracture anthropologique plus profonde entre systèmes familiaux endogame et exogame.
Ce billet achève de dresser un tableau qui montre que toutes les temporalités convergent vers un moment critique pour l’humanité. Face aux défis existentiels multiples auxquels notre espèce est confrontée, la communauté internationale montre un front dangereusement désuni, dans une crispations des identités fondées sur des socles anthropologiques profonds. La chine ne cesse de souligner sa singularité – une nouvelle forme de la « destinée manifeste » des Etats-Unis ? – et de remâcher les humiliations subies lors du « siècle de la honte ». Chine et Russie semblent fantasmer un « Sud global » comme autrefois les Etats-Unis un impérium planétaire. L’heure est à la recomposition de blocs plutôt qu’à leur dépassement, l’Occident portant sa part de responsabilité dans cette dynamique négative.
Dans un dernier billet conclusif, nous tenterons une approche prospectiviste à partir de l’ensemble de ces constats.
[i] Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005.
[ii] Pour une introduction à sa recherche, je recommande la bande dessinée qu’il a cosignée avec Terreur Graphique : Il était une fois la famille. Systèmes familiaux et idéologies, Casterman, 2024 et la vidéo adoptant un format unique sur le site du média Elucid : Cette théorie est une arme intellectuelle pour prédire les évolutions du monde - Élucid, également visible sur la chaîne YouTube de ce média.
[iii] Emmanuel Todd, La troisième planète. Structures familiales et systèmes idéologiques, Seuil, 1983.
[iv] La diversité du monde, Seuil, 1999 qui regroupe deux ouvrages : La troisième planète, op. cit. supra et L’enfance du monde, Seuil, 1984.
[v] L’illusion économique, Galimard, 1998.
[vi] Le destin des immigrés, Seuil, 1994.
[vii] Voir la vidéo : Emmanuel Todd - Allemagne : de la puissance à l'impuissance
[viii] L’invention de l’Europe, Seuil, 1990.
[ix] Les origines des systèmes familiaux, Gallimard, 2011
[x] Voir l’essai d’Arnaud Orain, Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe – XXIe siècle), Flammarion, 2025.
[xi] La défaite de l’Occident, Galimard, 2024.
[xii] John Mearsheimer : Pourquoi les grandes puissances se font la guerre, par John Mearsheimer (Le Monde diplomatique, août 2023)
[xiii] Voir la vidéo : Trump et Poutine contre l’Europe : la fin des illusions occidentales - Emmanuel Todd - Élucid
[xiv] Sur l’identité juive israélienne, voir Shlomo Sand, Comment j’ai cessé d’être juif, Flammarion, 2013.
[xv] Voir le rapport de Francesca Albanese, A/HRC/59/23
[xvi] La véritable histoire de la conquête française de l’Algérie | Mediapart