Le 21 avril 1946, il y a 75 ans exactement, s’ouvre en soirée à Grenoble le 35e congrès de l’Union nationale des étudiants de France. C’est le premier congrès qui se tient après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une France libérée où tout est à reconstruire, y compris l’Université et l’organisation étudiante. C’est lors de ce congrès que l’UNEF adopte un texte, une « déclaration des droits et devoirs des étudiants », charte de l'étudiant qui va être rapidement connue comme la charte de Grenoble, devenue pour le syndicalisme étudiant une sorte d’équivalent de la charte d’Amiens.
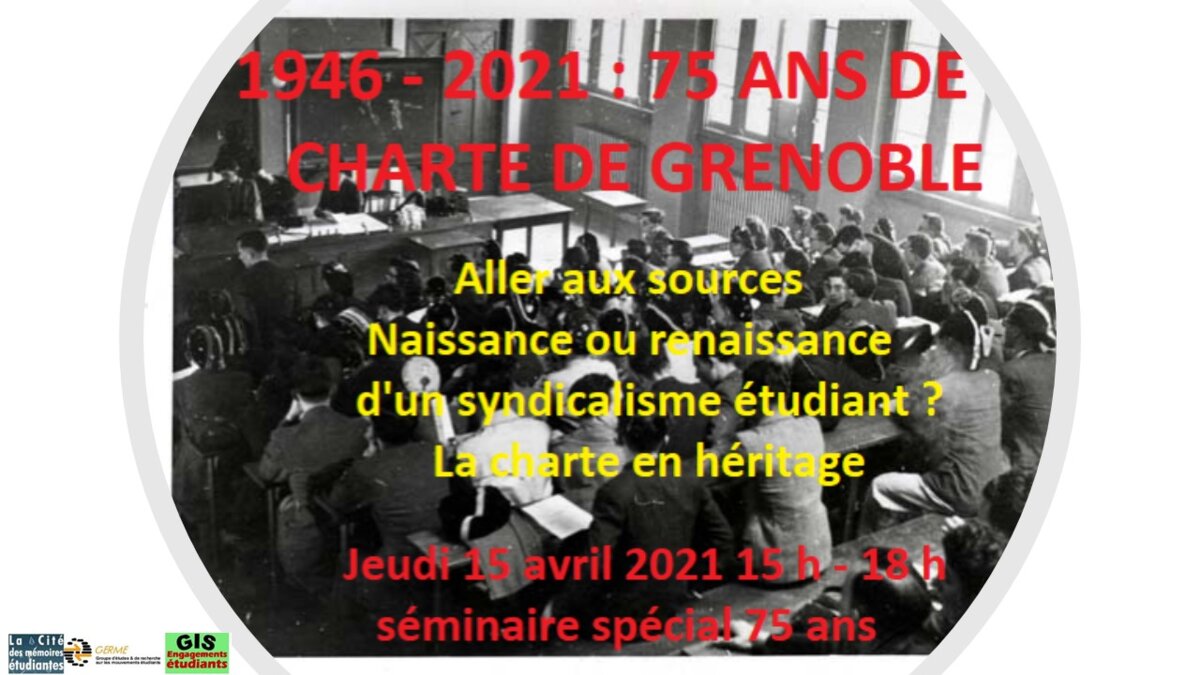
Agrandissement : Illustration 1
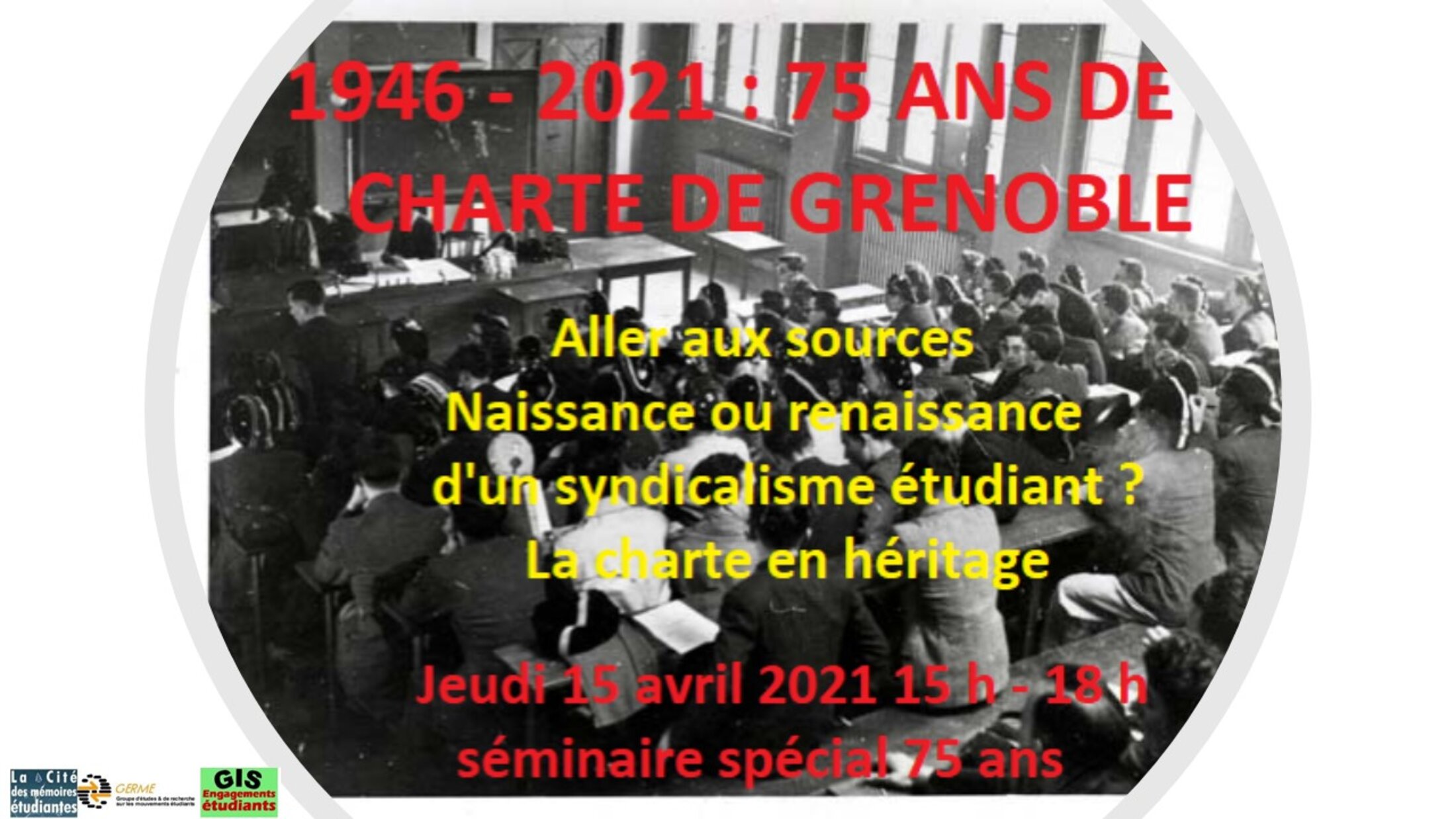
La charte n’invente pas la grève, l’action revendicative, la gestion (ou co-gestion) des services et œuvres en faveur des étudiants, le terme de syndical, tout ces éléments existaient auparavant. Mais elle donne une doctrine, un sens commun à ces pratiques jusque-là disparates. C’est sur cette base que les différentes directions qu’à pu connaître l’UNEF de la période, progressistes ou de la droite gaulliste du RPF, ont revendiqué le salaire, ou pré-salaire étudiant, ont obtenu la sécurité sociale des étudiants et son autogestion par une mutuelle, la MNEF.
La volonté de l’organisation étudiante est d’intégrer les étudiants dans la société, dans l’ensemble du mouvement syndical, en faveur d’une « révolution économique et sociale au service de l’homme » - ce sont les termes de l’époque. Rompant avec l’apolitisme autrefois revendiqué, « apolitisme » cachant mal en réalité une acceptation de l’ordre établi, ils se revendiquent toutefois d’un « apartitisme », c’est-à-dire une volonté d’indépendance vis-à-vis de tout contrôle, qu’il soit celui de partis, des administrations de tutelle ou du gouvernement. Toutes les forces qui auraient pu être concurrentes -mouvements confessionnels (JEC, FFEC), politiques (UJRF, socialistes, gaullistes) reconnaissent le monopole corporatif, c’est-à-dire syndical, de l’UNEF.
L’amalgame des traditions anciennes estudiantines et du nouveau syndicalisme, des différents courants qui composent et structurent la jeunesse des facultés, est le fruit d’une volonté commune forgée dans des circonstances particulières : expérience de la Résistance pour beaucoup, moments de la Libération où tout semble possible tant il faut rebâtir, et tant qu'à faire, sur des bases nouvelles. Et ce mouvement a su se faire respecter des uns et des autres.
C’est cet amalgame qui va faire de l’UNEF cette force qui sera capable de mobiliser tous les répertoires d'action, pour faire cesser la guerre d’Algérie tout en accentuant une sorte de syndicalisme luttant pour la réforme de l’université, de gestion des services, représentant le milieu étudiant sous toutes ses facettes et préoccupations.
Le paysage paraît terriblement différent aujourd’hui : un mouvement étudiant divisé, ayant subi des échecs importants avec la perte de la sécurité sociale étudiante, l’autonomie libérale de l’université, le passage de la gestion directe à l'étatisation des oeuvres. Un mouvement étudiant dénigré par les autorités et des médias parce qu’il ne ressemblerait pas à celui d’hier, arguments attestant de l’inculture et de la bêtise de celles et ceux qui parlent et écrivent sans connaître, sans enquêter, (voir mon précédent article de blog), et surtout sans donner de moyens à la recherche en la matière
Et pourtant, la crise actuelle n'est pas sans évoquer certains aspects de la situation d’après 1945 : les questions de logement, de nourriture, de santé. Hier on occupait les maisons closes pour loger des étudiants, les AGE (associations générales des étudiants, structures de l'UNEF) prenaient en mains des restaurants universitaires, luttent contre la tuberculose avec le sanatorium étudiant puis la sécurité sociale et la MNEF ; aujourd’hui les initiatives existent, preuve de la disponibilité, mais dispersées, voire concurrentes. Un amalgame – du moins une synchronisation – sont-ils impossibles ? La démocratisation ne serait-il plus un enjeu alors qu’il y a, en proportion, moins d’enfants d’ouvriers aujourd’hui qu’il y trois quarts de siècle ? Un monde étudiant 15 fois plus nombreux qu’à la Libération, fort de presque trois millions de jeunes, ne pourrait-il peser de tout son poids ? La charte de Grenoble n’est-elle pas la référence de la plupart des syndicats étudiants, dont la FAGE et l’UNEF ?
Nous venons de commémorer le 15 avril les 75 ans de la charte, entre actrices et acteurs, archivistes, chercheuses et chercheurs, pour la première fois sans son principal rédacteur, Paul Bouchet, disparu il y a deux ans. Il incitait à comprendre que si « la lettre tue, l’esprit vivifie ». Ensemble, Paul Bouchet, Jean-Philippe Legois et moi-même, dans ces colonnes mêmes , nous lancions pour le 70e anniversaire un appel à la sauvegarde de l’histoire, de la mémoire en précisant : « Cette mémoire n’est pas momifiée, elle demeure vivante. En attestent les livres, les expositions, les colloques et conférences. Là peuvent se rassembler pour échanger leurs points de vue toutes les générations et tendances d’hier et d’aujourd’hui, occasions rares et précieuses. Et si elles peuvent discuter du passé, pourquoi pas de l’avenir ? ».
Que rajouter de plus, sinon de passer aux actes.
Pour aller plus loin :
Video du séminaire des 75 ans
Dossier documentaire avec textes, photos, liens vers des vidéos, bibliographie, chronologie.



