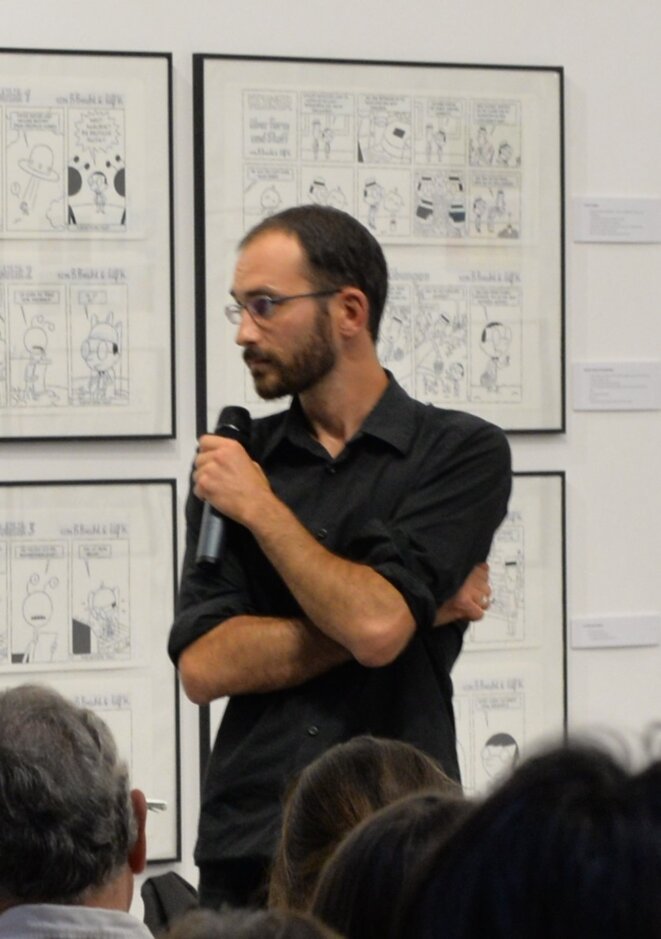Pour découvrir mes autres publications (livre, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
Les Français, dans leur grande majorité, sont hostiles aux taxes sur l’héritage. Cela peut surprendre, à une époque où il semble acquis que l’égalité des chances devrait être la règle, tandis que de nombreuses voix influentes font l’éloge de l’esprit d’entreprise, de la richesse méritée et de l’audace des « premiers de cordée ». Pourtant, les résultats des sondages sont sans appel : 87 % des personnes interrogées estiment qu’il faudrait diminuer les droits de successions (France Stratégie, 2018, p. 2). [1]
Ce qui est peut-être encore plus frappant, c’est que l’hostilité de nos concitoyens aux droits de succession ne dépend pas de leurs chances réelles d’accéder à un héritage : les plus modestes s’avèrent tout aussi opposés à ces taxes que les plus fortunés [2]. On constate aussi que les Français sont peu informés sur le niveau réel de cet impôt : alors qu’ils croient que les héritages sont taxés en moyenne à 22 %, le taux moyen pratiqué par le fisc est en réalité d’environ 5 %. En ligne directe (un enfant qui hérite de ses parents), le taux effectif [3] moyen descend même à 3 % [France Stratégie, 2018, p. 3].
Ce que la majorité des Français ignorent, c’est que chaque héritage en ligne directe bénéficie d’un abattement fiscal de 100 000 €, ce qui signifie que les taxes commencent uniquement au-delà de ce seuil. Il en résulte que la plupart des gens ne sont jamais contraints de payer des taxes sur l’héritage, puisque 85 % des successions sont d’un montant inférieur au seuil de 100 000 €. Les successions entre conjoints mariés ou pacsés sont, elles, intégralement exonérées d’impôts.
Le retour de l’héritage
Sans surprise, on peut relever que les successions sont fortement concentrées en haut de la pyramide sociale : les 10 % d’héritiers les mieux lotis reçoivent la moitié de l’ensemble des héritages. En fin de compte, seules les familles riches se voient amputer d’une part conséquente des sommes transmises, et ce n’est qu’un héritage sur cent (en ligne directe) qui est concerné par un taux effectif d’imposition supérieur à 18 % [Terra Nova, 2019, p.7].
L’impopularité des droits de successions est d’autant plus étonnante que les héritages ne cessent de prendre de l’ampleur, et qu’ils semblent bien partis pour retrouver l’importance qu’ils avaient dans la vieille société des rentiers du XIXème siècle. Quelques chiffres permettront de se faire une idée du phénomène : la part de l’héritage dans le Revenu National Brut (RNB) de la France était de 25 % au début du XXème siècle, puis elle a chuté jusqu’à 5 % dans les années 50. Elle est désormais remontée à plus de 15 %, et, si la tendance se poursuit, devrait atteindre entre 20 et 25 % aux alentours de 2050.
En 1980, les montants reçus en héritage correspondaient à 8 % du revenu disponible des ménages français. Ce chiffre monte désormais à 19 %. Les recettes des taxes sur l’héritage, quant à elles, ont doublé sur les 35 dernières années (de 0,22 % à 0,56 % du PIB). Cela n’est pas dû à un durcissement de la fiscalité, mais à la hausse considérable des montants transmis (via l’accroissement de la taille des fortunes, et l’augmentation du nombre de décès).
Si les héritiers se portent si bien, pourquoi existe-t-il de telles réticences à taxer ce qui leur est transmis ? Pourquoi de nombreux pays (l’Italie, la Suède, le Canada, l’Autriche, le Portugal et l’Australie, entre autres) sont-ils allés jusqu’à supprimer intégralement les droits de succession ? A part dans quelques cercles ultralibéraux ou traditionnalistes, presque personne ne défend un « droit à l’héritage », et les gens qui n’ont fait qu’hériter de la fortune de leurs parents ne bénéficient généralement pas d’une image positive. Sur ce point, l’opinion populaire semble solidement établie : hériter, ce n’est pas mériter. « Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus », lançait déjà Beaumarchais dans Le mariage de Figaro il y a plus de deux siècles.
« Vous n’aimez pas la famille »
Dans une interview à Slate.fr, le philosophe Patrick Savidan formule la question ainsi : « Nos sociétés modernes ont remplacé le principe de la naissance par le principe du mérite. Dans cette configuration-là, l’héritage devient problématique ». Pourtant, une large majorité de nos concitoyens refuse les taxes qui portent sur ce même héritage… La clé de cet apparent paradoxe se trouve peut-être dans un discours prononcé en 2007 par Nicolas Sarkozy, lors de sa campagne pour l’élection présidentielle : « Quand on a travaillé toute sa vie et qu’on a créé un patrimoine, on doit pouvoir le laisser en franchise d’impôt à ses enfants. »
En 2012, quand François Hollande restaurait le régime d’imposition des héritages qui avait été considérablement réduit par son prédécesseur, un député de droite protestait en ces termes : « Vous n’aimez pas la famille. » Si les droits de succession suscitent une telle opposition, ce n’est pas qu’ils portent préjudice aux héritiers : c’est parce qu’ils entravent notre possibilité de léguer à nos descendants les fruits d’une vie de travail.
Ainsi placé du point de vue de celui qui transmet, on peut mieux comprendre la légitimité de cette opposition. Citons encore Nicolas Sarkozy : « Quand on a travaillé dur toute sa vie, qu’est-ce qui donne du sens à la vie ? C’est de faire que ses enfants commencent un peu plus haut que soi-même on a commencé. » Chacun veut offrir le meilleur à ses enfants, et les droits de succession viennent s’opposer à cette noble intention. En définitive, la question ne porte pas sur le mérite de celui qui reçoit, mais sur le mérite de celui qui transmet.
L’héritage, dans cette perspective, est doublement vertueux : il est issu à la fois du travail et de l’épargne. C’est le dévouement et la frugalité des parents, qui leur permettent de léguer à leurs enfants de quoi être mieux protégés face aux aléas de la vie. Face à cela, les droits de successions apparaissent sous une lumière peu flatteuse : ils seraient à la fois une « taxe sur la vertu » et une « taxe sur la mort » [Masson, 2015, chapitre 3.2].
Au-delà même de la manière dont l’héritage a été constitué (travail ou transmission, mérite ou bonne fortune) c’est aussi son caractère familial qui lui donne sa valeur. Le patrimoine – qu’il s’agisse de la maison de famille ou de l’entreprise familiale – matérialise la force des liens familiaux [4]. Ce patrimoine possède une grande charge symbolique et affective, qui tolère mal les intrusions de l’administration fiscale. Toucher à l’héritage, c’est comme toucher à la famille.
Ce que nous transmettons
Pourtant, nous avons à notre disposition mille manières de transmettre quelque chose aux enfants sans passer par la case « héritage » : l’affection que nous leur donnons, le temps passé à leur donner confiance en eux, la richesse de l’environnement que nous leurs offrons, tout cela contribue sans doute plus à leur épanouissement que le montant du chèque qu’ils recevront lorsque nous serons morts. Il est bien établi que la transmission du capital culturel s’effectue prioritairement au sein de la famille, et que cela constitue d’ailleurs un puissant facteur de perpétuation des inégalités.
Le sociologue Bernard Lahire a souligné l’importance la dimension immatérielle de tout héritage : les parents transmettent à leurs enfants tout un ensemble de ressources, d’habiletés, de compétences, de goûts, de représentations du monde et de dispositions à agir. Les enfants s’imprègnent profondément du climat familial et des points de vue qui sont exprimés dans cet espace-là, ce qui peut les avantager ou les désavantager dans leur scolarité – ainsi que dans tous les domaines de leur existence.
Si l’on considère tout ce qui vient d’être énuméré, l’héritage strictement matériel apparaît comme la partie congrue de l’ensemble de ce qui est transmis. De surcroît, l’âge moyen auquel on hérite se situe désormais autour de cinquante ans [Terra Nova, 2019, p. 5], c’est-à-dire au moment où les jeux sont déjà faits et où la plus grande part de notre vie est déjà derrière nous. L’héritage n’arrive donc généralement que quand on n’en a plus besoin, ce qui signifie qu’une augmentation des droits de succession n’aurait que peu d’effet sur nos possibilités réelles d’offrir à nos enfants les meilleures chances de réussite.
Certains multimilliardaires ont fait le choix de ne transmettre à leurs descendants qu’une petite fraction de leur patrimoine. Le plus illustre d’entre eux est peut-être le magnat de l’acier Andrew Carnegie : réputé avoir été l’homme le plus riche de son époque, il donna presque toute sa fortune à de nombreuses œuvres éducatives et culturelles. « L’homme qui meurt riche, meurt déshonoré » disait-il. Il ne manqua pas de se conformer à son propre précepte : à sa mort en 1919, Carnegie légua ses trente derniers millions de dollars à des œuvres de bienfaisance.
Plus près de nous, on peut mentionner Bill Gates et son épouse, qui se sont engagés à ne laisser « que » trente millions de dollars à leurs enfants – ce qui signifie qu’ils donneront 99,96 % de leur fortune dans les années qui viennent. Mark Zuckerberg, quant à lui, s’est engagé à donner de son vivant 99 % de ses actions Facebook (d’une valeur de quarante-cinq milliards de dollars).
Au-delà des débats qui peuvent être suscités par ces initiatives (faut-il applaudir des philanthropes qui ont accumulé leur fortune en évitant l’impôt, en exploitant les ouvriers ou en usant de pratiques anticoncurrentielles ?), celles-ci donnent à penser qu’il ne serait pas déraisonnable de limiter par l’impôt la taille des héritages, de sorte que les fortunes accumulées finissent par être mises au service de l’intérêt commun.
Les impôts les plus justes
A partir de quel montant pourrions-nous considérer qu’un certain « droit de transmettre » a été respecté ? Quelle quantité de richesses matérielles est nécessaire pour soutenir la perpétuation des liens familiaux ? Cent mille euros ? Un million ? Dix millions ? Cent millions ? Non seulement, comme nous l’avons vu, l’héritage ne constitue qu’une partie de ce que nous transmettons à nos descendants – et pas celle qui leur sera la plus utile – mais le lecteur pourra sans doute convenir qu’un parent en capacité de léguer un million d’euros à ses enfants devrait déjà en être satisfait.
De telles considérations donnent à penser qu’il pourrait être pertinent de rehausser le taux moyen et la progressivité des droits de succession – c’est-à-dire de taxer plus, et de concentrer l’effort fiscal sur les gros héritages. Il ne s’agit évidemment pas de taxer pour le plaisir de taxer. L’impôt est nécessaire à la vie en société : sans impôt, pas de capacité collective à agir. Sans impôt, pas d’Etat social, pas de service public, pas de destin commun ni de prospérité possible. La question n’est donc pas de savoir s’il faut prélever des impôts, mais plutôt quels impôts nous devons prélever. La fiscalité peut certes prendre de nombreuses formes, mais ce qui n’est pas prélevé ici devra être prélevé là.
Du fait de la complexité du monde et de la diversité des situations particulières, il n’existe pas d’impôt parfaitement juste. Ce constat fait, nous pouvons cependant nous demander « quels sont les impôts les plus justes ? » Certainement pas la taxe foncière, qui fait payer aux classes moyennes un impôt sur un patrimoine qu’ils ne possèdent pas [5]. Certainement pas la CSG, qui grignote les petits salaires tout en épargnant largement les revenus des gros actionnaires. Certainement pas la TVA, qui pèse dans le budget des personnes pauvres bien plus que dans celui des milliardaires. Si nous faisons un classement des impôts les plus justes, les droits de succession doivent y figurer en bonne place [6], et il serait dommage que les gouvernements continuent à les réduire alors qu’ils pourraient en partie remplacer certains impôts injustes qui frappent aveuglément les plus modestes de nos concitoyens.
Cet article vous a plu ? N'hésitez pas à le recommander, et découvrez le reste de mes publications sur sylvain-bermond.fr
Annexe : quelques propositions
Ces dernières années, plusieurs chercheurs et instituts de réflexion ont proposé des réformes de la taxation des héritages. Le think tank Terra Nova suggère d’augmenter d’un quart le montant total des droits de succession, en accentuant la progressivité (alléger les taux pour les petits héritages, les augmenter pour les montants élevés) et en diminuant les exonérations possibles.
L’économiste André Masson recommande d’alourdir les taxes sur les héritages, mais pas sur les donations entre personnes vivantes. Un tel système aurait l’avantage de faire circuler plus rapidement le capital entre les générations, en encourageant les dons anticipés pour aider les plus jeunes à acquérir un bien immobilier ou à investir dans une entreprise.
Dans une note d’analyse publiée en 2017, France Stratégie propose de faire varier les droits de succession selon l’âge des héritiers (plus on est jeune, moins on paye d’impôts) et selon la totalité de l’héritage reçu au cours de sa vie (moins on a reçu, moins on paye d’impôts).
Thomas Piketty, quant à lui, appelle à augmenter radicalement le taux des taxes sur l’héritage (jusqu’à 90 % pour les plus grandes fortunes) [7] afin de financer une dotation universelle en capital, c’est-à-dire une somme de 120 000 euros qui serait versée à chaque jeune adulte – un « héritage pour tous », en quelque sorte [voir Piketty, 2019, pp.1126-1137].
Bibliographie :
Fiscalité des héritages : impopulaire mais surestimée, note de synthèse de France Stratégie, 2018, en ligne ici
Comment justifier une augmentation impopulaire des droits de succession, André Masson, Revue de l’OFCE 2015/3 (n°139), en ligne ici
Réformer l’impôt sur les successions, note de Terra Nova, 2019, en ligne ici
Capital et idéologie, Thomas Piketty, 2019, éditions du Seuil
Résistances à l’impôt, attachement à l’Etat, Alexis Spire, 2018, éditions du Seuil
[1] On trouve le même constat dans un sondage IPSOS/CGI réalisé en 2013 (résultats présentés dans Le Monde, en ligne ici) ainsi que dans un sondage OpinionWay réalisé en 2018 (en ligne ici). L’impopularité des droits de succession semble augmenter avec le temps : en 2011, ils n’étaient que 78 % à estimer que ceux-ci devraient être abaissés.
[2] Ainsi, 77 % des employés et 74 % des ouvriers non qualifiés estiment que l’impôt sur les successions est injuste, quand une proportion équivalente (73 %) de cadres supérieurs partagent cet avis. Voir Spire, 2018, p. 266.
[3] Le taux effectif d’imposition est le taux qui a réellement été appliqué sur l’ensemble de la somme concernée. Si je reçois une fortune en héritage, la part de cette fortune qui dépasse 1,8 millions d’euros sera théoriquement taxée à 45 %, comme le prévoit le barème fixé par la loi. Mais les premières tranches de cette somme (les parts comprises entre 0 € et 1,8 millions d’euros) seront nettement moins taxées – à des taux compris entre 0 et 40 %. De plus, la plupart des héritages bénéficient d’exonérations (assurances-vie et transmission d’entreprise, notamment) qui font baisser le taux auquel ils sont imposés. C’est pourquoi il est important de parler du « taux effectif » d’imposition, qui diffère du taux théorique et qui nous éclaire sur le poids réel de telle ou telle taxe.
[4] La transmission de l’entreprise familiale est largement facilitée par la législation française, puisque les biens industriels, commerciaux et artisanaux bénéficient d’un abattement de 75 % dans le calcul des droits de succession. Si la pertinence de cet abattement pose question du point de vue de la justice fiscale, il est vrai que sa suppression obligerait un certain nombre d’héritiers à céder l’entreprise familiale afin de pouvoir payer les droits de succession. Une solution existe pourtant : les héritiers pourraient choisir de payer les droits de succession avec de la monnaie, ou en remettant à l’Etat des parts de leur entreprise (évaluées à leur valeur de marché). L’Etat entrerait ainsi au capital de nombreuses entreprises, tout en laissant la possibilité aux héritiers de racheter ultérieurement ces parts quand ils en auront la possibilité. Cette solution est soutenue par Emmanuel Saez et Gabriel Zucman pour faciliter le règlement des impôts sur le capital. Voir Le triomphe de l’injustice, 2020, éditions du Seuil, pp. 219-221.
[5] La taxe foncière est payée chaque année par toute personne qui possède un ou plusieurs biens immobiliers. Cet impôt sur le capital possède deux particularités : d’une part, il ne porte que sur le capital immobilier et pas sur le capital financier (si je possède 200 000 euros d’actions en bourse, je n’ai pas à payer de taxe sur ce capital). D’autre part, il ne prend pas en compte le niveau d’endettement du contribuable : une personne qui s’endette de 150 000 euros pour acheter un appartement à 200 000 euros, ne possède en réalité que 50 000 euros – le reste appartient à la banque. Pourtant, cette personne sera taxée sur l’intégralité de la valeur du bien (appelée « valeur locative cadastrale », et qui représente le loyer que la propriété pourrait produire si elle était louée). La légitimité du mode de calcul de la taxe foncière ne saute pas aux yeux, surtout quand on la compare au défunt l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) qui a catalysé l’hostilité des classes supérieures pendant des décennies : l’ISF représentait environ 0,4 % de la valeur du capital des contribuables qui y étaient assujettis, et ceux-ci déduisaient leurs dettes dans leur déclaration de patrimoine. L’ISF a finalement été aboli par Emmanuel Macron lors de son arrivée au pouvoir, et il ne subsiste plus que sous une forme amoindrie – l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), qui épargne intégralement le capital financier et génère des rentrées fiscales trois fois plus faibles que l’ISF.
[6] Reste une objection courante, qui est celle de la « double imposition » : les droits de succession constituent une taxe sur un revenu qui a déjà été imposé du vivant de la personne, ce que certains considèrent comme une injustice. Plus généralement, cet argument est employé pour dénoncer toutes les formes d’imposition du capital. Le problème est que nous sommes tous concernés par la « double imposition » : chacun d’entre nous paye des cotisations sociales sur les revenus du travail, puis ce qu’il reste de ce revenu est soumis à l’impôt sur le revenu. Ensuite, nous payons la TVA et des taxes diverses sur tout ce que nous achetons, et ceux d’entre nous qui possèdent un bien immobilier sont soumis à la taxe foncière (en plus des taxes payées lors de l’achat du bien). En somme, l’argument de la double imposition ne justifie certainement pas d’abandonner tel ou tel impôt particulier : la seule alternative à la double imposition serait un impôt unique avec des taux extrêmement élevés, qui permettrait de remplacer les recettes perdues avec l’abolition de tous les autres impôts. Du fait de la complexité inhérente à une économie moderne, il est cependant peu probable que cet impôt unique (quel qu’il soit) parvienne à être à la fois juste et efficace.
[7] Certains objecteront que de tels taux risque de provoquer un exil fiscal massif des riches contribuables. Or, ce n’est pas ce que tend à démontrer la recherche en économie : une étude réalisée par Marius Brülhart et Raphaël Parchet (en ligne ici) a consisté à étudier la mobilité des contribuables entre les différents cantons suisses, pour savoir si les personnes âgées à haut revenu ont tendance à s’installer dans les cantons qui imposent le plus faiblement l’héritage. Leurs observations portent sur une période de 36 ans, et concluent que le niveau des droits de succession ne semble pas avoir d’influence sur la mobilité des contribuables concernés. Une autre étude, portant sur le cas des Etats-Unis, a cherché à vérifier dans quelle mesure les riches contribuables évitent les Etats qui ont mis en place des taux d’imposition élevés. L’étude aboutit à la conclusion que l’exil fiscal entre Etats fédérés existe, mais que ce phénomène est d’ampleur modeste (Bakija et Slemrod, 2004, en ligne ici). Le think tank Terra Nova, dans son rapport sur le sujet, explique pourquoi il est difficile d’échapper aux droits de succession : dans la plupart des cas, cela implique « d’expatrier à la fois le foyer fortuné et les foyers héritiers, le tout assez en avance, en prévision d’un évènement dont on ne connaît pas l’échéance, et à un âge où on aime moins déménager (…) Tout cela représente beaucoup d’effort, et les conseillers en gestion de patrimoine reconnaissent qu’ils ne rencontrent que rarement le cas. » [Terra Nova, 2019, p. 13]. Plus généralement, sur le thème de l’exil fiscal, voir mon article Exil fiscal : au-delà des idées reçues (en ligne ici).