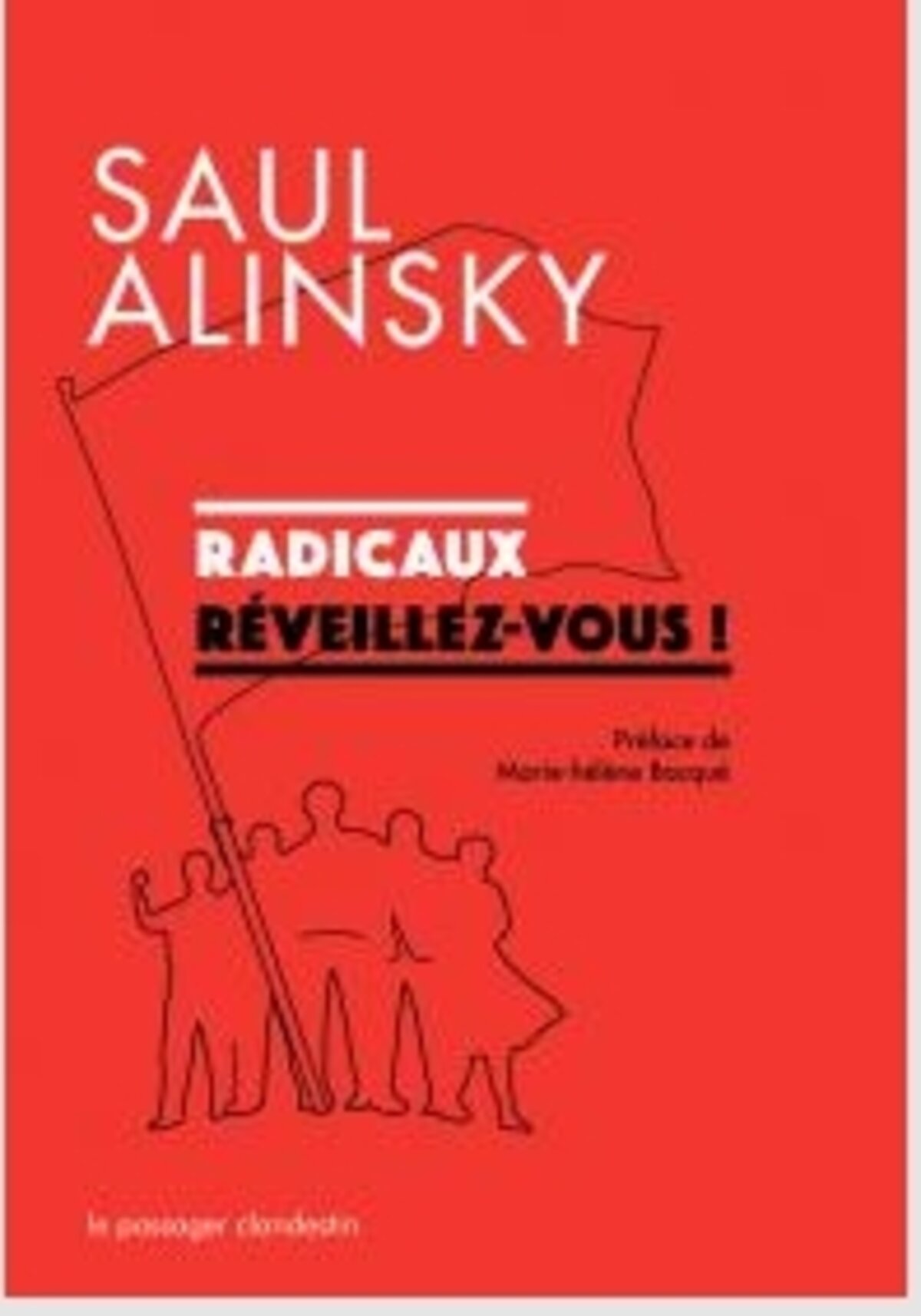
Né en 1909, mort en 1972, Saul Alinsky, fils d'immigrés russes juifs, passe son enfance dans un quartier pauvre de Chicago. Il devient sociologue et invente une approche d'intervention sociale permettant de mobiliser les acteurs locaux pour résoudre les problèmes sociaux posés : le community organizing. Ce terme est revenu au goût du jour avec Barak Obama qui l'invoquait pour expliquer ses méthodes électorales (consistant à ratisser large : réunion, porte-à-porte) qui en a inspiré d'autres sous nos latitudes. Cette apparente filiation a plutôt porté préjudice au sens de la démarche d'Alinsky. Par ailleurs, il importe de comprendre que ce penseur ne se perd pas en théories, il reste pragmatique car il souhaite une efficacité immédiate des actions menées. Ce que les "radicaux" américains lui reprocheront. Pour expliquer concrètement les règles qu'il prônait, il a publié Rules for Radicals en 1971 (traduit en français sous le titre quelque peu détourné de Manuel de l'animateur social, en 1976 puis sous le titre Être radical, manuel pragmatique pour radicaux réalistes, en 2012).
Il avait auparavant publié Reveille for Radicals en 1946, qui vient d'être traduit par les éditions Le Passager clandestin sous le titre éponyme Radicaux, réveillez-vous ! Il s'emploie dans cet ouvrage à définir ce qu'est un radical, ce qui nous donne des pages passionnantes décrivant le peuple américain. Avec des fulgurances bien éloignées des saillies racistes du Président actuel des USA : "les Américains sont rouges, blancs, noirs, jaunes et de toutes les nuances intermédiaires", "leurs visages sont le visage de l'avenir". N'oublions pas la date de parution, quand il nous dit "que les Américains sont des adeptes de toutes les grandes religions de la terre" : chrétiens, juifs, mahométans et… athées et agnostiques. Et qu'il n'y a pas à opposer de visa : "le peuple du monde" est "slave, tchèque, allemand, irlandais, anglais, espagnol, français, russe, chinois, japonais, et afro-américain". Les situations sociales sont variées, les uns ont des appartements, d'autres vivent dans des cabanes ("les nantis sentent l'eau de toilette, ceux qui n'ont rien sentent les toilettes tout court").

Agrandissement : Illustration 2

Et dans ce peuple, sont apparus des hommes qui aimaient les gens : c'est le cas depuis l'aube de l'humanité, de rares personnes se battent pour les droits de leurs frères et haïssent l'injustice. Aux USA, ce furent les radicaux : "la misère de leur voisin était leur misère". Ce sont eux qui sont partis en guerre contre "le nationalisme étroit", l'antisémitisme, contre les lois raciales, pour l'amélioration des conditions économiques. Et de stigmatiser les jalousies, les rancœurs, les préjugés, parfois présents à l'intérieur du même groupe humain. Des Mexicains qui se plaignent de la ségrégation et qui considèrent les Noirs comme une race inférieure. Alinsky décrit les radicaux comme étant de tous les combats, contre tous les privilèges, luttant auprès des ouvriers réprimés du IWW, auprès des Noirs lynchés, auprès des métayers affamés de la Grande Dépression. On croit plonger dans Les raisins de la colère de Steinbeck, Le Rêve et l'Histoire, de Claude Julien, ou chez Howard Zinn.
Pour qui sonne le glas ?
Pour le radical, "le bien commun est le principe le plus élevé". Il "s'identifie tellement à l'humanité qu'il éprouve personnellement les épreuves, les injustices, et les souffrances de ses frères et sœurs" et pas seulement pour son pays. Alinsky cite le poète anglais John Donne (mort en 1631) : "la mort de tout homme me diminue, parce que je fais partie du genre humain, et en conséquence, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas : il sonne pour toi".
Plus on avance dans la lecture plus on est époustouflé par les valeurs morales et politiques énumérées : ni frontières, ni propriétés, au-dessus des droits humains. Et finalement une sorte de programme (presqu'électoral) de socialisme autogestionnaire (même si le mot n'existe pas à l'époque). Et si les radicaux paraissent "excentriques", il rappelle que c'est loin d'un "centre" que naît une révolution. C'est pourquoi il oppose les conservateurs, les libéraux (au sens américain, c'est-à-dire des contestataires idéalistes qui, selon lui, n'agissent pas) et les radicaux qui mettent les mains dans le cambouis. Les libéraux protestent, s'indignent, rêvent de rêves ; les radicaux se rebellent, passent à la lutte, construisent le monde dont rêvent les hommes.
Les radicaux luttent pour une "civilisation humaine" et, pour ce faire, combattent "la jungle du laisser-faire capitaliste". L'étalon-or sera remplacé par une règle d'or : la morale sociale, "mariage des droits politiques et des droits économiques".

Si Alinsky défend le syndicalisme révolutionnaire, il constate que les syndicats dominants font, eux, le jeu du capital, prétendant que les ouvriers ne seraient pas prêts à un changement radical. Le fait même que ces syndicats négocient avec les patrons prouve leur acceptation du régime économique en place, tout-puissant. C'est alors l'occasion pour l'auteur de décrire les abus de ce syndicalisme. Ses exigences sont telles qu'elles seraient un frein au progrès, qu'elles entraînent des surcoûts au logement au point que le chef d'un syndicat du bâtiment, alors même qu'il a un salaire supérieur à la moyenne, reconnaît qu'il ne peut s'acheter une maison construite par le syndicat : lui-même a dû faire appel à des non-syndiqués ! Et de citer des exemples caricaturaux comme ces syndicats de la bière en bouteille de verre militant contre leurs "frères" qui fabriquent des canettes. Ou la consigne qui consistait à tout buveur syndiqué à briser sa bouteille de bière… pour donner du travail au souffleur de verre ! Il cite la collusion des mineurs avec l'industrie minière. Des syndicats se sont considérablement enrichis en obtenant des patrons des prélèvements sur salaires pour payer les cotisations. Ils sont allés jusqu'à prêter de l'argent à leur patron. Selon lui, le syndicalisme est perverti par l'individualisme qui gangrène la société capitaliste.
L'AFL et le CIO en prennent pour leur grade. Au début, le syndicat se bat mais il devient vite intéressé au système : il perd son idéalisme révolutionnaire aussi vite que n'importe quel tribun révolutionnaire improvisé retourne sa veste dès qu'on lui fourre 1000 dollars dans la poche.
Et le syndicalisme officiel va jusqu'à faire preuve de "sectarisme racial". Et de citer moult exemples de discrimination à l'égard des Noirs. Nombreux dirigeants, de la main droite, agitent ostensiblement la flamme des droits de l'homme et de l'égalité raciale, tandis que, de la main gauche, ils trempent activement dans des pratiques secrètes, infectes et discriminatoires.
Le radical a donc pour mission de "démocratiser le mouvement syndical". Mais il doit aussi faire comprendre que l'usine ce n'est pas tout. A quoi bon se battre pour un meilleur salaire si, dans le même temps, les loyers augmentent. Alinsky développe alors tout une théorie sur le refus de "segmentation de nos vies". Tout est lié (travail, logement, consommation, délinquance, santé publique), il faut donc adopter une attitude transversale. Être capable de voir "au-delà de son pré-carré". Et donc la négociation doit être menée au-delà des portes de l'usine
La civilisation industrielle a déchaîné des forces destructrices : "le chômage, l'appauvrissement, la maladie et la criminalité". Les disputes entre capital et travail ne sont pas juste des sujets intéressants mais "une lutte pour la vie". Et le peuple est inscrit dans des communautés, il s'appuie sur ses propres organisations. En démocratie (qui ne peut être que dynamique), les gens sont le moteur de la société, et les organisations les rouages : des organisations du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est là que l'on rejoint la démarche radicale : Saul Alinsky décrit comment vivent les organisations (culturelles, civiques, sociales, sportives, syndicales, de loisirs, de nationalité, de service). Avec des or-ga-ni-sa-teurs ! Pas des organisateurs venus d'en haut : des leaders choisis et qui ont la confiance de la base, et qui, à ce titre, sont habilités à la représenter.

Agrandissement : Illustration 4

Alinsky s'insurge contre ceux qui veulent adapter les pauvres à la pauvreté, avec bienveillance, "non pas pour organiser le peuple, pour l'aider à se rebeller et à sortir du trou", mais "pour "adapter" ces gens, qui, une fois adaptés, pourront vivre en enfer et même y prendre goût". C'est, selon lui, la pire forme de "trahison sociale", perpétrée au nom de la charité.
Lorsque l'on a affaire avec la décrépitude économique d'un quartier, eh bien il n'y a qu'une chose à faire : "dépaupériser" ce quartier pauvre.
On comprend que des travailleurs sociaux aient voulu se ressourcer chez Alinsky, quand ils se sont mis à parler "droit des usagers", responsabilisation des publics (même si la démarche reste en France bien timorée). Ces "radicaux" qu'il décrit, ces "meneurs" sont issus du terrain, ils savent parler aux gens, les réunir afin que l'on parvienne à un accord commun. L'expérience montre que les conseils de quartiers se sont cognés à la question du leadership. Souvent parce que les représentants des organismes officiels adoubent ceux qui leur ressemblent : ils font appel "à des locaux appartenant aux classes moyennes supérieures", "poignée de grands bourgeois, vautrés dans leur ego de sauveurs du peuple autoproclamés", contemplant "avec pitié ces pauvres gens du quartier plongés dans l'ignorance". Alinsky cite ce sociologue intrigué qui constatait que les gens préféraient le chef de gang qui leur donnait 5 dollars plutôt que les services sociaux qui leur accordaient 150 dollars. La réponse fut : "ce n'est pas ce qu'on donne qui compte, mais comment on le donne". Pour l'un, t'es un être humain, pour les autres, "un cas".
Le leader idéal est local, compétent, honnête, et il a la confiance de ses mandants. Il est jugé sur ses actes, moins sur ses paroles. Les organisations officielles doivent en prendre acte, sans chercher à imposer des leaders qui leur conviendraient mieux. Ainsi, après des réflexions presque philosophiques, Saul Alensky entre dans des aspects plus pragmatiques et délivre des conseils sur le choix des leaders et sur leur comportement face aux difficultés rencontrées. Il faudrait consacrer encore des pages et des pages à ce qu'il dit de "l'éducation populaire" et des considérations psychologiques sur l'organisation des masses. Mais ce qui compte c'est de lire le livre. Alors qu'il a été publié il y a 70 ans, il demeure d'une incroyable modernité. Il soulève une multitude de questions totalement d'actualité. Il nous parle comme un chercheur qui voudrait aujourd'hui nous dire sa compréhension du vivre ensemble. Le Passager clandestin a vraiment été perspicace en décidant de traduire et de publier ce livre.
Même si Alensky est tolérant avec les lobbys et les grands groupes de pression aux USA, preuve selon lui de la dynamique démocratique (la gauche radicale américaine lui reprochera de ne pas remettre en cause totalement le système), il en appelle à une citoyenneté démocratique : "un peuple informé, actif, participatif, intéressé". Et de conclure sur le chant des IWW, Solidarity Forever ("la solidarité pour toujours") avant de pousser ce cri, rassembleur des laboureurs et des ouvriers, et de tous les citoyens : "Radicaux, Réveillez-vous !".

Quelques citations :
. "Le bien-être d'un seul dépend du bien-être de tous."
. "Aucune clinique, aucune caste, aucun groupe d'intérêt, aucune administration bienveillante ne saurait avoir l'intérêt du peuple autant à cœur que le peuple lui-même."
. "Formé quelqu'un à un boulot quand aucun boulot n'est disponible revient à vêtir un cadavre d'un costume trois-pièces. Au final, ça reste un cadavre. C'est comme sortir le service du dimanche pour se retrouver devant des assiettes vides."
. Saul Alinsky a quelques mots cruels envers l'Église catholique qui s'inclina devant l'esclavage, condamna les droits proclamés par la Révolution française, et dont "les prélats s'agenouillèrent servilement devant le nazisme avec Pétain".
. Radicaux, réveillez-vous !, éditions Le Passager clandestin, 2017 (15 €). Préface brillante de Marie-Hélène Bacqué et belle traduction d'André Verhaeren, avec notes de l'éditeur et du traducteur. L'ouvrage se termine par 11 pages de Saul Alinsky présentant les Statuts de l'organisation du peuple (sans but lucratif). Marie-Hélène Bacqué, qui est co-auteur d'un livre publié en 2012 L'empowerment, une pratique émancipatrice ? (La Découverte) explique que Saul Alinsky ne parle pas d'empowerment, notion qui ne fera son apparition aux Etats-Unis qu'au début des années 1970. Dans toutes les bonnes librairies, sinon au Passager clandestin : ici
. voir article de Julien Talpin, sur le site de la Vie des idées, Mobiliser les quartiers populaires, vertus et ambiguïtés du communauty organizing vu de France.
. Mouvements, la revue éditée par La Découverte, a publié un article intitulé Ma cité s'organise. Community organizing et mobilisations dans les quartiers popualires, par Hélène Balazard, Marion Carrel, Simon Cottin-Marx, Yves Jouffe et Julien Talpin, 2016/1 (n°85).
Billet n° 313
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr
Tweeter : @YvesFaucoup
[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées.



