Episode 1/4 : « J'aimerais mieux avoir une vie de chien »
Episode 2/4 : « On ne parle pas à la police »
Episode 4/4 : « La machine judiciaire »
Episode 3/4 : « Profesor, ça va ? »
Je me réveille en colère. Je n'ai pas vraiment dormi, perché sur mon banc, tourné contre le mur. J'ai fait des rêves trop courts, trop agaçants, comme lorsqu'on a trop bu, des rêves qui tournent en rond et dans lesquels il ne se passe rien. Le bourdonnement incessant m'énerve, la lumière incessante m'énerve, ne pas connaître l'heure m'énerve. J’ai toujours aussi mal à la tête. Est-ce encore le « beau » milieu de la nuit, ou la comédie va-t-elle bientôt reprendre ? Mes bras sont ankylosés, mes hanches me font mal, je me sens sale, ma peau me démange. M et A dorment toujours ; l'un d'entre eux ronfle doucement. Je m'assois et m'étire comme je peux, tends l'oreille, mais je n'entends rien dans les bureaux ; il doit encore faire nuit et toujours cette rumeur de ventilation alors qu’il n’y a pas d’air. Je finis par m'allonger à nouveau et à somnoler, il n'y a que ça à faire de toute manière. Le plafond est toujours constellé de sueur. Il fait moite, je transpire sur ma veste synthétique et sur ces matelas de plastique. Pourquoi au juste n'ai-je pas été auditionné ? Mon avocate avait pourtant quitté les lieux certaine de l'imminence de l'audition. Qu'est-ce qui cloche dans mon affaire ? Pourquoi les cas de M et de A sont-ils régulièrement traités, et pas le mien ? Le doute s'installe encore un peu plus dans mon esprit : aurais-je frappé un policier ? J'imagine, de l'autre côté du mur, toute une brigade s'activer comme une colonie de fourmis pour venger l'une des leurs, observer toutes les vidéosurveillances de Paris pour me suivre sur les derniers jours, débusquer la moindre faute, pour m'accabler.
Je retombe dans un demi sommeil proche de l'hallucination, dans lequel la mâchoire de la justice se referme sur moi, me plante ses crocs dans la gorge, me recrache en prison, la vraie prison, celle dont on ne ressort pas indemne, celle peuplée d'hommes auprès desquels je n'arriverai pas à m'intégrer. S ne m'attendra pas. Elle va refaire sa vie. Et tous nos projets ? Notre départ dans les Alpes, la vie dont on rêvait ? Aux oubliettes. Ma vie aux oubliettes. Je vais perdre mon travail, ma famille aura honte de moi et tous·tes me tourneront le dos. Mes ami·es m'oublieront. Le sang tambourinait derrière mes tempes et chaque bouffée d'air puant me brûlait les poumons.
Je ne saurais dire une fois de plus combien de temps ce moment a duré. Finalement M se réveilla et m'extirpa de mon cauchemar éveillé. Nous échangeâmes quelques mots : il avait parfaitement bien dormi. On nous apporta le fameux petit déjeuner des commissariats, puis le silence retomba. Il serait vain de chercher à restituer ici toutes les petites conversations qui animèrent de loin en loin notre cellule. Toute la journée, infinie, uniforme, s'écoula au ralenti, balisée seulement par les visites des gardiens, d'allers-retours au lavabo, des tentatives de A de garder le contrôle sur son destin en communiquant avec son frère, et tout cela enveloppé de mystère opaque, sans qu'à aucun moment ne nous parvienne la moindre information nous concernant. Des années s'écoulèrent.
Surtout ma détresse se transformait doucement mais sûrement en une colère sourde : c'en était fini des politesses. Plus de « merci », plus de « excusez-moi ? », rien, rideau. Qu'ils aillent se faire foutre. A avait raison depuis le début : pour eux nous sommes coupables, et ils nous traitent comme tels. Alors à quoi bon donner le change ? Celles et ceux parmi ces clowns sanguinaires qui sont de corvée de cellules, qui doivent regarder les gens pisser et déféquer leurs sales barquettes, et se taper l'odeur des cages, ceux et celles-là doivent être vexé·es de se retrouver aux basses œuvres, non ? Elles et ils seraient mieux dans un bureau ? Bien fait. On va les appeler sans cesse. Minuscules vengeances mais tellement jouissives ; et puisqu'on nous considère comme des voyous, pourquoi pas. A peine les gardiens ont-ils le dos tourné que les insultes murmurées pleuvent dans les cages. Bande de fils de putes. Chiens. Nique ta mère. Parfois un gardien se retourne : t'as dit quoi ? Qui c'est qu'a dit ça ? C'est personne, chef, déclare A. C'est personne. Crétin.
Quand enfin on vint me chercher pour mon audition, plus de quarante heures s’étaient écoulées depuis mon arrestation.
Je fis un petit signe à mes camarades de cellule. Force ! me lança A, que je voyais sans le savoir pour la dernière fois. J'espère le recroiser un jour. Il l'ignore sûrement mais il m'aura lui aussi permis de tenir, à sa manière. J'entends encore sa voix, souvent. A mon tour, je lui tire mon chapeau. Je ne l'oublierai pas.
Mon audition eut lieu dans un grand bureau partagé par trois officiers, et en même temps qu'une autre : B se faisait cuisiner. Il avait refusé de donner les codes de son téléphone et se faisait engueuler. Je rappelle qu'il était mineur et qu'il n'avait apparemment pu parler à personne depuis son arrestation la veille. Aucun·e avocat·e n'était à ses côtés. L'OPJ lui disait que c'était la dernière fois qu'il voyait son appareil, que celui-ci allait être placé sous scellé pendant des années, que lui-même risquait de graves ennuis. Mais le petit ne broncha pas. Il fit une chose amusante qui mit son interlocutrice hors d'elle : il fit mine d'accepter de donner ses codes mais en donna un erroné. Il ne restait plus que deux essais.
L'OPJ derrière son écran d'ordinateur me signifia que mon audition pourrait bientôt commencer. Pourtant il me proposa d'abord une cigarette, en me tutoyant. Le petit numéro commençait. Qu'est-ce qu'il s'imagine, ce con ? Que je vais développer subitement un syndrome de Stockholm ? Non merci, je ne fume pas. Toutefois je vis derrière lui sa machine à café rutilante et proposai de troquer la cigarette pour un café. Quarante heures que j'en rêvais. Je vis qu'il était satisfait de réussir à nouer un lien avec moi et me fit couler un petit espresso. Je le bus par petites lampées, espérant chasser mon mal de tête. Je lui demandai alors s'il pouvait me permettre de me voir dans un miroir. Je sentais bien en le touchant que mon visage était gonflé et j'étais un peu inquiet. Je me sentais défiguré. Il fit mine de chercher dans son bureau mais ne trouva rien. En revanche il en profita pour me mettre la pression l'air de rien : j'ai vu la vidéo, avant l'arrestation ton visage est le même. Manière de me signifier que tout avait été filmé et qu'il était inutile de mentir. Il me lut mes droits, me fit confirmer mon identité et me posa ses premières questions. J’avais eu le temps de réfléchir et d’anticiper tant bien que mal tout cela malgré l’état psychique lamentable dans lequel je me trouvais. Je n'allais rien dire à ces imbéciles, et réserver ma parole pour un magistrat1. Je savais que le pire pour moi serait d’avoir affaire à un agent qui prendrait mon refus de parler pour une offense personnelle ou comme de l’effronterie, comme le Prussien dans La Folle. Dans la nouvelle de Maupassant, une vieille femme traumatisée par les décès successifs de son mari et de son enfant reste alitée pendant quinze années sans se lever, sans parler, sans bouger. Lorsque l’occupant prussien envahit la France d'abord, puis sa chambre, la vieille femme toujours pétrifiée reste au lit le regard au loin. Petit à petit, le commandant se vexe. Il commence à douter : ne serait-ce pas en réalité une forme de résistance dédaigneuse ? Il décide finalement de faire emporter la vieille sur son lit à travers le village, et la laisse en pleine forêt, où, toujours immobile dans ses couvertures, elle sera dévorée par les loups.
1 Article 63-1 du code de procédure pénale : La personne placée en garde à vue est immédiatement informée [...] du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Pour ce qui me concernait il s’agissait de trouver le moyen de ne rien dire sans que cela ne passe pour de la témérité malvenue. J’avais donc décidé de tout mettre sur le dos de mon avocate et de transformer en avantage le retard important de mon audition : je suis fatigué, je ne suis plus lucide. Deux jours que je suis en cellule, je n'arrive pas à aligner deux idées. Je crois comprendre d’après ce que vous me dîtes que ce n’est peut-être pas la meilleure chose à faire – et je vous crois ! – mais je vais suivre les conseils de mon avocate : je n’ai rien à déclarer. Il me posa des dizaines de questions, et toujours la même réponse, bientôt abrégée – il avait mal aux doigts, la blague ! – Suivant les conseils de mon avocate, je vous annonce que je n’ai rien à déclarer. Est-ce que c’est la police qui vous a blessé ? Suivant les conseils de mon avocate, je vous annonce que je n’ai rien à déclarer. Ah, même ça, tu ne veux pas répondre, t’es sûr ? Je n’ai rien à déclarer. Quelles sont vos revendications politiques ? Je n’ai rien à déclarer. Je notai la bizarrerie et la grandiloquence des questions. Pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances vous avez été arrêté ? Je n’ai rien à déclarer. C’est énervant, hein ? Bien fait pour lui et merci pour le café. Avez-vous quelque chose à dire avant de terminer ? Non. Bien. Je vais te faire signer le papier et puis on va passer à l'exploitation de ton téléphone2. La blague, mais qu’est-ce qu’il croit, celui-là ? Par ailleurs, il valait mieux pour moi qu’il ne l’allume pas : photos de manifestations, de fumigènes, de feux de poubelles, de vidéos de charges, et j’en passe. Depuis quarante heures, je me maudissais de m’être pris pour un pseudo reporter de guerre. La blague était allée loin puisque S m’avait offert un brassard « PRESSE » que je mettais de temps en temps en manifestation pour passer derrière les cordons de police et prendre des images. Rien de criminel évidemment mais, dans la mesure où l’exploitation de mon téléphone devait permettre au procureur d’établir mon profil…
2 Article 434-15-2 du Code de procédure pénale : Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires [...]. Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450 000 € d’amende.

Agrandissement : Illustration 1

Je déclarai donc à mon OPJ que je ne lui donnerais pas mes codes – tout cela au bluff car le code, c’était 1234, et il l’aurait déverrouillé à la première tentative s'il avait essayé. Je suppose que la procédure le lui interdisait, de toute manière. Il me rappela que c’était un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de centaines de milliers d’euros d'amende, ce qui n’était qu’en partie vrai au demeurant, mais je ne me lançai pas dans une conversation de juriste de comptoir. Je connaissais la loi, j'avais déjà anticipé ce moment et j'y avais déjà longuement réfléchi. Il ajouta que le magistrat pouvait demander un mandat pour l’exploiter sans mon consentement. Je lui répondis que j’étais au courant, que je ne changerais pas d’avis. Très bien, comme tu veux, dit-il, à peine menaçant. Il démonta mon téléphone, recopia méticuleusement les chiffres gravés sur la petite carte SIM et plaça le tout dans un scellé. Il me tendit le procès-verbal afin que je le signe. Je pris soin, comme à chaque fois, de lire tout ce qu’on me faisait signer. Après tout, on avait le temps. Et c’est là que je vis, inscrit sous la mine de mon stylo levé, un probable vice de procédure : mes chefs d’accusation n’étaient plus les mêmes.
Voilà pourquoi les questions étaient si étranges ! Je tâchai de ne rien laisser paraître et pesai le pour et le contre. J’étais maintenant accusé d’un délit plus grave, à savoir d’avoir participé à un attroupement non autorisé en vue de commettre des dégradations3. J’hésitais. Il ne s’agirait pas d’être broyé par la machine judiciaire – l’expression, on le verra, n’est pas de moi – un peu comme dans le Brazil de Terry Gilliam, à cause d’une malheureuse faute de frappe. Mais en même temps, je pourrais peut-être m’en sortir comme ça, par la petite porte ? On est acquitté pour moins que ça. Le premier document qu’on m’avait fait signer à mon arrivée au commissariat devait bien être quelque part. En comparant les deux papiers, l'erreur serait manifeste. Toutefois, ce document-ci stipulait bien, en bas, que je confirmais que tout ce qui était au-dessus était bien exact. Il aurait quand même été malheureux de se tirer une balle dans le pied. Je me souvins des paroles de mon avocate, surprise elle aussi de trouver le refus de se disperser dans mon dossier : c'était assez rare et, en général, on ne déférait pas les prévenus pour si peu. D’ailleurs, on ne les gardait parfois même pas à vue. Finalement, bêtement, en bon élève, je signalai une erreur à l’OPJ. Il y a une erreur, ce n’est pas ça dont je suis suspecté. Bah si, répondit l’autre. Bah non, je vous assure, regardez. Il relut la feuille. Où est le problème ? Faites une vérification, mais j’insiste, on m’accuse de ne m’être pas dispersé. Il consulta son ordinateur quelque peu embarrassé et subitement, déchira la feuille comme pour cacher sa bêtise. Je n’avais peut-être pas fait le bon choix, car il n’en menait vraiment pas large. Il réimprima le papier avec correction et cette fois-ci, je signai au bas de la feuille.
3 Article 222-14-2 du code de procédure pénale : Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
De retour en cellule je constatai quelques changements : A avait été remplacé par un autre gars d'une trentaine d'années qui ne parlait pas le français. Il était assis sur « mon » banc. Je m'assis à côté de lui et racontai mon audition à M, toujours allongé près de la porte. Nous avions bon espoir de sortir le soir même, du moins c'est ce que nous nous racontions l'un à l'autre. En fait, il était presque inimaginable de ne pas sortir. Quarante-huit heures de garde à vue, ça a déjà de la gueule. Exténués l'un comme l'autre, nous sentions le soir venir. Nous nous attendions à une soirée mouvementée en raison de la manifestation qui promettait d'être monstrueuse ce jeudi-là. Il n'en fut rien. Le calme régnait, seulement entrecoupé par le martèlement des petits d'à côté qui n'en pouvaient plus d'être là. Surveillants ! Surveillants !
Bientôt notre nouveau trio se changea en quatuor puisqu'on nous amena un nouveau camarade : F était égyptien, très grand, assez gros et barbu. Il parlait un français rudimentaire, pas toujours compréhensible, ce qui ne l’empêchait pas d’être très bavard. Il nous accompagnera, M et moi, jusqu'au bout de cette histoire. Nous étions donc quatre dans la cellule alors qu'il était indiqué sur la porte qu'il s'agissait d'une cellule de trois. Nous ne manquâmes pas l'occasion de râler. Dès lors il ne me fut plus possible de m'allonger, contrairement aux minutes qui s'étirèrent encore. On transféra plus tard le remplaçant de A et nous fûmes trois de nouveau. F s'était assis à la place qu'il avait occupée avant lui. Il venait de l'étage inférieur et était manifestement ravi de changer d'air. Il nous raconta les motifs de son incarcération, mais je dois avouer n'avoir pas tout compris. F exposa par la suite en long et en large ses opinions sur la gente féminine et le couple en général, que je ne retranscrirai pas ici. M et moi échangions parfois des regards convenus, mais nous ne lui dîmes rien. F nous demandait toujours conseil, tant sur la procédure que sur ses relations sentimentales. Il était inquiet puisque ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans cette situation et une OQTF4 avait déjà été prononcée contre lui. Bientôt je me pris d'affection pour lui, en dépit de tout ce qui nous opposait manifestement. Ce genre d'expérience rapproche je suppose, et face à la violence, à l'hypocrisie, à la bêtise, on se serre les coudes. Surtout, nous sentions qu'il était en train de se faire avoir. La police profitait de son incapacité à lire pour lui faire accepter n'importe quoi. Toutes celles et ceux qui échouent dans ces cages de commissariat sont présumé·es innocent·es et chacun doit pouvoir bénéficier d'une procédure juste et équitable, non ? S'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice ; et s'il n'y a pas de justice, il n'y a peut-être plus de bien ou de mal, si ? Il m'appelait Profesor, comme dans la Casa de Papel, il riait franchement et sa présence était pour moi particulièrement réconfortante, peut-être parce que sa situation était plus grave que la mienne, ce qui me permettait de prendre du recul par rapport à ma propre affaire, peut-être aussi parce qu'il était ici en habitué et qu'il n'était absolument pas inquiet pour nous, au contraire : nous allions sortir. Pour piquer un somme, je demandai à modifier un peu l'agencement de la cellule. Nous installâmes les trois matelas sur le sol, les pieds sous le banc et la tête contre la porte.
4 Obligation de Quitter le Territoire français
Nous approchions des quarante-huit heures. Nous étions, M et moi, particulièrement anxieux : et s'ils nous transféraient au tribunal ? M avait depuis quelques heures le moral dans les chaussettes. Il sentait que l'aventure allait continuer, et il avait raison. Un OPJ vint nous rendre visite en personne. En général, ils restaient dans leur bureau, ce n'était pas bon signe. Il demanda à M de se lever et lui indiqua son imminent transfert au tribunal pour passer la nuit au dépôt. La nouvelle me pétrifia. Ce fut comme un éclair qui me traversa de part en part. J'étais absolument désespéré pour lui. Il était celui qui m'avait permis de tenir jusqu'ici, lui qui avait exactement l'âge de mon petit frère. Il fut incroyablement digne. Il sortit de la cellule pour signer et ne laissa rien paraître. On lui signala qu'on viendrait le chercher plus tard. Il se rassit sans rien dire, puis leva la tête vers moi. Toi, tu vas sortir, me dit-il. Je lui fis signe que non, mais au fond de moi, il y avait encore un peu d'espoir. Je jetai un œil aux « 48H » mais cette fois-ci, elles indiquaient une bonne nouvelle, la fin du cauchemar. Nous étions sur le point de nous enfoncer encore un peu plus profondément aux Enfers, à nous perdre encore un peu plus dans le labyrinthe, et ce que nous venions de vivre, qui durait depuis des mois nous semblait-il, allait bientôt devenir un souvenir agréable en comparaison de la suite. Après tout, nous n'étions que trois, la communication était fluide et nous nous trouvions dans un environnement devenu familier. M était en train de vaciller. Il était complètement prostré et je ne savais quoi lui dire. Je ne savais même pas exactement ce que c'était que le dépôt. Il était assis le dos contre le mur toujours tâché de sang, la tête dans les mains. Il se noyait. F essaya de le garder à la surface et lui ordonna presque de garder le moral. A près tout, il n'avait rien fait du tout. Et ce fut mon tour.
On vint m'annoncer mon défèrement au tribunal. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je n'avais rien fait d'autre que protester et filmer l'arrestation d'un ami, croyais-je. En fait, tout se brouilla instantanément. Je ne sus plus pourquoi j'étais là. Je ne sus plus si je m'étais raconté des histoires. J'allais en prison et il y avait bien une raison, forcément. Je me levai pour signer. Je relus le document. L'OPJ qui était venu m'apporter la nouvelle en personne me glissa son analyse, à peine ironique, un brin rancunier : tu vois, tu n'as pas voulu parler, donc le procureur a demandé ton défèrement. Je t'avais prévenu ! La Folle. Je retournai m'asseoir. Chaque pulsation cardiaque me faisait mal, j'avais la tête qui tournait, je croyais me réveiller toutes les dix secondes en sursaut, mais non : c'était bien réel. J'allais en prison. Trente ans que je vivais dans ce corps, derrière ce visage, trente ans que ça n'allait pas trop mal, j'avais eu beaucoup de chance, mais voilà : terminus. Le monde s'écroulait et je n'arrivais plus à parler. M trouva la force, depuis son abîme, de me réconforter, mais plus rien ne passait. J'avais fermé les écoutilles. Comment en étais-je arrivé là ? Je réalisai avec horreur que j'allais me retrouver sur la sellette, en face d'un juge, au tribunal judiciaire, porte de Clichy. L'année précédente j'avais accompagné une classe pour assister à des comparutions immédiates, à cet endroit-là précisément. Je les avais vus ces misérables, faisant leur entrée par la porte de derrière, menottés, encadrés par des gardes, avec leur mine défaite et leurs vêtements sales. Et j'avais regardé ces hommes comme des bêtes curieuses ! Ils étaient de l'autre côté. Et maintenant c'était à moi, j'allais sortir de cette même petite porte sous les projecteurs, dans mes vêtements puants et tachés de sang, avec mon œil recouvert d'un pansement immonde et mes cheveux gras, et à cet instant je tournerais la tête vers la droite, vers le public, et alors je mesurerais pleinement, profondément, viscéralement à quel point ma vie m'avait échappé. Mais avant cela il y aurait le dépôt : les sous-sols du tribunal. La porte d'entrée des prisons. Je me figurais arriver au milieu de la nuit dans une grande cellule pour dix ou douze hommes, futurs citoyens de Fleury-Mérogis, de Fresnes, de la Santé, capitales de mon nouveau monde ; les écrous claqueraient, les sonneries d'ouverture des portes résonneraient, et j’entrerais en chaussettes, et il n'y aurait plus de matelas, et je n'oserais pas réveiller les autres détenus, et je me recroquevillerais contre le mur, ma veste collante sous la joue, sur le sol glacé et dur. Le greffe, les fouilles, les douches, mais putain qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? F interrompit mon délire intérieur et se mit presque à m'engueuler. Tu n'as rien fait. Tu vas sortir. Arrête, ça, c'est pas bon. C'est rien. Le silence se fit dans la cellule, tandis que M et moi regardions nos vies défiler. Les petits d'à côté nous appelèrent mais je ne compris pas. F non plus manifestement, car il cria : quoi ? Quoicoubeh ! firent ensemble les petits, hilares. F ne comprit toujours pas et s'emporta. Il leur cria de se taire et les fit rire de plus belle. C'était touchant ce type immense, au parcours chaotique, qui réclamait le silence pour que M et moi puissions retrouver nos esprits. C'était dramatique aussi, ce colosse enfermé et moqué par des enfants. Silence.
J'étais loin. F s'ennuyait un peu et il proposa de jouer à un jeu. Il se mit à découper les gobelets en carton blanc avec les doigts, puis disposa les morceaux sur son matelas : deux lignes de trois, séparées par deux lignes vides. Les échecs des prisons. Il s'entraîna tout seul pendant que M et moi encaissions le choc, hagards. Nous écoutions les bruits émanant du couloir des OPJ, à l'affût, attendant comme on attend le couperet qu'on vienne nous jeter dans d'autres souterrains. J'étais complètement effondré. Démoli. Les images se bousculaient dans ma tête : je pensais à S et j'avais vraiment envie de pleurer. J'imaginais combien elle devait m'en vouloir, combien elle devait être inquiète. J'espérais que sa colère était telle qu'elle l'empêcherait de souffrir. Je pensais à mon travail. Qu'allait-il se passer ? Allais-je avoir un casier judiciaire ? Pourrais-je continuer d'exercer mon métier ? Je ne me rappelais plus de rien. Je repensai à mon arrestation, de plus en plus floue, aux variantes de plus en plus nombreuses. Qu'avais-je fait pour mériter ça ? C'était un mauvais rêve, j'allais me réveiller, mais non c'est la réalité : réfléchis ! Anticipe ! Rien à faire. Voilà S dans notre lit. Elle regarde le plafond, meurtrie. Elle pleure. La voilà qui explique à mes parents ce qui m'est arrivé, qui explique à mes parents ce que j’ai fait. Qu’est-ce que j’ai fait, d’ailleurs ? Souviens-toi ! Et le sang qui tape, et la tête qui tourne, et les images qui défilent.
M se secoua finalement et s'installa en face de F sur le banc pour faire une partie. Moi j'étais assis le dos contre le mur, halluciné. F expliqua longuement les règles du jeu à M. L'objectif était de reconstituer une ligne de trois pour gagner, en effectuant des manipulations et substitutions de morceaux de carton autour d'un point de pivot. Subtilité : si la ligne était reconstituée mais que l'une des pièces n'avait pas encore quitté sa case d'origine, pénalité. Ils firent de nombreuses parties et M se révéla un adversaire redoutable, au point d'agacer passablement F, qui était très mauvais joueur. Il commençait à râler et exigeait après chaque défaite une revanche. Au bout d'une quinzaine de parties, M en eut assez et chercha à quitter la table, mais F, de plus en plus frustré, ne le laissait pas partir. Une dernière ! Je crois que M perdit volontairement l’ultime mène. F jubilait. Ils étaient marrants, ces deux-là. Il s'agissait d'un jeu de société très en vogue dans les cellules de France, nous assura F. Pour me changer les idées, je lui proposai de faire une partie. J'étais absolument sûr de le battre à plate couture : à cette époque je jouais sans cesse aux échecs et j'étais persuadé d'avoir trois coups d'avance sur le commun des mortels. Il n'en fut rien. Je n'arrivais pas à réfléchir. Impossible d'anticiper quoi que ce soit, mon cerveau était complètement à l'arrêt. Je perdis toutes les parties, pour le plus grand bonheur de F. Je n'apprenais nullement de mes erreurs et perdais coup sur coup sans progresser jamais. Bientôt j'eus horriblement mal à la tête et quittai le banc pour retourner m'allonger. J’étais littéralement exténué par ces quelques parties. En fait, mes problèmes de concentration étaient peut-être liés au coup que j'avais reçu ? Je n'y avais même pas pensé jusqu'ici, et j'avais tout mis sur le compte de la fatigue et de la nervosité. En attendant qu'on vienne, je tâchai de me reposer.
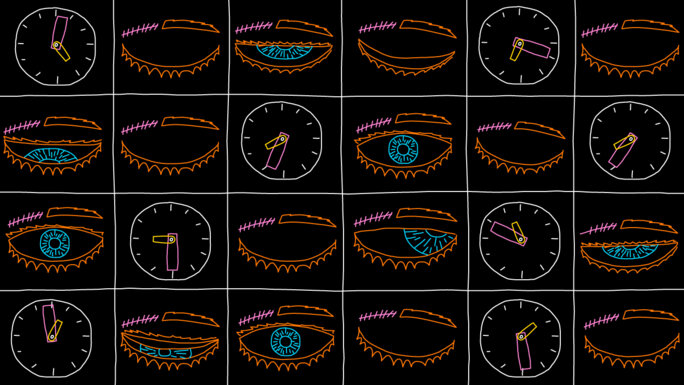
Agrandissement : Illustration 2
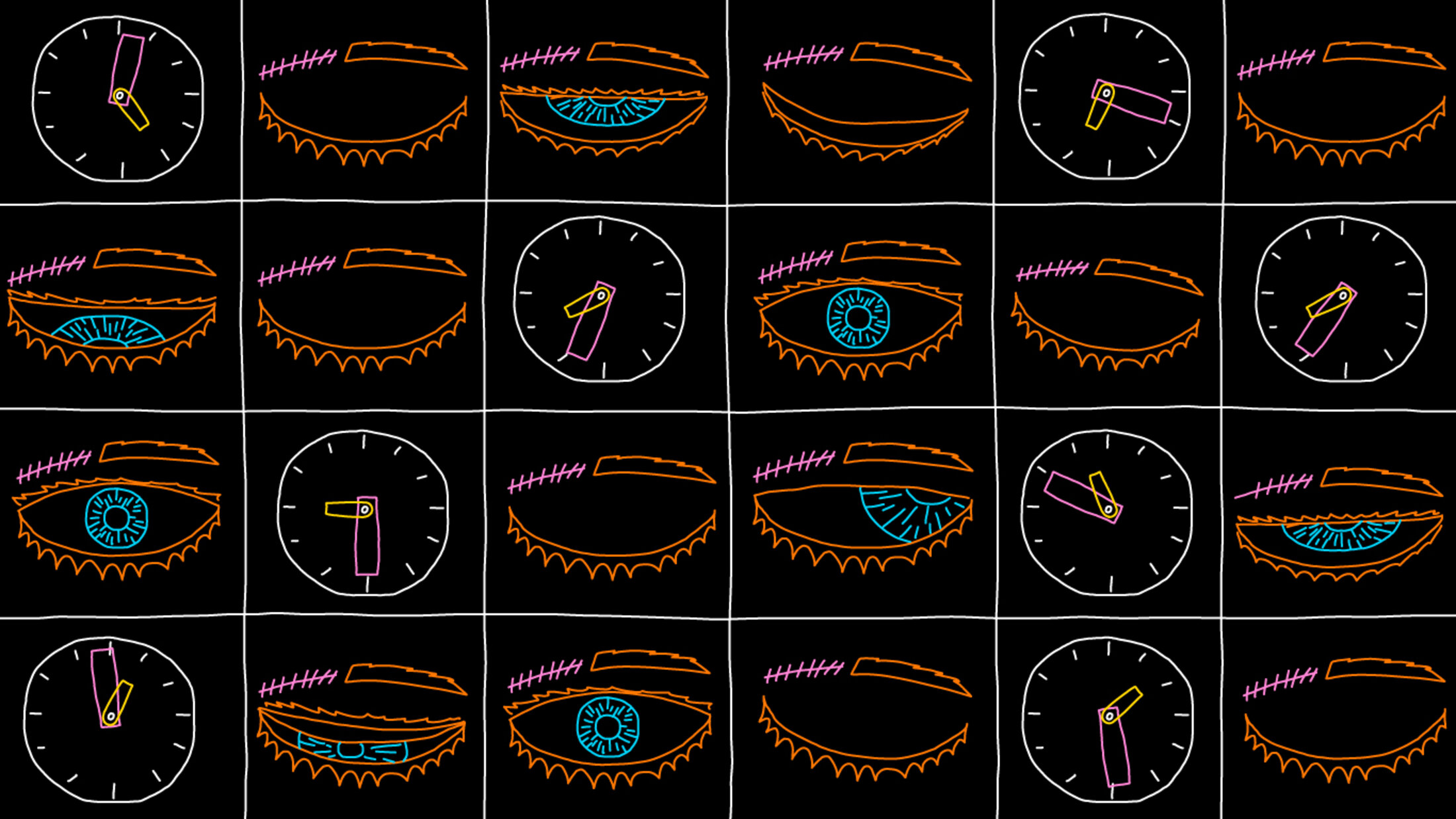
Nous étions tous les trois allongés côte-à-côte dans le vrombissement familier de notre cellule lorsqu'un gardien passa. Nous lui demandâmes l'heure : il était minuit passé. L'espoir revint un peu : la police était débordée et nous allions passer la nuit ici. Nous étions en cellule depuis plus de quarante-huit heures, alors que notre garde-à-vue s'était terminée dès lors que nous avions signé notre défèrement et notre placement sous main de justice, voilà quatre heures : il y avait un problème. Ne nous avait-on pas indiqué que nous serions transférés autour de vingt-deux heures ? Nous en parlâmes un peu, nous cramponnant à l'idée de rester ici, chez nous. Mais non. Réveillez-vous. Voilà deux jours que durait cette comédie, mais le vrai spectacle n'avait pas encore commencé. On peut toujours tomber plus bas. Le rideau se lève enfin : on vient.
Cinq ou six agents de police firent irruption dans le couloir, et ce n’étaient pas les mêmes que d’habitude. Ils portaient tout leur attirail, les coques de protection, les armes, les caméras à la poitrine. Ils nous firent savoir qu’ils venaient pour nous, ouvrirent la cellule, exigèrent que l’on se rechausse et nous alignèrent contre le mur. Nous fûmes menottés serré, puis empoignés. On nous fit traverser le commissariat endormi. On n’entendait pas un bruit, les bureaux étaient éteints, les couloirs muets. Dans le hall d’entrée, d’autres prévenus attendaient leur transfert, le visage baissé, et je reconnus J, toujours vêtu de orange. Je lui adressai un petit signe de tête auquel il répondit par un sourire désespéré. Tout s'enchaînait à toute vitesse, après cinquante heures passées à ne rien faire : nous sortîmes du commissariat et traversâmes la rue pour monter dans un camion. C’était une nuit parisienne comme une autre, l’air était doux, le ciel dégagé. La rue était calme. Je pris une profonde bouffée d’air frais. J’avais espéré que quelques-un·es de mes ami·es seraient là à m’attendre, mais il n’y avait personne pour nous, il était tard.
Les policiers étaient tendus et brusques. Ils nous poussaient en avant ou nous tiraient par le bras. Quelques agents répartis autour du camion surveillaient la rue, armés jusqu’aux dents, le passe-montagne remonté jusqu'au-dessus du nez. On nous chargea dans le camion comme des bêtes. Vous imaginez peut-être une sorte de panier à salade, mais ce n’est pas du tout cela. Dans le camion cellulaire, il y a six ou sept minuscules cages. À l'intérieur de celles-ci, on ne peut pas s’asseoir tant les parois sont étroites, il faut se mettre légèrement de biais pour que les genoux rentrent, et vous ne pouvez pas non plus rester debout car le plafond est trop bas. Vous avez toujours vos mains attachées derrière vous, et vous êtes dos à la route. Évidemment, il n’y a pas de fenêtre, vous êtes plongé dans l’obscurité. Seul un grillage permet de deviner l’allée centrale du camion. Dans cette prison sur roues j'ai la confirmation que ma vie a basculé. Je ne sais pas dans quelle cellule il se trouve mais je m’adresse à M pour lui demander si ça va, en parlant fort. C'est peut-être à moi que je parle. Oui. F prend également de mes nouvelles : alors Profesor ? Le camion démarre en trombe et je suis projeté sur la cloison en face de moi. Comme mes mains sont toujours liées dans mon dos je me cogne le front, mais j’essaye tant bien que mal de me contorsionner pour me rétablir. Comme je ne vois rien du dehors, je ne peux pas du tout anticiper les mouvements du camion, et je subis tout. En quelques secondes à peine je sens que je vais vomir. Le camion fonce sirène hurlante, moteur ronflant. Je me tords le cou pour essayer d’apercevoir un petit morceau d’extérieur à travers les grilles pour me soulager, prendre un point de repère, mais c'est encore pire. Le bruit est assourdissant, je me cogne à droite, à gauche. Derrière moi il y a la porte latérale du camion, devant laquelle se tient un policier armé. J’aperçois par un tout petit espace les façades des immeubles défiler à toute vitesse. Je ne cesse de me cogner. Les coups de frein, virages et accélérations manquent de faire gicler ma cervelle hors de mon crâne, par mon nez ou mes oreilles. On sent qu’ils nous torturent. F s’emporte et crie aux policiers de ralentir, mais on ne lui répond pas. Nous fonçons. J'essaye de lire des bribes de noms de rues mais je n’y arrive pas, nous allons trop vite. Je continue d’être balloté dans tous les sens, sur le point de vomir, je contracte ce qu’il me reste de muscles pour tenir en équilibre. Le camion s’arrête brutalement. Je suis sonné, j’ai du vomi dans la bouche et ma plaie me fait mal. Je salive sur le sol.
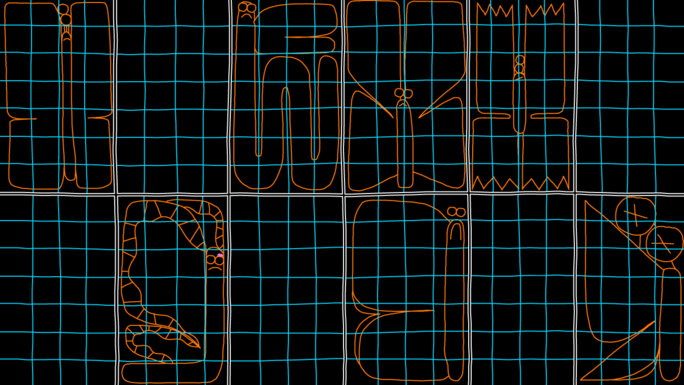
Agrandissement : Illustration 3
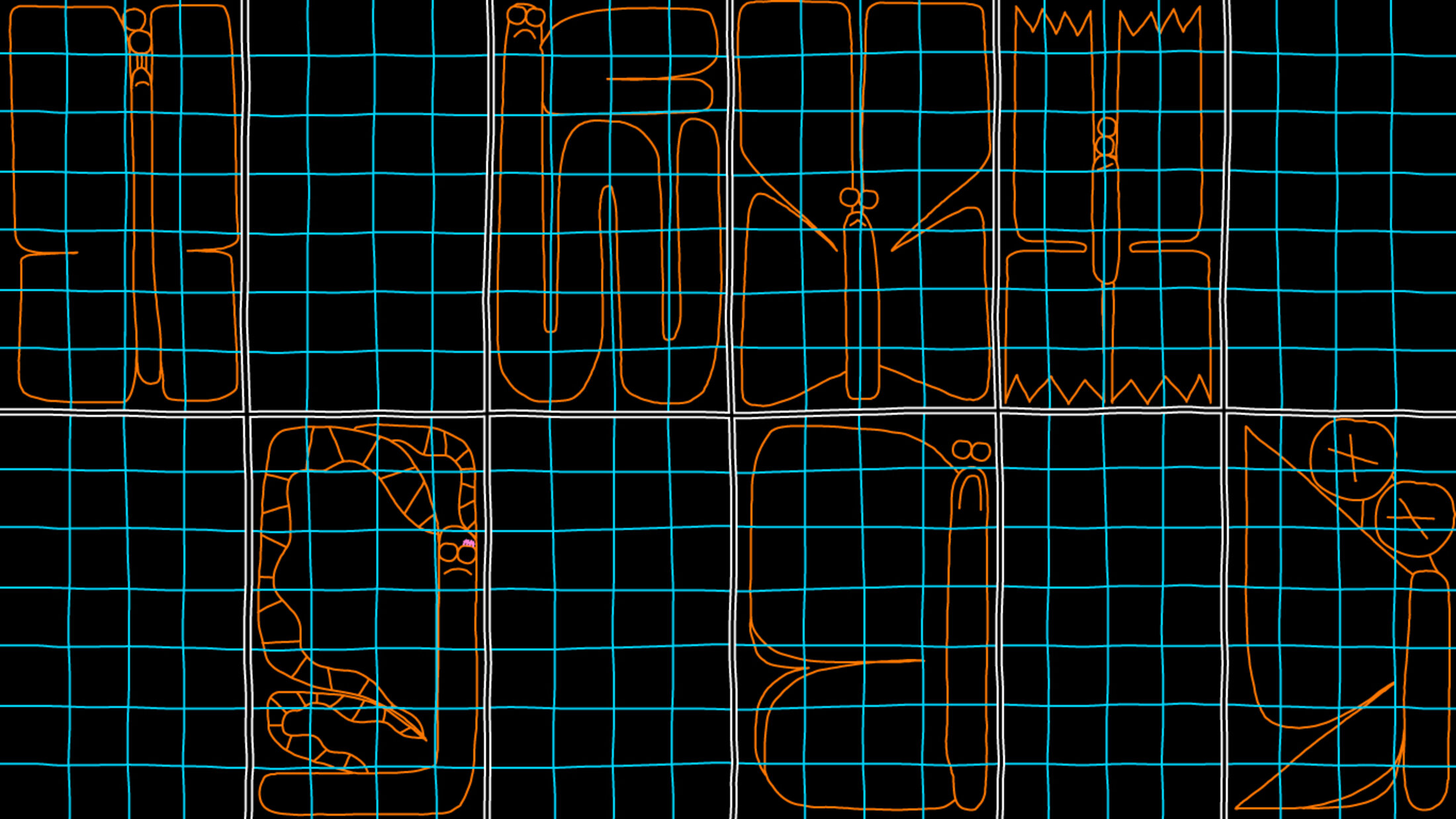
Les portes du camion s’ouvrent avec fracas. On fait une pause pour faire monter d’autres types, enfermés jusqu'ici dans d'autres souterrains. Les portes des cages claquent tandis que F s’insurge contre les conditions du transfert. L’un des policiers que j’aperçois furtivement lui répond qu’il n’avait qu’à pas faire de conneries, qu’il fallait réfléchir avant. F lui dit aussi que ses menottes sont trop serrées, ce à quoi l’agent répond qu’il est le seul à se plaindre et qu’il pourrait se comporter en homme plutôt que de chialer. On repart à toute vitesse et le cauchemar reprend. Je suis à nouveau projeté sur la cloison. Le trajet jusqu’au tribunal est interminable, d’autant que chaque seconde qui passe prend le temps de s’imprimer directement dans votre chair. J'ai envie de pleurer. J'ai besoin de vomir. Je serre les dents à m’en faire mal. Enfin une accalmie : le périphérique. F échange avec un nouveau détenu qu’on a enfermé dans la cellule qui jouxte la mienne, en criant pour couvrir le bruit du moteur et des sirènes. Il me parle aussi, Profesor ça va ? Ça le fait marrer ce surnom et il veut expliquer ma situation au nouveau. Je n’arrive pas à parler tant j’ai la nausée. Je salive encore entre mes pieds. Il insiste pour que je décline mon CV mais je ne peux vraiment pas parler. Je regrette ma cellule de garde à vue. Le nouveau évoque en criant ce pourquoi il est là quand F le lui demande : elle a pris deux ou trois claques, elle se plaint tout le temps pour rien. Il précise que les flics n'aiment pas ça et que ce n'est pas la première fois qu'elle lui cause des problèmes. Il me glace le sang. Pourtant, j’ai dû faire quelque chose d'au moins aussi grave, sans quoi je ne serais pas là, si ? La panique me reprend. Je sens que ma vie ne m’appartient plus, dans ce camion, avec ma sale gueule amochée, en compagnie de ceux-là, mes semblables, mes frères. Le nouveau se réjouit : la garde à vue est enfin finie, il va enfin pouvoir retourner en prison. F approuve : Fleury c'est mieux que le commissariat. Là-bas on cantine, on peut regarder la télé, on a ses propres affaires et il y a les promenades. Je suis au bord de la crise d’angoisse. Je me sens partir. Je vais m’évanouir. En m'efforçant de regarder derrière moi pour accrocher un repère, je quitte à toute allure mon monde. Ces routes que j'ai si souvent empruntées en voiture ne sont plus les miennes, ces visages dans les automobiles ne sont plus ceux mes semblables. Me voila autre. Plus rien n'est fait pour moi et je ne suis plus rien pour personne, pas même pour moi. Je ne m’appartiens plus désormais. Ils m'ont tué. J'abandonne. Le camion sort du périphérique et se remet à bondir de rue en rue. Je renonce à apercevoir le dehors, je me mets en veille.
Beaucoup plus tard, nous ralentissons enfin. J'ai aperçu le tribunal de l'autre côté du grillage. C'est un immeuble immense, d'un blanc immaculé, profilé comme une fusée de verre. Elle brille de mille feux dans la nuit parisienne. Nous la contournons et nous enfonçons en sous-sol. Le camion s'immobilise enfin. J'ai mal partout, à l’arcade et à la nuque, aux poignets et au cœur. Les policiers déchargent le bétail, toujours aussi violemment. Nous étions maltraités au commissariat mais ici on nous fait bien comprendre que nous avons encore franchi une étape : nous ne sommes plus dignes de la moindre compassion. Je me suis vomi dans la bouche. En file indienne, chacun accompagné d'un garde, nous découvrons le tribunal par l'entrée des artistes.
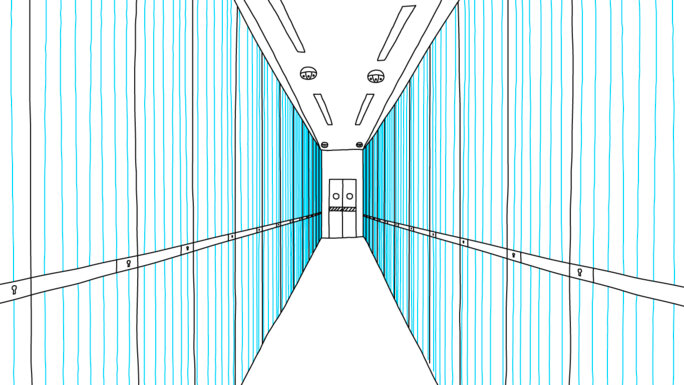
Agrandissement : Illustration 4
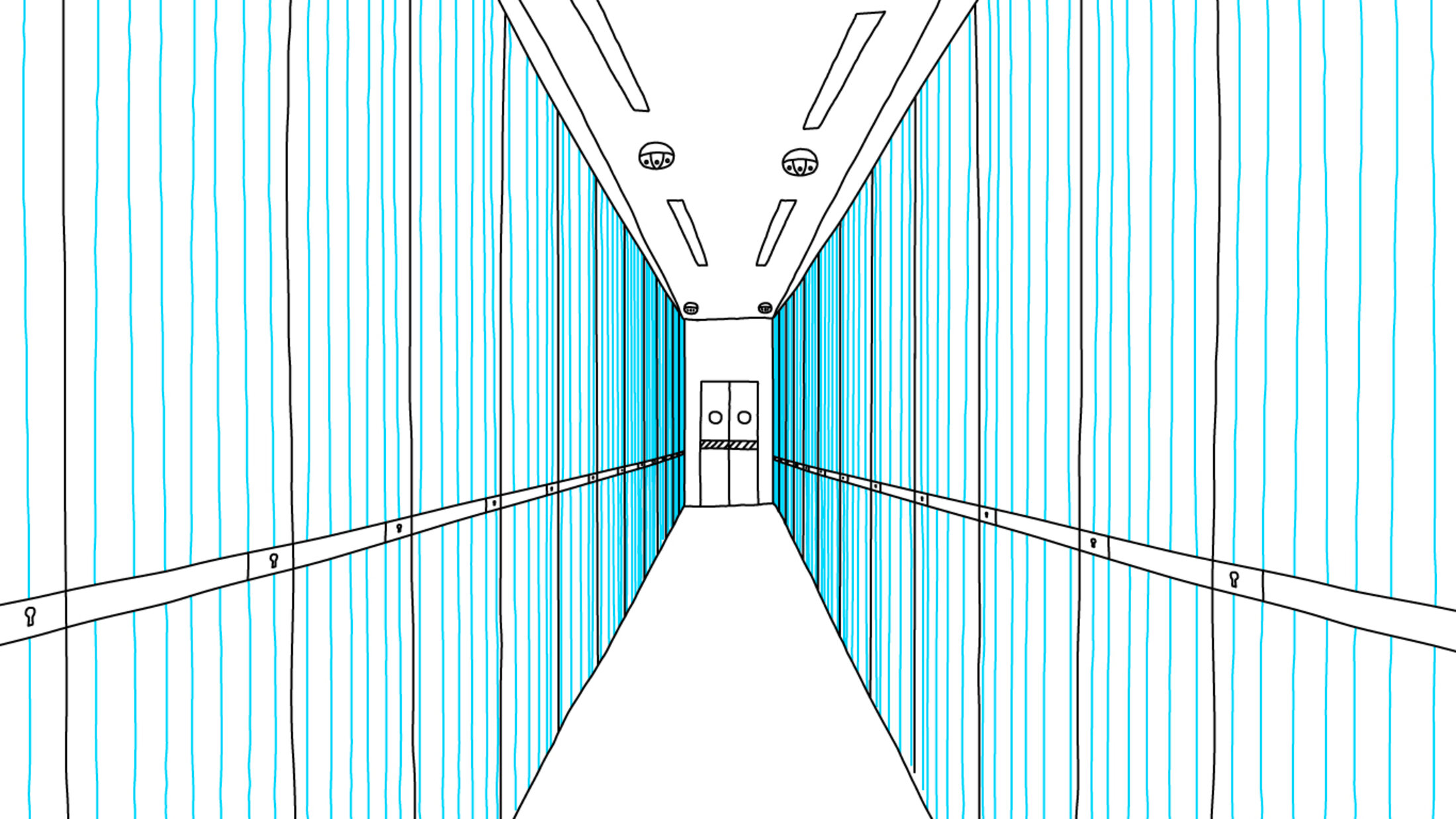
Le dépôt du tribunal judiciaire est une cathédrale glacée. Je suis frappé par le silence absolu qui règne dans ces très larges couloirs de béton. Tout est froid, sans vie. Les pas résonnent et même les flics murmurent. L’esprit aux yeux bandés qui hante ce palais souterrain inspire la crainte et le respect. Je m'étais imaginé complètement autre chose : une prison jaune avec des filets de sécurité, des cris, l'odeur acre de la peur, la saleté, des chiens en muselière, que sais-je ? Il s'agit en fait d'un hôpital désert. Tout est extrêmement blanc, neuf, propre, lisse et froid comme du béton. On nous fait asseoir le long du mur, sur des chaises. Enfin, on nous retire les menottes. C'est fou ce que ces instruments font mal. L’acier vous électrocute les nerfs, c'est extrêmement pénible. Je vous laisse imaginer ce qu'il en est après le transfert dans le camion cellulaire. Mon poignet droit en particulier est endolori. Chacun notre tour, nous sommes appelés pour les formalités d’écrou, au guichet en face. Un homme d'une cinquantaine d'années passe dans le couloir, mains dans le dos, encadré par deux gardiens. Il est en chaussons. A ma gauche se trouve F, et à ma droite le nouveau. C'est un homme d'une trentaine d'années, comme moi. Il a un regard de fou. Un à un, mes camarades sont emmenés au vestiaire. Et puis c’est enfin mon tour. Au guichet, on me redemande de confirmer mon identité, de signer de nouveau mes droits. Vous voulez voir un médecin ? Oui. On me demande si je veux faire appel à un avocat en particulier, ce que je confirme. Mais voilà, les agents ne trouvent pas mon avocate dans le registre. On me dit négligemment que dans ce cas je peux prendre un avocat commis d’office, mais je refuse. J'insiste : si on l'a trouvée dans le registre du barreau de Paris au commissariat, on va la trouver ici aussi. Ils regardent de nouveau et finissent par trouver en maugréant. Ils me demandent si je souhaite qu’ils la préviennent maintenant afin que je puisse la voir. Je confirme mais demande des précisions : si vous l'appelez maintenant et qu'elle ne répond pas, que se passe-t-il ? Il est deux heures du matin, est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux l'appeler demain ? Les agents sont impatients et me coupent : soit on l'appelle maintenant et elle a deux heures pour arriver, soit on ne l'appelle pas, vous aurez un avocat commis d'office, un point c'est tout. Je ne sais pas ce qui me prend à ce moment-là, mais de peur de déranger au milieu de la nuit, je demande de nouveau à ce qu'on n'appelle pas maintenant. Je me confonds en excuses et demande s’il n'est vraiment pas possible d'appeler le lendemain matin. J'ai largement épuisé mon temps, les agents en ont assez : soit vous signez, soit vous ne signez pas, c'est comme vous voulez. À bout de fatigue, je signe sans trop savoir si oui ou non je pourrai bénéficier des conseils de la même avocate. On me demande si je souhaite que le dépôt prévienne une personne, ou mon travail. Je demande à ce qu'on appelle S, mais je n'ai toujours pas le numéro. Les agents se regardent en levant les yeux au ciel. J’ajoute que le numéro est indiqué sur la notification de mon placement en garde à vue qui se trouve logiquement dans le dossier. Non mais écoutez qu'est-ce que vous croyez ? Je les supplie de jeter un œil, ce doit être la première page, ce sera l'affaire d'une seconde. L'agente attrape un dossier près d'elle, l'ouvre, le referme, et m'annonce qu'aucun numéro ne figure en première page. Retournez vous asseoir. Suivant.
On me conduit dans une grande cellule d'attente où se trouvent déjà M et J. M cherche sur sa peau une coupure car ses poignets sont couverts de sang caillé, c'est bizarre, je n'ai mal nulle part, je n'ai rien. Pourtant c'est vrai, je vois bien sur sa peau ce dont il parle, on dirait de la peinture séchée, qui partirait en petits morceaux, c'est rouge foncé, marron. Il lui faut finalement se rendre à l'évidence : ce n'est pas son sang à lui mais bien celui d'un autre, les vestiges d'un ancien voyage. Le détenu enfermé dans sa cage devait être blessé et il a maculé la cabine d'hémoglobine. M est horrifié et essaye tant bien que mal de se débarrasser de ce sang qui le dégoûte. Il est finalement appelé pour le vestiaire et sort. J'échange rapidement avec J. Il a donc vingt ans. C'était la première fois qu'il participait à une manifestation de sa vie. On l’accuse d’avoir voulu incendier une poubelle, comme M. Il me raconte que pendant les quarante-huit heures qu'a duré sa garde à vue, il n'a pas ouvert la bouche, recroquevillé dans un coin de sa cellule, intimidé par ses colocataires. J est pessimiste sur sa situation, et pour cause : il est parti de chez ses parents il y a un an, il dort à droite et à gauche chez des amis, il n'a pas de travail, ne fait pas d'études. Il y a des chances pour qu’on demande une détention provisoire en attendant son jugement. Il est pourtant obsédé par le fait que la police a perdu son téléphone pendant son arrestation : c'est un enfant. Il parle par phrases courtes et je devine que l'angoisse lui coupe le souffle. Il sort lui aussi. Tout est toujours aussi silencieux et blanc. On me fait entrer dans le vestiaire où l’on me présente mes affaires, c'est-à-dire mes lacets, ma carte bancaire et mon téléphone. Je signe pour confirmer qu’il s’agit bien des miennes. On me repasse les menottes. J’ai vraiment mal aux nerfs. Je tiens la menotte de droite avec ma main gauche pour que l'acier ne pèse pas sûr l'articulation mais ça ne plait pas au gardien. Arrête ça. Lâche. Je m’exécute.
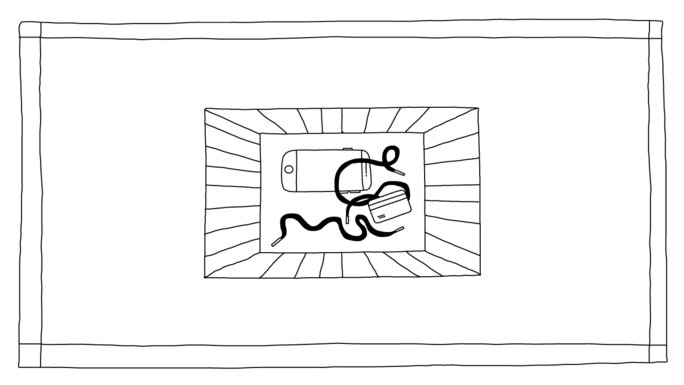
Agrandissement : Illustration 5
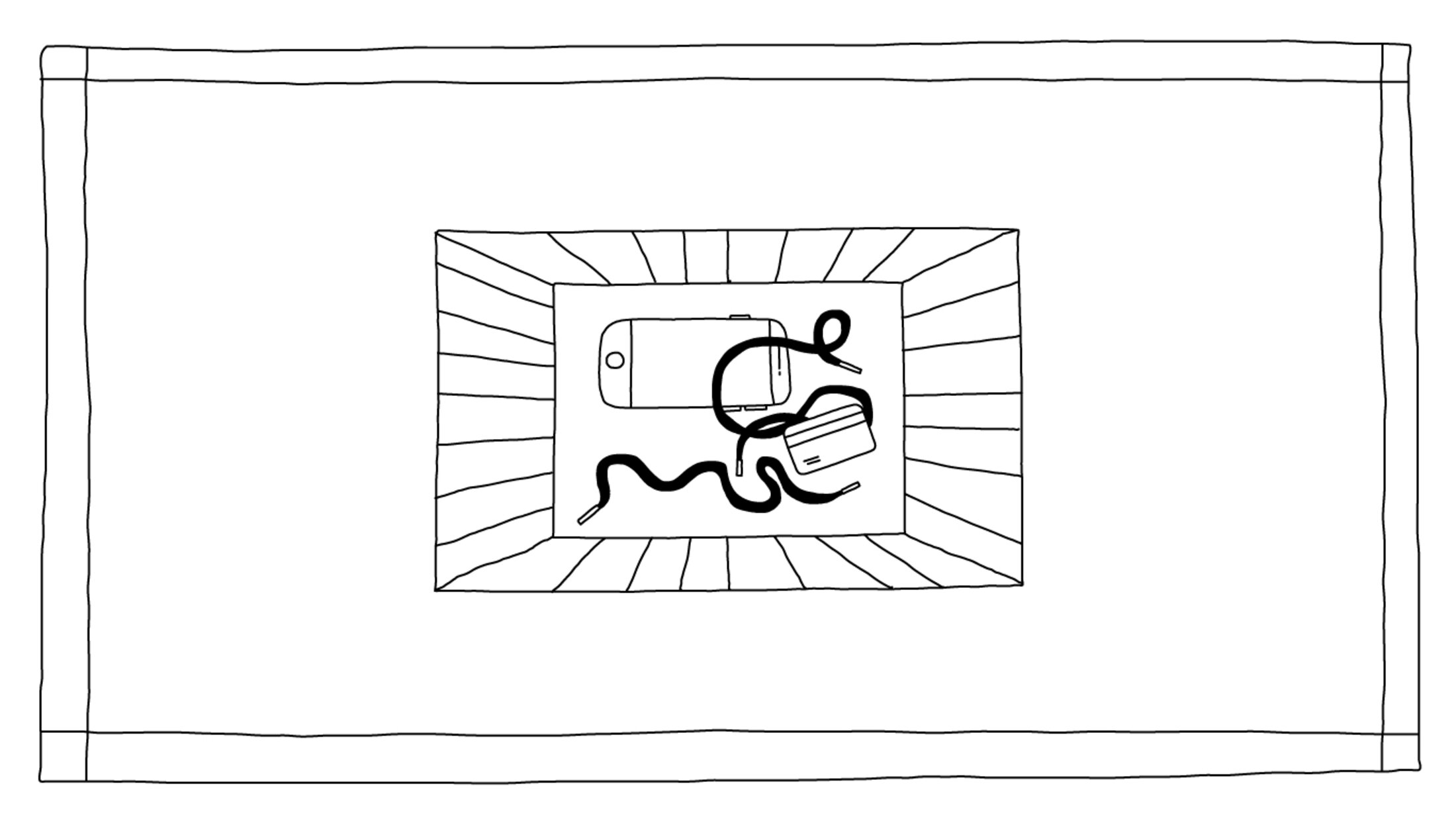
Nous partons tous les deux dans les couloirs muets et je ne demande même plus où l’on m’emporte, je suis ailleurs. Mes souvenirs sont étranges et je me rappelle de ce déplacement comme on se souvient d’un rêve, seules quelques images figées me sont restées, et il faut reconstruire ce qu’il y avait autour. Si je remettais les pieds là-bas, je pense que je ne reconnaîtrais pas les lieux. J’étais vraiment loin depuis le camion. Dans mes souvenirs, nous pénétrons dans un lieu très vaste. Nous empruntons une sorte de passerelle suspendue, et on peut voir en contrebas, à droite et à gauche, des rangées de cellules dans les étages inférieurs. Je ne distingue pas le fond, tout paraît immensément vide, et toujours ce silence et cette lumière blanche. Il fait froid. Seuls nos pas résonnent doucement dans le vide. Il n’y a personne. Nous grimpons quelques marches et empruntons d’autres passerelles, puis d’autres encore. De temps en temps retentissent les alarmes des ouvertures des portes qui me rappellent que nous sommes en prison. Je plane. On me conduit en fait chez le médecin. On me retire les menottes, donc, puis on me fait entrer dans son cabinet. Il s’agit d’un homme d’une cinquantaine d’années, un peu dégarni, pas bavard mais à l’écoute, contrairement à celui que j’ai rencontré deux fois au commissariat. Il porte une blouse, blanche comme les murs, comme l’air, comme ma voix. Je lui explique en quelques mots qu’on m’a suturé une plaie à l’arcade, que j’aimerais qu’il vérifie que rien ne s’est infecté dans ma cellule de garde à vue, et qu’il change si possible mon pansement. Le médecin ne parle pas beaucoup mais sa présence me fait du bien. Il me parle comme à un patient et me traite comme tel : il s’approche de moi sans peur. Après les menottes, les armes, le camion cellulaire, on s’habitue en effet à être un dangereux criminel. On ne se vexe plus des précautions que prennent les agents pour se prémunir d’une attaque violente. Dans le cabinet du médecin, je ne suis pas attaché, il n’y a pas de gardien dans la pièce, on n’agit pas avec moi comme si l’on craignait que je me saisisse de n’importe quel objet pour assommer le premier venu, non. Me voilà redevenu, pour quelques minutes, celui que j’étais avant mon arrestation.
Le médecin regarde ma plaie et salue le travail de sa consœur de l’hôpital. Il remarque qu’elle a fait des points serrés et nombreux, et pense que je ne devrais pas avoir de cicatrice trop voyante. Le voilà qui nettoie la blessure, délicatement, et qui change la compresse. Nous échangeons deux mots avant de nous séparer. Au revoir. Je sors. On ne me repasse pas les menottes, cette fois. On me conduit juste à côté, où l’on me donne une fine couverture et des draps en papier, pliés dans un film plastique. Cela sent le propre. Première surprise. Nous repartons dans l’autre sens, de nouveau des escaliers, du vide, du silence, des rangées de cages à l'infini, toutes apparemment vides. Je me souviens que mes oreilles sifflaient. Nous arrivons dans un grand couloir le long duquel s’alignent à droite et à gauche une trentaine de cellules. On me fait entrer dans la mienne. Contrairement à ce que je m’étais imaginé, je suis seul. La cellule est plus grande que celle du commissariat, il y a un point d’eau et des toilettes derrière un petit parapet. Tout semble propre, il n’y a pas d’odeur particulière. En revanche, il fait vraiment froid. Tout l’inverse de ce à quoi je m’attendais. Ma première pensée fut de me réjouir. Enfin seul, avec un peu d’intimité. Quelle erreur. Cette courte nuit sera de loin la pire de toutes.
Je me lave les mains. Cela faisait longtemps. Mes ongles sont noirs de crasse et dégagent une odeur pestilentielle, proche de celle du vomi, ou de la merde. Il n'y a pas de savon mais c'est déjà bien. Pour accéder à l'eau, il faut être debout au-dessus des toilettes turques, jambes écartées, et tendre les mains devant soi dans une alcôve aménagée dans le mur. Le débit est fort et m'éclabousse. Il me vient à l'esprit de me déshabiller au-dessus du trou pour faire un brin de toilette, je pue. Mais non. J'ai peur d’avoir froid. Je m'assois sur mon matelas, surélevé, posé sur un sommier de béton. La lumière est presque éteinte pour la nuit, ici. Il y a aussi des mots gravés sur les murs, des noms, des dates. Le silence. Je m'allonge. J'ai froid. Doucement, mes pensées vont et viennent. Je pense surtout à S. Elle me manque. Je me persuade que je ne la reverrai jamais et j’essaye de me tourner vers ma nouvelle vie, sans succès. Si on m’enferme en prison, je me laisserai mourir. Les larmes me montent aux yeux. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout gâché. J'ai trahi tout le monde. Ma vie est foutue. Les larmes coulent enfin sur mes tempes. Je les sèche d'un revers de main pour éviter qu'elles n’imbibent mon pansement. Comment ai-je pu me réjouir d'une cellule individuelle ? Je le savais, pourtant, que l'isolement était une punition dans les établissements pénitentiaires.
Lorsque d'autres prévenus partagent votre cellule, vous jouez votre rôle, vous êtes en accord avec vous-même, vous avez une identité. En garde-à-vue, j'étais le professeur enfermé qui détonnait dans le paysage, qui savait un peu mieux que les autres ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, ce qu'il fallait dire ou ne pas dire, qui donnait des conseils à des plus jeunes que lui. C'est confortable, de pouvoir s’occuper des problèmes des autres. On pense moins aux siens. Au dépôt, je suis deux. Il y a mon corps enfermé, celui qui souffre du froid et de la faim, celui qui fixe les caméras au plafond, celui qui tourne en rond, mon corps criminel, et il y a ma voix à l'intérieur de ma tête, qui me parle, qui se désole de ma situation, qui me tutoie. Elle me raconte comme c'était bien, avant, et comment tout cela aurait pu être facilement évité. Qu'est-ce qui t'a pris ? C'est trop tard maintenant. Elle fait pleurer silencieusement mon corps coupable, l'agite de contractions, ce corps gisant dans des draps de papier. Et toute la nuit se déroule ainsi, la conversation dure encore et encore, et les larmes coulent. Je m’endors parfois quelques minutes, pas plus. Et ça reprend. Ce ne sont pas des larmes qui soulagent comme ça arrive parfois, non, ni des larmes de désespoir. Ce sont des larmes mécaniques, qui ne servent à rien. Bientôt je ne serai plus qu'un corps enfermé, au repos. Je veux arrêter de penser, arrêter de me parler à moi-même. J'ai besoin d'une anesthésie, ne plus souffrir de l'intérieur. Mais c'est justement ça, la prison. La privation de la liberté d'aller et venir, ce n'est rien. La punition, c'est votre voix intérieure qui vous regarde navrée, l'enfant qui est toujours en vous qui ne peut pas cacher sa déception. Vraiment, tout ça pour ça ? Votre voix vous raconte votre vie passée et vous lit l'avenir, celui qui n’arrivera finalement pas. Se dessinent derrière vos yeux des souvenirs du futur, très nets, et vous pleurez, car vous savez pertinemment que ça, c'était ce qui était prévu pour vous, avant que vous ne sabotiez tout cela, volontairement, par bêtise, par orgueil, pour qui tu t'es pris, en fait ? Tant pis pour toi.

Agrandissement : Illustration 6




