Episode 2/4 : « On ne parle pas à la police »
Episode 3/4 : « Profesor, ça va ?»
Episode 4/4 : « La machine judiciaire »
Avant-propos
J’ai commencé à écrire ce témoignage très vite, dès le lendemain de mon retour chez moi. J’ai voulu dire le plus vite possible ce qui était arrivé, d’une part parce que je sentais que cela me ferait du bien, d’autre part parce que je sentais que j’allais tout oublier. C’est donc d’abord pour moi que j’ai écrit. J’ai écrit en espérant que ce serait un remède efficace, que cela m’éviterait de ressasser, que cela me permettrait de comprendre, de ralentir le flot de la pensée folle. Mais petit à petit, au fil de l’écriture et du temps qui passait, j’ai changé d’avis. J’ai éprouvé le besoin de ne plus penser à tout cela, de passer à autre chose. J’ai donc mis ce projet entre parenthèses. Je l’ai finalement repris. J’ai pensé que ce que j’avais vécu pourrait peut-être servir à d’autres, pour éviter les pièges, pour être prêt quand cela arrivera. Ayant moi-même eu la chance de bénéficier du récit de détention d'un ami avant ma propre arrestation, je sais le caractère décisif de la parole de celles et ceux qui sont passé·es dans ces cellules. Cela aura été long un an, mais je suis tout de même content d’être arrivé au bout. Il y aura d’autres combats à mener, et d’autres arrestations, à n’en pas douter.
J’ai été arrêté un soir de semaine après un rassemblement intersyndical, pendant la séquence politique de la réforme des retraites en 2023. Après son passage au 49.3 à l’Assemblée, après sa validation par le Conseil Constitutionnel, c’en était fini, en théorie, de la lutte. Il n’était plus nécessaire de convaincre qui que ce soit et d’ailleurs la très grande majorité des français et des françaises était contre ce projet de réforme. Battre encore le pavé n’avait plus de sens, la réforme était passée, démocratiquement diront les uns, en force diront les autres. Pourtant quelque chose d’autre avait commencé. Après l'échec de la mobilisation traditionnelle, de l’intersyndicale, et ce dès le 16 mars à l’appel de Solidaires, les irréductibles s’étaient rassemblé·es place de la Concorde, en face de l’Assemblée Nationale. La nuit était tombée et ça avait commencé. Deux cent cinquante-huit personnes ont été interpellées cette nuit-là, rien qu’à Paris. Chaque nuit, pendant des semaines, il y aurait des scènes pareilles : vous déambulez dans la ville. C’est le printemps, la nuit tombe plus tard, il fait plus chaud qu’avant, on a envie de respirer. Les rues sont bien plus animées qu'à l'accoutumée. Surtout, les passant·es ne sont plus du tout les mêmes, d'ailleurs elles et ils ne passent pas. Elles et ils vous cherchent du regard, sifflent les slogans de la révolte. Bientôt vous tombez sur un petit groupe, puis un autre, puis un autre, et bientôt tout déborde sur le bitume, les voitures font demi-tour : ça recommence. Jusqu’à ce que les moteurs des voltigeurs ne résonnent au coin de la rue. C’est dans un contexte similaire que j’ai été arrêté.
Pour ce qui est du contenu, j’ai essayé de faire au mieux. J’ai essayé d’éviter quelques écueils évidents mais je ne crois pas y être parvenu tout à fait. Mes lecteurs et lectrices me pardonneront, je l’espère. Mes souvenirs sont-ils exacts ? Je ne crois pas. Pas tout à fait du moins, on peut parier là-dessus. Mes souvenirs se sont plus ou moins bien imprimés en moi selon les émotions que j’ai éprouvées, forcément. De plus l’écriture a duré un an et les faits, petit à petit, se sont éloignés de moi. Ils ont perdu de leur netteté. J’ai en outre passé beaucoup de temps dans un état presque léthargique, à moitié en dehors de moi, à rêver plus ou moins derrière mes yeux ouverts. Je me souviens de ces soixante heures comme d’un long cauchemar dans lequel je faisais d’autres cauchemars. Enfin j’ai tellement raconté cette histoire que j’ai fini, forcément, en allant à l’essentiel, en essayant de ne pas fatiguer celles et ceux qui l’avaient déjà entendue vingt fois, par oublier certains détails, par simplifier et donc, nécessairement, par faire des raccourcis. J’espère simplement n’avoir rien inventé. J’ai fait de mon mieux.
Episode 1 : « J'aimerais mieux avoir une vie de chien. »
C'est mon compagnon de cellule qui avait murmuré cette formule et l’évidence cristalline avait l'espace d'un instant éclairé la petite pièce rectangulaire. Le silence était retombé. Ici-bas, les échanges sont distendus. Une conversation peut être reprise deux heures plus tard. Il y a le temps. On apprend assez vite à ne rien faire. À ne rien faire d'autre que divaguer. L'idéal serait d'occuper ce temps à réfléchir à ma situation, évidemment, mais toutes mes réflexions sont entrecoupées de rêveries parasites. Essaye de penser à ce que tu vas dire ou ne pas dire, anticipe les questions des OPJ1 ! Quelques secondes de concentration et ça y est, ça divague, impossible de résister. Des associations d'idées, comme lorsqu'on s'endort. Le bref soulagement de se laisser porter loin d'ici, aussi, alors on ne lutte pas tout à fait sérieusement. C’est peut-être une sorte de mécanisme de survie pour s’éviter de trop souffrir : impossible d'aligner deux idées. Quand le cœur s'emballe et que l'angoisse vous étouffe, votre cerveau vous envoie un petit coup de pouce : vous êtes soudainement au cinéma et vous regardez passivement se succéder des bribes d'idées, de rêves, de rien du tout ; vous laissez voguer votre regard sur les signatures indéchiffrables gravées sur les murs, vous regardez dans le vide, vous ne pensez à rien et à tout en même temps, vous vous couchez sur le flanc, vous recherchez une fugace sensation de confort ; et puis non tiens, sur le dos, c'est un peu mieux ; étrange ce plafond, ce plafond constellé de grosses gouttes d'eau qui pendent sans jamais tomber, serait-ce la sueur évaporée des corps enfermés ? Cette geôle serait comme un monde à part, avec son propre cycle de l'eau ; cela expliquerait les grandes traînées noires de pourriture sur le mur du fond. Ou les idées fixes des âmes damnées ? Aux Enfers, l'air ne circule pas et les pensées tournent en rond. Entre nous et le couloir, du plexiglas renforcé qui laisse passer le bruit mais pas l'oxygène. Il fait très chaud et l’air est lourd. Il y a une couverture dans un coin de la pièce. Personne n'y touche tant l'odeur qu'elle répand est pestilentielle. Je suis content d'avoir gardé ma veste matelassée au cas où, mais pour le moment elle me sert d'oreiller. Un oreiller maculé de tâches de sang d'accord mais un oreiller quand même, qui m'évite de dormir directement sur mes bras et de me réveiller d'un demi sommeil avec les membres durs comme du béton. Il ne faudrait pas qu'à force d'être ici depuis des heures, depuis des années, depuis des siècles, je finisse moi aussi par devenir cette cellule, disparaître petit à petit et devenir une signature gravée à la braguette. Mes hanches sont douloureuses à force de reposer sur le sol. L'air est vicié. Il sent l'angoisse et la saleté, il sent la trouille et la misère, les vieux vêtements humides sur des chairs moites. Nous sommes toutefois très largement privilégiés : les toilettes sont à l'extérieur. Un pauvre hère nous racontera plus tard les cellules du bas. Les cages de six où l'on va chier dans un coin, les lamentations, et aussi les conversations tuées par la chaleur. Divaguer. Penser à l'avenir, aux retrouvailles, au futur, aux voyages, aux sourires. Chasser les questions qui arrivent inévitablement : comment ai-je fait pour en arriver là ? Qu’est-ce que j’ai fait ? Changer d'idées. Ne pas tomber dans la détresse. Courage. Je regarde mon compagnon de cellule qui regarde le plafond. Le mur derrière lui est maculé de sang mais je ne sais pas s'il s'en est rendu compte. Il tourne la tête, nos regards se croisent mais ils n'expriment rien. On se fixe comme on fixe le mur.
1 Officier de Police Judiciaire. Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. du placement en garde vue dès le départ de la mesure.
On frappe aux vitres dans la cellule des « petits », à côté de la nôtre. Ils sont mineurs. Encore insouciants, ils crient « surveillant ! » pour singer les séries carcérales qu'ils regardent peut-être, et ils rient. Ils semblent incroyablement à l'aise, mais difficile de savoir ce qui se cache derrière les armures que l'on se forge. Moi-même je porte un masque, celui du calme et de la résignation, quand mon cœur est transpercé en permanence de flèches empoisonnées. Je pense que M fait pareil ; c'est une manière comme une autre de nous serrer les coudes. Ce vacarme des enfermés qui tambourinent sur les vitres blindées est insupportable et me restera en tête longtemps. Cela dit, on va pouvoir aérer brièvement. En attendant, je me refais le film.

Agrandissement : Illustration 1

Je suis né dans une voiture de police, la tête en avant, poussé par quatre brutes, le visage en sang et les mains dans le dos. On m'installa avec fermeté en position assise, on me sangla, le sang m'aveuglait et coulait sur mon menton, me piquait au coin des yeux, et je demandai au gardien de la paix assis à côté de moi s'il pouvait m’en enlever un peu qui me brûlait. Il n'avait pas que ça à foutre. Je posai le coin de mon arcade sourcilière éclatée sur l'arrière de l'appui-tête devant moi pour me soulager. Il me poussa brutalement la tête sur le côté. Arrête tes conneries. Le sang me coulait sur les joues, gouttait sur ma veste, sur mes genoux, les menottes me sciaient les poignets et m’électrocutaient bizarrement les nerfs. Le véhicule fila à toute vitesse, sirène hurlante. Mon corps était ballotté de droite et de gauche, d'avant en arrière, et le sang coulait. La ville défilait à toute vitesse, rouge et bleue, la force centrifuge plaquait ma cervelle tantôt au fond de ma boîte crânienne, tantôt derrière mon front, et je ne reconnaissais rien. Nous arrivâmes enfin devant un bâtiment dans lequel on me fit pénétrer en me tenant fermement par le biceps. J'avais envie de vomir. Là. Assieds-toi. Il fallut ôter ma veste pour la fouille2. On me retira les menottes d'acier froid et coupant. Dès lors, ce sera la bascule : je perdrai mon statut de citoyen en même temps que celui d'innocent présumé. Je serai bandit, escroc, violeur et menteur. Je serai celui que l'on tutoie, celui qu'on rudoie, qu'on insulte, à qui l'on accordera ou non un verre d'eau en fonction de l'humeur et du tempo. Un gardien de la paix âgé d'à peine vingt ans me traite de connard. Retire tes lacets connard ou je les coupe, et me voilà retirant les lacets de mes chaussures pour ne pas me pendre avec. Le sang goutte sur mes mains. A ma gauche il y a un très jeune gars, il est habillé en orange fluo de la tête aux pieds, glabre, les cheveux légèrement ébouriffés. J'apprendrai cinquante heures plus tard son nom : J, et son âge : vingt ans. Il ignore encore que son choix vestimentaire qui le fait ressembler à un prisonnier de Guantánamo ne va pas lui porter chance. Il menace la police de porter plainte si elle coupe le cordon de son jogging de marque. Il parle un peu du nez et il me rappelle soudainement Iliès, l’un de mes anciens élèves. Quand je le reverrai deux jours plus tard, il aura baissé le ton et la tête. Le cordon de son jogging sera le cadet de ses soucis.
2 Article 63-6 du code de procédure pénale : Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale. La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Une fois fouillé on vint me faire « souffler ». Le policier chargé de contrôler mon taux d'alcoolémie était sûr de lui : je pouvais être entendu dès maintenant. l’OPJ ne voulut cependant pas m'auditionner. Heureusement pour moi, car qui sait ce que j'aurais raconté à chaud ? M'aurait-on préalablement permis de m'entretenir avec mon avocate ? Tout mon séjour aux Enfers fut un labyrinthe de décisions à prendre par moi ou par eux, toutes apparemment anodines mais toutes décisives pour mon destin. En garde à vue toutes les planètes doivent s'aligner pour espérer revenir avec le moins d'ennuis possibles. A ce moment-là, naïvement, je trouvai ridicule d'être placé en dégrisement. En attendant de pouvoir légalement m'entendre donc, il fallut m'escorter à l’hôpital pour refermer mon arcade sourcilière. Je fis la route avec trois agents. Les sujets déballés, la légèreté des anecdotes, me sidéraient : ces trois-là étaient à des années-lumière de moi, moi qui était en train de vivre un cauchemar éveillé, qui était traversé d'émotions contradictoires, au premier rang desquelles la colère et la peur ; je n'étais tout simplement pas là pour eux, ils et elle faisaient leur travail machinalement, seul·es. Et après tout, comment aurait-il pu en être autrement ? Comment peut-on intégrer cette machine à détruire si l’on tient les prévenu·es pour ses semblables ? Je me refuse à croire que ces hommes et ces femmes qui nous humilient, qui nous déshumanisent ou nous infantilisent soient simplement de méchant·es humain·es - à moins que ? Le chef de meute, le plus ancien, avait des cheveux gras espacés. Il avait le visage mauvais et me parlait comme il l'aurait fait à un chien galeux. D'ailleurs non, il ne me parlait pas : il parlait de moi comme il aurait parlé d'un chien galeux et niait carrément ma présence. Il a une grande gueule celui-là, ça se voit que c'est un prof. Pardon, il m'adressa parfois directement la parole, pour m'ordonner de fermer ma gueule ou pour me traiter de connard.
Je fis une entrée remarquée à l’hôpital. Bien encadré par mes maîtres, le visage peinturluré de sang et les mains toujours attachées dans le dos, les patient·es dans les salles d'attente s'écartaient l'air apeuré. Dans leurs yeux, j'étais déjà un criminel, et ce reflet de moi-même dans les yeux des autres commença de me faire intégrer l'évidence de ma culpabilité. En passant de salle en salle, j'essayai de discerner sur quelques visages un regard de sympathie. Je me souviens avoir adressé un clin d’œil à quelqu'un en passant, mais je ne suis pas sûr de savoir si ce clin d’œil lui était adressé pour le convaincre de mon humanité, pour faire naître la connivence entre nous, frères humains, ou pour avoir l'air canaille, apache, criminel, pour commencer à creuser moi-même le sillon qui sépare le bon grain de l'ivraie. Déjà l'aliénation était en cours. Elle s'intensifiera plus tard par la discrète métamorphose de mon langage en cellule, de mon débit de parole plutôt, progressivement plus rapide, plus nerveux. Dans cet environnement, l'évolution est beaucoup plus rapide qu'à l'ordinaire. Ne dit-on pas d'ailleurs que les criminels évadés sont dans la nature ? Voilà peut-être l'indice de l'existence d'un espace carcéral à part, hors du temps et de la logique.
On me présenta menotté à une interne. On me détacha et je m'allongeai sur le lit incliné. La jeune femme me posa quelques questions, pendant qu'à deux mètres, mes gardiens m'observaient en souriant. Elle prit ma tension puis nettoya la plaie. Quelques minutes plus tard, quand les trois agents, lassés, portèrent leur regard ailleurs, et entamèrent une conversation badine, je la suppliai le plus discrètement possible de me sortir de là. Je vis dans ses yeux de la compréhension, et je redevins, un peu, humain. Elle constata que ma plaie était profonde, et qu'elle nécessiterait des points de suture. Elle fut gentille avec moi et prit un soin particulier à m'éviter de souffrir. Il n'était de toute manière pas question pour moi d'exprimer la moindre peine en présence de ces trois-là qui s'amusaient de mon malheur. Quand elle enfonça la première aiguille dans ma chair, et que je ressentis comme une décharge électrique, le plus jeune observa d'un œil intéressé. Pendant tout le temps que dura la manœuvre – et ce fut long – je fixai sur lui un œil noir, m'efforçant de ne pas ciller, un œil assassin dans lequel je laissai s'exprimer toute ma colère : celle d'avoir été blessé, de les voir s'amuser, toute la colère accumulée depuis tant de jours et de semaines à battre le pavé, colère décuplée par un sentiment d’injustice absolue, alimentée par le dédain, le mépris et l'hypocrisie, démultipliée par le nombre incalculable d'images violentes et de bavures qui tournaient en boucle sur les réseaux et qu'on découvrait tous les jours. Il continua d'observer les gestes de l'interne jusqu'au bout, et ne me regarda jamais dans les yeux : je n'existais pas.
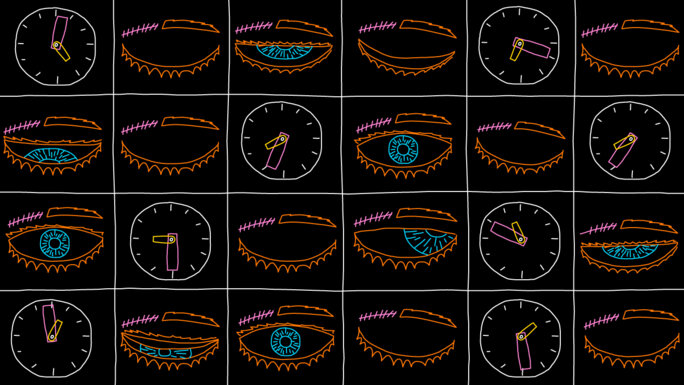
Agrandissement : Illustration 2
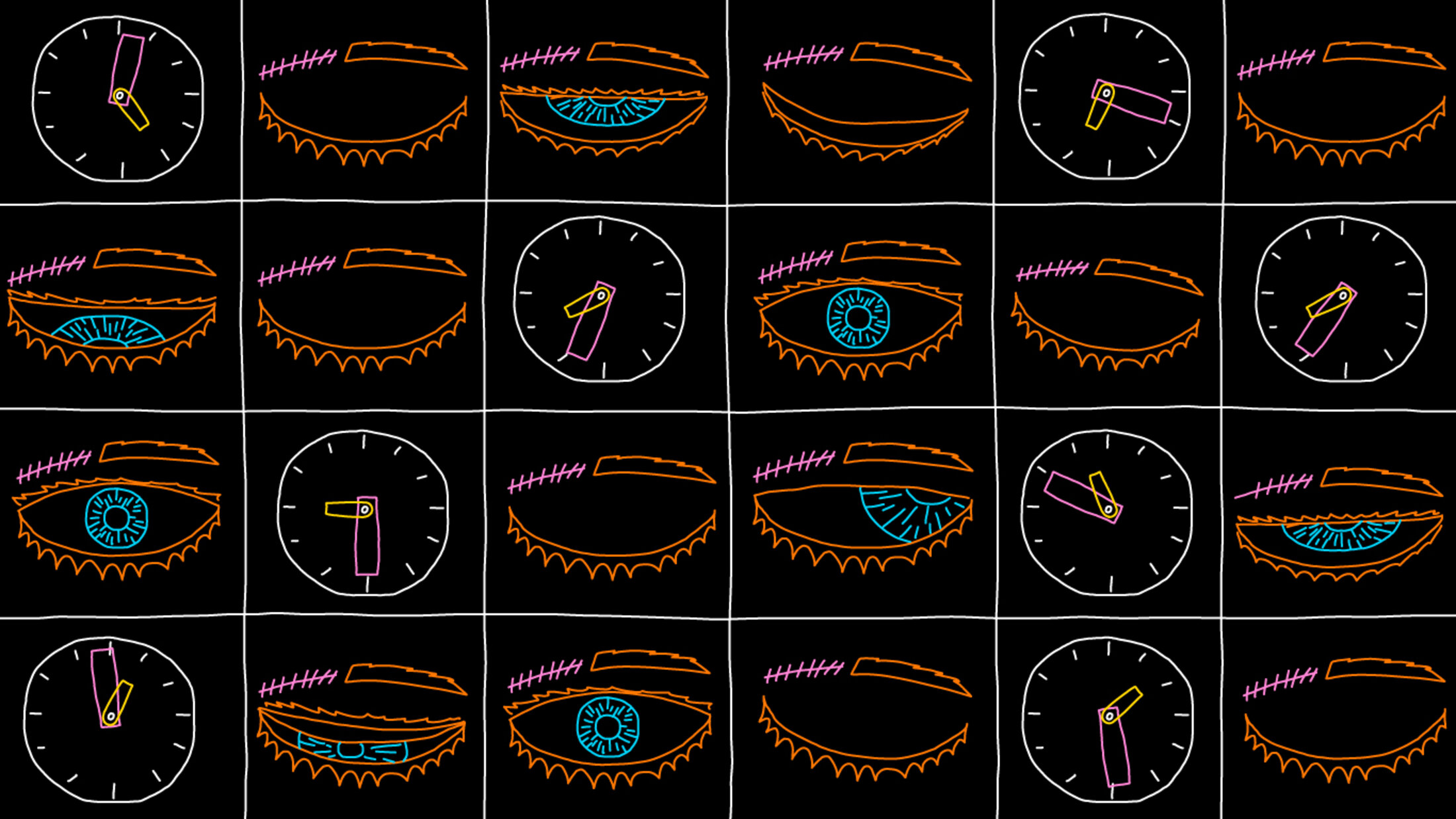
Les « petits » tambourinent toujours, de plus en plus fort. Répercuté par l'écho d'une pièce sans fenêtre et sans mobilier, le bruit est assourdissant. Un gardien de la paix finit par arriver, à gauche du couloir. Il passe devant notre cellule. De là où je suis, allongé sur le banc de bois, il m’apparaît à travers le grillage du bas qui est supposé laisser passer l'air. Les « petits » demandent à ce qu'on leur ouvre pour aller pisser et l'autre déverrouille la porte de la cellule dans un claquement métallique répercuté par l'écho. Encore un bruit que je n'oublierai pas. Les deux cellules de notre étage sont orientées vers le même mur et sont mitoyennes ; il est impossible de voir nos voisins. On peut toutefois facilement imaginer ce qu'il se passe à côté : le premier petit sort et remet ses chaussures délacées qui l’attendaient, béantes, dans le couloir, pendant que le gardien referme sèchement. Pendant qu'il fera ses besoins à même le sol dans le trou métallique, on prendra soin de laisser la porte légèrement entrouverte afin de garder un œil sur lui, évidemment. Les deux petits encore en cellule en profitent pour interroger l'agent. T'as parlé à mon OPJ ? Tu peux demander si je peux passer mon coup de fil3 ? Il leur demande d'attendre, il leur dit que ça viendra quand ça viendra, qu'il ne sait pas, mais il assure qu'il va aller voir. Si la garde à vue était une machine à briser les âmes, on toucherait là à l'un de ses plus fameux rouages.
3 Article 63-2 du code de procédure pénale :Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. [...]
Plus que l'ennui, que la monotonie des heures et l'étirement des minutes, c'est l'ignorance dans laquelle on nous plonge qui est facteur d'angoisse, de frustration et de souffrance. Nous ne savons rien de notre situation ou de l'évolution de notre affaire, nous ne savons rien de l'heure, nous ne savons rien de ce qui nous attend, nous ne savons pas même ce qui nous est reproché, en fait, sans blague. Le phénomène est permanent, et il ne peut venir d'une banale désorganisation des services : c'est une science. Une hydre dont chaque tête mord le cœur à sa manière: le suspect qui ne sait pas ce qui l'attend gamberge ; ses pensées sont constamment habitées par la crainte de l'avenir, par l'anticipation du pire ; il se prépare à mille scénarios dont pas un seul ne se réalisera d'ailleurs, et son angoisse augmente, oppresse sa poitrine, dans le ronronnement électrique des deux caméras placées de part et d'autre de la porte de sa cellule, et dans l'éclat éternel des néons. A l’extérieur, que se passe-t-il ? Qui est au courant de mon sort ? Est-ce que mon avocate a été contactée? Quelqu’un a-t-il prévenu mon établissement ? Petit à petit, le doute s'installe et les souvenirs fondent. Vraiment, je n'ai rien fait ? Allons. Est-ce que je ne serais pas en train de me raconter à moi-même une version pour la police, pour la famille ? Je ne sais plus. S'ils me gardent aussi longtemps, il doit y avoir quelque chose. Le suspect qui ignore l’heure se trouve désorienté et précipité hors du temps, dans un autre monde aux règles astronomiques bouleversées. Le temps passe différemment selon les heures de la journée, selon que l’on somnole, angoisse, discute, effleure du bout des doigts les gravures sur les murs de sa prison, et je crois qu'il est absolument impossible de ne pas en perdre la notion. Le besoin de savoir s'il fait jour ou nuit, s'il pleut ou si le soleil réchauffe la peau des hommes libres donne le vertige. On ne sait même pas si l'on se trouve en souterrain, au rez-de-chaussée ou à l'étage, d'ailleurs ; les cellules de garde à vue sont autant d'ascenseurs en panne dans le temps et dans l'espace ; et quand vous appuyez sur l'alarme, en tambourinant vous aussi sur le plexiglas blindé, c'est le gardien qui vient. Ou qui ne vient pas. La privation d'information est alors une arme redoutable pour vous rendre docile et pour accélérer les procédures. Beaucoup signent des reconnaissances de culpabilité alors qu'ils n'ont rien fait d'autre que se trouver sur la route des forces de l'ordre, et on les comprend : on n'a pas forcément besoin de sortir, mais on a viscéralement besoin de savoir. Pour la police, souvent, les geôles sont de petites alcôves peuplées de gens excessivement polis et déférents. En effet, qui est privé d'obscurité pour dormir, qui doit supplier pour boire et pisser, remercie chaleureusement pour une porte de cellule entrebâillée dix secondes, remercie chaleureusement pour une indication approximative de l'heure, remercie chaleureusement pour avoir pu accéder à une feuille de papier toilettes. Très vite on est soulagé de voir ce gardien plutôt qu'un autre, d'ailleurs : c'est le gars sympa. Celui qui s'intéresse à nous ! Quelle blague, ils doivent bien se marrer quand ils se partagent les rôles. Ça va ? Ah t'es prof ? On est collègues ! T'étais à la manif c'est pour ça que t'es là ? Le gars sympa qui, lorsqu'il prendra les empreintes, les mesures et les photographies du nouveau venu, à gauche de notre cellule, conseillera ce dernier, l'air entendu : pour sortir le plus vite possible, mieux vaut ne pas prendre d'avocat4.
4 Article 63-3-1 du code de procédure pénale : Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. [...]
En sortant de l'hôpital, on m'emmena en cellule de dégrisement dans un commissariat de Paris. Ma cellule était individuelle, avec des toilettes en inox « à la turque » à l'intérieur. Je m'endormis sans trop de mal, épuisé par les événements. Il devait être deux ou trois heures du matin. Peut-être quatre ? J’avais été arrêté vers minuit, et il me semblait que c’était il y a plusieurs jours. Jusqu’au lever du soleil, on me réveilla toutes les heures pour « souffler », et j'en profitai à chaque fois pour supplier à boire. Il fallait s'abreuver en position accroupie, à même le robinet d'un tuyau placé très bas dans la même pièce que l'éthylomètre. Je ne peux dire combien de fois on me tira de ma cellule ; la fatigue et les réveils en sursaut ont brouillé mes souvenirs. On m'informa finalement dans une lumière jaune que des agents allaient venir me chercher. J’attendis en bon élève, assis sur ma paillasse et la tête bourdonnante, mais au bout d'une bonne heure peut-être, je finis par m’allonger de nouveau. Je me rendormis. On ne vint me chercher que beaucoup plus tard en réalité, et je me demande bien pourquoi on prit soin de me réveiller ainsi à intervalle régulier toute la nuit si je devais en fait passer six ou sept heures dans cette cellule. Une idée ?
Trois agents en armes vinrent me tirer de mon mauvais sommeil, me menottèrent, me firent descendre dans la rue et entrer dans une voiture. Il était environ huit ou neuf heures, je pense. Quoi qu’il en soit, il faisait jour et les humains s’agitaient. Il faisait très blanc. Le véhicule démarra pour rejoindre le commissariat qui serait dorénavant ma prison, toutes sirènes hurlantes, tout en accélérations, en freinages d'urgence ou en virages serrés, sans que je ne comprisse bien pourquoi. Le pilote conduisait à toute vitesse, de manière extrêmement brusque, et sa collègue assise près de lui hurlait les informations du GPS affichées sur l'écran de son téléphone, comme dans un rallye. Je n'exagère pas. Ami·es, lorsque les voitures de police fendent les bouchons avec le gyrophare, vous avez raison, ce n'est pas une légende : il n'y a pas d'urgence. Ce sont seulement les rois de la cité qui affichent leur toute-puissance et s'affranchissent des règles, en jouant à la guerre. Le bruit me faisait mal à la tête, les soubresauts et changements de rythme, mal au cœur. Les trois agents, encore deux hommes et une femme, aboyaient sur les véhicules qui ne s'écartaient pas assez rapidement, ou traitaient leurs conducteurs de tous les noms. La femme tapait du poing sur sa vitre en arrivant à hauteur, en vociférant. Il n'y avait pourtant aucune urgence, à mon avis. Peut-être aussi voulaient-ils m'impressionner ? En tout cas, elle employa plusieurs fois l'expression « gauchiasses » pour insulter les automobilistes hésitant à griller les feux pour la laisser passer. En d'autres circonstances, tant de bêtise et si peu de raffinement dans la provocation m'auraient fait sourire car il était probable que ces invectives devaient, dans leur esprit, m'atteindre directement. Après tout, eux aussi vivaient la séquence des retraites dans la fumée des gaz lacrymogènes, et je devais représenter tout ce qu’ils détestaient. Mais traiter les automobilistes de « gauchiasses »… d'authentiques imbéciles qui se ridiculisaient eux-mêmes. Navrant. Mais voilà, aujourd'hui ces enfants frustrés et sadiques dépourvus d'étincelle étaient mes maîtres, et ils allaient le rester pour un bon bout de temps. Les menottes étaient trop serrées et mon poignet droit me faisait horriblement souffrir, d'autant que mon dos appuyait dessus. La voiture s'arrêta brusquement devant le commissariat. Je connaissais bien le bâtiment pour être passé de nombreuses fois devant et, pendant que l'agent assis à mes côtés faisait le tour du véhicule pour me faire sortir, j'eus, moi, le temps de penser à mes parents qui, trente-sept ans plus tôt, s'étaient mariés dans cette mairie, juste en face. Alors qu'ils descendaient les marches sous les hourras et les confettis, avaient-ils eu une sensation étrange en levant les yeux vers ce grand bâtiment, à l'angle ? S'ils me voyaient… La portière s'ouvrit, on décrocha ma ceinture et je fus tiré hors du véhicule. Si j'avais su, j'aurais respiré un bon coup, car je ne devais revoir le ciel et respirer l'air du dehors que bien plus tard, de nuit, et pour quelques secondes à peine. Nous pénétrâmes à l'intérieur du bâtiment. Un détail me reste en mémoire : un homme reculait vers la sortie en me tournant le dos car il plaisantait avec les agents situés derrière le guichet d'accueil. Je m'arrêtai pour éviter la collision, et quand il se retourna et se trouva brusquement nez-à-nez avec moi, blafard, un grand pansement imbibé de noir sur l’œil, débraillé, le visage encroûté de sang, les bras dans le dos et encadré par deux grands costauds, il ne put réprimer un cri étouffé. Portant les mains à son cœur comme s'il avait vu un fantôme, les yeux écarquillés, il fit un bond d'un mètre sur le côté.
On me conduisit enfin dans mon couloir. Les murs semblaient de plastique. En face de la porte, une table et une étagère sur lesquelles reposait tout le nécessaire pour prendre les empreintes digitales et palmaires des nouveaux5. A droite, le mur blanc devant lequel ces derniers étaient photographiés. Les deux cellules se trouvaient légèrement sur la gauche et faisaient face à la porte. Au bout du couloir, à gauche dans un recoin, se cachaient un robinet et, dans une petite pièce à côté, les toilettes, toujours les mêmes. Évidemment, il n'y avait aucune fenêtre, aucune lumière naturelle. Je ne me souviens pas de la couleur des murs mais tout semblait gris et jaune à la fois, comme dans un parking souterrain. L'agent me retira les menottes et m'ordonna de retirer mes chaussures pour les laisser à l'entrée de la cellule. La mienne serait la première. Il fit claquer les verrous et ouvrit. L'odeur me prit immédiatement le nez et me retourna l'estomac. Vautré par terre tel un pacha se trouvait mon premier codétenu. Il était installé sur deux fins matelas empilés, il m'en restait donc un sur le banc qui courait d'un mur à l'autre, au fond. La cellule devait mesurer à peu près trois mètres de large pour deux mètres de profondeur. Si l’on s’allongeait au sol, les pieds sous le banc touchaient presque le mur du fond, et la tête, presque la porte. Les matelas étaient très fins et mous, orangés, fabriqués en une sorte de simili-cuir usé sur lequel la peau suait et qui gardait les mauvaises odeurs. Mon colocataire était un homme assez gros, aux mains comme des pelles à tarte, âgé d'une quarantaine d'années, au crâne dégarni et à la peau mate. Il suait en mangeant doucement un petit biscuit sec. Il n'avait qu'une seule jambe ou plutôt, sa prothèse était appuyée contre le mur de gauche encore équipée de sa chaussure. M me fera remarquer plus tard, d’ailleurs, qu'il avait eu le droit de garder ses lacets, lui. Il ne me regarda pas. Crânement, je lui lançai un salut auquel il ne répondit pas et je m'assis sur le banc. Le gardien referma la porte et partit. Silence. Mon intimidant voisin entama une petite brique de jus d'orange « à base d'orange concentrée », le petit déjeuner des commissariats. On ne m'en donna pourtant pas, et je pensai que je n'aurais donc jamais l'occasion d'y goûter6.
5 Article 55-1 du code de procédure pénale : Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6 Article 63 du code de procédure pénale : La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.[...]
On revint bientôt me chercher en cellule pour me présenter à mon OPJ. On se déplaçait dans le commissariat sans les menottes, ce qui était déjà un grand soulagement. L'état des lieux était ahurissant de vétusté : dans tous les recoins s'entassaient des cartons ; des tuyaux et des fils sortaient des murs, la peinture s'écaillait partout. Les couloirs étaient étroits, biscornus et mal éclairés, jaunes. En de multiples endroits des hommes perchés sur des escabeaux rafistolaient ce qu'ils pouvaient. Nous traversâmes un couloir le long duquel s'alignaient les portes de nombreux bureaux aux tailles inégales. Enfin nous tournâmes à droite et on me fit asseoir. L’OPJ regarda avec insistance ma blessure et me demanda si celle-ci était liée à mon arrestation, ce à quoi je répondis par l'affirmative. Sauvé, une humaine ! pensai-je. Elle releva mon identité, répondit à mes questions sans rechigner et me notifia officiellement mon placement en garde à vue. Je lui demandai si mon temps de placement en dégrisement était à ajouter aux vingt-quatre heures réglementaires7, ou s'ils étaient compris dedans. Un gardien, là-bas, s'était amusé à me torturer en m'annonçant une chose, puis son contraire. Elle confirma que ma garde à vue avait commencé neuf heures auparavant. J'en déduisis que je n’aurais que quinze heures maximum à tenir en cellule et m’en trouvai soulagé : je ne passerai donc pas une seconde nuit derrière les barreaux. Je désignai mon avocate, puis la personne à contacter pour mon coup de fil réglementaire. Je choisis S évidemment, mais je ne connaissais pas le numéro par cœur. Imbécile. Mon OPJ m'autorisa néanmoins à rechercher le numéro dans mon téléphone, autorisation plutôt exceptionnelle apparemment, comme je l'apprendrai plus tard. Notez que les conditions de vie ici-bas peuvent être considérablement améliorées selon le bon vouloir de votre OPJ. En creux, on comprendra donc facilement que tout ce qui vous déprime, vous angoisse, vous effraie pendant votre détention est bien le fait de quelqu'un. Elle composa le numéro et me tendit le combiné. Elle restait là pour surveiller la conversation. S décrocha instantanément et j'eus pour la première fois envie de pleurer de honte. Elle était folle d'inquiétude et attendait l'appel depuis des heures. Elle avait passé la nuit devant le commissariat dans l'espoir de m'apercevoir, et avait fini par rentrer chez nous à pied, l'âme en peine. L'idée de la faire souffrir en étant ici enfermé sera une plaie ouverte tout le temps que durera ma détention. A la question de savoir si l'on me traitait bien, je répondis dans un souffle que pas du tout, et le regrettai instantanément : je n'aurais pas supporté d'être à sa place. Je me jurai de donner le change dorénavant, et de prendre sur moi. Vœu pieu, puisque je ne devais lui parler ni la revoir que plusieurs jours plus tard. Je lui rappelai le nom de mon avocate afin qu'elle se mette en contact avec elle. Je ne trouvai rien à lui dire, espionné par l'officier. J'aurais voulu la serrer dans mes bras et lui dire combien j'étais désolé et combien je l'aimais. Je rendis le combiné à l'OPJ. Celle-ci reprit son exposé calmement et se montra assez rassurante. Elle me fit part de mes chefs d'accusation qui étaient au nombre de trois : outrage8 - rébellion9- participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser10. Puis elle me raccompagna elle-même dans ma cellule. J'avais de la chance : mon dossier était entre de bonnes mains ! Je ne devais, en fait, plus jamais la revoir.
7 Article 63 du code de procédure pénale : Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
8 Article 433-3 du code de procédure pénale: Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
9 Article 433-6 du code de procédure pénale : Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. La rébellion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
10 Article 431-4 du code de procédure pénale : Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Je ne saurais dire combien de temps je passai en cellule avec mon premier codétenu. Allongé sur le banc, tourné vers le mur et tâchant de respirer à travers les mailles de mon sweat, j'essayais de faire le point, et peut-être de dormir un peu. Dans la cellule d'à côté, deux hommes parlaient très lentement mais très fort dans une langue inconnue, très mélodieuse, comme s’ils récitaient des prières. De temps en temps, ils criaient ou tambourinaient sur les vitres pour appeler les gardiens. Je tombai dans un demi-sommeil, changeant sans cesse de position. J’étais encore dans le déni, je crois. J’avais intégré la conviction profonde que tout cela était faux, que cela allait finir rapidement. Et puis non, j'étais bien en garde à vue, c’était bien moi, c’était bien réel, et, de plus en plus fréquemment, l'angoisse tambourinait dans ma poitrine. Le sang bientôt battit mes tympans. Allongé sur le dos, je voyais mon sweat se soulever à chaque pulsation. Je respirai profondément pour retrouver mon calme, sans grand succès. Finis les plans. Il fallait prendre les choses les unes après les autres, et chaque seconde passée ici me rapprocherait de la sortie. Je repensai à mes randonnées avec S, dans les Pyrénées ou dans le Vercors ; lorsque la marche s'éternisait ou que les sentiers s'élevaient trop brutalement, nous nous disions que mettre un pied devant l'autre nous rapprocherait de toute manière du but, et qu'il ne servait à rien de fixer le sommet qui toujours semblait s'éloigner. Je pensai à son sourire, à sa peau, à son regard lorsqu'elle croisait le mien là-haut sur les crêtes. Méfiez-vous, cependant. Chaque seconde passée au chaud dans le refuge des souvenirs, près du poêle tandis que la neige tombe au dehors, se paye cher. Très vite revient le goût de la cendre, du deuil, et la puanteur des cellules vous précipite tout nu dans la glace.

Agrandissement : Illustration 3




