Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA déclare « nous demandons la suspension immédiate des 4 % de jachère, dès cette année […] Plus de 800 millions de personnes menacées par l’insécurité alimentaire mondiale et l’on veut nous imposer 4 % de surfaces agricoles improductives ! » (Le Monde, 25 janvier 2024). En filigrane on lit donc que les mesures imposées par l'UE au nom de l'écologie déclenchent des famines.
Arnaud Rousseau, n'est pas exploitant agricole, ni agriculteur et encore moins paysan. Il a fait la Europe Business School où l'on n'apprend pas à faire pousser les carottes mais à les vendre. En l’occurrence il finira dans le négoce de matière première. Il gère un groupe, Avril, qui réalise un chiffre d'affaire de 6 milliards (2021) et 9 milliards (2022) c'est-à-dire assez loin de la réalité des adhérents du syndicat dont il est président, qui certes brassent de grosses sommes d'argents (grosses primes et grosses dépenses), mais tout en vivants sous le seuil de pauvreté.
Comme l'a montré une enquête de Reporterre (Au coeur de l’agro-industrie française, les tentacules d’Avril Sofiproteol, 23 février 2015) Sofiprotéol, l'ancêtre d'Avril, s'est d'abord constituée comme un établissement financier appelé à gérer les fonds de la filière oléo-protéagineuse. Dans ce cadre elle a pu bénéficier de la « contribution volontaire obligatoire » (sic), une taxe professionnelle versée par les producteurs, qui a permis à la pieuvre de s'étendre. Concrètement cela signifie qu'une entreprise, Avril en l’occurrence, s'arroge le droit de représenter une filière et de prélever un impôt sur tous les acteurs qu'elle est censée représenter. Tout cela est légal depuis une loi du gouvernement de Jacques Chirac en 1975, même si une plainte pour abus de confiance, complicité et recel a été déposée en 2004. On ne s'étonnera donc pas qu'après Xavier Beulin (chef de la FNSEA de 2010 à 2017) et président d'Avril, on retrouve un Arnaud Rousseau avec les deux casquettes. Avril, FNSEA, Ministère ... CQFD.
Contrairement à ce qu'affirme Arnaud Rousseau, sa mission n'est pas de nourrir les français, mais aussi de convertir des terres nourricières pour remplir le réservoir des bagnoles. Avril est devenu un leader du diester, un biodiesel à base de colza. L'État l'a évidemment soutenu, en fixant un taux d'incorporation des biocarburants à l'essence plus élevé qu'ailleurs en Europe (7%) tout en reversant une partie de la Taxe Intérieur sur la consommation d’agrocarburant directement à Sofiprotéol (une subvention publique de 153 euros la tonne de colza pour la production de Diester). Bref, on est loin de la fable "nourrir le monde" et plus proche de l' "assistanat". Mais si il y a une chose sur laquelle Rousseau ne ment pas c'est qu'il participe à faire de la France une grande puissance agricole exportatrice.
Bref. Revenons sur l'histoire des 4% de jachère et des 800 millions de personnes qui crèvent la faim. Arnaud Rousseau ment. Il le sait car il a travaillé dans le négoce. Et il cache son mensonge derrière le bon sens, en substance « Si on meurt de faim c'est parce qu'on ne produit pas assez ». Mais dans le monde réellement inversé, dans un monde où les paysans meurent de faim et où l'on crève trois fois plus de l'obésité que de la famine (depuis 2010 il y a dans le monde plus d'obèses que de gens souffrant de malnutrition), la surproduction peut très bien côtoyer la famine. Si les gens meurent de faim c'est à cause du prix des denrées qui est lui indépendant de la production. Arnaud Rousseau le sait très bien il a travaillé dans le courtage de matière première. Rousseau fait partie de ceux qui sont régulièrement montrés du doigt lorsque l'on parle de "spéculation", de"manipulation du prix", de "ceux qui en profitent sur le dos de". Alors il va inventer une fable qui met tout le monde d'accord : le problème c'est l'écologie.
Rousseau est un militant No Borders, un militant de l'abolition des frontières. Il souscrit parfaitement à l'affirmation d'un ancien administrateur de la FNSEA en plein débat sur le TAFTA « Quand on est à la FNSEA, on est favorables à la libéralisation des marchés » ( Arnold Puech d'Alissac en 2016). Ça il ne peut pas le dire car il en profite, mais dans le froid des blocages routiers on est plus branché souverainisme que sanfrontiérisme. Alors l'écologie et les 4% de jachère du Green New Deal c'est le bouc émissaire parfait.
Alessandro Stanziani est historien de l'économie et auteur de Capital Terre (Payot, 2021). Avec lui nous allons essayé de comprendre ce fait paradoxale : comment le prix d'une denrée peut évoluer indépendamment de sa production. Comment est-il possible que des famines puissent côtoyer des crises de surproduction ? Comment admettre que des gens meurent de faim alors que les silos à grain débordent ? Pourquoi Arnaud Rousseau ment et cache son mensonge derrière un bouc-émissaire.
à lire sur le même sujet:
petite histoire des marchés à terme
sur la financiarisation des céréales
la souveraineté alimentaire, nouvelle excuse du productivisme agricole

Agrandissement : Illustration 1
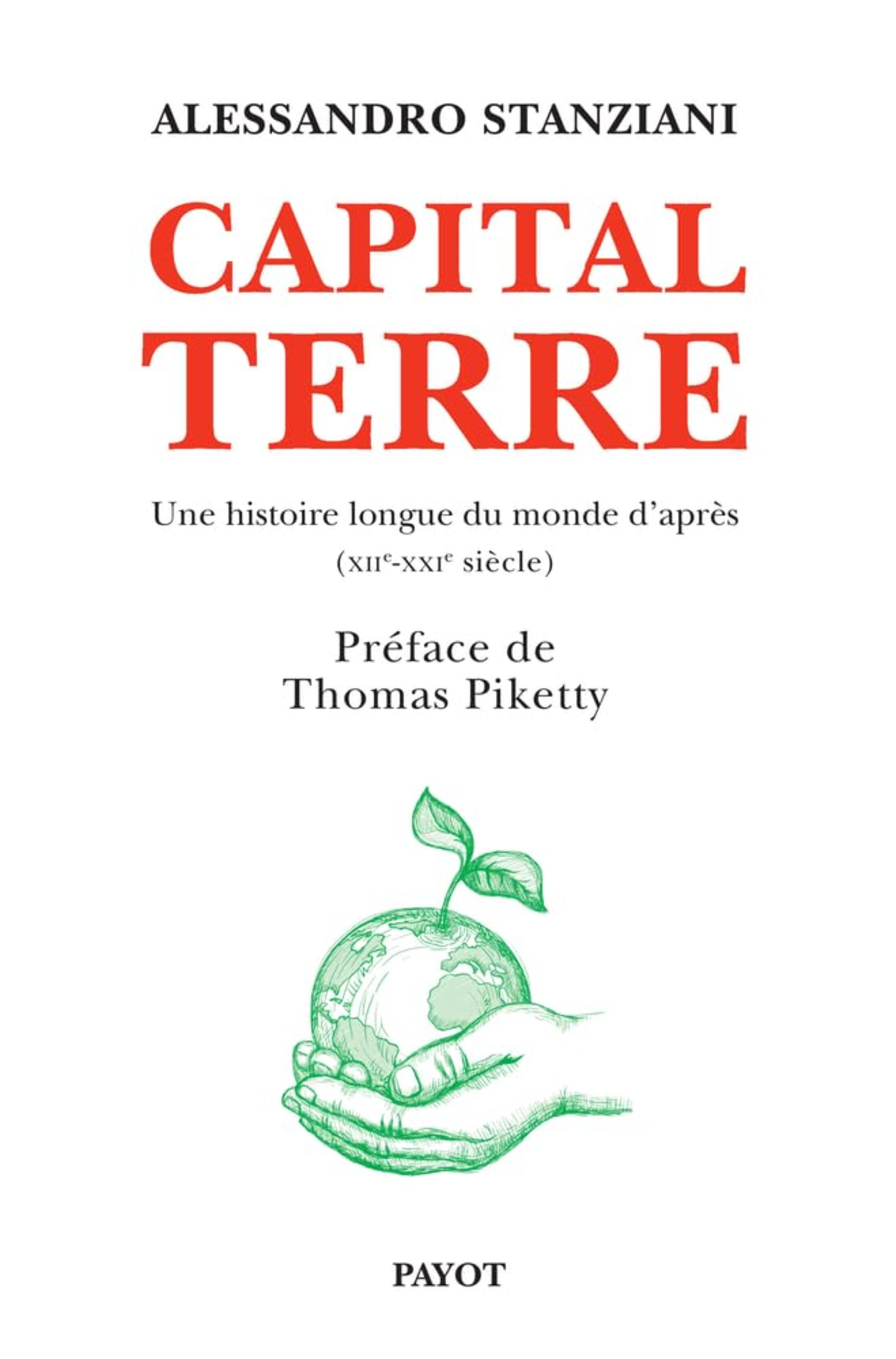
Durant le mois de mai 2022, le prix du blé a atteint des sommets. Pourtant, les chiffres des récoltes publiés par la FAO étaient plutôt bons et auraient dû rassurer les marchés. Cependant, ils ont pourtant été pris de panique et l'on a commencé à parler des famines à venir. Nous avons alors découvert que ce sont les prix qui créent les pénuries et que ceux-ci sont indépendants des productions. Mais alors, qui fixe le prix du blé ?
Le prix Nobel d’économie Amartiya Sen avait distingué entre mauvaise récolte et pénurie : la première est liée à des phénomènes climatiques, la seconde à l’action des marchés ; en présence de mauvaises récoltes, les spéculations s’emballent et font artificiellement flamber le prix des denrées alimentaires. C’est aussi dire que les prix ne dépendent pas du jeu de l’offre et de la demande, mais du pouvoir sur le marché. Ainsi, Entre 2008 et 2011, les flambées des prix des céréales sont si importantes que des émeutes éclatent dans plusieurs pays, en 2008 à Haïti et en Égypte, puis à Dakar, en Indonésie et au Yémen. Les émeutes gagnent Conakry, Maputo, les principales villes du Burkina-Faso, la Guinée et le Cameroun, mais aussi le Maroc. Le printemps arabe aussi doit beaucoup à ces mouvements de prix, élément déclencheur et souvent sous-estimé dans les analyses, excessivement focalisées sur les aspects strictement politiques. Ce n’est pas qu’une affaire des pays du Sud ; entre temps, 28 millions de personnes aux États-Unis aussi s’écroulent frappées par cette même crise. Comment expliquer ces crises ? Une population trop nombreuse ? Des réseaux commerciaux peu efficaces ? L’impact de la spéculation ou encore celui d’une crise environnementale ?
Écartons d’emblée l’hypothèse démographique malthusienne : à chaque occasion qu’un manque de ressources, des fléaux sanitaires ou environnementaux ou même une guerre surgissent, le même refrain revient ; nous sommes trop nombreux sur terre. Cet argument était répandu au XIXe siècle et encore à la veille de la Première Guerre Mondiale, puis après elle, parmi les nazis, les soviétiques, les fascistes, même parmi certains libéraux. Ce même refrain a accompagné certaines politiques dites du développement jusqu’à nos jours. Si en Asie ou en Inde les famines, puis la malnutrition, les maladies sont si répandues c’est que dans ces pays on fait trop d’enfants. Ce constat est en bonne partie erroné : la population mondiale est passée d’environ 700 millions en 1750 à 7,8 milliards de nos jours. En temps, le PIB mondial a explosé, surtout à partir des années 1870 et encore plus après 1970. Le résultat est que le revenu par tête a même augmenté, d’autant plus que le taux de croissance de la population a fortement ralenti, d’abord en Europe et dans les pays avancés, puis en Asie, désormais même en Afrique. Depuis le XVIIIe siècle à nos jours, et encore plus à partir des années 1950, la croissance de la production de céréales a largement dépassé celle de la population mondiale. Au point que le système actuel conduit à gaspiller des quantités de denrées alimentaires tellement importantes que le dixième suffirait à enrayer la faim et la malnutrition dans le monde. Malgré nos prouesses technologiques, une partie de l’humanité ne mange pas à sa faim et, au contraire, avec le réchauffement climatique, les pénuries extrêmes et les famines risquent même de s’aggraver : c’est un problème de distribution et non pas de production. Celle-ci n’est pas insuffisante, elle est même largement détruite et gaspillée ; cependant, on spécule sur la faim.
Dans votre livre vous écrivez que les évènements politiques (guerre) ou climatiques (mauvaise récolte) peuvent créer des disettes. Mais pour qu'une disette se transforme en famine il faut que le marché s'en mêle, et ce, dès le XIIè siècle. C'est donc l'économie qui créée la malnutrition ?
Les prix ne dépendent pas du jeu de l’offre et de la demande, mais du pouvoir sur le marché. Or, les investigations historiques ont permis de montrer que, du moins en Europe et dans certaines régions d’Asie, ces mouvements spéculatifs autour des céréales sont présents dès le XIIe siècle. Les famines dites d’Ancien régime seraient donc moins liées à une agriculture arriérée et à une population en excès qu’à la conjoncture de mauvaises récoltes et mouvements de marché. En même temps, jusque vers le dernier quart du XIXe siècle, en Europe comme en Asie, ces tensions sont limitées car les autorités mettent en place des systèmes de régulation des marchés : des réserves céréalières sont constituées et les prix des céréales et de la farine sont contrôlés en ville, afin d’éviter les émeutes. Il faut éviter de confondre ces mesures avec des politiques redistributives telles que nous les connaissons avec l’essor de l’État social : dans les sociétés pré-industrielles les niveaux de vie sont relativement modestes et les inégalités sociales sont figées (la division de la société en « ordres » ou états : seigneurs, paysans, marchands, ecclésiastiques, etc). Les nouvelles économies et sociétés « bourgeoises » qui dominent à partir du XIXe siècle ne défont qu’en partie cet ordre social. Elle se définissent libérales mais gardent une certaine méfiance vis-à-vis des « spéculateurs » qui font des profits sur la rareté des céréales. Les marchés céréaliers demeurent alors relativement contrôlés et les marchés à terme, conclus à partir des récoltes à venir, sont soumis à des contrôles sévères
À la fin du XIXe siècle, se met en place un marché mondial des céréales, favorisé par le télégraphe, la révolution des transports et la centralisation des échanges commerciaux dans les Bourses. La productivité s'accroît, et le blé traverse les océans. Cependant, c'est également à ce moment que la « finance » prend son essor, notamment à travers les marchés à terme. Paradoxalement, les famines refont leur apparition. Ces famines entraînent une cascade de conséquences (cheptel mal nourri, développement de zoonoses, transmission à l'homme). Vous expliquez que les événements météorologiques tels que trop de pluie ou trop de chaleur ne suffisent pas à expliquer ces famines. Pouvez-vous développer cette chronologie à partir de la seconde moitié du XIXe siècle?
Cet équilibre est remis en discussion à partir du dernier quart du XIXe siècle : l’essor des moyens de transports et de communication (le télégraphe), celui de nouveaux pays producteurs (Russie, Etats-Unis, Canada) bouleversent l’ordre économique mondial et encouragent les responsables politiques et économiques des pays avancés à libéraliser radicalement les marchés à terme des céréales. Les futures n’ont rien à voir avec les marchés à terme existant depuis le Moyen-Âge. Ces derniers consistaient à acheter à l’avance des produits en espérant réduire le risque et, si possible, engendrer des profits liés à la distance et aux fluctuations des marchés. Ils permettaient également aux agriculteurs d’avoir des avances, des crédits sur les récoltes à venir. Les futures, au contraire, sont des promesses de produits virtuels qui s’échangent contre d’autres promesses de produits qui ne verront peut-être jamais le jour. C’est un pur pari spéculatif qui ne porte pas sur des produits à venir mais sur des promesses autour de produits virtuels. L’essor des futures ne creuse pas juste les inégalités au sein des pays développés, il contribue également à accroître le fossé entre ces pays et leurs colonies. À partir des années 1870, malgré la hausse de la production céréalière mondiale, des famines répétées frappent plusieurs régions du monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Entre 8 et 10 millions de victimes sont comptabilisées en Inde entre 1876 et 1879, dix autres millions dix ans plus tard, accompagnés de 20 millions de victimes en Chine entre 1876 et 1879, un million au Brésil pendant ces mêmes années et encore deux millions dix ans plus tard. Certaines interprétations considèrent que ces famines faisaient partie de l’histoire de ces régions ; des données détaillées, environnementales, archéologiques, outre qu’économiques prouvent qu’il n’en est rien : les mauvaises récoltes, certes déjà présentes dans ces régions, se transforment progressivement en famines avec l’essor du capitalisme mondial qui encourage les spéculations dans ces pays même et en soumet la production aux règles des bourses de commerce internationales. La révolution des transports du dernier quart du XIXe siècle, au lieu de réduire les famines, les aggrave, contrairement aux théories économiques libérales. Ces tensions se reproduisent pendant l’entre-deux-guerres où, à côté de la crise financière bien connue de 1929, les spéculations sur les denrées de première nécessité s’envolent au « Nord » et accentuent les mauvaises récoltes et les disettes dans les mondes coloniaux.
Dans votre livre vous montrez que chaque crise est suivie de la mise en place d'une régulation, d'une période de stabilité puis du démantèlement de cette régulation qui entraîne inévitablement une nouvelle crise. Vous montrez que des discours critiques des marchés à terme existent dès leur mise en place. En somme que la critique de la « finance folle » et des spéculateurs ne datent pas de 2008. Pourquoi le marché, ou ceux qui sont en charge de le réguler, ont-il si peu de mémoire ?
Ces nouveaux instruments sont admis pendant le dernier quart du XIXe siècle ; cependant, les réticences demeurent : la Première Guerre Mondiale et l’après-guerre obligent à réintroduire des contrôles sur ces activités. Elles restent en vigueur pendant les années 1920, avant la libéralisation du milieu de cette décennie, aussitôt suivie par la crise de 1929. Suite à cette dernière, en France, comme aux États-Unis et dans la plupart des pays européens, de nouvelles politiques de régulation s’imposent. Ces mesures sont reprises après la Seconde Guerre Mondiale et il faudra attendre les années 1980 pour revenir à une libéralisation sauvage. C’est aussi dire, que pendant plusieurs phases, le capitalisme et ses variantes, tout en jouant sur les marchés et les profits, ont pu bien se passer des spéculations sauvages sur les céréales, ces dernières étant une création de l’époque néolibérale.
Une crise relativement passée inaperçue est celle de la peste porcine africaine en Chine. En 2019, contrainte d'éradiquer une partie de son cheptel, les prix du porc ont augmenté et ceux de l'aliment (maïs) ont chuté, ouvrant les portes à l'importation. Cependant, quand la Chine a reconstitué son cheptel, cette tendance s'est inversée. À l'automne 2021, le prix des céréales servant à l'alimentation animale a explosé, et il n'y a pourtant pas de guerre. Les céréales servent aujourd'hui majoritairement à nourrir les animaux. Dans votre livre, vous expliquez que l'alimentation carnée est devenue une façon d'éviter les crises de surproduction. Cependant, le marché des céréales est aussi lié à celui de la viande. Pouvez-vous développer ?
Le bétail, facteur traditionnel de limitation des céréales, a acquis un poids nouveau et spectaculaire, remplaçant en quelque sorte les tensions sur les céréales liés aux guerres et aux choix et équilibres périlleux entre recrutement, pillage et approvisionnement. Au XXe siècle, la production de viande a explosé d’abord dans les pays développés, puis, très récemment, dans les pays dits en développement. Désormais, le cheptel et les mangeurs de viande constituent les pires concurrents des mangeurs de céréales, la concurrence étant souvent indirecte avec le passage du blé vers le maïs et le soja destinés aux animaux. Le passage des uns aux autres est un fait, cependant il n’affecte pas tout le monde de la même manière, les inégalités dans ce domaine étant encore importantes entre les pays développés, une partie de l’Asie, l’Amérique latine d’une part, l’Afrique et des parties d’Asie de l’autre. Ces inégalités en termes de consommation de viande et d’accès aux céréales sont tout aussi significatives entre des couches sociales différentes des populations concernées. De nos jours, l’élevage représente 40 pour cent du produit intérieur brut (PIB) agricole mondial. Il emploie 1,3 milliard de personnes et aliment un milliard de personnes vulnérables dans le monde. Les produits d’élevage représentent le tiers de la consommation de protéines de la population mondiale et sont à la fois l’une des causes de l’obésité et un remède possible à la malnutrition. Il est prévu que la production mondiale de viande s’élèverait de 229 millions de tonnes en 1999-2001 à 465 millions de tonnes en 2050, tandis que la production laitière passera de 580 millions de tonnes à 1 milliard 43 millions de tonnes. Cette production est à la hausse surtout en Amérique latine et en Chine. À l’échelle planétaire, la surface des pâturages s’est multipliée par six depuis 1800 . La déforestation s’explique surtout par l’élevage, notamment en Amérique latine et en Afrique (35-50 de la superficie totale). 70 pour cent des terres autrefois boisées de l’Amazonie servent aujourd’hui de pâturages. Actuellement l’élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre ; Au final, les activités liées à l’élevage contribuent pour 18 % aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre provenant des cinq principaux secteurs responsables de ces émissions, à savoir l’énergie, l’industrie, les déchets, l’agriculture et l’ensemble constitué par l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie. Si l’on ne considère que les deux derniers secteurs, alors la part de l’élevage atteint 50 %. Les volumes d’eau utilisés par l’élevage dépassent 8 pour cent de l’utilisation humaine mondiale des ressources en eau. La plus grande partie de l’eau est utilisée pour la production des aliments pour animaux, ce qui représente 7 pour cent de l’eau utilisée dans le monde ; l’abreuvement et l’entretien des animaux sont les besoins en eau les plus évidents dans le secteur de la production animale. La destruction des écosystèmes du fait de l’élevage produit d’importants effets : dans les pays du Nord, de nouvelles formes de contagion apparaissent, à commencer par celles liées à l’alimentation des bêtes et aux conditions de l’élevage (crise dite de la vache folle). Dans les pays du « Sud », les maladies animales, les épizooties se répandent grâce à la globalisation. L’Europe exporte trois variétés de peste porcine vers les États-Unis. Entre temps, d’autres variantes voyagent de l’Afrique sub-saharienne vers l’Europe, le Proche Orient et l’ex URSS, y compris l’Asie centrale au début des années 2000. Des études montrent que de 1940 à 2004 ; il apparait que ces maladies se sont intensifiées au fil du temps ; des zoonoses se distinguent dans la majorité (60,3%) des cas dont 71,8% trouvent leur origine dans les espèces animales sauvages. 54,3% des événements infectieux sont causés par des bactéries et reflètent la résistance croissance des microbes aux médicaments. Des corrélations significatives sont établies entre l’explosion de ces maladies et les facteurs environnementaux, socio-économiques et écologiques, notamment dans les basses latitudes.
Comment se fait-il que le prix des céréales et celui des hydrocarbures soit liés ? Quel est le lien entre pétrole et blé ?
Sur le plan économique, c’est simple : d’une part, la production agricole demande une quantité d’énergie considérable, que ce soit pour les machines pour le labourage, la moisson, pour la transformation des produits et, surtout pour l’élevage. Plus l’agriculture se développe, plus la demande en énergies s’accroit et avec elle, le prix du pétrole.
D’autre part, et réciproquement, la hausse du prix du pétrole provoque celle des coûts de production agricole. Certains produits sont plus sensibles que d’autres, le maïs en particulier, utilisé pour la production d’éthanol. La hausse des cours des énergies affecte celui du maïs et réciproquement.
Ce cercle vicieux est encouragé par la mécanisation extrême et l’agriculture intensive, sans oublier les coûts de transport. Le lien entre cours du pétrole et cours agricoles, des céréales en particulier, c’est intensifié pendant les dernières décennies du fait de la globalisation des échanges et de la production elle-même.
Des formes agricoles davantage respectueuses de l’environnement auraient une moindre demande en énergie, sans que cela passe nécessairement par des « esclaves énergétiques ». Il ne faut pas sous payer les travailleurs agricoles , souvent des immigrés clandestins, afin de réduire le poids des machines. Au contraire, il est possible de bien rémunérer le travail agricole et développer en même temps une agriculture moins polluante et énergivore. Quant aux coûts de transport, le soutien à la production agricole de proximité contribuerait à réduire la force du lien entre prix du pétrole et prix des céréales.
Vous écrivez que la Russie se sert du blé comme arme depuis longtemps. Ce qui lui permet de faire pression sur l'Europe. Pourtant on parle plus du gaz que du blé. Quel rôle jouent les céréales dans la machine de guerre impériale russe ?
La reconstruction de la Russie après Eltsine s’est appuyée sur des stratégies classiques : d’une part, de la géopolitique et de la diplomatie habilement orchestrée, de l’autre le blé. La production russe n’a cessé de grimper au cours des vingt dernières années ; le contrôle de l’Ukraine ne vise pas juste celui de la Mer noire et de son accès à la Méditerranée, mais aussi et surtout la production céréalière et son rôle crucial dans les équilibres mondiaux. Les pays autour de la Mer noire sont à nouveaux cruciaux : Russie, Ukraine, Kazakhstan, Turquie et Roumanie réalisent 25% des exportations mondiales de blé. Les deux premiers pays sont de loin les acteurs les plus importants ; le contrôle de l’un sur l’autre est dès lors crucial en géopolitique comme en économie.
Actuellement, la Russie conforte sa place de premier exportateur mondial, avec "une capacité d'export de 49 millions de tonnes de blé", soit 23% du commerce mondial, - pour une production estimée à 87,5 millions de tonnes -, largement "au-dessus de la moyenne quinquennale", selon Agritel. La région de la mer Noire, de la Russie à la Bulgarie en passant par l'Ukraine et la Roumanie, représente 40% des exportations de blé dans le monde. En 2019, les exportations de pétrole brut s’élevaient à 129 milliards de dollars, celles de gaz à 26 milliards, tandis que le blé atteignait 8,14 milliards. Avec la guerre, les exportations de blé ont augmenté de 36% en quantité, 45% en valeur, tandis que celles de pétrole et de gaz ont chuté.
Beaucoup de raisons sont invoquées pour expliquer l'impérialisme russe en Ukraine. La peur de voir tomber un ancien allié aux mains de l'OTAN, le fait que l'Ukraine serve de porte d'entrée vers l'Europe, d'accès à la Méditerranée via la mer Noire, mais aussi l’accaparement des ressources minérales. Vous avancez que le blé est aussi une raison de cette guerre. Vous écrivez que c'est une logique impériale vieille de 400 ans qui consiste à mettre la main sur le blé ukrainien. Pouvez-vous développer ?
La Russie profite des spéculations mondiales sur le blé où elle tire des profits importants ; si la fermeté européenne vis –à -vis de la Russie est indispensable (quoique défaillante, tantôt en Italie, tantôt en Allemagne), l’origine de l’occupation de l’Ukraine n’est nullement à rechercher dans les politiques de l’Otan ; Poutine avait commencé à rétablir l’Empire soviétique dès les années 1990 et sa politique constitue l’héritage de l’expansionnisme russe, tsariste d’abord, soviétique ensuite. Ainsi, la Russie cherche à bâtir un Empire à partir précisément du contrôle des céréales. Son expansion dans les steppes, en Asie centrale, puis en Pologne et en Ukraine vise précisément ce but : le blé est certes vu comme un instrument apte à garantir l’ordre social intérieur, comme en Europe, mais il constitue également un outil de conquête de vastes territoires, avec l’expulsion ou la soumission des « nomades » présumés d’Asie centrale et des propriétaires insoumis de Pologne et d’Ukraine. Dans cette configuration, la production et le contrôle du blé sont envisagés comme des outils de pression sur l’Europe en cas de guerre ou de mauvaise récolte. Depuis Pierre le Grand jusqu’à Catherine et après elle, la Russie commercialise son blé suivant des modalités qui ne correspondent en rien à ce que Wallerstein avait avancé, à savoir, une quasi-périphérie à la botte de l’Europe en train de s’industrialiser. Tout au contraire, son extension territoriale et l’importance de son blé pour l’Europe offrent à l’Empire russe de formidables outils de pression.
Les tensions actuelles autour des céréales et du blé, en particulier en liaison avec la guerre en Ukraine, sont à première vue le résultat d'une pénurie. Cette dernière est indéniable, cependant il serait réducteur de se limiter à l’expliquer uniquement par le modèle de l’offre et de la demande. En effet, en partant de notre récit historique, il apparait clairement que la pénurie actuelle reflète non seulement l’évolution conjoncturelle, mais aussi des tendances structurales longues: les ambitions expansionnistes de la Russie s’appuyant sur son rôle dans le commerce international, puis mondial du blé ; la lente évolution des marchés occidentaux, puis mondiaux, vers une dérégulation spéculative globale sur les matières premières et les denrées de première nécessité. La Russie cherche à mettre les mains sur le blé ukrainien suivant une logique impériale à l’œuvre depuis le XVIIe siècle. Dès sa naissance, l’Empire russe a vu dans l’accès à la Mer noire et dans le contrôle des marchés internationaux du blé deux objectifs géopolitiques prioritaires. En même temps, cette stratégie, dans le passé comme de nos jours, ne serait gagnante si, en Occident, puis à l’échelle mondiale, les spéculations sur le blé -depuis les marchés à terme, jusqu’au futures et aux spéculations globales de nos jours- ne lui avaient pas créé un environnement propice. En créant une pénurie en quelque sorte artificielle, malgré les capacités techniques et les transports, les marchands puis les capitalistes internationaux (qui incluent de nos jours aussi des entreprises indiennes, chinoises et brésiliennes) donnent un atout à Poutine. Finalement, ces deux dynamiques se sont rencontrées grâce à la manière dont la « transition » du socialisme au capitalisme a été gérée en Russie et dans le contexte international au tournant du millénaire : face au dilemme -faut-il commencer par instaurer la démocratie ou des marchés- la majorité des observateurs et des responsables européens et russes avaient opté pour la seconde solution, en oubliant que dans plusieurs réalités historiques, de la Russie tsariste, à la Chine, à certaines « tigres » du sud-est asiatique, l’essor des marché ne s’était nullement accompagné de la mise en place d’institutions représentatives. La Russie post-socialiste a emprunté ce même chemin et, de ce fait, son expansionnisme territorial fait écho à l’élimination de toute opposition véritable à l’intérieur.



