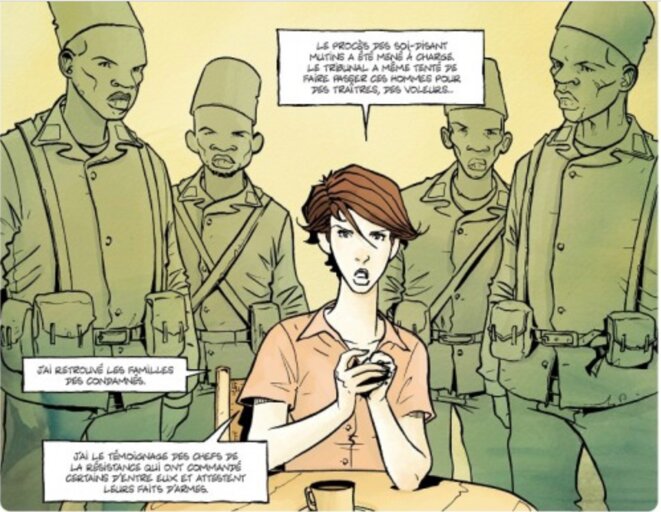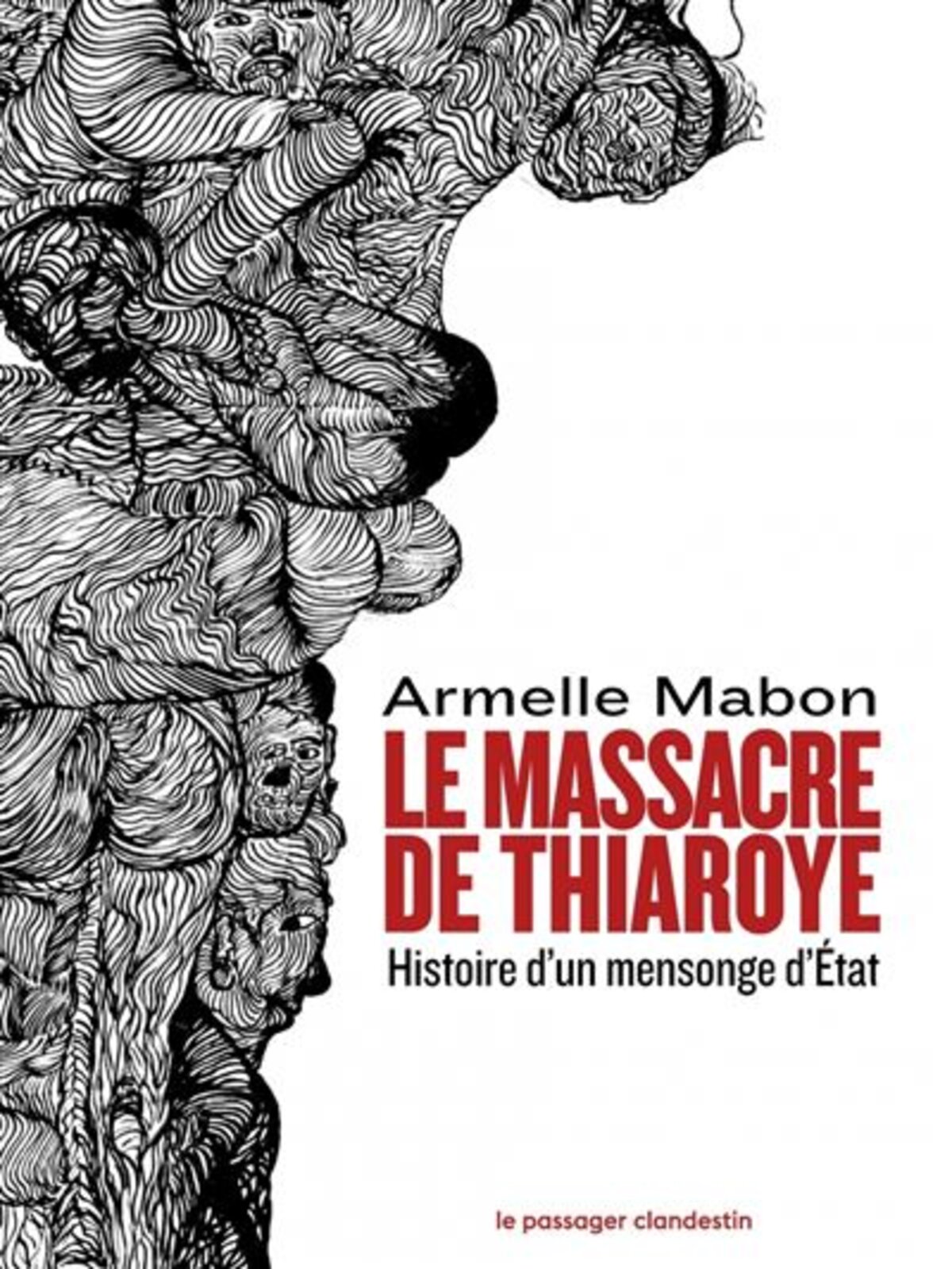
A la lumière des récents développements sur le massacre de Thiaroye, je crois utile de revenir dix ans en arrière.
Une lettre ouverte : procédé bâillon
Le 4 juillet 2014, après que je lui ai adressé la synthèse de mes travaux comme tout historien avide d’échanger avec des collègues bien informés et alors que je n’avais pas mis en cause ses travaux, Julien Fargettas envoie une lettre ouverte au président de la République sur "la tragédie de Thiaroye (1944)" qui sera diffusée sur les sites internet d’Études coloniales et de Jeune Afrique Tragédie de Thiaroye : lettre ouverte à François Hollande - Jeune Afrique et reprise sur de nombreux sites. Parmi les destinataires en copie, outre le Premier ministre, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, la présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces Armées du Sénat, le Secrétaire Général de L’Organisation internationale de la francophonie, le général commandant le Service Historique de la Défense. La lettre était accompagnée de ma synthèse, de ses commentaires et de son article publié dans XXème Siècle Revue d’Histoire mais seule la lettre a été diffusée sur les réseaux sociaux. N’ayant pas été informée, c’est par hasard que j’ai découvert sur la toile la lettre ouverte dont ici les principaux extraits :
« […] Devenue un symbole en Afrique, la tragédie de Thiaroye est aujourd’hui encore sujette à polémiques et discussions. L’Histoire scientifique n’a pu que très sommairement s’emparer du sujet.
Ne serait-il pas temps qu’un véritable travail historique et scientifique sur le sujet puisse voir le jour ?
Vous avez été saisi en octobre 2012 du sujet des archives de l’événement par Madame Armelle MABON. Depuis, de nouvelles pièces ont été retrouvées et mises à sa disposition, lui permettent de rédiger une “synthèse” de l’événement récemment remise à vos services. Si effectivement de nouveaux faits apparaissent, l’omission d’autres archives et témoignages, des conclusions hâtives et autres raccourcis incohérents, témoignent de la partialité de ce travail […] »
Cette lettre se situe hors de tout champ scientifique et méritait une réponse adaptée pour juguler la violence qui n’a strictement rien à voir avec une quelconque controverse ni même une polémique. Je n’avais pas d’autre moyen, pour poursuivre mon travail d’historienne, que de déposer, le 18 septembre 2014, une plainte pour diffamation publique envers un fonctionnaire public.
J’ai saisi la justice pour qu’elle qualifie ou non la diffamation publique. Je ne l’ai pas saisie pour qu’elle dise la vérité historique. Mais pour beaucoup d'historiens, je faisais de la judiciarisation de l'histoire et j'ai reçu un florilège de critiques parfois violentes dont les traces sont sans doute visibles sur le site clionautes provenant notamment de Dominique Chathuant. Du côté du Sénégal, des historiens ne comprennent pas non plus la raison de ma plainte à en croire le commentaire d’Ibrahima Thioub suite à l’effervescence médiatique avec l’octroi de la mention « Mort pour la France » : « Les historiens n’ont pas à trancher leurs désaccords devant les tribunaux, s’ils font bien leur métier(1) ». Un quotidien sénégalais estime qu'aucune recherche n'a été effectuée : "La décision de la France de reconnaître "morts pour la France" des tirailleurs tués lors de Thiaroye 44, alors qu’aucun travail mémoriel n’a été fait par des historiens français et africains, est perçu comme un moyen pour la France d’échapper au travail de mémoire qui pourrait ouvrir la voie à des réparations de la part des familles de Thiaroye 44" (2). C'est oublier les travaux des historiens sénégalais comme Abdoul Sow, Cheikh Faty Faye, Guèye Mbaye, etc. Les recherches des historiens ne sont pas assez connues.
Cette plainte s’est incrustée sournoisement dans un « inentendable » comme le montre Anthony Guyon dans son ouvrage publié en 2022 : « Si les sujets soulevant débats, passions et polémiques ne sont pas rares, Thiaroye a néanmoins la particularité d’avoir conduit deux historiens devant les tribunaux. Armelle Mabon a, en effet, porté plainte contre Julien Fargettas pour diffamation. Même si celle-ci n’a pas abouti, cela reste suffisamment rare et nocif au sein du monde de la recherche pour être ici mentionné (3)».
De l'intérêt de saisir la justice
Je suis donc l’historienne qui a posé un acte nocif alors que la toxicité d’une recherche orientée et partiale peut perdurer si rien ne vient la contrarier. Julien Fargettas s’est englué dans son propre piège. J’ai procédé à quelques vérifications de ses sources pour me rendre compte qu’il m’avait accusée de ce qu’il avait commis à savoir des omissions d’archives. Dans l’ouvrage Des soldats noirs face au Reich. Les massacres racistes de 1940, sous la direction de Johann Chapoutot et Jean Vigreux, publié en 2015, alors que Thiaroye n’a rien à voir avec les massacres racistes de 1940, Julien Fargettas profite de cette tribune pour s’en prendre encore à Ousmane Sembène et son film Camp de Thiaroye. Après avoir donné le bilan des victimes de 35 morts, Julien Fargettas poursuit : « La tragédie demeure aujourd’hui encore au cœur d’un conflit mémoriel et certains n’hésitent pas à remettre en cause le bilan de la répression ou bien encore à accuser les autorités françaises de cacher certains documents relatifs à l’événement (4) ». Jusqu'en 2024, ce docteur en histoire, salarié de l'ONaCVG, nie le massacre. Référent national « histoire et mémoires des soldats africains » à l'ONaCVG , il était également le pilote de l'opération des plaques de Chasselay (voir « Tata » de Chasselay : hommage ou outrage ? #1 | Le Club (mediapart.fr) et « Tata » de Chasselay : hommage ou outrage ? #2 | Le Club (mediapart.fr) ). En 2024, il a été co-commissaire avec Julie Le Gac d'une exposition sous l'égide de l'ONaCVG pour le Mont-Valérien avec la participation de l'historien Martin Mourre. Si, dans le catalogue, ce dernier parle de massacre, Julien Fargettas, dans la préface , évoque la répression meurtrière supposant l'existence d'une mutinerie ou d'une rébellion armée en amont. Personne voulant me donner le libellé du panneau, j'ai saisi la justice administrative. Le 24 juin 2024, alors que l'ONaCVG n'a produit aucun mémoire en défense, 30 mn après le jugement qui m'était favorable, il m'a transmis le libellé du panneau où était bien indiqué "massacre"(5). L'ONaCVG, en reconnaissant le massacre, ne pouvait pas faire autrement que d'attribuer la mention "Mort pour la France".
Pour avancer dans cette recherche, j'ai pris le moyen à ma disposition en recourant à la justice administrative. Même si le ministère ressasse qu'il n'y a pas d'autres archives sur Thiaroye, au détour de mémoires en défense, le ministère livre des informations sur les sépultures et finit par se prendre les pieds dans le tapis avec des incohérences. Malgré les preuves certes imparfaites puisque je ne connais pas le lieu où sont entreposées ces archives si sensibles, pour le moment la justice donne raison au ministère des armées. Maintenant que les victimes sont reconnues "Mort pour la France", la justice administrative va t-elle encore juger que des archives qui prouvent qu'il n'y a pas eu de rébellion armée n'existent pas?
"La recherche n'a rien à faire dans les prétoires"
Mon université ne m'a pas accordé la protection fonctionnelle avec toujours ce motif que je n'avais pas à saisir la justice pour dire la vérité historique. J'ai saisi le tribunal administratif de Rennes qui n'a pas rouvert l'instruction après que j'ai adressé la mise en examen des responsables des deux sites et de Julien Fargettas en tant que complice. Le rapporteur public a donc étudié ma requête sans prendre en compte la mise en examen. Les juges ont suivi les conclusions du rapporteur public : Rejet. J'ai fait appel. Le rapporteur public de la cour d'appel administrative de Nantes a beaucoup hésité justement du fait de la non réouverture de l'instruction mais a proposé le rejet. Non seulement les juges l'ont suivi (6) mais m'ont condamnée à payer une somme de 1000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à mon université. Je n’ai pas imaginé une seule seconde me pourvoir en cassation – je n’avais plus les moyens financiers nécessaires - et aujourd’hui je le regrette car j’aurais pu renverser cette sentence « La recherche n’a rien à faire dans les prétoires » alors que la chercheuse a saisi la justice administrative pour obtenir la protection fonctionnelle et non pour que la justice juge le travail des historiens. Les chercheurs sont des citoyens ordinaires qui peuvent saisir la justice mais qui doivent aussi répondre de leurs actes en cas de suspicion de fraude scientifique.
La 17ème chambre correctionnelle
Le 31 mars 2017, je découvre le Palais de justice de Paris et cette 17ème chambre correctionnelle.
D’emblée le président a indiqué qu’il n’était pas là pour juger l’Histoire, ni les versions diamétralement opposées de deux historiens. Par contre, il a estimé devoir comprendre pourquoi deux historiens se retrouvent devant cette Cour sur un sujet sensible. Il a voulu savoir pour quelles raisons il avait fait cette lettre ouverte et pourquoi il avait estimé ne pas me tenir informer de la diffusion alors que je l’avais sollicité pour un avis sur l’avancée de mes travaux. Julien Fargettas a répondu qu’il n’avait pas vu l’utilité de m’en informer mais qu’il devait informer le président afin de constituer un comité d’historiens. Il a mentionné que j’avais eu accès à des archives par une sorte de privilège et a essayé de démontrer à quel point mon travail était partial tout en reconnaissant ma capacité de chercheuse. Il n’a pas pu dire quelles archives j’avais omises.
Le président m’a alors demandé ce que j’avais ressenti quand j’ai découvert la lettre et pourquoi j’avais déposé plainte. J’ai d’abord signalé que Julien Fargettas n’était pas chercheur associé au CHERPA depuis fin 2014, ce mensonge est un parjure. J’ai essayé d’exprimer cette notion de violence et ma stupéfaction face à cet acte inédit pour discréditer une historienne par le truchement d’une lettre ouverte au président de la République. J’ai indiqué que sans cette plainte, je n’aurais pas pu poursuivre ma recherche car j’aurais été prise dans le filet de l’intimidation.
Le président a insisté pour comprendre si moi seule avait bénéficié d’un régime de faveur ou si l’accès était le même pour tout le monde. Je crois que la Cour a compris que c’est une règle générale et que je n’ai bénéficié d’aucun privilège.
Quant au directeur de Jeune Afrique, Marwane Ben Yahmed, il mentionne qu’il y avait bien un motif légitime d’information sur un sujet d’intérêt général, une absence d’animosité personnelle et qu’il s’est assuré du sérieux de l’enquête en amont avant de diffuser la lettre de l’universitaire. Mais il ne m’a pas sollicitée afin de connaître mon avis sur ce sujet d’intérêt général qu’il savait sensible avant diffusion. Si Julien Fargettas s’est présenté comme universitaire, il a trompé Marwane Ben Yahmed en usurpant un titre qu’il ne possède pas.
L’avocat de Julien Fargettas a voulu montrer que je n’avais pas signalé toutes les archives dans ma synthèse et a listé les pièces non produites. La France a transmis plus de 8000 pièces d’archives au Sénégal et je n’ai effectivement pas cité dans ma synthèse les 8000 pièces ! L’avocat est revenu abondamment sur le lieutenant de vaisseau Salmon qui ne pouvait pas commander les automitrailleuses puisque ne faisant pas partie de l’Armée de Terre. Pourtant, il y avait bien deux officiers Jules et Max Salmon et ce dernier, tout en étant lieutenant de vaisseau, a été appelé pour commander les automitrailleuses car considéré comme bon tireur. Toutes ces considérations nous éloignaient de la plainte pour diffamation publique.
Son directeur de thèse, Jean-Charles Jauffret, après avoir rappelé que ses collègues étrangers font référence à sa thèse publiée « y compris pour le triste et sanglant épisode de la mutinerie (7) de Thiaroye en novembre 1944 » il déploie toute l’hagiographie possible pour son ex-doctorant : maîtrise d’un très large corpus, rigueur scientifique, hauteur de vue, sens de l’écriture. Il conclue en ces termes : « […] en cette époque où le phénomène de “judiciarisation” risque de déborder sur des querelles vaines encombrant les tribunaux, il me semble extrêmement grave qu’un docteur en histoire attaque en justice un autre docteur en histoire sur l’appréciation d’un fait. C’est la porte ouverte au n’importe quoi et à la négation du fondement même de la recherche ». Ce professeur des universités refuse de me citer comme maître de conférences .
Quant à mon collègue de laboratoire, Vincent Joly :
« Il est à mes yeux le meilleur spécialiste de cette question et ses travaux enrichissent ceux de Marc Michel, Myron Echenberg, Colette Dubois ou encore Jacques Frémeaux ».
Marc Michel, président de son jury de thèse, atteste de la qualité scientifique, de l’honnêteté intellectuelle, de la bonne foi scientifique et de l’ouverture d’esprit nécessaire au « métier d’historien » de Julien Fargettas. Il situe le début de la controverse avec la publication de l’article de Fargettas dans la Revue XXème siècle. Marc Michel ne fait aucunement référence à la lettre ouverte et je m’étonne de ce qualificatif de controverse car non seulement je n’ai jamais alimenté ni controverse, ni polémique à l’issue de cet article, mais de surcroît, j’ai proposé à Julien Fargettas de lire les épreuves de mon livre où je cite son article sans le critiquer.
La procureur de la République a évoqué la bonne foi de Julien Fargettas. Ils seront relaxés par le jugement du 12 mai 2017.
Le Comité d'historiens fantôme
La proposition de Julien Fargettas de mettre en place un comité d'historiens n'a jamais été entériné et pourtant, le 9 août 2024, lors d'une conférence de presse donnée à l'Elysée pour la préparation de la commémoration du 15 août, les conseillers du président Macron ont mentionné l'existence de ce comité d'historiens depuis 2014. Mensonge quand tu nous tiens! Si ce comité avait été constitué, je suppose que je n'aurais pas été appelée.
Julie d'Andurain pour qui le nombre de morts à Thiaroye est un aspect de détail La responsabilité des historiens et le massacre de Thiaroye | Le Club (mediapart.fr) avait mentionné des spécialistes : "Si Iba Der Thiam ou Ibrahima Thioub sont deux historiens à même d’encadrer à l’avenir un programme de recherche côté sénégalais, des historiens français aussi indiscutables que Jacques Frémeaux, Jean-Charles Jauffret ou Marc Michel doivent y être associés [...] (8).
Aucun de ces historiens ont travaillé sur Thiaroye. Jacques Frémeaux évoquait Thiaroye en ces termes dans une exposition en 2012 : « Les ex-prisonniers revenant des camps allemands étaient en colère car ils avaient pu échanger que la moitié de leurs marks ». Dans son article « Les contingents impériaux au cœur de la guerre »(9) il parle de séquestration de plusieurs officiers dont un général. À n'en point douter un grand connaisseur ! qui fut le référent de Julie d'Andurain pour son mémoire HDR. Dans son ouvrage (10) issu de ce mémoire, Thiaroye est une mutinerie, rien qu'une mutinerie avec 35 morts. Ceux qui osent prétendre autre chose sont hostiles à l'armée.
J'imagine que l'octroi de la mention "Mort pour la France" va considérablement perturber Julien Fargettas, Julie d'Andurain mais aussi Eric Deroo qui vont avoir plus de mal à poursuivre leur besogne. Mais leurs écrits restent et il n'y a aucune raison de ne pas procéder à des rétractations lorsqu'ils sont volontairement mensongers pour maintenir le récit officiel de la rébellion armée et de la mutinerie avec 35 morts.
Le milieu universitaire préfère mettre la poussière sous le tapis en ne traitant pas les signalements pour suspicion de fraude scientifique. Par contre, il refuse de soutenir une historienne malmenée parce qu'elle avait mis au jour un mensonge d'État bien dérangeant comme nous l'avons constaté avec le récent tsunami médiatique.
(1) Le Soleil, 1er août 2024.
(3) Anthony Guyon, Les tirailleurs sénégalais De l’indigène au soldat, de 1877 à nos jours, Perrin, 2022, p. 263.
(4) Julien Fargettas, « La “Force noire” : mythes, imaginaires et réalités », dans Johann Chapoutot et Jean Vigreux (dir.), Des soldats noirs face au Reich, les massacres racistes de 1940, Paris, PUF, 2015, p.33.
(5) Suite au jugement du 24 juin 2024, je n'ai toujours pas reçu les documents qui prouvent que les disparus dont les noms sont indiqués sur deux plaques, sont bien inhumés à la nécropole de Chasselay.
(6) Arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Nantes 22-12-2017 n° 16NT03109.
(7) Souligné par moi.
(9) Jacques Frémeaux, Histoire, économie & sociétés, n°2-2004, pp. 228-229.
(10) Julie d’Andurain, Les troupes coloniales. Une histoire politique et militaire, Paris, Passés Composés, 2024.