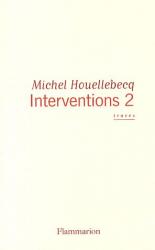Interventions 2. Pourquoi 2 ? Interventions, paru en 1998, était épuisé, la nouvelle édition a été refondue et augmentée. Elle regroupe des textes publiés pendant plus d’une décennie (juillet 1992-septembre 2008), sur des supports divers, de la NRF aux Inrocks, du Web à Paris-Match ou 20 ans, s’intéressant au cinéma, à la littérature, à l’art contemporain, à la pédophilie, à l’architecture, à la réhabilitation du beauf…
Ce sont autant d’articles, d’entretiens, de lettres, qui dessinent un parcours qui n’est qu’en apparence éclaté, construisant peu à peu la trame d’une réflexion aiguë, dont la cohérence est soulignée dès L’Avant-Propos. Le roman « isomorphe à l’homme » peut et doit tout contenir, en un modèle d’œuvre-monde, d’architecture du sens. Les réflexions théoriques sont un « matériau romanesque ». « Tout devrait pouvoir se transformer en un livre unique, que l’on écrirait jusqu’aux approches de la mort ». Interventions 2 est une des pierres de l’édifice, à la fois art du roman et miscellanées. Il est, somme toute, une extension du domaine de la lutte.
Interventions 2, ce sont les Mythologies de Houellebecq. Un anti Dictionnaire capricieux du tout et du rien. Un anti inventaire à la Prévert, aussi. D’ailleurs – clin d’œil ? ironie ? – le recueil de Houellebecq s’ouvre sur un article au titre explicite : Prévert est un con. Le titre vous semble violent ? Lisez la suite pour comprendre ce que Michel Houellebecq entend par « intervenir ». Il tire à vue : sur Prévert donc, Philippe Claudel, Cabu, Guy Bedos. Ce ne sont pas des haines ordinaires ou de petits règlements de compte entre (faux) amis.
Les luttes de Houellebecq sont fondamentales, nécessaires, elles engagent une vision du monde, de l’homme, de l’art et du social. Si Prévert est un con, ce n’est pas – seulement – parce que Houellebecq serait dans la bravade ou la provocation. Mais parce que Prévert incarne tout ce que Houellebecq refuse : une forme médiocre assortie à un fond « d’une stupidité sans borne ». Et parce que sa « seconde mort » – l’entrée de Prévert dans la Pléiade – est le signe d’une œuvre « complète, figée ». Sous naphtaline.
Or Houellebecq aime les possibilités, les plateformes expérimentales, les extensions, en témoignent les titres de ses romans. Un œuvre en devenir, qui s’essaie jusque dans les formes les moins figées (entretiens, articles sur internet, commandes). Des traces, comme le souligne le sous-titre d’Interventions 2. Plurielles, diverses malgré leur nécessité commune et leur volonté concertée de couvrir le champ, vaste, du contemporain, du rapport du roman au réel, au social. De porter une réflexion sur la modernité (architecturale, sexuelle, scripturale, scientifique…).
Interventions 2 est une entrée dans l’œuvre de Houellebecq, non par les coulisses ou le hors scène, mais de plain-pied, dans son style si particulier, fait de provocations, de cynisme apparent et de parenthèses humanistes que l’auteur feint de s’empresser de refermer, d’un humour parfois grinçant, volontiers noir et désabusé, souvent jubilatoire. Le Houellebecq qui aime à citer Schopenhauer, Auguste Comte et… Wittgenstein, quand il est de bonne humeur (Philippe Muray en 2002).
Approches du désarroi (quatrième texte du recueil) est l’art du roman de Michel Houellebecq. Un texte central comme le souligne sa permanence temporelle, sa réitération de lieux en lieux : d’abord paru dans Genius Loci (La Différence, 1992), il est repris dans Dix (Les Inrockuptibles/Grasset, 1997) puis dans Interventions (Flammarion, 1998), dans Rester vivant et autres textes (Librio, 1999) et aujourd’hui dans Interventions 2.
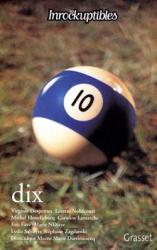
La littérature y est présentée comme un « pôle de résistance », réflexive, supposant un lecteur sujet, et non pur consommateur, allant en ce sens à contre-courant de la soif contemporaine d’actualité permanente. Le livre y est l’absolu, l’infini des possibles, car il est un « art conceptuel » :
« Rien ne peut être affirmé, nié, relativisé, moqué sans le secours des concepts et des mots. D’où l’étonnante robustesse de l’activité littéraire, qui peut se refuser, s’autodétruire, se décréter impossible, sans cesser d’être elle-même. Qui résiste à toutes les mises en abyme, à toutes les déconstructions, à toutes les accumulations de degrés, aussi subtiles soient-elles ; qui se relève simplement, s’ébroue et se remet sur pattes, comme un chien qui sort d’une mare ».
Elle est une « révolution froide », car elle se place « en dehors du flux informatif-publicitaire », elle est résistance à l’urgence, activité mentale qui immobilise pour mieux mettre en branle nos certitudes et nos croyances, comme le déclare l’auteur dans un entretien à Art Press (1995), affirmant que son rapport à l’écriture, à l’art, se fonde sur « le refus radical du monde tel qu’il est ».
Au-delà de ces réflexions sur la littérature, l’art (Pasolini, Neil Young, les rapports du roman et de la poésie), Houellebecq livre des analyses sociologiques, centrées en particulier sur la question du désir, du narcissisme, sur notre « société qui organise l’exacerbation du désir sans apporter les moyens de le satisfaire ».
Tout trouve place dans Interventions 2 (sauf BHL) : la brebis Dolly, les salons de la vidéo hot, l’immortalité, le livre de poche, les polémiques sur l’Islam, le féminisme, le clonage, les bactéries, une théorie de La Fête hilarante, ce que le passage de la machine à écrire à l’ordinateur a changé dans le rapport au manuscrit, des autoportraits au vitriol :
« Je ne m’aime pas. Je n’éprouve que peu de sympathie, encore moins d’estime pour moi-même : de plus, je ne m’intéresse pas beaucoup. Je connais mes caractéristiques principales depuis longtemps, et j’ai fini par m’en dégoûter » (Consolation technique).
Des haines, donc, de soi, des autres, du siècle littéraire, « nul, qui n’a rien inventé. Avec cela pompeux à l’extrême » (Sortir du XXè siècle). Mais aussi des coups de cœur, pour des films, des écrivains (Djian, Ravalec, Dantec, Dustan), des genres littéraires, comme la Science-fiction, qui seule sait encore mettre en perspective l’humanité, ses valeurs, ses connaissances, se donne comme philosophique et poétique. Il annonce que ce sera là, sans doute, la voie de son prochain roman, mutation amorcée avec La Possibilité d’une île.
Houellebecq réaffirme sa détestation du politiquement correct. « De plus en plus de choses deviennent impossibles à penser » (Entretien de janvier 2002 pour L’Opinion indépendante). Raison de plus pour intervenir. Michel Houellebecq refuse de devenir un « gentil », comme il le déclare à Paris-Match en octobre 2006 : « je sais ce qu’il faut faire pour passer pour gentil ; je ne suis pas idiot. Mais je n’en ai pas très envie ». Ne changez pas. Continuez d’intervenir, et, selon les principes que vous énoncez comme nécessaires, de « regarder le monde en face » pour « élaborer des clichés neufs ».
Michel Houellebecq, Interventions 2, Flammarion, 286 p., 20 €.