Deux leaders socialistes ont fait, ces derniers jours, des discours en forme de déclarations de candidatures […] Il s’agit de François Hollande, le week-end dernier à Lorient, et de Manuel Valls, lundi soir à Paris. Le premier ne dit pas explicitement qu’il est candidat mais ça se voit autant que son nouveau look.
Manuel Valls n’a pas ces pudeurs d’homme politique du vingtième siècle. Il est candidat, ça paraît peut-être incongru mais le culot est une arme assez classique pour sortir du lot en politique. Nicolas Sarkozy l’a remise au goût du jour !
Bref, ils sont candidat et ça les force (s’ils ne veulent pas être rapidement ridicules) à formuler clairement une pensée un tant soi peu originale. Et c’est le moment parce que, comme le dit l’anthropologue Marc Auger paraphrasant Claude Levy-Strauss : « la crise est bonne à penser ». La crise qui brouille les repères permet, à droite comme à gauche, de réfléchir tout haut sans la crainte d’être taxé de social traître (à gauche) ou de dérive gauchiste (à droite).
A gauche, il y a ceux qui bataillent pour que toute la gauche se trouve un lieu de rencontre et élabore un projet en commun. C’est le rêve et le combat de l’ancien ministre de la défense, Paul Quilès. Il en appelle à un nouveau front populaire. L’homme ou la femme providentielle viendrait après.
Et puis, il y a ceux qui pensent qu’un projet ça s’incarne et tant qu’à faire, par leur propre personne. Manuel Valls et François Hollande par exemple. Il se trouve que leurs discours ne sont pas si éloignés que ça. Ils s’opposent tous les deux au discours plus marqué à gauche de Martine Aubry, discours renforcé par Benoît Hamon […] Hollande et Valls, (comme ils ne s’aiment pas, ils ne seraient pas forcément ravis qu’on les associe, mais ça, c’est leur problème !) donc Hollande et Valls profitent de la crise pour élaborer des solutions de l’après crise.
Le premier, qui est plus naturellement porté sur les questions économiques et qui s’est libéré de son obligation et de son goût pour la synthèse, ose enfin affirmer. Le second, plus prolixe sur les questions de société, affirme depuis toujours. Il se contredit parfois mais, au fil du temps, une pensée identifiée se crée. François Hollande prend soin de rappeler que l’égalité est toujours l’étoile polaire de la gauche parce qu’en réalité, il prône déjà une politique budgétaire rigoureuse, axée sur un petit nombre de priorités. Dans l’ordre : la compétitivité, la solidarité et l’écologie.
La compétitivité avant la solidarité ! Quand on compare ça avec le discours social de Nicolas Sarkozy devant l’OIT, on croit revenir, comme le soulignait Henri Guaino lundi, au débat à front renversé droite-gauche Pleven/Mendes-France, d’après guerre. Pleven voulant ouvrir les vannes de la dépense alors que Mendes veillait aux équilibres budgétaires.
Manuel Valls, lui, veut s’inscrire dans la lignée mendésiste et rocardienne. Il prône un discours dit « responsable plutôt que flamboyant », parle de « l’utopie du possible », cite Camus ou Anthony Giddens, le sociologue britannique théoricien du blairisme […] Hollande et Valls font le pari du retour d’un besoin d’ordre dans les concepts autant que dans les finances publiques. C’est bien à la naissance de l’aile droite du PS que nous assistons. Une tendance bicéphale qui s’est sentie encouragée en constatant qu’aux Européennes, la grogne des électeurs habituellement socialistes ne s’est pas traduite par un succès de la gauche de la gauche.
Ce qui précède et qui semble, presque, coller à l’actualité n’est pas de moi. C’était « L’édito politique », sur France Inter, de Thomas Legrand… du mercredi 1er juillet 2009. Édito intitulé La renaissance de l’aile droite du PS. Comme quoi, rien de bien nouveau sous le soleil.
Manuel Valls, aux prochaines élections présidentielles, sera candidat… si François Hollande, courbe du chômage aidant, n’y va pas. L’un ou l’autre iront à une Primaire, s’ils seront certains d’être en tête (sondages dictant), ou alors ils n’iront pas… à une Primaire ouverte. L’épouvantail Marine Le Pen sera agité… comme un leurre. Elle a bien peu de chances cependant de devenir Présidente. Pareillement aux régionales où elle a échoué. Le second tour ? Valls aura cependant bien peu de chances, lui également, d’y figurer. Juppé ou Sarkozy seront de biens meilleurs remparts face au Front national. La primaire à gauche, alors que le pays penche majoritairement vers les valeurs de droite (voir le billet précédent : https://blogs.mediapart.fr/edition/la-securite-par-la-democratie/article/010216/violence-detat-une-histoire-qui-se-rejoue) risque alors de tourner à une mascarade. Finalement, il y a fort à parier que les sondages, exit un socle commun de propositions, remplaceront la Primaire à gauche.
Mais cela n’a pas grande importance puisque l’objectif pour Hollande ou Valls, comme pour Juppé ou Sarkozy est, au sortir de l’élection présidentielle, une gouvernance d’union. Non pas nationale, mais UMPS, pour reprendre l’expression inventée par Marine Le Pen. Pour eux, Valls ou Hollande, l’enjeu est de limiter les dégâts et, dans la perspective de cette union annoncée, d’arriver troisième au premier tour de l’élection présidentielle de 2017.
Le bilan de droite de François Hollande aurait pu aussi bien être celui de Sarkozy, s’il avait été élu en 2012. La politique de ce dernier, ou de Juppé, sera dans la continuation de celle du couple Hollande-Valls. Ces derniers n’ont aboli, à ma connaissance, aucune des lois importantes votées sous la précédente législature. Pareillement, Juppé ou Sarkozy n’aboliront aucune des lois adoptées sous la législature Hollando-Vallsienne… puisque ensemble ils gouverneront… sur un même programme, pour faire une même politique. Sauf imprévu.
Et pourtant, Valls nous avait prévenu où il voulait nous mener. Dès 2007 :
« Désormais, les lignes de fracture politiques se situent pour moi entre life politics et emancipatory politics, entre modernisateurs et traditionaliste, que l’on retrouve indifféremment à droite comme à gauche. Sarkozy est, par exemple, un modernisateur certain de la droite. » […] Au fond, il n’y a plus qu’une économie de services fondée sur la connaissance, et si vous n’intégrez pas ce que cela implique, vous êtes fini en tant que parti de centre gauche. Vous serez, au mieux, un parti de gauche radicale qui ne gagnera jamais le pouvoir […] Dans une économie moderne fondée sur les services, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre les contrats à temps partiels. Il faut les additionner, car il est impossible de maintenir des contrats adaptés au monde de l’industrie : l’économie s’effondrerait […] L’une des raisons pour lesquelles il faut modifier le système d’assistance, c’est que, dans les économies modernes, il y a un taux de perte de 20 % des emplois. Leur destruction est un signe de prospérité. Un système de protection qui permette aux salariés de se confronter au changement en un sens profitable est donc nécessaire. Plus on permet aux gens de se retrancher dans leurs emplois, plus on menace la prospérité globale de l’économie […] Dans ce monde compétitif, rapide, mouvant, il ne faut plus trop investir dans les anciennes missions de l’État-providence […] En tout cas, s’il y a bien une chose à ne pas faire, c’est de revenir à une solution de la vieille gauche et d’augmenter la contribution des tranches supérieures des contribuables. Il faut faire très attention aux conséquences économiques de ce genre de convictions morales […] Je suis opposé au protectionnisme, parce qu’il est toujours double. Vous ne pouvez pas adopter de position protectionniste sur l’économie européenne sans que nos partenaires limitent ce sur quoi vous pouvez commercer avec eux. Par principe, j’estime qu’une économie concurrentielle, même si elle demande à être régulée, est le mécanisme de la prospérité ». Etc…Etc…
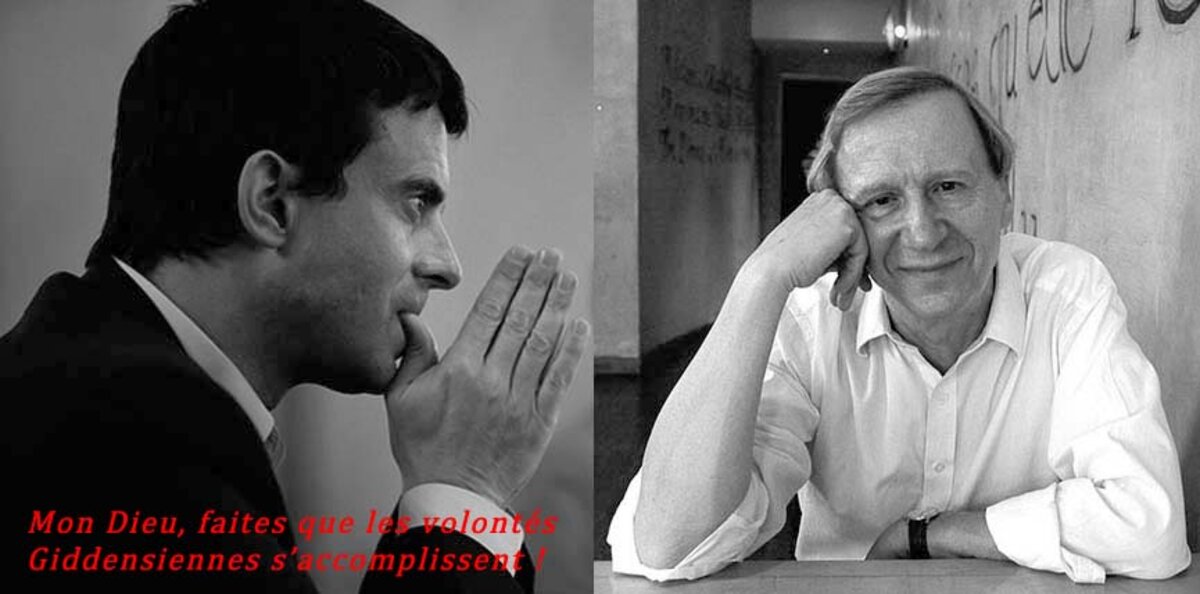
Agrandissement : Illustration 1

Les propos qui précèdent ne sont pas de Manuel Valls. Ils sont d’Anthony Giddens, le sociologue britannique théoricien du blairisme auquel notre homme se réfère, comme le dit Thomas Legrand dans son édito. Propos tenus en 2007 et recueillis par Théophile Hazebroucq pour une revue (No7/8) alors éditée par la Fondation Gabriel Péri. Mais ceux qui suivent sont, eux, bien de Valls, toujours en 2007 :
« Il faut renoncer aux vieilles recettes, il faut redéfinir cette nouvelle société. L'incarnation de ces mots-là doit être faite par quelqu'un de la nouvelle génération. Ma référence, un peu osée, c'est celle de John Kennedy à la fin des années 50, qui rompt avec le vieux parti démocrate de Truman. On peut retrouver le même élan avec les nouveaux démocrates des années 80 ou la troisième voie d'Anthony Giddens et de Tony Blair. Il faut remette les valeurs de la gauche en mouvement » (Le Nouvel Économiste, recueilli par Jean-Michel Lamy).
On peut retrouver l’ensemble de ces professions de foi giddensniennes et vallsiennes, néo-libérales et ultra-violentes, dans un billet du 15 janvier 2015 sur : https://blogs.mediapart.fr/armand-ajzenberg/blog/150115/aux-origines-de-la-politique-sociale-liberale-vallso-hollandaise-anthony-giddens
« Le néolibéralisme est cet économisme total qui frappe chaque sphère de nos sociétés et chaque instant de notre époque. C’est un extrémisme. Le fascisme se définit comme l’assujettissement de toutes les composantes de l’État à une idéologie totalitaire et nihiliste. Je prétends que le néolibéralisme est un fascisme car l’économie a proprement assujetti les gouvernements des pays démocratiques mais aussi chaque parcelle de notre réflexion. L’État est maintenant au service de l’économie et de la finance qui le traitent en subordonné et lui commandent jusqu’à la mise en péril du bien commun ». C’est ce que soulignait Manuela Cadelli, présidente de l’Association syndicale des magistrats belge, dans un billet publié par le quotidien belge Le Soir (billet signalé par Laurent Mauduit dans son article du 8 mars intitulé « Réformisme », « social-libéral » : quand les mots ne veulent plus rien dire ») : https://www.mediapart.fr/journal/economie/080316/reformiste-social-liberal-quand-les-mots-ne-veulent-plus-rien-dire
La social-démocratie, « c’est davantage le capitalisme qui l’a réformée, assagie […] la modernisation de la social-démocratie semble se dérouler en marge de la tradition sociale-démocrate, et peut-être même en rupture avec elle » constatait, c’était en 2007, Philippe Marlière dans la revue déjà citée.
En effet, Valls ou Hollande nous feraient, presque, regretter le capitalisme de papa. Souvenez-vous : le Front populaire de 1936, le programme du CNR et les lois sociales issues de la Libération, Mai 68 et ses avancées sociétales, les 35 heures de Martine Aubry et Lionel Jospin… Fini tout cela. Il faut être « moderne ».
« Une formation sociale (le capitalisme contemporain) ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes les forces productives qu’elle est assez large pour contenir, jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s’y substituent avant que les conditions d’existences matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société » (Marx).
En sommes-nous là ? Si le capitalisme aujourd’hui financier n’a pas encore donné tout ce qu’il pouvait donner, Anthony Giddens et Emmanuel Valls ont raisons. Il faut se contenter de « l’humaniser »… aux conditions en France du MEDEF. Si le capitalisme n’a plus rien à donner, l’urgence et la priorité sont alors de démontrer que cette formation sociale, celle où nous vivons, est parvenue au bout de son cycle. L’autre priorité est alors de tenter de définir celle pouvant la remplacer. Ce qui n’a rien à voir avec un programme présidentiel réduit à un socle commun minimum rassemblant des tenants d’une société sociale-libérale d’un côté et de l’autre ceux d’une société anticapitaliste. En fait les éléments d’une nouvelle société sont déjà présents et c’est ce qu’il faut prendre en compte. Se pose aussi alors la question du « comment » ? Par un réformisme révolutionnaire selon moi, non violent par essence.
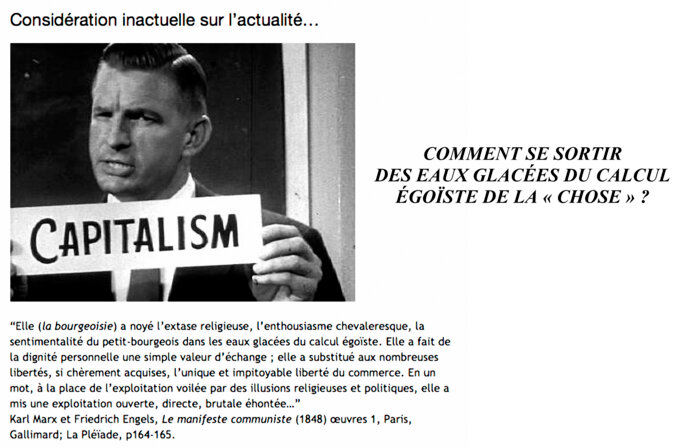
Agrandissement : Illustration 2

C’est en 1850 que Marx et Engels utilisent pour la première fois l’expression « évolution révolutionnaire ». Jaurès s’en empara en 1898 et en fit l’un de ses combats théoriques, le considérant comme une nouvelle méthode socialiste. Méthode qui fut ensuite occultée, par les communistes notamment. Communistes soumis alors à la doxa stalinienne. Jaurès est alors érigé en icône, voire en fétiche, et la force subversive de son socialisme fut évacuée.
Henri Lefebvre, en 1968, utilisa l’expression « réformisme révolutionnaire », voisine mais plus moderne, en remplacement de la précédente. Mais l’occultation continua. Aujourd’hui, un historien (Jean-Paul Scot) y a consacré un livre (Jaurès et le réformisme révolutionnaire, Éditions du Seuil, 2014), et un philosophe, Yvon Quiniou, réactive aussi le sujet : « la révolution n’étant alors que le somme, étalée dans le temps, de réformes qui aboutissent à nous faire changer de société » (Retour à Marx Buchet-Chastel, 2013).
Les questions centrales posées sont, on l’a vu, soit d’humaniser le capitalisme à la manière de Manuel Valls ou, si ce mode de production est en fin de vie, d’aller alors vers un « monde nouveau » ? Si on examine un certain nombre d’éléments comptables des économies nationales, il semble bien que la réponse à la seconde question soit oui. Jusqu’ici, les formes violentes de révolution, au 20e siècle, ont produit des sociétés pires que les systèmes capitalistes qu’elles ont remplacé. Reste le « réformisme révolutionnaire » comme méthode à tenter. Méthode par nature, répétons-le, démocratique et donc non-violente.
Cela a déjà été traité longuement, il y a quelques temps, sur un billet de mon blog. On peut y aller, et le lire ou le relire, et en débattre ou re-débattre :



