Plusieurs publications récentes nous permettent de préciser les notions d’athéisme (militant ou non), d’indifférence religieuse et de critique des religions.
« Je crois en l’athéisme » Le témoignage d’Emmanuel Pierrat
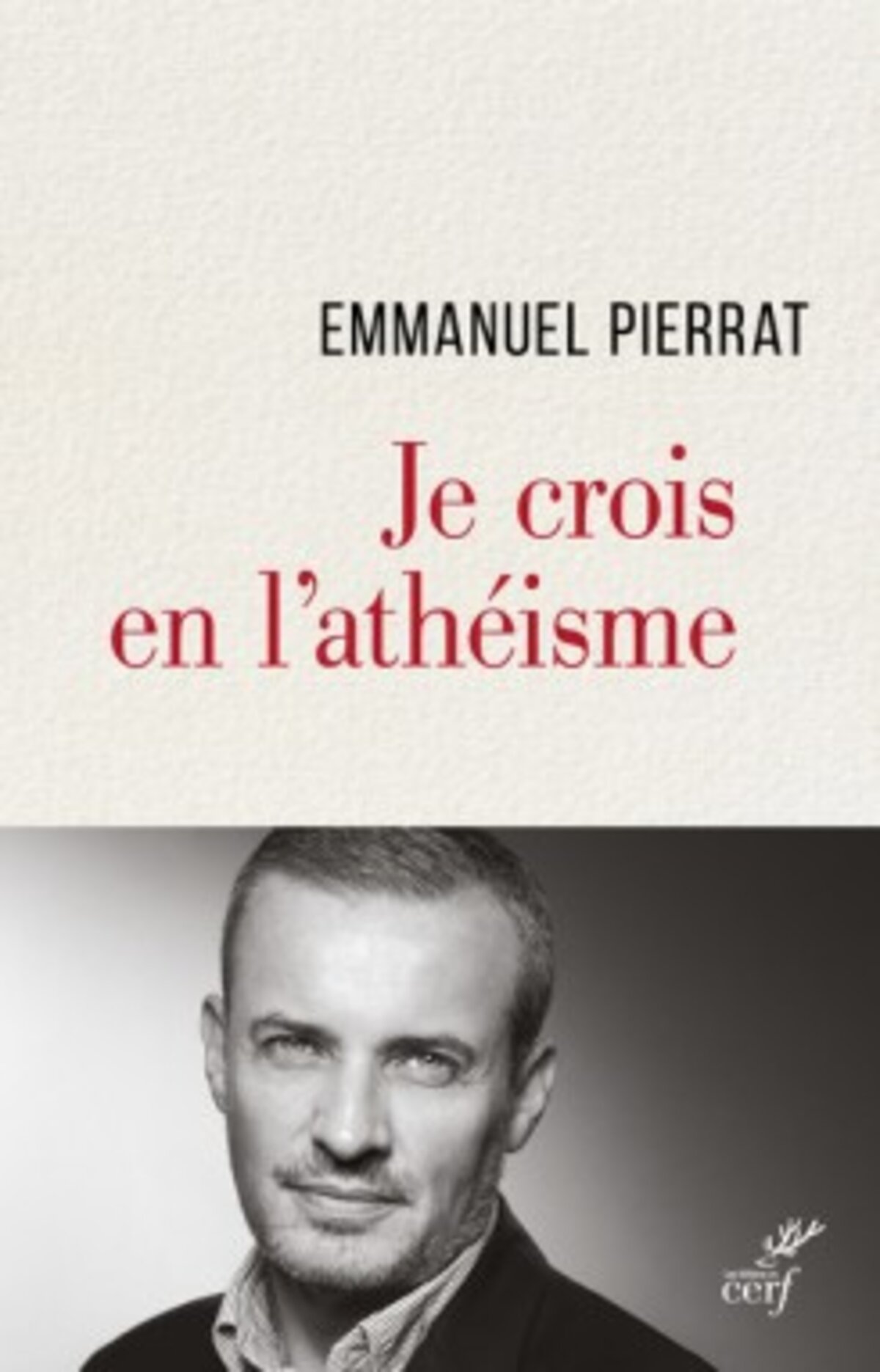
S’il est un athée atypique, c’est bien Emmanuel Pierrat. C’est que le personnage lui-même sort de l’ordinaire. Avocat à l’expertise incontestée, « défendant parfois l’indéfendable », avec des livres et des responsabilités associatives par dizaines. Il est connu pour son professionnalisme en matière de propriété intellectuelle et ses engagements argumentés contre toutes les formes de censure, avec un blog très lu sur Livres hebdo. Ses livres sur ce thème sont présentés dans notre édition, et il a fait une intervention remarquée lors des Rencontres laïques de la Ligue de l’enseignement consacrées à la liberté d’expression le 5 juin 2019. Son dernier livre, « Je crois en l’athéisme », est une manière de réponse à son éditeur, Jean-François Colosimo : « Et toi, à quoi crois-tu ? ». Le contenu surprendra plus d’un lecteur. Emmanuel Pierrat est né dans une famille catholique. Ses parents n’assistaient pas à la messe dominicale, mais ne manquaient pas d’y envoyer leur fils, aussi bon paroissien qu’élève studieux. L’affaire se corse au lycée, où le jeune garçon s’émancipe en particulier de la foi. Il vire promptement sa cuti, c’est presque une « conversion », notamment à la lecture de Bakounine. Il est athée ! En une quarantaine de chapitres brefs, il nous donne une série de tableaux des moments de son évolution et de ses passions intellectuelles et esthétiques. Car les unes comptent autant que les autres. Son athéisme ferme et documenté (Russel, Comte-Sponville, Onfray –contre lequel il a plaidé-, Dawkins…) cohabite avec une attention pour les cultes… du point de vue culturel. Franc-maçon passionné, auteur d’une dizaine de livres sur le sujet, il révèle devoir à cette appartenance un regard plus apaisé sur le monde catholique de son enfance. Pénétrant, et il le fait souvent, dans une église ou une cathédrale, il ne manque pas de se signer. Il y voit une forme de politesse. Aussi allergique au judaïsme qu’aux autres religions, il possède tout de même deux kippas en cas de besoin. Il participe ainsi à nombre de cérémonies à caractère religieux, dont des enterrements ou des crémations. Mais aussi à bien d’autres tout au long de ses voyages autour du monde. La cérémonie la plus étonnante fut celle des masques bobos (tribu du Burkina Faso et non du 7° arrondissement parisien). Manifestement païenne, quoique initiée par deux frères, l’un chrétien, l’autre musulman, on y découvre notre héros chevauchant un crocodile ! Atteint de collectionnite aigüe, il a rassemblé une formidable panoplie d’objets rituels, d’armes, de masques… Conscient de la dimension sacrée qu’ils véhiculent, il est avant tout sensible à leur beauté et présente avec affection l’histoire de chaque objet sur Twitter où il sévit 24 h/24 h. Quand on dit qu’Emmanuel Pierrat est atypique, c’est un euphémisme…

Agrandissement : Illustration 2

Emmanuel Pierrat, en pleine cérémonie des masques bobos. Photo inédite.
Indifférence religieuse ou athéisme militant ? Penser l’irréligion aujourd’hui.
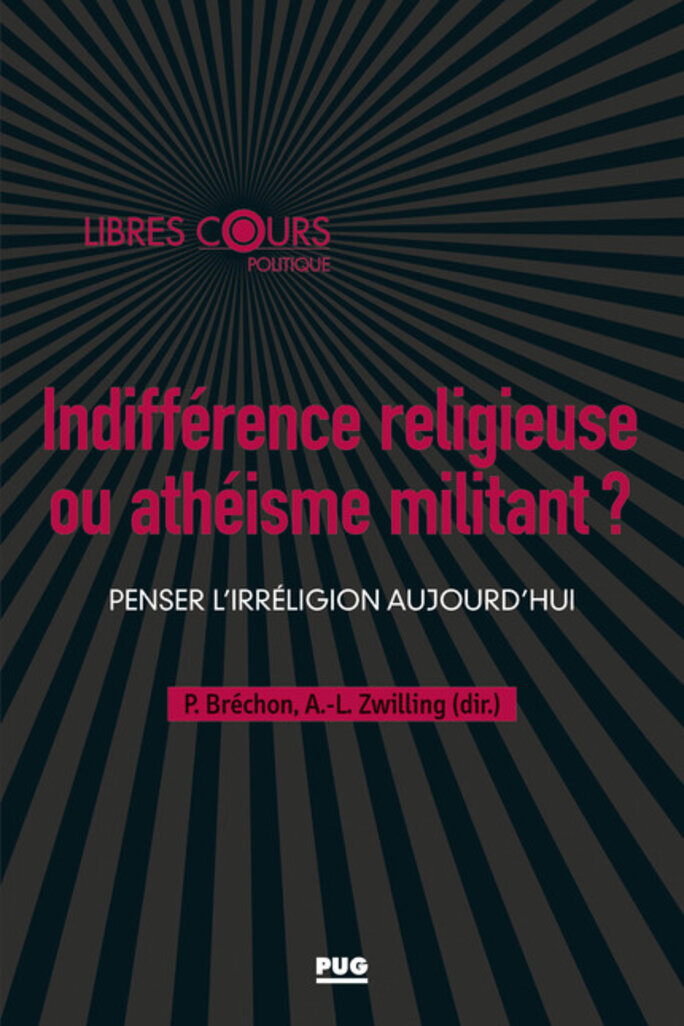
Agrandissement : Illustration 3
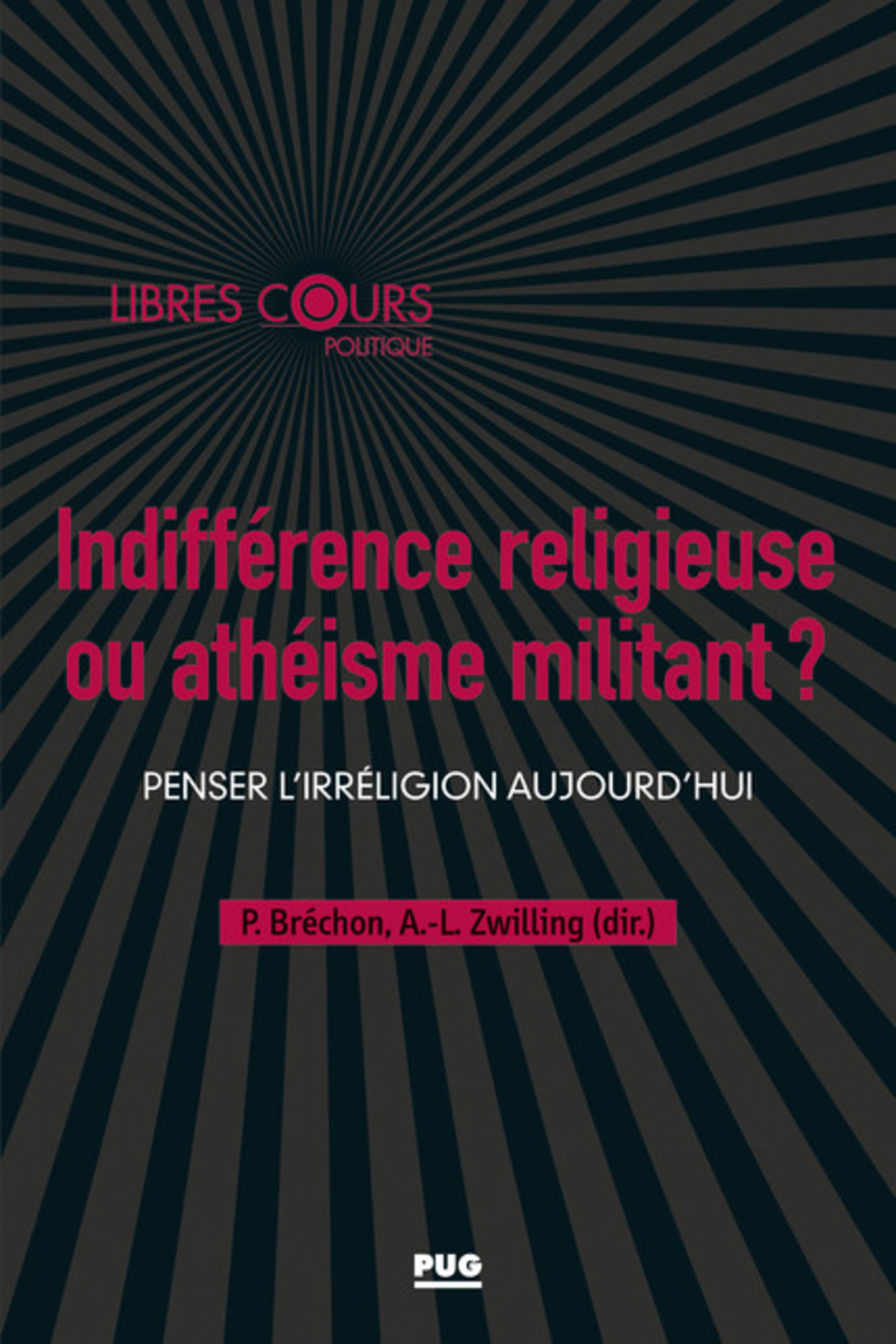
Cet ouvrage collectif est paru aux Presses Universitaire de Grenoble. Il est coordonné par Pierre Bréchon, professeur émérite de science politique à Sciences po Grenoble, et Anne-Laure Zwilling, ingénieure de recherche au CNRS. Précisons d’emblée que ce travail précis et méthodique est dépourvu du jargon qui encombre parfois les publications de ce type. C’est la clarté qui caractérise les dix contributions et la conclusion. Les sources classiques de l’athéisme (Xénophane, Périclès, Démocrite, Epicure, Protagoras…) sont replacées dans le contexte antique. Sa formulation moderne au XVIII° siècle est rappelée (Holbach, Helvétius, Diderot…). Jean Baubérot reprend sa thèse des trois seuils de laïcisation, de la Révolution aux années soixante en passant par la III° République. L’analyse des données, en 1990 puis en 2008, des « European Values Studies » confirme la baisse vertigineuse des croyances et des pratiques. Moins connue, l’indifférence religieuse aux Etats-Unis est inventoriée : plus de 20 % de la population ! En incluant les athées (3 %) et les agnostiques (4 %).
Dans la population française, on peut identifier environ 20 % d’athées assumés, 40 % de non religieux (agnostiques, indifférents…) et 40 % de croyants. Point particulier : les scientifiques français sont nombreux à revendiquer leur « identité athée » (50 %). Par ailleurs, les résultats d’une enquête internationale (en France avec Sébastian Roché dans les Bouches-du-Rhône) exposent la corrélation négative entre l’attachement à la religion et l’attachement à la nation. Deux « super identités ». Plus on est croyant, moins on se réfère à la nation. Selon cette enquête, le fait est prouvé chez les jeunes musulmans et leur « patrie céleste » et, à l’inverse, chez les jeunes irréligieux et leur « patrie terrestre ». La position socio-économique pouvant expliquer cette distance. Contrairement à une idée reçue, les milieux catholiques les plus fervents se réfèrent moins à leur « sentiment national » que les milieux catholiques modérés ou les milieux irréligieux.
La Fédération Humaniste Européenne est présentée par Bérangère Massignon comme porteuse d’un athéisme organisé et militant. Fondée en 1952, la FHE rassemble 125 organisations (dont la Ligue de l’enseignement) dans 47 pays d’Europe. Le « marquage à la calotte » contre les diverses menées cléricales au sein des institutions européennes est décrit avec précision. Il s’agit d’un activisme laïque plutôt que athée. Bien sûr on ne réduit pas les nombreuses activités culturelles humanistes des organisations de la FHE à cet aspect. Le recours aux écoles laïques françaises implantées en Tunisie et l’enseignement universitaire de l’athéisme en Allemagne de l’Est jusqu’en 1990 font l’objet de deux contributions.
Dans la conclusion, Philippe Portier, titulaire de la chaire « Histoire et sociologie des laïcités » à l’EPHE, use du terme neutre « areligion » plutôt que « irréligion », plus offensif. Les indifférents et même la plupart des athées n’étant pas engagés dans un combat contre les religions en tant que telles, ni même contre leur influence. Le militantisme athée est périphérique mais le caractère massif de cette areligion est souligné. En conséquence les sociologues ne peuvent plus inventorier et réfléchir en termes d’absence ou d’abandon de pratiques et de croyances. Mais en termes de « contenu » de cette areligion. Celle-ci est croissante dans les jeunes générations. Elle sera majoritaire en Europe autour de 2050 si on prolonge les courbes statistiques. Philippe Portier note son « épaisseur » culturelle. Quoique non formelle, elle mérite d’être reconnue comme une conception du monde, de la nature et de la société à part entière et non comme un manque. L’Humanisme dans toute sa diversité…
« Indifférence religieuse ou athéisme militant ? Penser l’irréligion aujourd’hui » Sous la direction de Pierre Bréchon et Anne-Laure Zwilling. Presses Universitaires de Grenoble. 190 pages 25 €
L'athéisme militant existe bel et bien aux USA. Ronald Prescott Reagan, dit Ron Reagan, fils de l'ancien président, est membre de la Freedom from religion foundation FFRF composée d'athées et d'agnostiques qui appellent à la séparation des Eglises et de l'Etat.
Adogma, revue de réflexions libres-penseuses
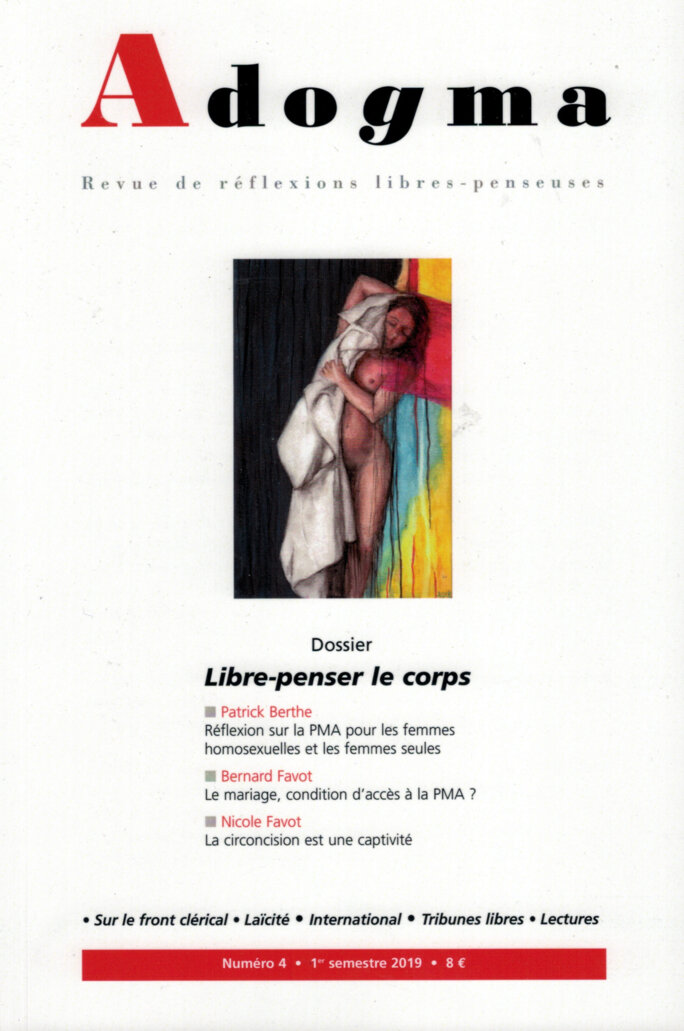
Agrandissement : Illustration 5

Le titre de la revue « Adogma » ne laisse aucun doute sur ses objectifs. Elle est publiée par l’Association des libres penseurs de France (ADLPF). Le directeur de la publication, Thierry Mesny, est président de l’ADLPF. Elle a été fondée par Roland Bosdeveix, par ailleurs actuel Grand Maître de la Grande Loge Mixte Universelle. Les numéros 4 et 5 de « Adogma » ont un format et une maquette renouvelée. Positions classiques des mouvements de libres penseurs, la défense laïque côtoie la critique radicale des religions.
Le N° 4 de Adogma propose ainsi un texte de Gilles Poulet « « L’athéisme questionné, l’athéisme questionnant », présenté comme une position personnelle plutôt que comme une doctrine codifiée. Cette tribune libre cohabite avec une autre, de Patrice Decormeille, par ailleurs président du Cercle Condorcet d'Auxerre. Elle est consacrée, si on ose écrire, à un portrait de Paul Bert qui fut en son temps l’incarnation de l’anticléricalisme républicain. Dans le même numéro se trouve un dossier « Sur le front clérical ». On ne saurait être plus clair. Eddy Khaldi, par ailleurs président des DDEN, décrit la politique de l’Eglise catholique visant à instrumentaliser la laïcité. Nicole Favot met en perspective l’Eglise protestante évangélique avec cette même Eglise catholique Avec un article au titre en forme de pronostic « Une gagnante, une perdante…et peut-être une arbitre ». L’arbitre espérée étant la laïcité. La même auteure analyse les conséquences de la scolarisation obligatoire dès trois ans. Deuxième dossier, faisant la Une de la revue : « Libre-penser le corps ». Joli titre qui chapeaute deux réflexions favorables à la PMA pour toutes et un article sur un sujet peu traité, la circoncision comme atteinte à la liberté de conscience. Nouvelles contributions à un combat mené par le mouvement laïque dès avant les lois des années 60 et 70 sur les droits sexuels et reproductifs.
Le N° 5 de Adogma est organisé autour du dossier central « Politique et religion : l’éternel recul ». Gérard Bouchet est président de l’Observatoire de la Laïcité Drôme-Ardèche, auteur de « Laïcité : textes majeurs pour un débat d’actualité » (Armand Colin) et de « La laïcité en question(s) » (Editions L’Harmattan. Collection Débats laïques). Redoutable collecteur et commentateur de textes, il passe au crible les discours d’Emmanuel Macron, d’une part, et les déclarations officielles de l’Eglise catholique, d’autre part. Charles Arambourou, responsable de la commission laïcité de l’UFAL, décrypte le « projet bonapartiste et gallican » d’organisation officielle d’un « islam de France ». Eddy Khaldi planche sur l’ambition émancipatrice de l’école publique. Et Gérard Vignaud repose la question décisive : « Et nous alors ? » en se réclamant des non religieux et des athées de France…
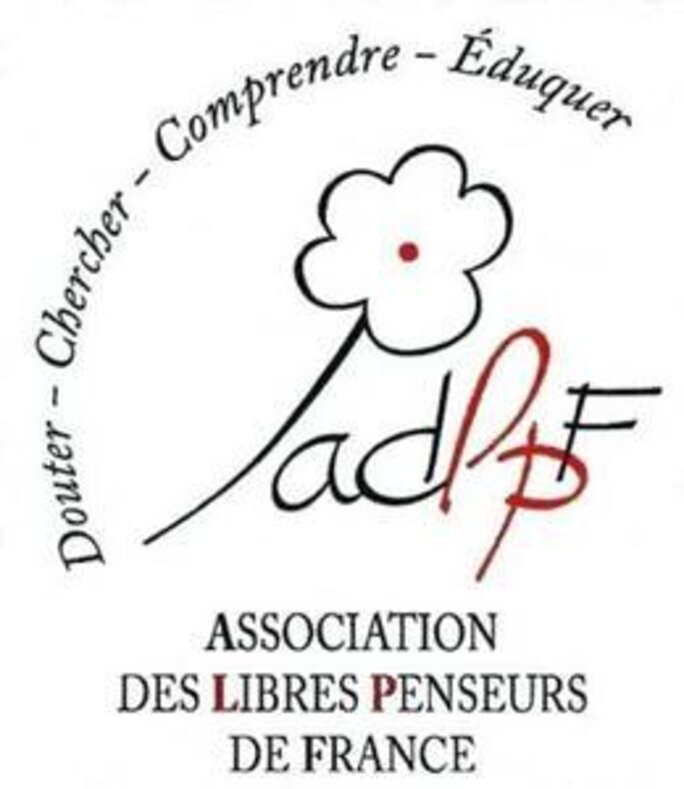
_______________________________________________________________________________________
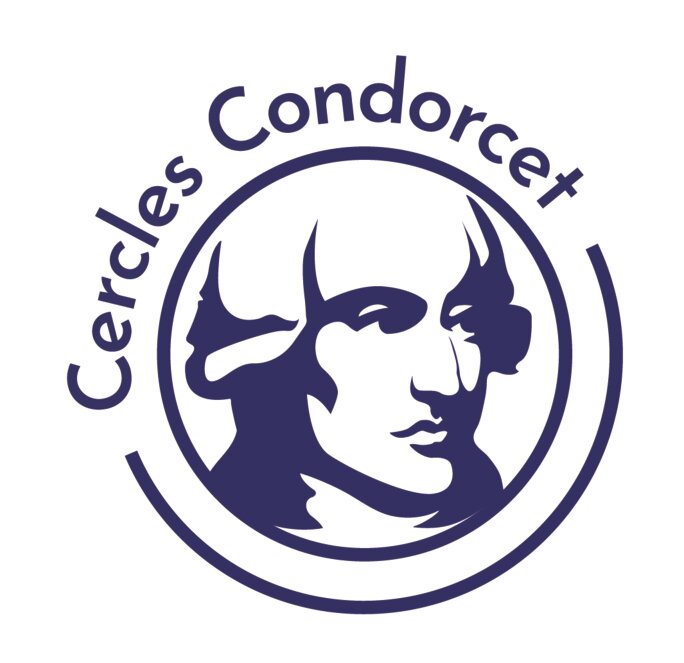
Agrandissement : Illustration 7

Les Cercles Condorcet accompagnent la vie intellectuelle et militante des fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire laïque, mouvement d'idées. Une cinquante de Cercles rassemblent environ 2.000 personnes.
Ils animent une édition sur Médiapart Ne manquez pas de la consulter !



