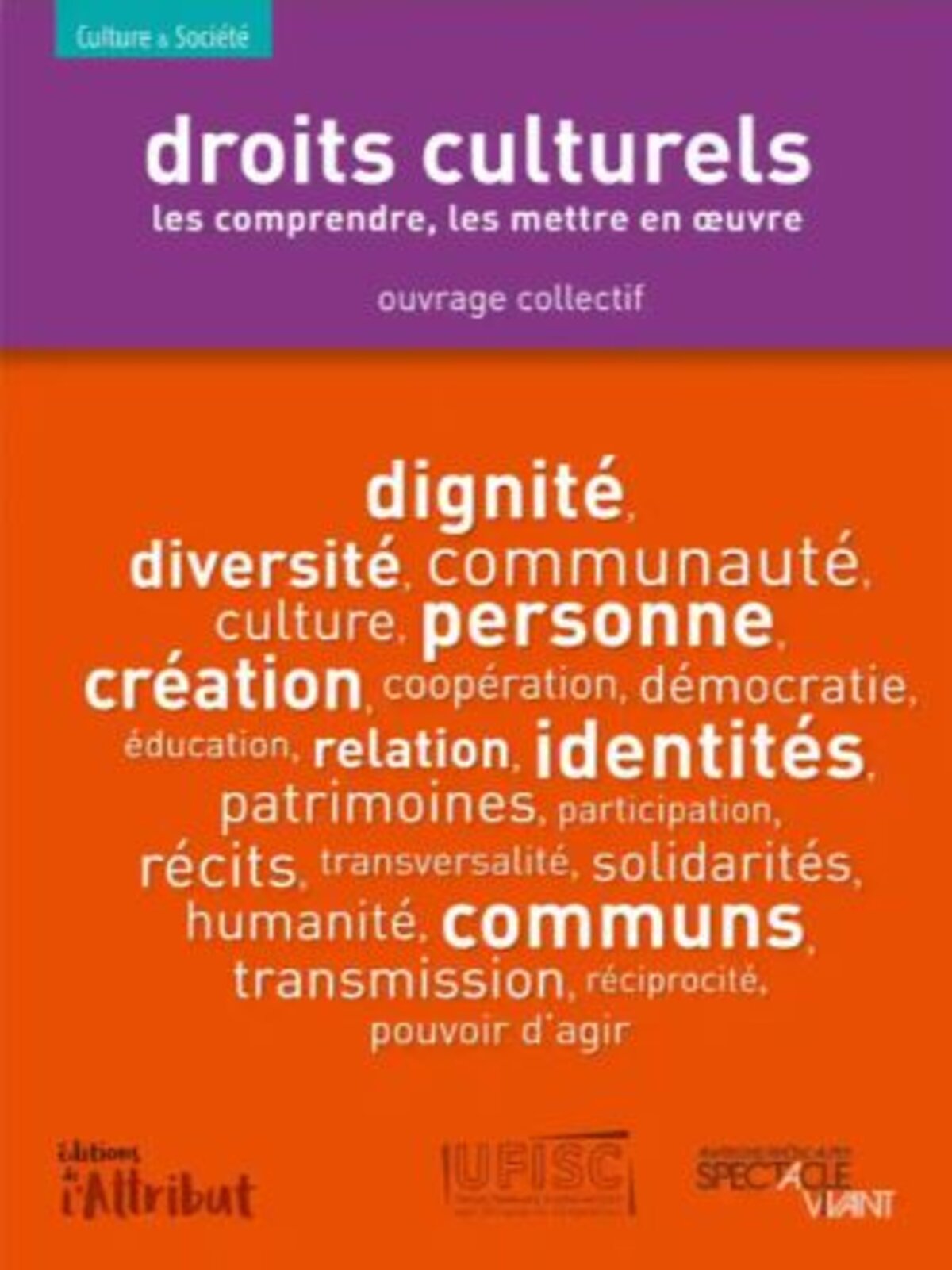
« Droits culturels. Les comprendre, les mettre en œuvre » : tel est le titre de cet ouvrage récemment paru aux Editions de l’Attribut. Cette publication est coéditée avec l’UFISC (Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles) et Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant. Rédigé par une bonne vingtaine de spécialistes, ce recueil de contributions ne s’adresse pas qu’à leurs collègues « cultureux ». En effet ces droits sont ceux de chaque citoyenne et citoyen. Leur prise en compte, parfois laborieuse, par les collectivités locales et les institutions nationales nous concerne toutes et tous.
Droits culturels. Les comprendre.

Contrairement aux droits politiques ou sociaux, les droits culturels sont parfois mal identifiés. Ils sont pourtant sollicités chaque jour dans une société démocratique. Droit à l’éducation, à la participation à la vie culturelle, liberté de création et d’expression, liberté de conscience en matière philosophique et religieuse… Cette dernière liberté étant assurée par la laïcité de la République. L’ouvrage « Les droits culturels » se compose de deux grandes parties évoquées dans le sous-titre « Les comprendre. Les mettre en œuvre ». Dans la première partie, les textes internationaux sont scrutés et discutés. On peut s’aventurer à résumer l’idée centrale qui parcourt l’ensemble des contributions : les droits culturels ne nourrissent pas un relativisme pour lequel tout se vaudrait. Ils expriment de façon concrète des modes de vie et de développement d’une infinie diversité. Les droits culturels ne sont pas un luxe dont il faudrait s’occuper une fois que les autres droits seraient effectifs. Ils ne sont pas restreints au champ des arts et à l’accès aux ressources culturelles. Ils relèvent de l’anthropologie : c’est la personne et ses liens sociaux qui en sont les possesseurs et les acteurs.
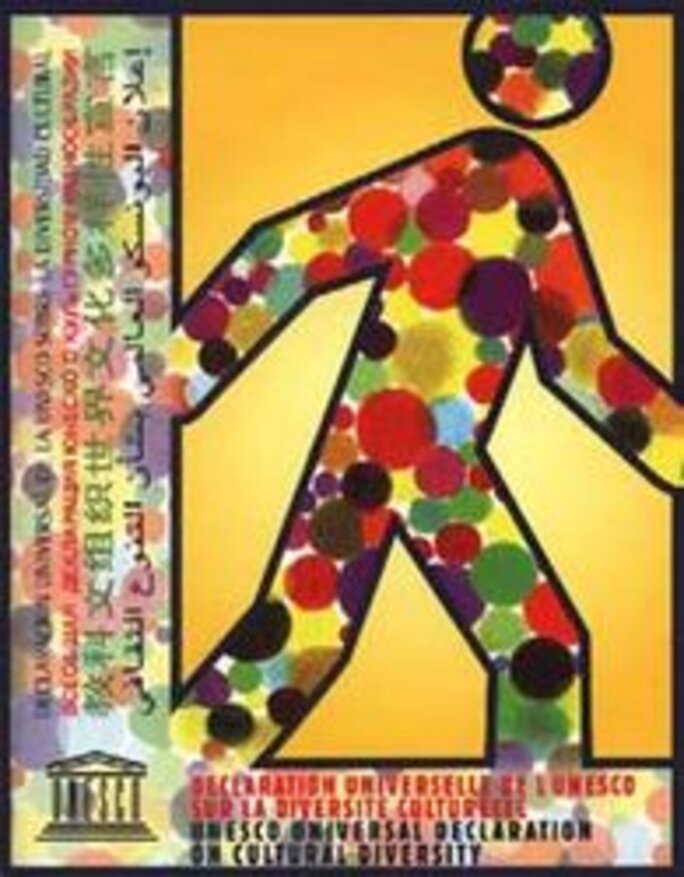
En ce sens, les droits culturels sont sollicités comme « boussole » et même comme « nouveau paradigme pour l’action »… La « dignité y est la notion centrale ». Ils sont « une antidote contre les communautarismes ». En conséquence : « nous sommes tous artistes », « co-auteurs d’une œuvre commune »… Précision décisive, « les droits culturels sont enchâssés dans les droits humains ». On se permettra ici une contribution en évoquant un passage non mentionné de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 de l’Unesco : « Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée ».
Droits culturels. Les mettre en oeuvre.

Agrandissement : Illustration 4

La deuxième partie de l’ouvrage s’interroge sur la façon de mettre en œuvre les droits culturels. Ceux font expressément partie du droit français avec la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) de 2015 et la loi Liberté de Création Architecture Patrimoine de 2016. L’ensemble des articles réunis dans cette partie constituent un tableau foisonnant. Il faut chausser les bottes de sept lieues pour le parcourir, du « Rize » de Villeurbanne, qui rassemble des espaces culturels et pédagogiques, les archives municipales, une médiathèque, un pôle recherche et un café aux portraits de cinq artistes investis sur ce champ, en passant par l’application de la Charte de projet culturel de territoire en Comminges, la Caravane des possibles dans la Loire, les travaux de la Ligue de l’enseignement en Nouvelle-Aquitaine et le rapport et les recommandations qui en sont issues : « Droits culturels des personnes »… jusqu’à la grande aventure de la recherche-action Paideia, développée à partir de 2012 par le Réseau Culture 21 en partenariat avec l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme de l’Université de Fribourg (IIEDH) et son Observatoire de la diversité et des droits culturels…
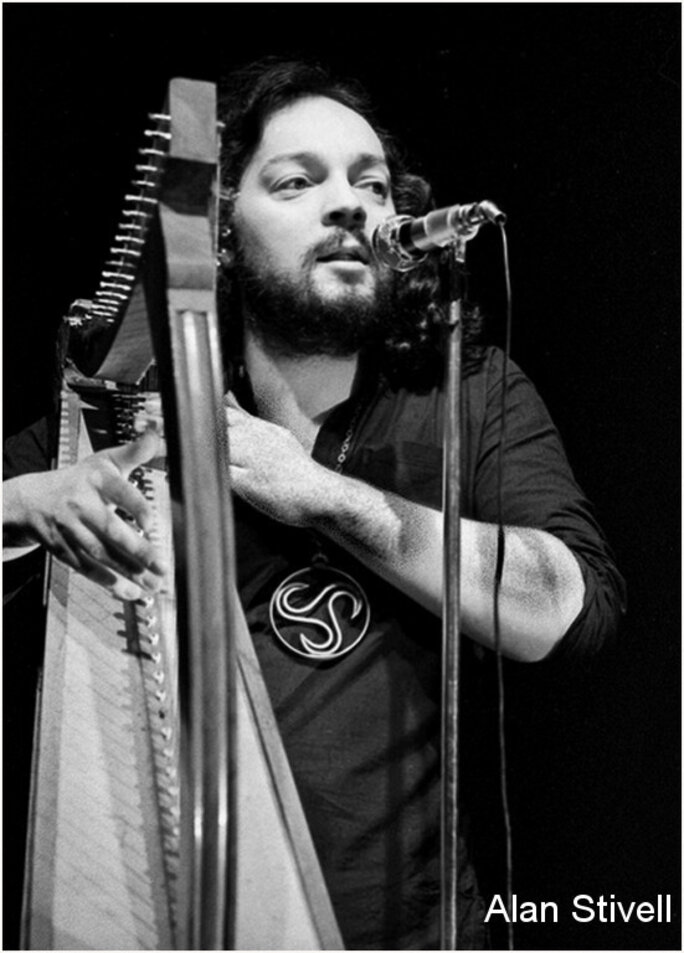
Agrandissement : Illustration 5
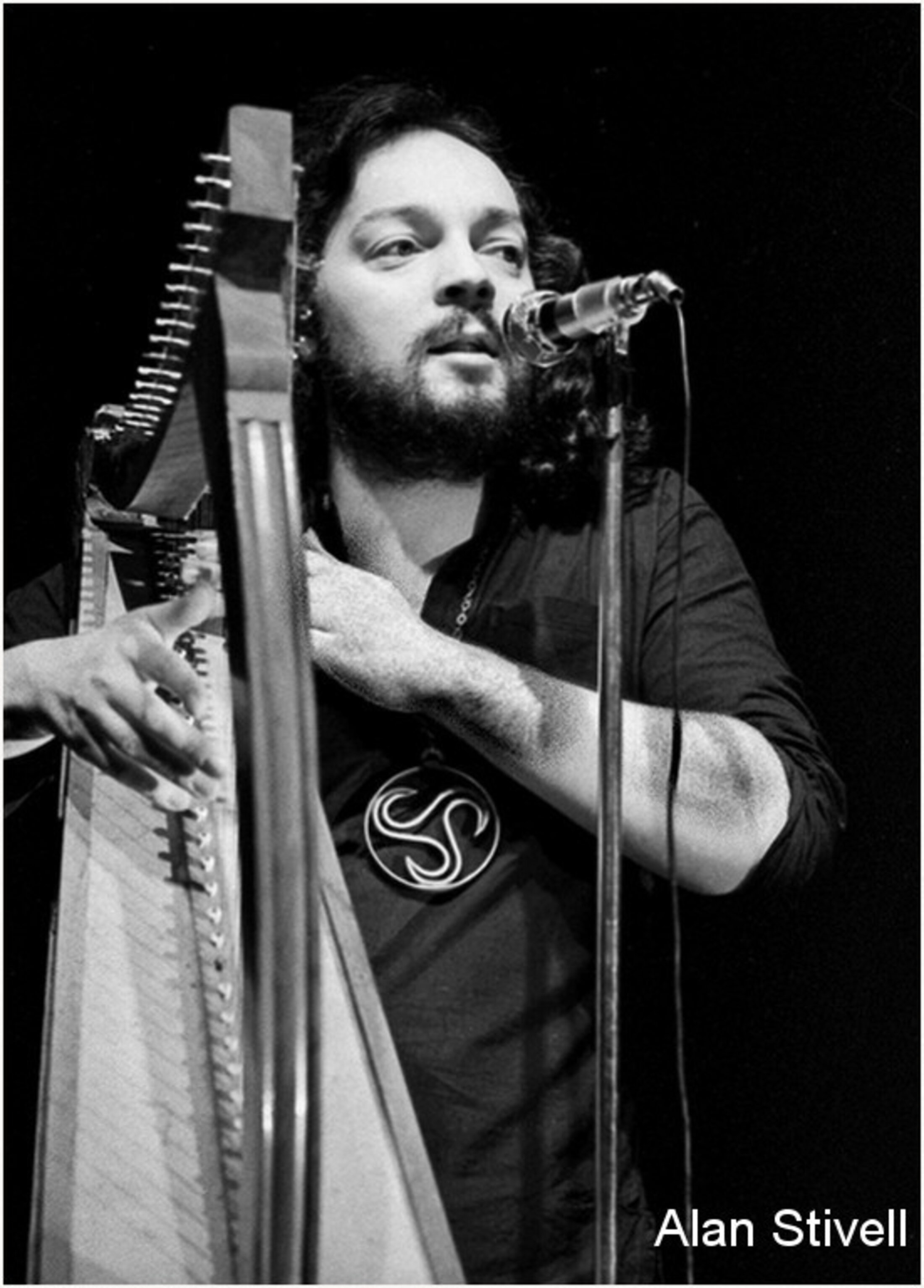
L’inscription de la Fédération des acteurs et Actrices des Musiques et Danses Traditionnelles FAMDT dans les droits culturels constitue un excellent exemple de cette démarche. Créée en 1985, la FAMDT trouve ses origines artistiques et ses modes d’organisation dans le mouvement folk. Elle prend appui sur la Convention de Faro, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société de 2005. Elle opère une sélection dans le patrimoine traditionnel et les associe à des réflexions sociales et politiques. La FAMDT s’investit dans la création avec les rencontres MODAL qui constituent des compagnonnages et vont donner naissance à de nombreuses associations dont les Musiciens Routiniers à Lyon ou Dastum en Bretagne. Attentive aux protest-songs américaines de Joan Baez, Cisco Houston, Woody Guthrie… la FAMDT a la volonté de ne pas se faire « coca-coloniser » pour reprendre l’expression d’un de ces protest singers, Pete Segeer. Porteuse des cultures populaires, elle s’affirme ainsi face à la culture de masse vendue par les producteurs de disques sous l’étiquette « world music » depuis 1987. Des œuvres face à des produits…
Notre dossier sur les droits culturels:
Qu'est-ce que les droits culturels ?
Les droits culturels dans les textes internationaux
Alexandra Xanthaki, rapporteuse de l'ONU pour les droits culturels



