
Agrandissement : Illustration 1

« Je prendrai ma vie comme elle l'a laissée
Avec un sourire en coin, un secret
Afin d'accepter la tendresse
Que j'avais refusée sans cesse
Avec l'impression d'être fort
Le sommeil, c'est presque la mort. »
Bernard Lavilliers, Attention fragile, 1980.
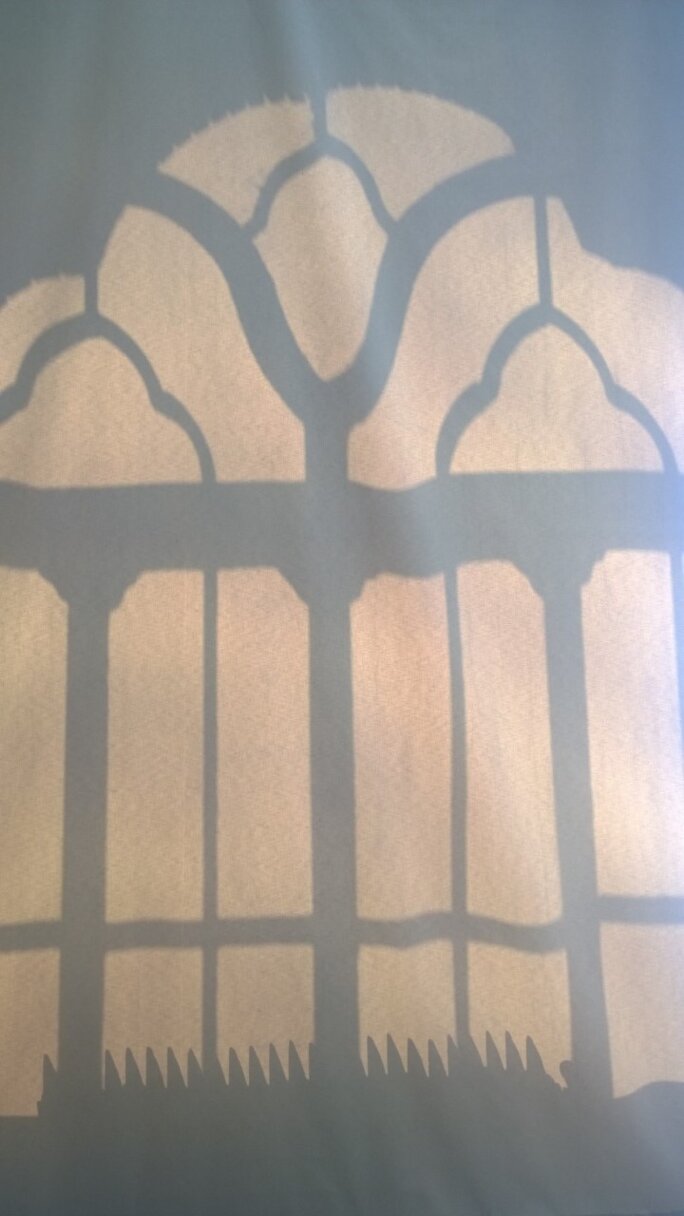
Agrandissement : Illustration 2

*********************************
Ce nouveau livre de la collection « Petite Encyclopédie Critique » des éditions Textuel esquisse un espace spirituel agnostique et démocratique pour répondre aux confusionnismes contemporains, au dessèchement spirituel provoqué par l’argent-roi ainsi qu’aux impasses meurtrières proposées aujourd’hui par les violences fondamentalistes. La spiritualité y est entendue en un sens non nécessairement religieux (mais pas, non plus, antireligieux) comme l’exploration individuelle et collective du sens et des valeurs de l’existence. L’agnosticisme est pris comme une mise entre parenthèses de la question de Dieu ou des dieux. Quelques cailloux noirs et rouges jalonnent mon cheminement, qui se situe dans le sillage d’un livre précédent, La société de verre. Pour une éthique de la fragilité (2002), dont entre autres :

Agrandissement : Illustration 3

* Les chansons, parties prenantes de nos cultures ordinaires, sillonnent souvent les quêtes, les déboires et les lueurs du sens de manière moins arrogante et plus sensible que ceux qui prétendent nous donner « la réponse », que cela soit les « philosophes-rois » d’inspiration platonicienne (du type André Comte-Sponville ou Luc Ferry), les marchands de soupe spirituelle (du type Jacques Atttali ou Frédéric Lenoir) ou le marketing spirituel du « développement personnel ». C’est pourquoi le livre s’arrête sur Barbara, Brassens, Claude François, Anne Sylvestre, France Gall/Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Eddy Mitchell, Alain Souchon, Axelle Red, Vincent Delerm, La Rumeur, Mickey 3D, Keny Arkana, Casey et Louane. Ces promenades chansonnées dans les tourbillonnements existentiels réinscrivent les interrogations philosophiques dans les magnifiques banalités de la vie ordinaire. Ce faisant, elles croisent une définition étrange de la mélancolie donnée en 1765 par le grand livre des Lumières du XVIIIe siècle, l’Encyclopédie sous la direction de Diderot et D’Alembert :
« C’est le sentiment habituel de notre imperfection. »
L’entrée par les chansons nous ramène donc à la vie ordinaire. Ce à quoi nous incitait aussi un des plus grands philosophes du XXe siècle, Ludwig Wittgenstein, nourrissant notre méfiance à l’égard de « la gonflette » (par analogie avec les salles de culturisme) philosophique :
« Pour atteindre à la profondeur, il n’est pas nécessaire de voyager loin ; et même il n’est pas nécessaire de quitter son environnement le plus proche et le plus habituel. » (1946, Remarques mêlées)
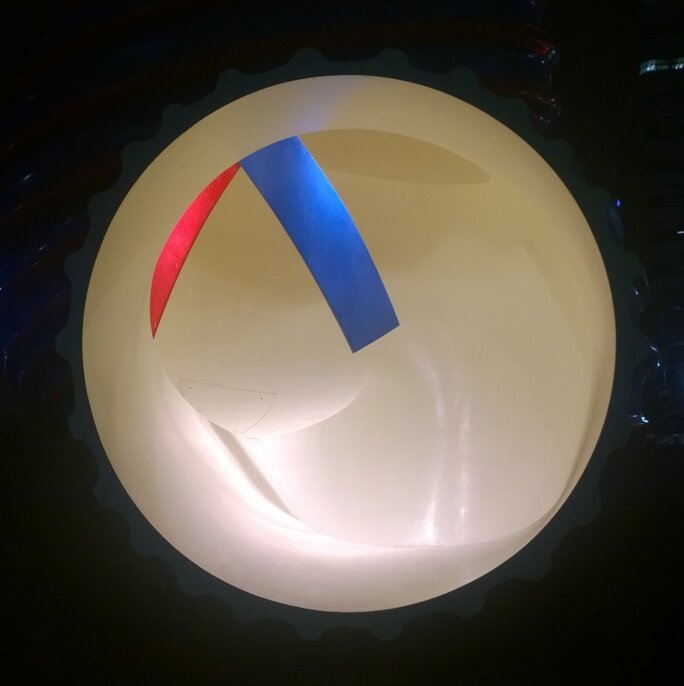
Agrandissement : Illustration 4
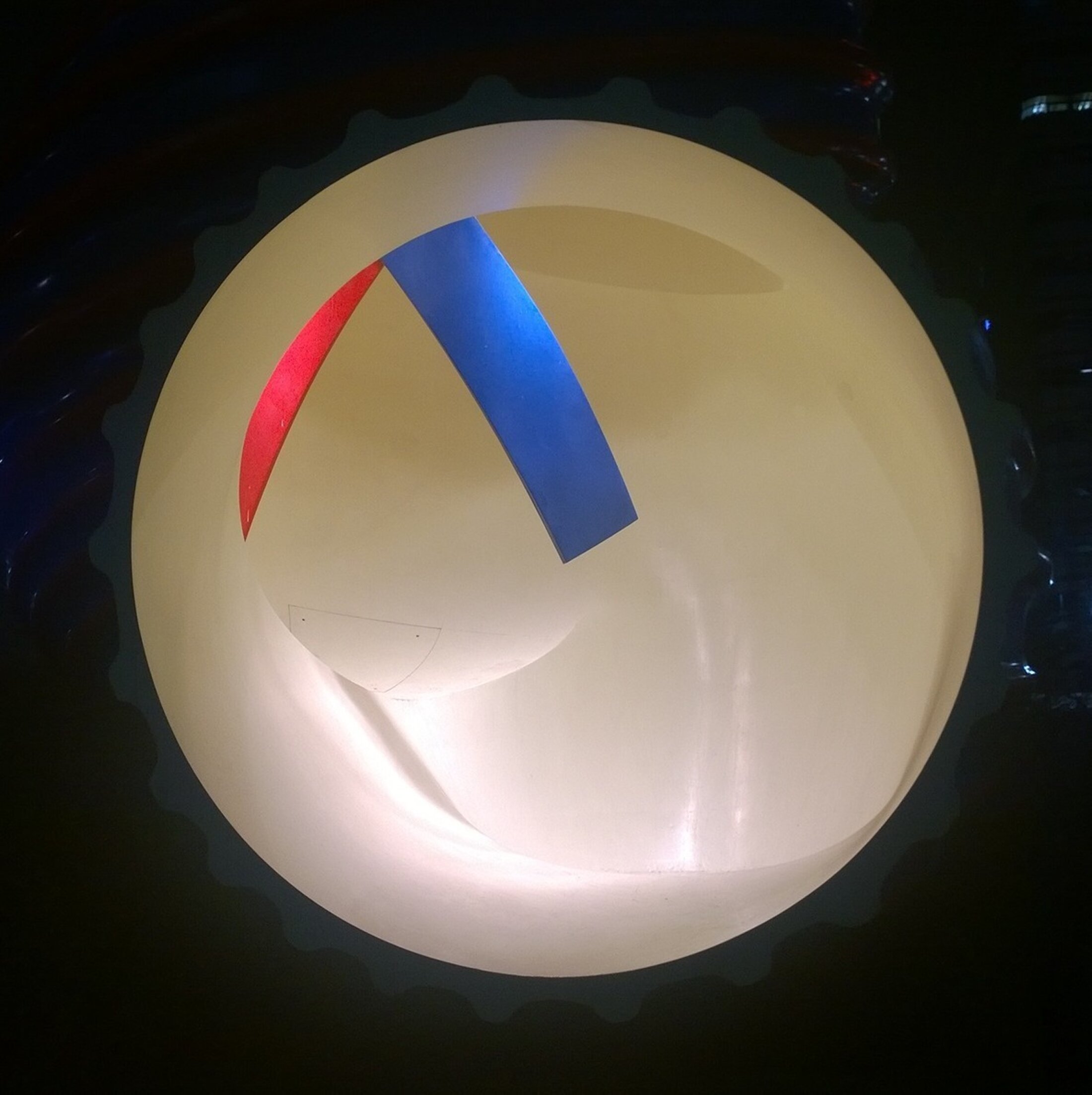
* En quoi les sentiers spirituels proposés peuvent être qualifiés de démocratiques ? Si l’intellectuel de métier que je suis veut prendre au sérieux le double horizon idéal, à la fois démocratique et libertaire, d’autogouvernement de soi et d’autogouvernement des collectivités humaines, il ne peut pas proposer des solutions que les autres n’auraient plus qu’à adopter. Il peut tout au plus fournir un appui méthodologique dans la formulation des questions et des problèmes. Il s’agit modestement de mettre à disposition des outillages susceptibles d’aider des individus et des groupes – ceux qui souhaitent s’en saisir – à bâtir leurs propres réponses. Cela désappointera ceux qui sont en quête de réponses simples, rassurantes et définitives, passant par de prétendus « penseurs providentiels ».

Agrandissement : Illustration 5

* Le spirituel a fréquemment été défini dans son opposition au corporel. C’est particulièrement le cas dans les théologies chrétiennes traditionnelles où le corps a souvent été considéré comme « impur », voire « sale », vis-à-vis d’une âme plus « élevée » car associée au divin. Á l’inverse, on a aujourd’hui des ressources pour tisser de nouvelles alliances entre la quête de sens et nos sens, comme :
- Dans son ouvrage La phénoménologie de la perception (1945), le philosophe Maurice Merleau-Ponty a réinséré le spirituel dans le corporel, en faisant plus largement de l’interrogation réflexive une composante seconde, liée au corps et pourtant autonome, de la condition humaine.
- Le philosophe Emmanuel Levinas, au carrefour de la phénoménologie et du judaïsme, a bâti une éthique du visage arrimée au corps en me liant intersubjectivement à autrui. Elle vient d’abord des tripes, pas des idées et des principes, quand je suis face à un SDF dans le métro, à proximité des pleurs d’un enfant dans la rue, devant un visage mélancolique dans le train... Elle est à proprement parler corporéifiée.
- Une voie a été explorée par des recherches féministes en psychologie, en sciences sociales et en philosophie, en premier lieu aux États-Unis à partir des années 1980, pour s’émanciper de la dichotomie raison/sentiments imposée par la domination masculine au détriment des femmes localisées dans le seul domaine des sentiments : le care (ou souci des autres).

Agrandissement : Illustration 6

* Nous sommes nombreux à avoir été tétanisés face aux tragédies de janvier et de novembre 2015. Pourtant des réponses proprement spirituelles n’apparaissent pas clairement du côté des milieux athées, agnostiques et croyants attachés à des valeurs humanistes, émancipatrices et progressistes. C’est à partir de ce manque que je propose une éthique de la fragilité, une éthique qui assume nos fragilités humanistes et démocratiques, en abandonnant les rêves mortifères de pureté. On me rétorquera : les fragilités humaines peuvent-elles casser les briques de l’absolu ? N’ont-elles pas perdu d’avance leur pari spirituel devant la force potentielle des promesses d’au-delà ? Pas nécessairement. L’ancrage dans la vie ordinaire, ses aléas et ses repères, ses joies et ses mélancolies, ses fidélités et ses ruptures, ses habitudes et ses ouvertures, ses familiarités et ses moments inédits, ses vulnérabilités singulières et ses puissances coopératives, ses états de solitude et ses plaisirs mis en commun… a aussi sa grandeur propre. Il suffit peut-être d’oser l’envisager comme un cheminement spirituel alternatif. Ou du moins d’essayer, ce qui est rarement fait. « Attention fragile » chante Bernard Lavilliers, en liant la redécouverte de sa propre fragilité à celle de la tendresse contre le virilisme de la force propre aux conceptions encore dominantes de la masculinité dans nos sociétés. « Quand je titube au petit jour », ajoute-t-il…
***********************************
Sommaire de Pour une spiritualité sans dieux
(Paris, Éditions Textuel, collection « Petite encyclopédie critique », 96 pages, 13 avril 2016)
Introduction
Des chansonnettes du sens à l’intello-plombier
1. Flâneries chansonnantes dans la quête spirituelle : de Barbara à Louane
Mélancoliques pertes de sens
Le sens et l’ailleurs
Entre le global et l’instant d’éternité
Rap(t) du sens et poids du social
Et si on assumait (spirituellement) nos fragilités ?
2. Un sentier agnostique et méthodologique pour une spiritualité démocratique
Du démocratique au méthodologique
De l’agnostique au démocratique
Une spiritualité ni religieuse, ni antireligieuse, de tolérance et de dialogue laïcs
Plan de l’ouvrage
Partie I
De la malbouffe dans les fast-foods de l’âme aux ballades de Souchon
1. Sur les gourous du sens unique : l’exemple de Comte-Sponville
Un athéisme de l’absolu ?
La gonflette philosophique au service de LA solution
2. Notes légères pour un problème lourd : la spiritualité avec Souchon
Foule sentimentale (1993)
De Et si en plus y’a personne (2005) à…Woody Allen
Partie II
Un espace de questionnements pour une spiritualité sans dieux
1. Ni absolus, ni nihilisme
Des « colonnes absentes » pour nous soutenir ?
Méthodologie des transcendances relatives
2. Lumières tamisées contre Lumières aveuglantes : les trous de mémoire d’Élisabeth Badinter
Le manichéisme d’Élisabeth Badinter
Parts d’ombre des Lumières
Des Lumières tamisées au secours des Lumières
3. Un spirituel renoué au corporel
L’interrogation spirituelle comme une des possibilités de mon être-corps avec Merleau-Ponty
Une éthique intersubjective et corporéifiée avec Levinas
Le care ou les accroches féministes de la raison et du sentiment
4. Retrouver des repères temporels entre présent, passé et avenir
Crise de l’avenir, futurisme, présentisme, nostalgisme
Une nouvelle alliance du présent, du passé et de l’avenir avec Benjamin et Bensaïd
Partie III
Des pistes pour une spiritualité contemporaine
1. Individus et relations sociales (1) : Se fabriquer ses propres réponses spirituelles en puisant dans des repères communs
Les fils collectifs de l’habitus individuel chez Bourdieu
Le perfectionnisme américain entre le commun et le je
La politique entre pluralité humaine et espace commun chez Arendt
2. Individus et relations sociales (2) : Moments de solitude et liens sociaux
Relations sociales et solipsisme chez Merleau-Ponty
Société et solitude : en partant d’Emerson
3. La construction de soi (1) : Se créer soi-même plutôt qu’être soi-même
L’enfermement nostalgique dans l’authenticité perdue
Taper son propre tempo avec Casey
4. La construction de soi (2) : Bricolage de soi et transformation du monde
Vers un bricolage de soi
Doit-on transformer le monde pour se transformer soi-même ?
Conclusion
Éthiques de la fragilité face aux kalachnikovs des âmes tourmentées
L’enjeu spirituel au défi du tragique
La force des fragilités partagées
Une boussole éthique ni nihiliste, ni moralisatrice

Agrandissement : Illustration 8

*********************************
Philippe Corcuff est maître de conférences HDR en science politique à l’Institut d’Études Politiques de Lyon et membre du laboratoire de sociologie CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux, UMR 8070 du CNRS, Université Paris Descartes et Université Sorbonne Nouvelle). Co-fondateur de l’Université Populaire de Lyon et de l’Université Critique et Citoyenne de Nîmes, il a été chroniqueur de Charlie Hebdo d’avril 2001 à décembre 2004. Il est aussi membre du conseil scientifique de l’association altermondialiste ATTAC et de la Fédération Anarchiste. Il a notamment publié : La société de verre. Pour une éthique de la fragilité (Armand Colin, 2002), Bourdieu autrement (Textuel, 2003), Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des savoirs (La Découverte, 2012), Marx XXIe siècle. Textes commentés (Textuel, 2012), La gauche est-elle en état de mort cérébrale ? (Textuel, 2012), Polars, philosophie et critique sociale (avec des dessins de Charb, Textuel, 2013), Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard (Textuel, 2014), Mes années Charlie et après ? (avec des dessins de Charb, Textuel, 2015) et Enjeux libertaires pour le XXIe siècle par un anarchiste néophyte (Editions du Monde Libertaire, 2015). Voir aussi son blog sur Mediapart : Quand l’hippopotame s’emmêle...



