
Agrandissement : Illustration 1

Originaire du Liban, Dima Abdallah arrive en France à l’âge de douze ans en 1989, la tête et le cœur emplis des senteurs, bruits de la rue et couleurs du pays du cèdre. Son père poète et sa mère romancière lui ont déjà transmis le goût des mots et sans doute aussi inoculé cette méfiance vis-à-vis des groupes, des places définies d’autorité pour chacun (Liban ultra-communautaire et stigmates de la guerre civile obligent) qui ne la quitteront plus et ne cesseront d’influencer son regard si singulier sur le monde, sur la société française, sur les marginaux, les inadaptés qui ne trouvent pas leur place.
Repérée par Sabine Wespieser, l’Oeil de l’édition indépendante tricolore (la maison ne publie qu’une dizaine d’ouvrages de fiction par an, ce qui lui permet de faire des paris audacieux sur les auteurs qu’elle estime bien partis pour bâtir une œuvre forte et atypique), Dima Abdallah secoue en 2020 le monde littéraire et séduit les lecteurs avec son premier roman, ‘Mauvaises Herbes’, un texte écrit d’une traite et qui n’avait pourtant pas vocation à être publié.
La délicatesse poétique de sa plume, son regard bienveillant et fin sur ses personnages en rupture de ban, se confondant tel un lierre ou un rosier grimpant et obstiné sur un mur froid réputé imprenable avec ses analyses au laser des mécanismes du rejet et de la tentation du vide, donnent un ton et une force uniques à son travail qui n’a de cesse de mettre à nu les multiples strates qui nous composent, nous les équilibristes perpétuels. Lire un roman de Dima Abdallah (ancienne étudiante en archéologie, ça ne s’invente pas) est la garantie de se prendre un vent d’humanisme, une dose d’universel et de complexité dans la face, autant de valeurs de plus en plus boudées par l’époque, simplificatrice et belliqueuse jusqu’au grotesque. À peine refermé le dernier livre, encore envouté par les effluves de jasmin et de terre sèche qui s’en dégagent (parfums obstinés du temps évadé), le lecteur se prend à espérer la publication rapide du suivant tant cette plume subtile, mélancolique comme les yeux de l’écrivaine mais, féroce aussi par sa lucidité permanente, a des vertus médicinales secrètes sur les âmes blasées par le temps.
Étude d’une œuvre en construction, aussi douce que déchirante, poétique mais implacable, aussi limpide qu’inexorablement attirée par les cœurs confus, aussi indifférente aux frontières actuelles qu’attachée à celles à jamais perdues de l’enfance.
- «Mauvaises herbes», de Dima Abdallah. Bouquet d’épines. Le Liban en plein cœur

Agrandissement : Illustration 2

« Il ne me parle plus de marjolaine, de sauge et d’amandiers en fleurs. Il ne cherche plus à se souvenir parce que la place occupée par les mauvais souvenirs devient beaucoup trop grande par rapport à celle occupée par les potagers et les jasmins. La mémoire fait bien son travail et, dans ces conditions, elle privilégie l’oubli. Il ne rêve plus de maison. Pas même d’un mur ou deux pour y faire grimper une vigne. Il ne rêve plus d’un bout de terre, de thym, de vignes et de rosiers. Peut-être que le sentiment d’être de nulle part reste à tout jamais. Peut-être qu’à force, de nomade, on devient déraciné. La guerre est finie depuis longtemps et sa maison continue à ne pas être sa maison. Peut-être que le calme après la tempête, c’est le pire, qu’on ne déménage plus assez souvent pour pouvoir laisser les cauchemars coincés dans les murs qu’on a quittés. C’est le temps de se rendre compte que le temps va nous manquer pour trier les tonnes de grains de riz et pour replanter. La terre a été tellement souillée qu’aucune patrie ne pourra plus jamais y repousser. »
Comment aborder ce premier roman de Dima Abdallah publié chez Sabine Wespieser, premier roman mais aussi chef-d’œuvre de la rentrée littéraire ? Faut-il se plonger dans les méandres de la guerre civile libanaise (1975-1990, environ 200.000 victimes), se familiariser avec les milices armées autonomes, les fedayins palestiniens, les phalanges libanaises, la politique israélienne après la guerre des six jours ? Faut-il remonter au général Gouraud, brandir le nom de Gemayel, entendre les aspirations de la France à être la protectrice des Chrétiens d’Orient, embrasser l’histoire de la Syrie, décrypter le jeu des grandes puissances puis les intérêts des multiples confessions qui forment et donnent souffle (un souffle bien irrégulier, certes) à ce pays singulier du Cèdre ?
S’y plongera qui aura le temps et la saine curiosité, alors que l’actualité braque à nouveau tristement ses projecteurs sur le pays en plein chaos (voir d’ailleurs aussi la tribune de l’auteure dans Le Monde : « Ne t’endors pas, Beyrouth ! ») mais ‘Mauvaises Herbes’ ne nécessite pas un doctorat en Histoire ni des connaissances ultra-pointues en géopolitique, spécialité zones à risques. Des notions de botanique, éventuellement. Des connaissances en jardin des âmes (tout bon lecteur en a. Tout vivant, même s’il l’ignore et ne sait pas les cultiver).
Car ‘Mauvaises Herbes’, plutôt que de se pencher sur les sanglantes vendettas communautaires, sur les féroces jeux de pouvoir et de corruption dissimulés derrière la religion au sein de l’ancienne ‘Suisse du Moyen-Orient’, tord d’emblée les tripes en invoquant l’univers de l’enfance, aspire fissa dans son univers introspectif à peine la narratrice, petite-fille introvertie, s’est-elle saisie et accrochée à l’auriculaire de son géant, de son poète de père par elle déifié, dans les rues ravagées de Beyrouth.
Les bombes peuvent bien déchiqueter les entrailles de la cité, elle ne risque rien, la petite-fille qui s’évade enfin de l’école-prison, agrippée au doigt protecteur et rassurant (« Il ne sait pas, lui. Il ne sait pas ce qu’on me demande de faire et d’être. Il ne sait pas comme j’ai mal au ventre le matin dès que j’ouvre les yeux. Il ne sait pas que mes mains restent moites toute la journée »). Jamais quelques millimètres de peaux en contact n’auront signifié autant, révélé sans dire.
Car ‘Mauvaises Herbes’ est un livre sur la tendresse, la tendresse unissant un père et sa fille une vie durant, sous des formes différentes mais entremêlées dans leurs nuances à jamais, telles des racines indestructibles. ‘Mauvaises Herbes’ est un livre universel sur la cruauté, la cruauté du monde en général (plus que de la guerre civile en particulier). ‘Mauvaises Herbes’ est un premier roman, résultat d’une vie de mots retenus, ‘Mauvaises Herbes’ est un chef-d’œuvre dont toutes les phrases fouettent le cœur du lecteur même si celui-ci ignore jusqu’à la localisation du Liban sur une carte.
Lui déchirent des lambeaux d’une chair qu’il croyait cicatrisée. Lui imposent des affleurements douloureux, la résurgence de strates camouflées, lui balancent des bouquets d’épines en pleine face avec une délicatesse et une simplicité apparentes d’autant plus brûlantes, entre deux visites sur un balcon surchargé de plantes en pots, que son histoire personnelle à lui, lecteur, ou son lieu de naissance n’ont rien à voir avec ceux de la narratrice.

« J’avale et je fais redescendre la boule dans ma gorge jusqu’au plus profond de mon ventre. Je repense à une telle qui se serait moquée de mon physique, de mes vêtements ou de je ne sais quoi encore, à un tel qui m’aurait bousculée ou frappée, et j’avale. Je repense aux interminables récréations et je les efface une par une. Je me revois là, dans la cour, contre le mur, à regarder de loin les autres jouer et hurler. Je me revois penser que je ne suis pas normale, que ce n’est pas eux, le problème, mais moi. C’est comme ça, ce n’est peut-être de la faute à personne après tout et la seule chose à faire est d’oublier. Vu qu’ils sont nombreux à se rassembler, c’est certainement eux qui sont normaux et moi qui suis bizarre. Il y a une logique à tout ça. Ils doivent être plus intelligents, ils savent faire mille et une choses que je ne sais pas faire, ils savent mieux parler, ils savent mieux bouger, ils savent mieux penser, ils savent mieux s’habiller, mieux se coiffer, ils savent s’amuser [...] La seule parade que j’aie trouvée à tout ça , c’est l’oubli. Je referai défiler les images, chaque jour, avec pour mission de les anéantir. Je passe beaucoup de temps à ça depuis des mois et je me dis qu’avec de l’entraînement j’aurai bientôt un super-pouvoir, un talent secret, pour ce qui est d’oublier. »
Cette cour d'école que tant parmi nous ont connue, peu importe les passeports. L’oubli comme arme de survie, oublier l’humiliation, oublier la différence, la douleur diffuse, oublier la guerre, oublier et dompter la boule. Elle la suivra longtemps pourtant, cette boule, tout comme ce sentiment de n’être de nulle part, provoquant des crises d’angoisse aiguës et des fuites irraisonnées, même une fois réfugiée à Paris, séparée du père resté au pays.
« J’ai peur qu’elle aille trop loin, qu’elle aille là où on s’est trop trahi, là où on s’est trop autodétruit pour se relever. Là où le tunnel est tellement sombre qu’on a perdu de vue l’enfant qui est en nous, là où c’est tellement noir qu’il devient impossible de le retrouver pour lui prendre la main et lui dire de ne pas s’inquiéter, on va avancer à deux. »
La France n’est pas pour elle un eldorado, peu importe le pays finalement, son exil intérieur - loin d’elle-même - semble programmé pour durer et son regard sans concession sur l’alentour n’amoindrit aucun doute. « J’ai longuement réfléchi à la raison pour laquelle il y a tant de clochards dans un pays si riche. Je crois que, s’ils laissent les gens dans la rue, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas les moyens de les aider, ni de les chasser. C’est pour les laisser là, à la vue de tous, comme un exemple, comme ce qu’il ne faut pas faire, comme un avertissement. En discutant avec ce monsieur, j’ai enfin compris pourquoi mes maîtresses m’isolaient sur une table toute seule en guise de punition. C’était pour que j’aie honte. J’étais une sorte d’épouvantail, elles se servaient de moi pour motiver les autres élèves à rester attentifs. C’est pareil pour ce monsieur, on ne veut ni l’aider ni s’en débarrasser. On le laisse là, à la vue de tous, seul, pour dire ce que chacun peut devenir s’il lui prend l’envie de ne pas respecter les règles de la classe. Gare aux différents. Gare aux rebelles. Gare aux inaptes. »
Roman à deux voix, l’hypersensibilité du père répond à celle de la fille, mais ils n’échangent jamais verbalement directement. Voix de deux êtres n’appartenant à « aucun groupe, aucune faction, aucune tribu » dans un monde qui ne réclame que cela, des tribus, dans un pays qui n’est basé que sur cela, des confessions et des clans. Lui observe son idéalisme qui s’effrite (les portraits des assassins sont toujours affichés haut dans les rues et lequel de ses amis intellectuels ne s’est pas encore compromis avec l’un des pouvoirs, pour au moins manger ?), sa petite-fille grandie qui s’éloigne, inexorablement (« le silence avait trop pris racine. La peur avait trop pris racine. Elle s’était tellement infiltrée partout, elle avait tout colonisé. Ses racines avaient tellement eu le temps de s’étendre en nous qu’il était devenu impossible de la déloger, de l’arracher, pour que les autres émotions soient capables de construire les bons mots et de les mettre dans le bon ordre pour se parler »)
Elle tâtonne, s’écroule, se relève et se perd dans le Jardin des Plantes (quand lui file à celui du Luxembourg lorsqu’il est de passage dans la capitale française), se confronte à la mort, celle de l’âme, celle de l’espoir, avec son amie Sandrine, mauvaise herbe arrachée de ce parterre parfait, froidement agencé. Sur le balcon parisien, un plant de jasmin. S’adaptera-t’il ? Survivra-t’il ou se laissera-t’il dépérir ? La petite-fille est loin, désormais. Ou plutôt non, elle n’est jamais partie mais le décillement final et son corolaire de décisions cruelles mais inévitables auront fini de la faire grandir. Plus de tuteur pour le jeune pousse, les mauvaises herbes si elles survivent aux jardiniers officiels ont, en plus d’être sauvages, indomptables et résistantes, des vertus, faut-il le rappeler, médicinales.
Un extrait pour finir. Un retour au Liban. Une nouvelle crise d’angoisse. Le père.
« C’est moi et ce pays. Elle est possédée par moi et par lui. Nos poisons respectifs coulent dans ses veines. C’est moi et les cent cinquante mille corps et notre décomposition au même rythme. C’est cette ville qui, quand elle descend de l’avion, n’a pas besoin de la renifler plus de deux secondes avant de la reconnaître. C’est cette ville qui la rappelle à elle par des cris stridents comme les mammifères rappellent leurs rejetons. C’est cette ville qui ne voulait pas qu’elle remonte dans l’avion. Cette ville qui s’est accrochée à son cou avec ses griffes, qui voulait la retenir ici. C’est cette ville qui veut que personne ne la quitte, que personne ne s’en sorte, que personne ne l’oublie. C’est les trente-trois degrés Celsius et les soixante-treize pour cent d’humidité. »
Quelle langue ! Un univers chargé d’odeurs, d’encens, de souvenirs, de regards. De dévastations. D’espoir, insensé. Lecture à peine achevée, une envie immédiate : la reprendre aussitôt. Bouleversant. Sensibilité et force, délicatesse et cruauté, portées par une écriture lumineuse. Majeur.
— ‘Mauvaises Herbes’, de Dima Abdallah, éditions S. Wespieser —
* ‘Mauvaises Herbes’ a déjà obtenu un prix : celui d’Envoyé par la Poste (le premier d’une longue série pour sûr)
* janvier 2021 : ‘Mauvaises Herbes’ remporte le Prix France-Liban
- Morsures de la rue, sévices de la mémoire : étourdissant « Bleu nuit »

Agrandissement : Illustration 4
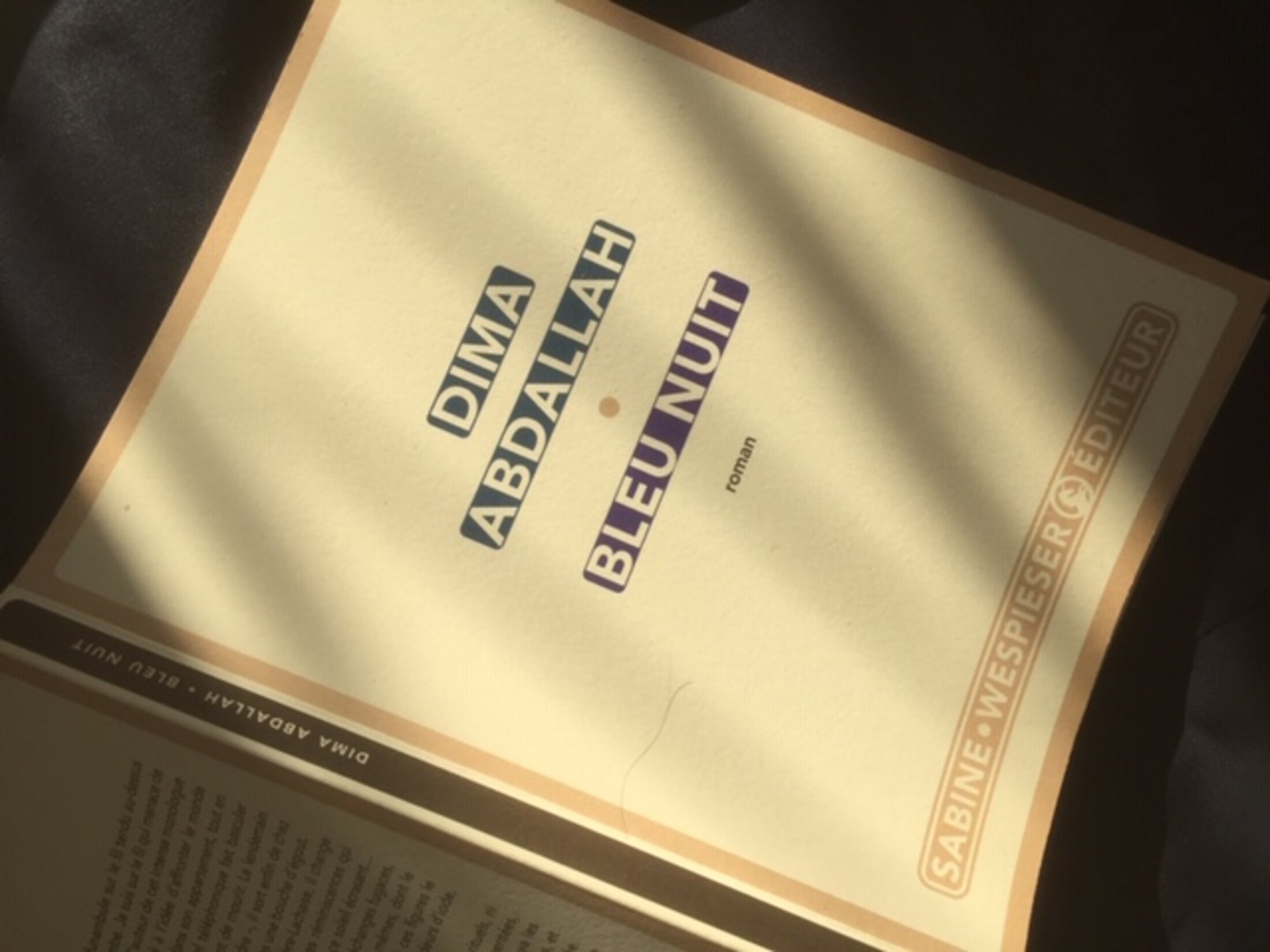
« Je n’ai vécu avec elle que les premiers mois. J’ai vécu seul pendant toutes ces années. J’ai fait semblant de vivre à Paris. Je ne vivais nulle part. J’ai fait semblant des sorties au cinéma, j’ai fait semblant des soirées entre amis, j’ai fait semblant de ma carrière, j’ai fait semblant de dormir la nuit, j’ai fait semblant de vouloir un enfant, pas tout de suite, bientôt, bien sûr. J’ai fait semblant que mes pannes au lit étaient passagères, que oui, j’irais consulter. J’ai fait semblant de n’être pas complètement foutu. Je n’ai pas fait semblant de l’aimer. Je n’ai pas fait semblant de la baguette chaude de 18 heures, je n’ai pas fait semblant de ses mains, de ses cheveux, des crises de fou rire, de nos balades dans le quartier, de nos regards. Je n’ai pas fait semblant de Cabourg en hiver. Je n’ai pas fait semblant des ‘Nocturnes’ qu’on écoutait en boucle.
Je l’ai autant aimée que je l’ai abandonnée. Je ne lui ai jamais rien dit de moi. Du moi qui devait brûler. »
Elle c’est Alma, la seule femme qu’il ait jamais aimée, lui dont on ne connaît pas le prénom.
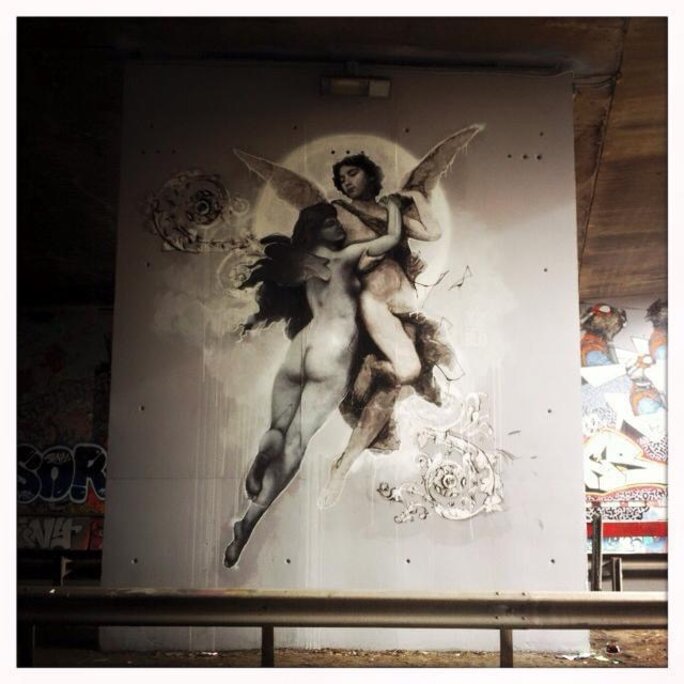
Agrandissement : Illustration 5

Alma est morte, il ne s’est pas rendu à son enterrement. N’a même pas conservé cette robe bleu nuit qu’elle et lui aimaient tant. Les notes de Chopin et la voix lacérée de Nina Simone ont résonné une dernière fois dans l’appartement, appartement dont elle avait claqué la porte plusieurs mois auparavant.
Puis il est descendu sur le trottoir (ce qu’il ne faisait plus), a jeté sans plus de cérémonie la clé du logis-forteresse dans l’égout. Il ne s’est pas retourné. Ne s’est pas plus interrogé sur les pièges que lui concoctait déjà peut-être en secret la rue, abandonnant même derrière lui ce traitement contre l’angoisse qui l’aidait pourtant à contrôler ses tocs et autres bouffées délirantes depuis des années. Marcher, marcher sans se retourner; laisser le bitume vous avaler. Vous laver totalement la tête.

Agrandissement : Illustration 6

« On ne connaît jamais si bien un quartier qu’en vivant dans la rue. Depuis quelques mois, je suis un habitant privilégié du 20e arrondissement et d’une bonne partie du 11e. Je connais chaque rue, chaque boulevard, chaque impasse dans un grand périmètre autour du Père-Lachaise. La seule rue que je ne connais pas est celle où j’habitais. Je parviens aisément à l’éviter. Elle ne fait plus partie de la géographie du quartier. Elle n’existe plus. Je veux que toute ma vie d’avant brûle doucement et tombe en cendres. Je ne veux presque rien garder. Il n’y a pas grand chose à garder. Je fais mourir ce qui doit mourir. Je brûle ce qui doit brûler. La rue a ce pouvoir magique, elle vous débarrasse des tous les murs et de tous les fantômes qui y logent, de tous les prénoms qui s’accrochent. Je me débarrasse petit à petit des murs de ma mémoire comme on extrait des tumeurs. »

Agrandissement : Illustration 7

Du boulevard Ménilmontant à la rue des Partants, de celle du Repos aux grilles du Père Lachaise, le récent SDF arpente son nouveau domaine (jamais un pas dans la rue du Liban ! Jamais !), établissant un programme hebdomadaire, un rituel guetteur de plus en plus pointu. Il croit encore au pouvoir thérapeutique de la rue, se pense toujours apte à la contrôler. Il ne finira pas comme ces fantômes vaincus, telle Aimée, qui n’attendent plus que la délivrance sur un coin d’asphalte; il filera vers la mer avant, retrouvera le soleil, vierge à nouveau de toute douleur.
Moussa, le dealeur, passe et repasse devant lui, patient.
« Les madeleines ont un goût rance et amer, mon cher Marcel. Un arrière-goût métallique de sang que je porte sur la langue en permanence. Je ne le recherche pas, le temps perdu, je le terrasse. L’édifice immense du souvenir, je le pulvériserai, je ferai exploser, une pierre après l’autre, un goût après l’autre, une odeur après l’autre, les ruines de la mémoire. Je sacrifierai tes madeleines comme on égorge un animal. Je me sacrifierai moi tout entier sur les trottoirs de l’oubli. »

Agrandissement : Illustration 8

Emma créature de Giacometti, Carla l’habituée des néons, Ella Grâce de Botticelli, Martha qui cache un prénom dans son ventre : l’homme peut bien moquer le dandy, ces femmes dont les prénoms évoquent autant de sonorités familières et qu’il a pris l’habitude de croiser, d’étudier de loin chaque semaine depuis des postes réfléchis, ramènent sur Paname des spectres lointains venus de l’autre rive de la Méditerranée.

Agrandissement : Illustration 9

« Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires
Ceux de l'enfance nous déchirent » chantait la grande dame en noir.
Mais l’homme croit encore pouvoir dompter sa mémoire, l’étourdir jusqu’à l’épuisement.
Chacun de ses pas et chacune de ses pensées le renvoient un peu davantage pourtant vers ces territoires perdus, impitoyablement. Irrémédiablement.

Agrandissement : Illustration 10

« Je brise l’univers où bientôt je ne verrai plus les yeux d’Elsa
J’enflamme les récifs où seront engloutis et brûlés les yeux d’Elsa
Je me vide de l’eau salée de la mer du souvenir où se reflètent les yeux d’Elsa
Retourne à ta tombe, Elsa, disparais de moi, Elsa, vide-Moi de toi, Elsa. »
Un carnet d’écriture et des injonctions balancées en silence n’impressionneront jamais les morts. Leur danse sadique s’accélère donc, ici dans un geste de la jeune anorexique Emma, là à travers le regard sombre de la fière et terrible Layla.
« Je t’ai quittée alors que je n’étais encore qu’un gamin pour essayer de m’en sortir. M’arracher de ton monde qui n’existe que dans ta tête. Mais c’était sans compter sans ta détermination à saboter le boulot. Il fallait que tu mettes Nour sur mon chemin ! Il fallait que tu mettes un prénom mixte sur ma route. Un homme qui porte ton prénom ! Un corps parmi des centaines d’autres qui m’a foutu en l’air, qui a tout gâché. Il fallait que tu m’envoies Nour pour tout bousiller, tu ne pouvais pas t’en empêcher. »

Agrandissement : Illustration 11

Layla la SDF au teint buriné rejette en arrière sa longue tresse, étale cette crème hydratante à l’odeur si singulière sur ses mains et son visage avant de disparaître sous les mille couvertures de son palais chimérique, totalement indifférente au supplice vécu par cet homme qui la dévisage, songe à sa mère, Nour, chaque fois qu’il vient la voir rue du Retrait. À cet homme mystérieux également, portant même prénom.

Agrandissement : Illustration 12

Même Minuit la chienne du Père Lachaise, fidèle gardienne de la tombe de sa jeune maîtresse, même Minuit qui quitte le cimetière chaque nuit pour venir le rejoindre quel que soit le bosquet ou le recoin dans lequel il se terre pour dormir, lui offrir affection et chaleur, n’arrive plus à l’apaiser. Le Liban s’impose à nouveau, chaque hésitation ou décision de ces femmes parisiennes protégées par lui de loin, chaque gaufrette périmée, chaque chant magique, chaque effluve de jasmin offrent un boulevard aux Nour, aux grands-mères depuis longtemps parties, à Amir, Jad, Hana, à l’épicière généreuse d’un temps très très lointain. Comme s’il ne s’était précipité dans la rue que pour finalement les retrouver (et non les tuer).
Où Alma est-elle enterrée ? Proche de Chopin, qui sait ? Elle qui aimait tant ‘Les Nocturnes’. Tous les jeudis il part arpenter le cimetière parisien de l’Est. Il ne s’est pourtant jamais risqué dans cette section. Alma...
« Bleu est le gouffre sans fond
Bleues sont les pluies acides qui me brûlent
Bleu est mon sang empoisonné

Agrandissement : Illustration 13

Bleues sont les cendres qui coulent dans mes veines
Bleu est le vertige
Je marche encore et encore
Je me lave encore et encore de rues qui défilent
Je déverse en moi un torrent de blanc immaculé
De vide
De néant
Une cascade blanche inondera bientôt les vallées bleues et tout sera englouti
Bientôt le blanc aura tout dilué, tout éteint,
Blanc vierge
Blanc pur
Blanc propre de tout »
´Bleu nuit’, second roman de Dima Abdallah après le très remarqué ‘Mauvaises Herbes’ en 2020, se referme délicatement bouche entrouverte ou se laisse tomber sur le sol, regard bloqué vers le large. Un tel condensé d’humanité en 200 et quelques pages, un tel sens de l’observation, bribes du quotidien renvoyées à leur signifiance, une telle poésie affleurante à toutes les pages et une farouche volonté de dire ce qui se ressent vaguement mais ne s’exprime pas ! Dima Abdallah confirme avec ce bouleversant et magistral ouvrage son attrait pour les anti-héros à vif, trop sensibles pour s’adapter à notre société au sens perdu. Déjà dans ‘Mauvaises Herbes’, ses lignes sur les sans-abris et les raisons qui poussent un pays riche à les laisser ainsi errer, visibles de tous tel un avertissement, étaient remarquables de lucidité. À travers les déambulations aux alentours du Père Lachaise et de la rue des Pyrénées de cet homme empli de fêlures, dévoré par ses souvenirs et attiré par le vide, l’écrivaine porte un regard sans fard sur Paris, sur l’époque, sur les mécanismes qui broient sans pitié les inadaptés, les trop grands rêveurs irrémédiablement punis, entrainés vers le fond. Un extrait ici de sa description d’une caissière, aussi féroce que splendide.

Agrandissement : Illustration 14

« Je ne quitte jamais la rue des Pyrénées avant que Carla ne sorte du Franprix. Elle franchit la porte automatique et, instantanément, son visage se vide de son sang. Elle parvient à faire bonne figure jusqu’au moment où elle franchit le seuil du supermarché. Là, c’est comme si son corps la lâchait. Elle marque une pause sur le trottoir et prend une grosse inspiration pour que son cœur veuille bien réoxygéner son sang. Les oreilles sont si colonisées par les bips qu’il lui faut un moment pour percevoir à nouveau le bruit de la rue. Les yeux sont si possédés par les milliers d’articles passés à la caisse dans un rythme militaire qu’ils regardent partout et nulle part. Il faut quelques minutes pour que la rétine se réacclimate à autre chose qu’au tango des codes-barres. Je la regarde se frotter les yeux et les oreilles avant d’allumer une cigarette qu’elle fume avidement en quelques secondes. »

Agrandissement : Illustration 15

Carla la caissière rejoindra un bar-PMU aux néons agressifs, comme pour se réhabituer par paliers à la lumière naturelle, tandis que le SDF observateur se laissera lui glisser lentement, sous la plume bouleversante et désormais confirmée de Dima Abdallah, du bleu nuit romanesque au noir ténèbres. Oubliant que les Pyrénées ne sont pas seulement le nom d’une rue parisienne qui voit pousser les tentes Quechua aussi vite que des champignons, mais aussi celui d’une chaîne de montagnes magnifiques. D’un ailleurs devenu pour lui désormais inatteignable. Impensable.
Un livre aussi subtil et fin que radical qui ne manquera pas de faire du bruit et d’installer cette plume franco-libanaise comme l’une des plus talentueuses et pertinentes de sa génération. Un appel à désiller nos yeux blasés autant qu’une réflexion sur les griffures du temps, de nos cruelles mémoires qui finalement savent nous renvoyer malgré nos gesticulations à ce que nous sommes et resterons à jamais : de bien fragiles enfants vieillis.
— ‘Bleu nuit’, Dima Abdallah, ed. Sabine Wespieser —
- Deci-Delà-
- ‘D’une rive l’autre’, Dima Abdallah : en bordure de soi. Beyrouth au fil des silences

Agrandissement : Illustration 16

- Partageren copiant le lien de la page
(« Dors, toi qui ne dors jamais
Prends ton soleil insolent
Prends tes terres arides
Traverse toutes les mers qu’il faudra
Laisse-moi respirer dans le rythme que je veux
Écrire avec la respiration que je veux
Dors, toi qui ne dors jamais »)
Toujours là, affleurant, sans jamais l’être vraiment. Là. Réellement. Incarné au quotidien par une galette au thym accompagnée d’un « comme au pays ! » irritant. Planqué dans les effluves de cuisson de la voisine Aïcha. Et puis même, aussi, dans chaque claudication de la mère. Cruelle. Intolérable.
Il n’y a jamais posé grolles, le narrateur, au Liban. Ne s’est jamais éloigné de sa banlieue parisienne pourrie. Et pourtant, l’indisciplinée Beyrouth hante depuis l’enfance son existence. Rythme ses humeurs, nourrit sa mélancolie; à son jeune corps défendant. Il peut bien enchaîner les spliffs, assis sur son banc de fortune, accompagné ou pas de son pote Elias (trop rond, trop gentil pour ce monde carnassier), à distance des petits caïds qui font marcher l’économie même plus souterraine de la cité (ils le trouvent « bizarre », trop taciturne pour être fiable), refouler façon étouffoir les mots qui se bousculent dans sa tête (feuilleter les dicos suffira-t-il à y remettre ordre ?), l’ombre du pays lointain, inconnu, de s’immiscer tout le temps, partout.
« Ce quartier, ce n’est pas chez nous, ça n’a jamais été chez nous. Les quartiers comme le nôtre ne logent que des déracinés, des partis d’ailleurs, des gens qui essayent de se bâtir un nouveau pays autour d’un pauvre parc qui ne suffira jamais à donner l’illusion. L’illusion qu’on n’est pas en lisière du monde. »

Agrandissement : Illustration 17

Mais lui n’est pas né au pays du Cèdre et sa mère est sans doute la seule blonde du quartier. Pourtant même elle, la Gauloise de la cité, au milieu de son quotidien de galères, d’anxiolytiques et de pleurs, ne songe qu’à lui, qu’au Liban. Ou plutôt à l’homme absent, disparu depuis longtemps, mais qui lui a laissé à vie deux traces indélébiles : son fils; et sa jambe handicapée. Alors elle se traîne de pièce pas aérée en pièce non-nettoyée, huis-clos HLM oppressant, obéissant aux seules règles de la psychasthénie. Le fils se voit gratifier brusquement entre deux portes - léthargie deux secondes brisée - d’une de ces satanées galettes au thym, accompagnées des sempiternels « comme au pays ! ». Qui sonnent comme autant de « comme pour lui ! » Elle croit bien faire, la mère. Elle pense gâter son gosse vénéré, peut-être même lui dire ainsi à sa façon, gauche, « tu vois, je ne te coupe pas de ton ascendance. Il n’est plus là mais, si un jour tu veux que je te raconte… » Lui n’a qu’une envie : la secouer, la réveiller, lui hurler dessus « mais tu n’y as jamais été, au ‘pays’ ! Pas plus que moi ! Sans la voisine, tu ne connaîtrais même pas la recette ! Et je ne veux rien savoir, rien connaître ! Tout est déjà dit dans ta patte folle ! » Il se tait, prend les manakish dans un demi-sourire forcé; retient ses larmes qui montent. La mère, elle ne le supporterait pas.
Parfois, il craint la pousse de cette "mauvaise graine" plantée, qui vient de qui il sait. Il redoute sa germination.

Agrandissement : Illustration 18

(« Traverse ce qu’il faudra de frontières fantômes
Ce qu’il faudra de tempêtes marines
Gagne les terres maudites loin de moi
Dors, toi qui ne dors jamais »)
L’autre rive de la Méditerranée se personnifie donc, aux yeux de l’enfant puis de l’adolescent dont Dima Abdallah trace ici la (dé)construction par de très fins coups de pinceau, dans la dépression maternelle, dans les traits indistincts d’un homme lâche et violent. Mais haïr requiert une constance destructrice. Haïr son père (on n’en a jamais qu’un) une énergie atomique. Consumante. Bientôt peut-être même constituante.
« Je lis des recueils de poésie, mais, depuis quelque temps, c’est comme si les mots des livres ne suffisaient plus, comme si j’avais au fond de mes poumons des millions de mots écrits en tout petit qui m’empêchent de respirer et qui ont besoin de sortir. Je fais sortir les mots un par un, je les expire, et j’écris comme un possédé. J’ai des carnets noircis de mon mutisme de la journée. Des bouts de textes, des poèmes , des raps. Tous les mots ravalés la journée, tapis dans mon corps, cognent la nuit. J’aurais peut-être dû lui dire, à Elias, que j’écris des raps et des poèmes, des centaines, que je transforme la matière noire de la journée en lumière. J’aurais peut-être dû lui avouer que c’est bien plus puissant que le shit et qu’écrire ça me fait m'évader au plus loin possible de ce monde tout en m’y ancrant à jamais, tout en y plantant des racines comme jamais. Peut-être qu’il m’aurait compris, Elias. Il est intelligent. Mais non, on a un pacte depuis toujours, lui et moi, une promesse de ne jamais se bousculer avec les mots qu’il ne faut pas, de garder chacun nos douleurs et nos secrets muets et de se les dire seulement avec les yeux, de ne jamais trop parler de ce qui est vraiment sérieux. De ne jamais trop parler tout court. »
Et surtout pas des pères volatilisés. Des géniteurs évaporés.
Elias fait partie du club des abandonnés lui aussi, des pas-grand-chose aux yeux de darons je-m’en-foutistes. Énième chiard répandu à la va-vite. Sa mère enchaîne les grossesses, jamais le même dab. Aucun homme ne semble décidé à mouiller l’ancre durablement dans ce logement social noyé sous les couches. Aucun ersatz de regard paternel ne s’attarde sur ce petit gros qui ne brille pas à l’école, ne sait pas se faire respecter dans la rue. Alors il fait le clown, Elias, essaie d’être sympa avec tout le monde, avec les zonards comme avec les dealeurs, casque de zik bien vissé sur les oreilles. Sous l’œil attendri et protecteur du jeune narrateur.
Y a-t-il place pour le hasard dans nos amitiés ?
« Pendant qu’on danse, il n’y a plus rien d’autre et on se sourit quand nos regards se croisent. Parfois, on met la musique très fort et ça nous prend aux tripes, alors les mouvements des bras et des jambes se font de plus en plus amples, on ferme les yeux et tout s’évanouit à part le gros beat qui cogne. Elias oublie complètement sa mauvaise graine, sa douleur et son gros bide et se met à danser comme un fou. Quand il oublie tout comme ça, je trouve qu’il danse super bien. Il aime tellement écouter de la musique, Elias, il a tellement tout le temps son casque sur les oreilles quand il est dehors, que la musique et lui, ils se comprennent, il est tellement habité par le son que son gros bide n’enlève rien à l’élégance de ses gestes. Il est beau quand il danse, Elias. Quand je lui ai dit ça une fois, il a rougi un peu et s’est mis à danser avec encore plus d’enthousiasme. »
Elias choisira le premier de partir sur les traces de son paternel.
Et ne se remettra pas de l’ultime rejet à venir.
(« Prends tes spectres
Prends toutes les illusions et tous les cauchemars
Je suis las
Rempli et vide de toi
Toi dans les limbes
En moi
Toi sans visage
Toi sans nom
Dors, toi qui ne dors jamais »)

La danse, l'apprentissage en boulange (« les boulangers, quand c’est des bons, c’est des artistes »), la musique : l’indifférence de l’irresponsable retrouvé balaiera tout. Cassera tout, le peu, à nouveau. Coup de poignard silencieux en plein cœur.
Les prédicateurs intégristes, à l’affût telles des hyènes locales, trouveront en Elias le mouton blessé idéal pour déverser leurs inepties, leur fiel belliqueux, leur lecture biaisée.
« Alors je l’accepte du mieux que je peux, son nouveau monde, en priant tous les soirs dans mon lit pour qu’il ne se casse pas la gueule, qu’il ne tombe pas dans un précipice où je ne pourrai pas aller le sauver. Il y a des gouffres sans fond où plus personne ne peut vous tendre la main et vous en extirper. Il y en a une tripotée, des gars et des meufs dans le quartier, qui ne connaissaient rien de rien à la religion et ça ne les a pas empêchés de signer pour je ne sais quel prêcheur à la con. Je suis tombé un jour sur un mec qui n’arrêtait pas de cracher par terre parce que je ne sais quel génie lui avait fait croire qu’il était interdit d’avaler sa salive pendant le ramadan. Eh purée, le mec y a cru. Je prie tous les soirs pour qu’Elias ne devienne pas taré. »
Brassens chante toujours Sète sur le téléphone du narrateur, regard tourné vers la Méditerranée et les autres rives, celles d’en face, terres des racines mais, Elias n’écoute plus depuis son petit tapis de prière. Seuls les prêches des charlatans guerriers portent à présent sa colère.
(« Prends tes mots
Prends mes mots
Emporte-les aussi loin que tu pourras
Prends-les et éparpille-les au vent d’hiver
Attends l’hiver
Attends le froid qui prend tout
Et berce mes mots de tempête folle
Attends décembre
Attends la bise du nord
Le vent froid qui anesthésie tout
Dors, toi qui ne dors pas »)
‘D’une rive l’autre’, troisième roman de l’écrivaine Dima Abdallah, est un lumineux exercice d’équilibriste. En bordure de soi, à la frontière entre la mélancolie et la brisure, sur le seuil d’où commence l’exil intérieur.

Agrandissement : Illustration 20

Ses personnages, qui incarnent les périphéries, touchent rapidement à l’universel entre ses mains. Le narrateur, personnage principal suivi sur plusieurs décennies, claquemuré dans ce quartier qui est sien sans l’être vraiment, dans son tête-à-tête suffocant avec une mère fragile, ne trouve comme respirations que son amour distant pour la belle Layla, sa solide amitié sans jugement avec Elias et les mots, les dictionnaires, le rap, Brassens, la poésie et ses carnets d’écriture. Le Liban n’est pas son quotidien. Il l’habite pourtant à chaque réveil.
Comme toujours avec l’auteure de ‘Mauvaises herbes' et de ‘Bleu nuit’, la marge devient le centre et les normes (l'école dans ‘Mauvaises herbes’, le travail et la routine d’une vie rangée dans ‘Bleu nuit’) les vrais sujets d’interrogation.
Avec son œil félin et sa plume légère mais sans complaisance, l’écrivaine franco-libanaise accouche les vérités les plus sensibles en perçant le fracas des silences. Familiaux, sociétaux, intimes et par là aussi historiques.
Comment parler autrement des séquelles d’une guerre civile (1975-1990) qui fit 250.000 morts, autant de disparus et créa une diaspora de 14 millions de personnes descendance comprise (sur une population de 6 millions actuelle), avec tous autant de souvenirs troubles, personnels ou familiaux, et du déracinement, et des horreurs vécues, entendues, des conflits intercommunautaires ? Qui a fait quoi ? À quelle faction armée l’allégeance de qui ?
Les fantômes rôdaient et les plaies peinaient à cicatriser, avant même l’explosion du hangar numéro 12, port beyrouthin, 2020 (symbole de l’incurie et de la corruption de la classe politique libanaise). Avant même le Hezbollah, le Hamas, l’occupation et les bombes israéliennes.
Les experts des plateaux bondissent tels des cabris de drame en drame pour asséner froidement leurs prévisions géopolitiques, géostratégiques, Mmes Irma enivrées de dates et de tableaux.
Aux écrivains, au temps lent de l’écriture, de rappeler que la guerre, toujours, étend ses souffrances sur plusieurs générations, même dans les tripes de celles qui ne l’ont pas vécue.
« Je les entends siffler, les bombes, et je me maudis d’avoir regardé des films de guerre ou les informations à la télé, parce que sinon je ne saurais même pas ce que ça produit comme son, une bombe. Je les entends et me demande si c’est la télé ou les immeubles mouchetés de Beyrouth qui hurlent de l’autre côté de la mer. Qui hurlent encore quinze ans de sifflements de bombes dans le ciel, de cris stridents des impacts. Est-ce que j’entends ce que lui, l’autre là-bas, a tellement entendu que ça a fini par couler dans mon sang ? »
La belle Layla, autre amie de la petite enfance, passe dans le quartier. Elle a bien grandi, rend chaleureusement de la tête ses salutations au narrateur, déstabilisé à chaque rencontre depuis son banc; amoureux éperdu (« puceau handicapé » selon lui-même). Elle est surveillée à présent par son grand frère, trop lâche pour se confronter aux cadors du trafic mais pas pour menacer sa petite sœur. Le narrateur s’en fiche, promet ses foudres proches à ce coquelet.
Ces mots qui cognent toute la journée dans sa caboche, il les couche sur ses carnets et, les passages dédiés à Layla sont les plus beaux. Les plus secrets. Les plus poétiques. Les plus inspirés. Le lecteur y retrouvera toute l’idéalisation, la flamme passionnée des premières fois. Et s’inquiètera peu à peu, au fil des années dépliées par Dima Abdallah, de cette divinisation qui s’éternise au-delà du passage de l’adolescence.
Quand viendra l’heure, bien entendu qu’il partira. Qu’il foulera enfin pour la première fois le sol libanais. Mais pour chercher quoi ? Beyrouth, ses ruelles étroites, la lumière qui surgit de derrière les montagnes, celle d’après un jour de pluie salvatrice ?
Ou les traces de celui qui l’a abandonné ?
Quel sera le prix à payer ? Les mots sauvent-ils de tout ? La promesse d’un amour partagé éloigne-t-elle tous les monstres du passé ? D’un passé jusqu’ici férocement, inconditionnellement, refoulé.
« Les mots rugissaient en moi et les vers se formaient sans me demander mon avis. Les vagues qui venaient soupirer à mes pieds me criaient leurs origines, elles me bombardaient des mots des terres chaudes de l’autre rive parce qu’il y a bien une autre rive. Même une rive quittée depuis plus de vingt ans. Les vagues venaient me souffler des odeurs de poudre, des immeubles écroulés sous des soleils accablants, des peaux mates, des yeux noirs, des souvenirs increvables et des "comme au pays" comme s’il en pleuvait parce qu’il y a un pays. Les mots le savent et ne nous demandent pas notre avis. Ils savent les terres brûlées, les villes dévastées et les corps ensevelis qui ne refroidissent jamais.
J’ai des carnets remplis de ce que je n’ai jamais voulu écrire. »
Il va « réussir sa vie », répète fièrement en boucle sa mère entre deux « comme au pays ». Il ne la contredit pas, conscient d’être pour elle une béquille. Mais « réussir sa vie » : qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Lorsqu’on est en plus amputé de la moitié de soi. De son histoire.
Que les nuisibles invisibles rongent depuis le commencement les fondations bancales.
(« Dors et borde-moi avant de fermer les yeux
Alors peut-être que je m’endormirai
Dans un hiver qui ignore tout
Qui oublie tout
Un sommeil propre de ton soleil ardent
Propre de tes corps
Propre de tes ruines
Propre de la jambe qui boite
Un sommeil profond qui prend tout
Je dormirai enfin, moi qui ne dors jamais. »)

Agrandissement : Illustration 21

Des délicieux rikakats de madame Hind au café de Batroun en bord de mer, de la plage beyrouthine de Ramlet el-Baïda aux amours qui s’affirment au bord des cascades de la vallée de l’Ibie (Ardèche), oasis personnelle, il cherche voie et équilibre, conscient des charges invisibles posées sur ses épaules, sacs de poudre, de chimères, de passions déçues et de violence. Qui ne lui appartiennent pas. Mais le définissent, le bâtissent aussi, cependant. Comme chacun d’entre nous. Sous d’autres formes, d’autres héritages tus.
« Réussir sa vie » ? Oui, le projet est beau. Universel.
Layla repasse. Ses cheveux ondulés remués par le vent. Ses dents blanches parfaites qui se dévoilent en un éclair lorsqu’elle l’aperçoit.
« Réussir sa vie ». Le monde autour, alors, n’existe plus. Un instant. Suspendu.

Agrandissement : Illustration 22

‘D’une rive l’autre' parvient subtilement à évoquer le Liban tout en, malgré les apparences et étonnamment, ne pas en faire son sujet central.
Le jeune narrateur sans nom pourrait aussi bien être un garçon tamoul vivant en France, une adolescente haïtienne expatriée, un descendant de survivants de la Shoah, une rescapée du génocide rwandais. N’importe quel jeune adulte, nationalité indifférente, porteur d’une histoire familiale lourde, de secrets enfouis. Là est la force de Dima Abdallah ! Partir du matériau qui est le sien, de la glaise qui lui est donnée, pour regarder au-delà du particulier tout en se nourrissant sans cesse de celui-ci. Fixer le point commun à tous (la matière humaine, les sensibilités à vif) et : viser juste.
Un roman étourdissant sur l’exil intérieur, sur ceux qui ne trouvent aucune place dans les cases prédéfinies, qui ne veulent plus participer au bal masqué géant. Également, en creux, un rappel aux agités du roman national que les histoires désormais ici sont diverses. Complexes. D’autant plus indispensable aujourd’hui que le monde gronde à nouveau, menace de furies, de nouvelles plaies béantes ceux qui aspiraient juste à… « réussir leur vie ». Aussi un mémento-bouteille à la mer sur la fragilité des enfants, des adolescents, éponges friables (même si âmes résilientes). Le cadet des soucis, certes, des nouveaux bellicistes maîtres du monde.
— ‘D’une rive l’autre’, Dima Abdallah, éditions Sabine Wespieser —

Agrandissement : Illustration 23

• voir aussi : - Dima Abdallah dans Le Monde : « Ne t’endors pas, Beyrouth ! »
- ‘Plongée entre les pages de 20 livres de la maison Sabine Wespieser pour ses 20 ans !’
— Deci-Delà —
* voir aussi 'Un Oeil sur l'oeuvre de...'



