Suite de : The Lancet : avenir des soins et de la recherche clinique en matière d'autisme 3

Agrandissement : Illustration 1

La base de données probantes pour les interventions en matière d'autisme
Il existe de nombreux guides de pratique clinique pour l'autisme, publiés par des organismes gouvernementaux et des associations professionnelles du monde entier, bien que la qualité, la composition de ces groupes et les méthodologies utilisées varient considérablement. D'autres articles résument également la situation dans différents pays ou régions, comme la Chine, l'Indonésie, l'Iran, l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne et le Vietnam.
Certaines des méthodes d'élaboration des lignes directrices sont similaires, dépendant principalement des recommandations d'un groupe d'experts parvenant à un consensus sur les interventions appropriées sur la base d'un examen systématique et spécialisé des preuves. Cependant, les conclusions varient, allant de celles qui recommandent uniquement des approches soutenues par des méta-analyses des résultats de multiples essais contrôlés randomisés, à d'autres qui recommandent un éventail plus large d'interventions et de pratiques basées sur des examens de consensus d'experts, y compris des preuves provenant d'études cas-témoins (dites quasi-expérimentales), de cas uniques et de cohortes.
De plus, les praticiens ne s'entendent guère sur ce qui est fondé sur des données probantes et ce qui ne l'est pas, ce qui remet en question l'hypothèse selon laquelle les cliniciens - qui peuvent avoir des idées très différentes sur ce qui est suffisant, ou qui viennent d'horizons professionnels différents avec des préjugés différents - accepteront automatiquement les lignes directrices. L'utilité des lignes directrices de pratique clinique pour guider les praticiens dans les interventions et les stratégies de soutien complexes (et souvent interdisciplinaires) afin de fournir des soins adéquats à la population hétérogène des personnes autistes variera selon l'intervention particulière envisagée, la nature du service ou du cadre de soins, et les facteurs contextuels sociaux et culturels.
Le nombre croissant de lignes directrices de pratique clinique provenant de différentes parties du monde (tableau 1) constitue une étape importante vers la création de normes internationales pour la prestation de services et offre des repères pour une prestation de services de qualité. Toutefois, sans évaluation critique, il ne s'agit pas d'un moyen en soi.

Agrandissement : Illustration 2

Tableau 1 - Les guides de pratique clinique par pays ou région
Les facteurs historiques et culturels locaux jouent un rôle dans les approches et les seuils utilisés pour juger des niveaux de preuve des interventions sur l'autisme. Par exemple, aux États-Unis, la recherche sur les interventions en matière d'autisme a commencé par des approches comportementales (par exemple, l'analyse appliquée du comportement) qui utilisaient la modification du début, du décalage et de la reprise des approches de traitement dans des cas uniques plutôt que des essais contrôlés randomisés comme moyen de comparer différentes conditions. Ces modèles de recherche sont systématiques, peu coûteux et flexibles dans leur capacité à répondre aux besoins de différents enfants. Cependant, ils présentent des limites évidentes, telles que les biais associés à la petite taille des échantillons, l'absence d'informations sur la généralisation et le rôle du développement et, souvent, la non-randomisation ou l'évaluation des résultats en aveugle.
Les essais contrôlés randomisés, lorsqu'ils sont bien menés, fournissent les estimations les moins biaisées de l'efficacité et intègrent souvent d'autres atouts méthodologiques rigoureux, tels que les interventions dirigées, la préspécification des résultats primaires, l'attention portée au masquage des évaluateurs et les analyses prudentes en intention de traiter. Cependant, elles présentent également des limites bien connues, telles que la non-représentativité d'échantillons hautement sélectionnés, une dépendance excessive à l'égard de programmes orientés vers la recherche qui pourraient ne pas être transposables à une pratique communautaire plus large, et des restrictions en matière d'individualisation et de modification d'une intervention en fonction des réponses, comme cela se produirait dans la pratique clinique. Malgré les différences d'approches en matière d'interprétation des données, on s'accorde de plus en plus sur les techniques d'intervention particulières qui sont utiles, telles que l'utilisation du renforcement positif, des supports visuels pour soutenir les attentes comportementales, et l'adaptation du niveau de difficulté du langage et du jeu aux capacités de l'enfant. Les chercheurs sont plus unanimes que les cliniciens quant à la valeur des différentes interventions, car ils respectent généralement les normes relatives aux essais contrôlés randomisés et à l'évaluation en aveugle. Cependant, les cliniciens doivent prendre des décisions quotidiennes sur les interventions à recommander et à mettre en œuvre (figure 5) et doivent donc souvent aller au-delà des interventions à court terme et de faible intensité qui sont les mieux documentées.
Toutes les formes d'intervention et toutes les pratiques cliniques dans les domaines liés à l'amélioration des résultats pour les personnes autistes ne peuvent pas être testées dans le cadre d'essais contrôlés randomisés conventionnels, dits modèles médicaux. L'absence de preuves issues d'essais contrôlés randomisés pour une approche particulière ne signifie pas nécessairement que cette approche est inefficace (ou efficace). En outre, plusieurs tentatives bien intentionnées d'introduire des changements à grande échelle dans les écoles avec une affectation aléatoire de différentes classes à différentes interventions ont échoué pour diverses raisons.
Malgré les appels en faveur de telles recherches, la mise en œuvre de modèles d'essais contrôlés randomisés en double aveugle et à l'épreuve des faits n'est pas toujours réalisable dans les évaluations de services complexes à plus long terme et à composantes multiples, qui concernent souvent des populations pour lesquelles la randomisation est soit difficile en pratique, soit contestable sur le plan éthique. Par exemple, dans les essais psychosociaux, les déclarations des parents sur la fonction adaptative ou le comportement de l'enfant seront affectées par le fait que les parents savent qu'ils participent à l'intervention, ce qui introduit un biais potentiel ; les preuves des interventions sont généralement plus faibles lorsque de telles études sont exclues (figure 7). Dans les essais d'efficacité avec les soins habituels comme contrôle dans les HIC, il peut être difficile de trouver et de maintenir un groupe de comparaison assigné de manière aléatoire au traitement habituel, car les familles peuvent avoir accès à des traitements similaires et parfois même plus personnalisés par d'autres moyens. En fait, au fil du temps, les services communautaires changent tellement que les comparaisons avec le traitement habituel peuvent varier considérablement en fonction de l'évolution de ce traitement.
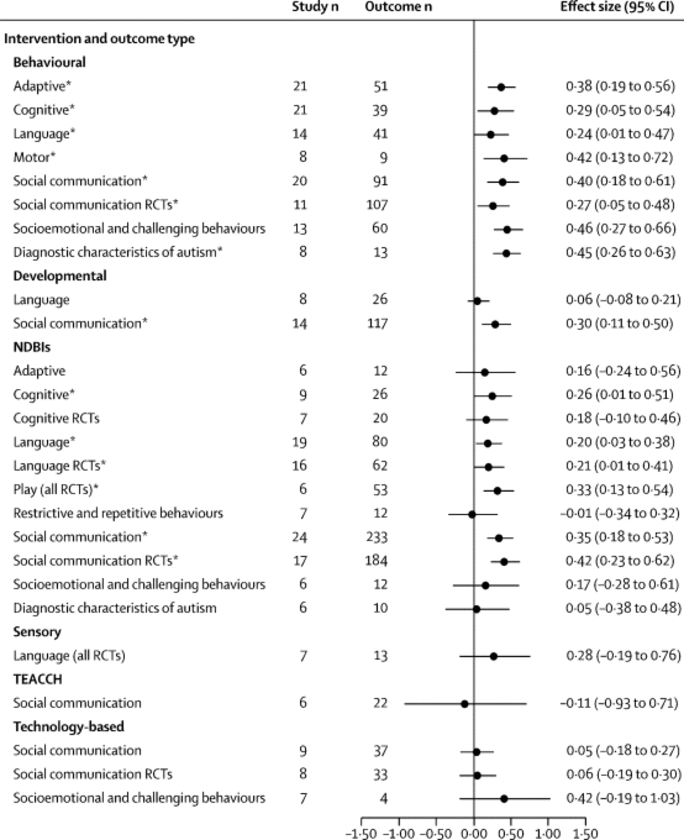
Agrandissement : Illustration 3
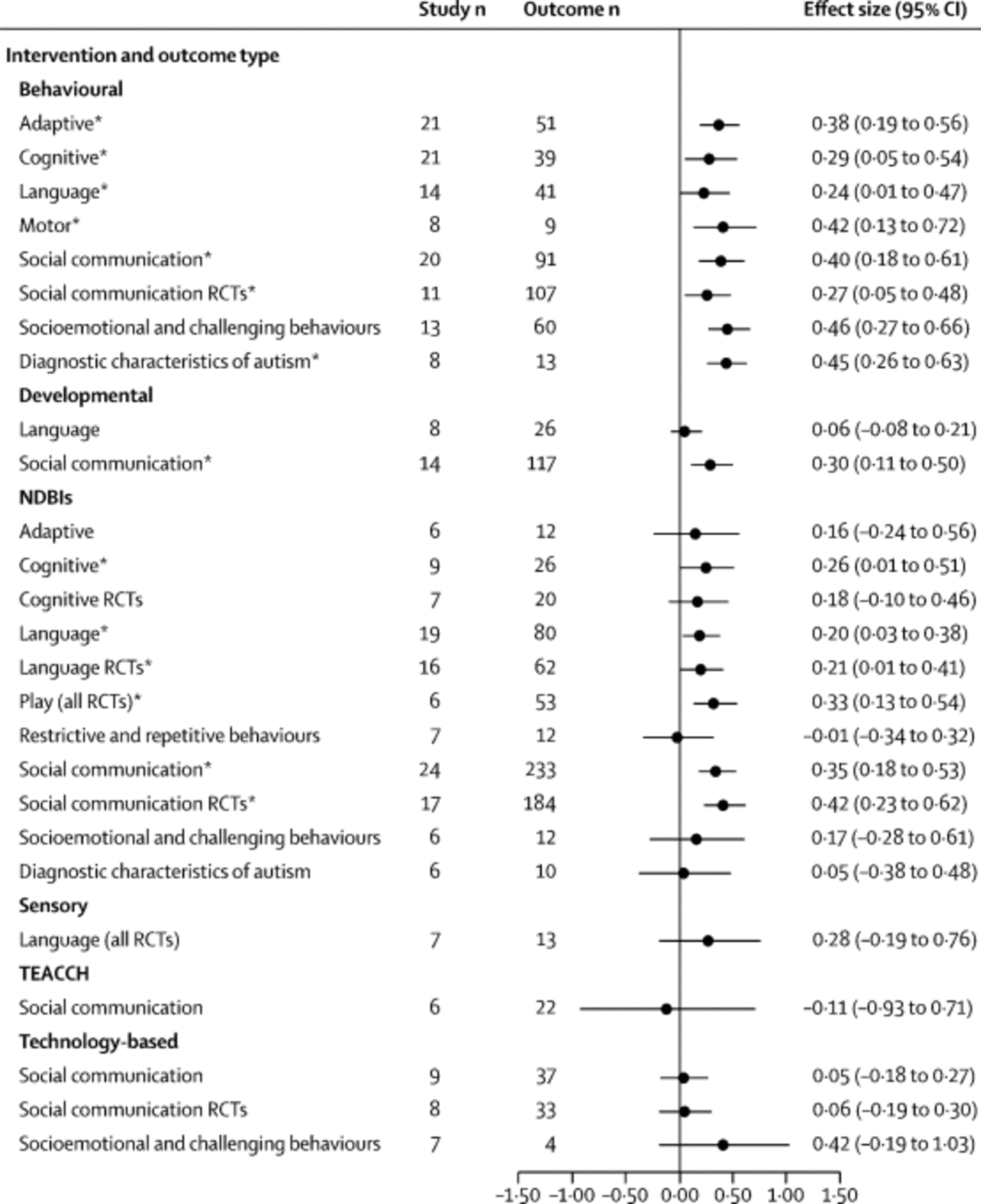
Figure 7 - Graphique en forêt pour l'estimation robuste de la variance des résultats par type d'intervention
Adapté de Sandbank et de ses collègues,31 avec l'autorisation de l'American Psychological Association. Diagramme en forêt des estimations sommaires de l'estimation robuste de la variance avec correction du biais des petits échantillons pour chaque résultat par type d'intervention, lorsque tous les résultats des études quasi-expérimentales et des études sur le plan de groupe des ECR sont inclus. Les estimations sommaires de toutes les études dans un domaine cible sont indiquées en premier, suivies des estimations limitées aux résultats des ECR. NDBI=Intervention comportementale de développement naturaliste. ECR = essai contrôlé randomisé. TEACCH=Programme de traitement et d'éducation des enfants autistes et des enfants souffrant de troubles de la communication. *Indique des estimations sommaires de la taille de l'effet avec des intervalles de confiance qui ne se chevauchent pas avec zéro.
Nous présentons des approches communes d'intervention à différents âges, recommandées dans de nombreux ensembles de directives (figure 6). Pour les enfants de moins de 5 ans, les interventions médiatisées par les parents telles que l'approche de l'attention conjointe, du jeu symbolique, de l'engagement et de la régulation (y compris celles mises en œuvre par un enseignant ou un thérapeute), l'intervention Preschool Autism Communication Trial [PACT], le traitement de la réponse pivot, l'interaction sociale précoce, l'approche Parent-Mediated Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder in south Asia, et les versions du Early Start Denver Model mises en œuvre par un thérapeute ou un enseignant sont les plus étudiées. Certaines d'entre elles, comme le montre la figure 7 (sous interventions comportementales développementales naturalistes), ont été soutenues par des essais contrôlés randomisés montrant des changements le plus souvent dans les comportements de communication sociale spécifiques enseignés, tels que l'attention conjointe, la synchronisation et les interactions sociales. Les programmes généraux de psychoéducation (par exemple, le programme More Than Words de Hanen) sont également souvent utilisés, bien que les preuves à leur appui soient plus variables.
Les traitements directs avec des approches similaires pour les très jeunes enfants, impliquant généralement un non-spécialiste (par exemple, un étudiant diplômé ou un travailleur de la petite enfance), font état d'une intensité allant de 1 h à 40 h par semaine. Des programmes bien étudiés ont rapporté une efficacité principalement dans l'amélioration de la cognition, du langage, ou des deux (par exemple, le Early Start Denver Model, l'analyse appliquée du comportement et l'entraînement aux essais distincts, et l'entraînement à la réponse pivot), ou des compétences de communication sociale précoce (par exemple, l'approche Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation et Social ABCs). L'efficacité potentielle des interventions en classe, basées sur des modèles de communication sociale similaires, a été démontrée dans plusieurs études, mais généralement avec des conceptions de recherche plus faibles (Early Start Denver Model). Le programme de formation des aidants de l'OMS se concentre sur l'enseignement des compétences en matière de soins aux parents de très jeunes enfants et d'enfants plus âgés présentant des retards de développement et des handicaps, y compris l'autisme, et est évalué dans de nombreux sites dans le monde entier. Ce programme est une première étape très importante, mais il laisse encore la charge principale du soutien et du traitement à la famille.
Pour les enfants d'âge scolaire et certains enfants plus âgés d'âge préscolaire, plusieurs interventions ciblées à court terme, soit avec les parents (par exemple, les Unités de recherche en intervention comportementale), soit directement avec l'enfant (par exemple, les Interventions comportementales pour l'anxiété chez les enfants autistes), soit avec des thérapeutes en santé mentale (par exemple, une intervention individualisée en santé mentale pour les enfants autistes), Une intervention individualisée en santé mentale pour les enfants TSA [troubles du spectre de l'autisme]), s'attaquent à des difficultés concomitantes courantes telles que les problèmes de comportement, l'anxiété et les peurs, avec de bonnes preuves d'efficacité provenant d'essais contrôlés randomisés, d'examens systématiques et de méta-analyses.
Des techniques telles que l'écriture d'histoires sociales sur des événements anticipés sont largement utilisées, de même que des stratégies visant à accroître la communication pour diminuer les comportements difficiles. Dans les écoles, le programme Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (traitement et éducation des enfants autistes et des enfants souffrant de troubles de la communication) fournit des principes d'organisation de la classe qui visent à accroître la prévisibilité et l'autorégulation, bien qu'il ait été difficile jusqu'à présent de produire des preuves empiriques spécifiques pour prouver son efficacité. Les preuves de l'efficacité des programmes de soutien des aptitudes sociales pendant les récréations ou les pauses et d'augmentation de l'interaction sociale avec les pairs sont plus solides et soutenues par les résultats de plusieurs essais multisites.
En dehors de l'école, de nombreux programmes d'aptitudes sociales ont été conçus (par exemple, le programme pour l'éducation et l'enrichissement des aptitudes relationnelles, summerMAX, et l'entraînement aux aptitudes sociales de Francfort pour les enfants et les adolescents autistes) qui sont soutenus par des preuves empiriques. La plupart des changements observés concernent des comportements spécifiques à court terme, tels que l'augmentation du jeu et de l'interaction avec les pairs, et leur généralisation à des interactions sociales plus larges, comme à l'école, est limitée.
De nombreux enfants des HIC bénéficient également de thérapies spécifiques, le plus souvent l'orthophonie et l'ergothérapie, qui sont parfois abordées dans les directives de pratique clinique. L'orthophonie et l'ergothérapie utilisent une variété de techniques courantes dans les interventions comportementales développementales naturalistes, au sujet desquelles il existe au moins un consensus clinique sur leur valeur.
Questions relatives à l'adolescence
Les adolescents autistes ont des besoins et des atouts particuliers, et l'élaboration et l'évaluation des interventions destinées à ce groupe nécessitent une attention accrue de la part des chercheurs. À l'adolescence, on s'appuie généralement sur l'éducation en milieu scolaire. Les données convergentes de plusieurs études (pour lesquelles la randomisation était impossible) montrent que les enfants et les adolescents autistes plus âgés qui fréquentent des écoles inclusives dispensant un enseignement général ont de meilleurs résultats que ceux qui sont placés dans des établissements d'enseignement spécialisé, notamment une augmentation plus importante du quotient intellectuel, un niveau d'instruction plus élevé et de meilleurs résultats scolaires, même en tenant compte de la probabilité que le placement dans une école inclusive soit associé à différentes caractéristiques de l'enfant. La psychopharmacologie devient une composante plus typique du traitement des troubles associés à l'adolescence et à l'enfance, notamment le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, l'anxiété et l'agressivité. Les lignes directrices officielles diffèrent d'un pays à l'autre et, ce qui n'est pas surprenant, d'une profession à l'autre, quant à savoir si les approches psychosociales doivent toujours être tentées avant l'introduction de médicaments (tableau 1). Les interventions sur les compétences sociales et la thérapie cognitivo-comportementale se sont révélées efficaces pour réduire l'anxiété, mais pas encore les sentiments dépressifs. Cependant, on en sait trop peu sur la manière d'optimiser la santé mentale et de développer l'indépendance dans l'hétérogénéité des personnes autistes ; un autre domaine où la recherche est nécessaire.
Problèmes à l'âge adulte
Répondre aux besoins des adultes autistes nécessite la collaboration de la communauté locale et des parties prenantes avec les chercheurs et les cliniciens impliqués dans le développement de programmes appropriés, ainsi qu'un changement systémique. La majorité des personnes autistes sont des adultes, et pourtant les services et le soutien disponibles pour ce groupe sont beaucoup moins nombreux, et très peu de programmes destinés aux adultes autistes ont été rigoureusement évalués.
Des traitements similaires à ceux utilisés pour les adolescents (y compris la thérapie cognitivo-comportementale, les médicaments et les groupes d'habiletés sociales, tels que le Programme d'éducation et d'enrichissement des compétences relationnelles) ont tous démontré une certaine efficacité pour les adultes. Des programmes d'emploi assisté et de coaching professionnel sont disponibles dans certaines régions de certains pays et leur efficacité est de plus en plus prouvée.
Les programmes comportementaux destinés aux adultes autistes sont décrits depuis de nombreuses années, bien que peu d'entre eux soient des essais contrôlés randomisés et que beaucoup concernent des personnes présentant des déficiences intellectuelles plus sévères. L'utilisation d'approches comportementales est également controversée par certains défenseurs de la neurodiversité.
Les services destinés aux adultes présentant un autisme sévère et à tous les niveaux d'aptitude constituent le domaine où les besoins sont les plus importants dans certains PHR et nécessitent un soutien systémique. Dans les LMIC, les services étant moins nombreux à tout âge, les besoins sont encore plus vastes tout au long de la vie. La nécessité d'une sensibilisation à l'autisme, d'une formation du personnel et, dans certains cas, d'un soutien spécifique aux individus est largement et de plus en plus reconnue dans les services réglementaires de nombreuses communautés, y compris les services d'aide au chômage et à l'emploi, la police, les tribunaux et les prisons.
Enfin, de nombreuses interventions développées pour l'autisme, telles que celles portant sur la communication sociale, pourraient être utiles aux enfants, aux adolescents et aux adultes atteints d'autres troubles du développement neurologique. Le fait de ne pas avoir un diagnostic d'autisme ne devrait pas être un critère d'exclusion pour l'accès à une intervention efficace. De même, les interventions développées pour d'autres populations peuvent être utiles aux personnes autistes, parfois avec des adaptations qui reconnaissent les déficiences sociales ou les difficultés sensorielles particulières de l'autisme. Par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale de l'anxiété chez les adolescents autistes a été modifiée pour tenir compte des différences de style cognitif, de communication et d'intuition.
Les interventions en matière d'autisme ne peuvent pas être proposées uniquement par des spécialistes de l'autisme. En réalité, la plupart des traitements destinés aux personnes autistes de tous âges, même dans les pays à haut revenu, ne sont pas proposés par des spécialistes ; la plupart des soins sont dispensés dans des environnements éducatifs et communautaires qui peuvent ou non bénéficier de la consultation ou du soutien d'experts.
Ainsi, comme nous le verrons plus loin, la formation et le soutien des non-experts doivent également faire partie de la recherche et de la planification des systèmes. Les facteurs cruciaux comprennent la compréhension de ce qui fonctionne pour qui et quand, et quels sont certains des besoins prévisibles et des variations qui doivent être pris en compte pour soutenir les personnes autistes. Ces informations, ainsi que la formation et la supervision, doivent être mises à la disposition des prestataires non spécialisés, qu'il s'agisse des enseignants des écoles maternelles et des écoles, des accompagnateurs professionnels, des professionnels de l'école ou de la communauté, ou des familles. Ces facteurs sont une autre raison en faveur d'un suivi basé sur les mesures ; si les objectifs ne sont pas atteints, les cliniciens, les patients et les soignants doivent se demander pourquoi.
L'encadré 4 résume les recommandations d'intervention et les considérations relatives à la pratique clinique tout au long de la vie.
Encadré 4 - Recommandations et considérations pour les interventions en pratique clinique
- 1 - Les interventions de santé personnalisées appropriées dans un modèle de soins par étapes pour un enfant ou un adulte donné nécessitent l'intégration des informations provenant des évaluations précédentes, des prestataires et des enseignants actuels, de la famille et de l'individu dans le contexte des soins locaux existants ou possibles.
- 2 - Chaque plan de traitement doit inclure l'identification des traitements formels appropriés, des ressources communautaires et des activités quotidiennes qui peuvent répondre aux objectifs du traitement et des moyens de soutenir l'utilisation de ces ressources, ainsi que la réduction ou l'élimination des services qui ne sont pas efficaces ou ne sont plus nécessaires ; les systèmes de soins de santé doivent soutenir cette communication, cette navigation et cette continuité.
- 3 - Les interventions doivent tenir compte des préférences des individus et des familles et des implications de la mise en œuvre dans des contextes culturellement diversifiés ; les interventions fondées sur des données probantes dans des contextes à faibles ressources doivent être mises en œuvre, mais des adaptations et des stratégies innovantes peuvent être nécessaires.
- 4 - Les familles et les adultes autistes qui peuvent parler pour eux-mêmes devraient être impliqués à chaque étape, mais on ne devrait jamais s'attendre à ce qu'ils assument des responsabilités sociétales et communautaires pour les personnes qui ont besoin de soutien.
- 5 - Les personnes autistes et leurs familles constituent une population vulnérable aux fausses allégations d'efficacité et aux traitements non étudiés qui peuvent avoir des effets indésirables importants.
- 6 - La psychoéducation et les interventions pour les familles et les personnes autistes qui favorisent l'autonomie et le choix personnel et diminuent la vulnérabilité par la connaissance sont des composantes essentielles des modèles mondiaux et locaux équitables pour soutenir la prise de décision à travers les étapes de soins.
- 7 - Des interventions rapides (c'est-à-dire dès que les difficultés sont identifiées) sont vitales :
- Les interventions précoces, axées sur les problèmes, pour les troubles du développement neurologique devraient être accessibles et fondées sur le dépistage et les besoins identifiés par le biais d'un modèle de soins par étapes, sans attendre qu'une évaluation complète ou un diagnostic formel d'autisme soit posé.
- Les troubles associés, y compris les troubles médicaux, développementaux, comportementaux et psychiatriques, doivent être traités de manière adéquate dès qu'ils sont reconnus.
- Les modèles de soins par paliers fondés sur des données personnalisées et un suivi systématique devraient permettre d'augmenter ou de diminuer l'intensité de l'intervention de manière rationnelle et graduelle, si nécessaire.
- Les systèmes devraient donner la priorité aux interventions fondées sur des données probantes, en reconnaissant que la plupart de ces traitements sont à court terme et ciblés, et que d'autres approches continues, y compris l'éducation et le soutien à l'emploi, sont également nécessaires pour soutenir les personnes autistes au fil du temps. - 8 - Des modifications des traitements existants fondés sur des données probantes, y compris des adaptations culturelles, pourraient être nécessaires pour optimiser les approches comportementales-psychologiques et médicales, ensemble et séparément, pour les troubles associés à l'autisme et pour accroître l'efficacité et la participation.
- 9 - Les adolescents autistes ont des besoins et des atouts particuliers ; le développement de pratiques cliniques à leur intention, notamment les interventions, nécessite une attention plus ciblée de la part de la recherche.
- 10 - La durée de vie typique comprend plus d'années à l'âge adulte qu'à l'enfance ; pour répondre aux besoins urgents des adultes autistes, il faut que les chercheurs, les cliniciens, les défenseurs de leurs intérêts et les familles collaborent à l'élaboration de programmes d'intervention et de changements systémiques.
A suivre : The Lancet : avenir des soins et de la recherche clinique en matière d'autisme 5



