L'IGAS et l'IGF viennent de pondre un rapport censé éviter les divergences territoriales entre MDPH sur les droits des personnes en situation handicap (on appelle cela harmoniser).
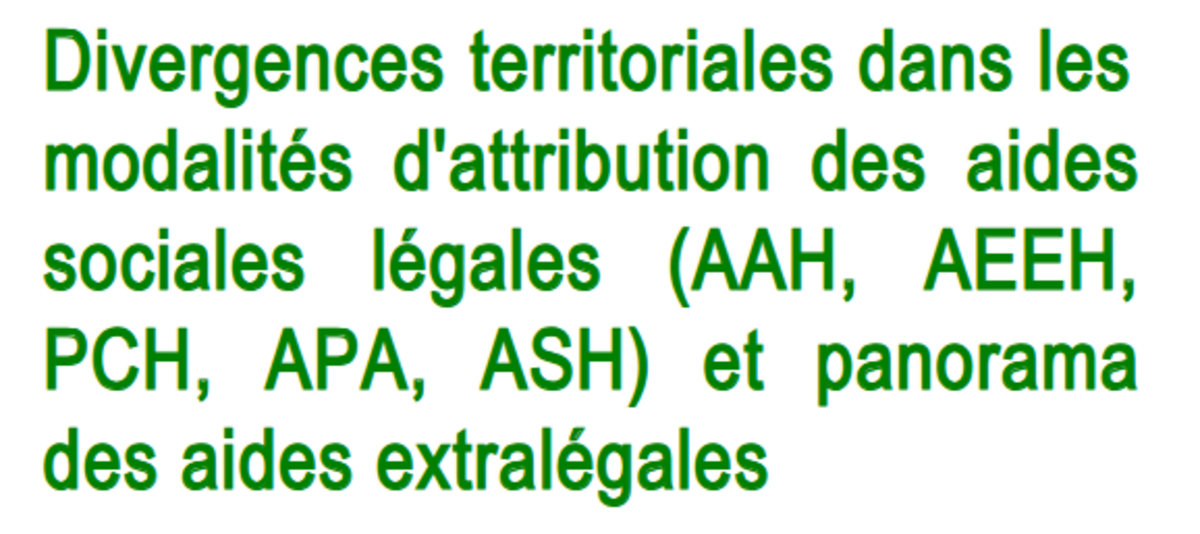
Comme c'est à la mode, un accent est mis sur la fraude, sans argumentaire objectif, à mon avis.
Sur 239 personnes interrogées (annexe II), il n'y a que 4 ou 5 représentants des personnes handicapées... Ce n'est vraiment pas respectable ni conforme à la convention internationale des droits des personnes handicapées (CDPH).
Les différences territoriales ont des différences objectives (âge, situation de l'emploi, niveau de l'offre de services ou établissements ...) et le résultat d'interactions avec les acteurs (Éducation Nationale, associations d'usagers, centres de ressources ...). Elles ne doivent pas être considérées négativement (alignement sur les décisions les plus favorables ou sur la moyenne). Le rapport estime ne pouvoir expliquer statistiquement les différences dans l’évaluation du handicap ... La tendance du rapport est de considérer qu'il y a erreur ou fraude quad les décisions sont plus favorables à la moyenne. Et donc d'y trouver des "économies financières".
Je vais examiner le rapport au fur et à mesure, sans prétendre à une exhaustivité. Je ne commente pas les préconisations peu critiquables. Ou parce que je n'ai pas d'idée particulière sur ce point pour l'instant. Accrochez-vous !
Mais "la mission a étudié différentes mesures permettant de générer des économies financières". L'accès juste aux droits peut pourtant entraîner des dépenses supplémentaires !
Il est par exemple préconisé (n°3) d'utiliser le SI-E (système d’évaluation informatisé) pour prendre les décisions. Cela peut être utile pour objectiver les propositions. Mais cela ne remplace pas le besoin d'un avis humain. D'autant plus quand l'arbre dé décision est branlant (exemple de la RSDAE - restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi).
La proposition n° 5 prévoit dans la réglementation les catégories de dépenses pouvant être couvertes par l’APA, l’AEEH et la PCH, "dans une logique d’équité territoriale et d’efficacité thérapeutique". Il est normal de se baser sur l'efficacité thérapeutique. Il est question de l'équithérapie, de la sophrologie, de l'art-thérapie. J'avoue être réticent sur l'efficacité thérapeutique parfois, mais elle peut être argumentée. Mais quand il s'agit du financement d’AESH à titre privé, qui est cité, cela relève du manque d'accompagnement par l’Éducation Nationale (EN). Pas tellement du complément d'AEEH, mais si l'EN n'applique pas la notification de la CDAPH, que faire ?
Cela ne va pas diminuer la durée du droit au complément d'AEEH, et donc la simplification des demandes : proposition n° 8 : Ouvrir la possibilité de réduire à un an la durée des droits pour les compléments d’AEEH.
En fait, la demande peut être simplifiée : le devis des prestations, le temps de travail des parents (ou l'embauche d'une personne). Certificat médical ou autres documents sont inutiles. Il ne faut pas seulement parler de "réduire", mais aussi d'augmenter. Parce que le décret imposant une durée d'au moins deux ans pour l'AEEH s'est traduit pour la remise en cause des pratiques préconisées par la CNSA, appliquée par une partie des MDPH. Il y a un effet de seuil pour les dépenses, au détriment des parents. D'autre part, quand le complément est lié au temps d'activité des parents, il est normal que la CAF/MSA fasse un contrôle en cours de droit.
Si l'attestation de l'employeur limite le contrat à temps partiel, il me semble que la CDAPH en tiendra compte pour définir le droit à un complément. Une prolongation du complément devrait être simple.
L'idée de réduire la notification des droits au complément d'AEEH à un an peut sembler une régression. En fait, pour moi, cela peut être un progrès. A prévoir la simplification des démarches pour une prolongation en fonction des dépenses et du temps d'activité des parents (ou avec une embauche).
A noter : "malgré la mise en place d’un téléservice dédié, les dossiers ne sont transmis par les demandeurs aux MDPH de manière dématérialisée qu’à hauteur de 12,6 %, impliquant des ressaisies chronophages et sources d’erreur et rendant moins efficace la mise en place de règles de contrôle". Je crois rêver : le contrôle est moins efficace à cause des erreurs de la MDPH ?
Le contrôle par la MDPH pourrait porter sur : "faux certificats médicaux, fraude à la résidence, sous-déclaration des ressources, fausses factures ou déclarations erronées de la part de prestataires d’aide humaine". En fait, il n'y a que les certificats médicaux qui relèvent de la MDPH. Les autres relèvent de la pratique routinière des CAF ou du conseil départemental.
Proposition n° 11 : Introduire un contrôle d’effectivité des dépenses prises en charge au titre de l’AEEH pour la compensation de la réduction d’activité
Ce contrôle existe en théorie depuis toujours. En 2002, le Ministère a dit à la CAF/MSA qu'il ne devait pas être fait à l'ouverture de droit parce que la CDAPH (CDES à l'époque) le faisait. Dans une instruction du 5 décembre 2024, la CNAF a préconisé de le faire a priori : ce qui conduit à une inflation de demande de pièces qui ont déjà été fournies à la MDPH. Le contrôle doit être fait correctement ensuite : temps d'activité de chaque parent, embauche d'un tiers.Et la MDPH informée pour modifier le droit au complément.
Proposition n° 12 : Mettre en place un financement direct des dépenses de soins par l’assurance maladie des professionnels de santé et des autres frais aux professionnels, évitant l’avance des frais par le bénéficiaire et permettant de sécuriser les flux financiers.
Ce serait génial. C'est un peu le cas dans le cadre des plate-formes de coordination et d'orientation des troubles neuro-développementaux (PCO TND). Le rapport de l'IGAS sur la compensation du handicap pour les enfants le préconisait.
Le problème peut porter sur l’intervention d’éducateurs. Ce ne sont pas des "professionnels de santé". S'il est admis par la CDAPH, il serait pourtant normal que l'assurance maladie le finance.
Proposition n° 13 : Encourager la télégestion pour les prestataires et les mandataires et le recours au CESU préfinancés pour l’emploi direct, pour le paiement des heures d’aide humaine au titre de l’APA et de la PCH.
Très bonne idée. Si elle était accompagnée d'une proposition pour appliquer l'augmentation de la PCH au 1er juin 2024 : cette augmentation doit permettre de financer des dépenses aléatoires - ce qui n'est pas pris en compte dans les dépenses mensuelles avec CESU.
Le développement de la télégestion et du recours aux CESU doit être accompagné de la mise en place d’un flux de données des conseils départementaux vers les services de la DGFiP visant à préremplir l’avis d’impôt afin d’éviter les doublons potentiels entre versement de la prestation d’aide humaine et crédit d’impôt au titre des services à la personne, auquel les personnes âgées et en situation de handicap peuvent aussi prétendre.
Très bonne idée : pour commencer, il faudrait que les conseils départementaux communiquent aux usagers les dépenses d'aide humaine (salariée) déductibles fiscalement.
Proposition n° 16 : Développer un programme de dématérialisation du certificat médical MDPH, en coopération avec l’assurance maladie, et poursuivre la dématérialisation des dossiers de demandes et des pièces justificatives apportées à l’appui, dans une logique de simplification (CNSA, en lien étroit avec la CNAM).
Je suis plutôt sceptique sur ce sujet. La fraude documentaire se concentrerait donc sur les certificats médicaux. Elle est notamment repérée par les MDPH en l'absence de date, de cachet, de diverses écritures sur le certificat, de concentration de demandeurs à la même adresse. Ce contrôle apparaît artisanal, mais s'il n'a pas été systématisé, c'est que le problème peut être marginal.*
Je recommande aux usagers de préremplir (au crayon) un exemplaire vierge du certificat médical avant d'aller voir leur médecin. Parce que celui-ci ne connaît pas suffisamment le demandeur ou ne prend pas le temps de remplir le certificat, malgré le financement spécifique par l'assurance-maladie. Les répercussions sur la vie quotidienne ne sont pas toujours connues du médecin (généraliste ou spécialiste).
Évidemment, il ne faut pas envoyer à la MDPH un certificat médical non complété par le médecin.
Je connais quelques situations où le certificat médical a été préparé par des professionnels, avant que le médecin mette son cachet. Le Tour de France des solutions MDPH prévoit que des professionnels de santé autres que le médecin pourraient compléter le certificat. Je trouve cela très positif : encore faut-il organiser cela.
La question se pose par exemple pour la PCH (prestation de compensation du handicap). Quand pour une personne autiste, il est dit qu'il n'y a que des A ou des B, cela pose problème, parce qu'il devrait y avoir un ou des C (besoin d'aide humaine ou de stimulation). Pour les certificats médicaux, il y a une sous-estimation des besoins : il n'est pas question de fraude. De plus, le certificat médical ne questionne pas sur l'exécution des tâches multiples, nouveau critère ajouté à la PCH depuis le décret de 2022 pour une grande partie des personnes handicapées (troubles psychiques, cognitifs, neurodéveloppementaux).
Dans mon département, la MDPH accepte le Questionnaire Autonomie. D'autres MDPH utilisent le certificat médical adapté au décret d'avril 2022 (troubles psychiques, cognitifs, neurodéveloppementaux).
Proposition n° 17 : Confier à la CNSA le pilotage d’un programme pour améliorer la qualité du remplissage du certificat médical (en collaboration étroite avec la caisse nationale d’assurance maladie).
Je ne peux qu'appuyer cette proposition, car du fait du certificat médical, il y a beaucoup de refus de la PCH, de l'AEEH ou de la PCH.
Proposition n° 19 : Réviser les modalités des aides à la parentalité de la PCH, dans une logique compensatrice, en tenant compte des coûts réellement supportés, en particulier lorsque les enfants des bénéficiaires ne sont pas présents au foyer
C'était ce qu'avait demandé le CNCPH, mais le Ministère (Sophie Cluzel) voulait une mise en œuvre rapide.
Proposition n° 20 : Réviser le régime de l’aide humaine de la PCH pour les personnes accueillies en établissement s’agissant des délais de prise en compte ou du champ d’application au regard des besoins réels du bénéficiaire hébergé.
Cette proposition est assez "drôle". Le problème réside en fait dans le fait que les établissements n'assurent pas une bonne prise en charge, ce qui contraint la personne (par l'intermédiaire de ses parents ou d'un salarié) à financer un accompagnement en dehors de l'établissement. L'aide technique de la PCH est due si l'établissement ne l'assure pas. Il devrait en être de même pour la PCH, sans attendre un délai de 25 heures.
Le rapport demande aussi de revoir notamment :
- " la modification du régime de la demi-part fiscale en cohérence de l’évolution de la PCH et le régime d’exonération de l’impôt sur le revenu pour les personnes qui en sont bénéficiaires ;
- la sécurisation juridique des abattements de la base ressource entrant dans le calcul de l’AAH différentielle (cf. notamment CA Aix-en-Provence, 7 février 2025, M me M. Deniau c/ CAF du Var), arrêt au fond faisant l’objet d’un recours en cassation à la date de la
mission"
Nous avons obtenu l'exonération de l'impôt sur le revenu de la PCH aide humaine. Il n'est pas question de la remettre en cause.
Sur la base ressources de l'AAH, je crois que le rapport a raison. L'arrêt de la Cour d'Appel me semble mal argumenté. On verra la position de la Cour de Cassation.
Il faut continuer dans le détail la lecture du rapport.
Par exemple, p.83 : "le complément de ressources AAH a été supprimé à compter du 1er décembre 2019 et remplacé par la majoration pour la vie autonome, aux conditions d’accès équivalentes" ... sauf qu'il faut aussi percevoir une aide au logement pour avoir droit à la majoration de vie autonome à la place du complément de ressources.
" À 60 ans, elles pourront conserver l’AAH et la cumuler le cas échéant (de façon différentielle) avec leur pension de retraite pour atteindre 1 016€ par mois. En revanche, si la personne ne bénéficie que de l’AAH 2 au moment de faire valoir ses droits à la retraite (TI<80 %), et ce même si son taux d’incapacité évolue peu après" Le basculement se fait à 62 ans. Si le taux augmente après 62 ans, l'AAH est rétablie (ne pas confondre avec la PCH).
"lutte contre le non recours : l’intensité de la politique de lutte contre le non recours aura un effet direct sur l’assiette des demandeurs, et donc sur le nombre de bénéficiaires" Ah ouais ? Il n'y a pas d'exemples de lutte contre le non-recours, et bien sûr pas de préconisation, parce que l'objectif est de faire des économies.
C'est difficile d'interpréter les données. Par exemple, pour le Finistère, par rapport aux départements voisins; pour l'AEEH, les taux de bénéficiaires et de dépenses sont plus élevés, mais les dépenses par habitant sont plus faibles (p.97).
"Entre les départements, un taux de chômage supérieur d’un point de pourcentage se traduit par un montant moyen annuel d’AAH
par bénéficiaire supérieur de 100 €, du fait de ressources individuelles plus faibles. " P.117
"Malgré le fait que la PCH représente une prestation universelle et compensatrice et soit attribuée dans une logique personnalisée, 60 % des disparités départementales de montants moyens par bénéficiaire s’expliquent par des disparités de variables socio-économico-démographiques (...) le financement de l’AAH et de l’AEEH revient à la CNAF, ce qui détend la contrainte budgétaire des départements, liée au nombre de
bénéficiaires, dans les effets éventuels sur les montants moyens versés.." Qu'en termes délicats cela est présenté : la détente de la "contrainte budgétaire des départements". Autrement dit, ce ne sont pas les besoins qui déterminent les décisions de la CDAPH, mais les "contraintes budgétaires".
"la part de la population vivant dans un pôle urbain semble être un facteur explicatif d’un montant d’AEEH par bénéficiaire plus élevé. Le modèle ne permettant pas de contrôler pour d’autres variables de conditions de vie présentant une distinction entre espaces urbains et ruraux, la significativité de cet effet peut se traduire par des disparités territoriales de pratiques d’embauche d’une tierce personne, d’arrêt partiel ou total de travail et de structure familiale (notamment parents isolés)." Différences à creuser.
"la part d’agriculteurs et d’ouvriers dans la population est une variable associée à un degré élevé de significativité concernant les aides aux personnes handicapées." (AAH et PCH)
" une augmentation de 100 € de potentiel financier par habitant se traduit par une augmentation du taux de bénéficiaires comprise entre 0,2 et 1 pour mille habitants."
" la situation concernant la PCH est intermédiaire, avec un poids qui varie entre 1 % en Haute Saône, à Paris et dans la Meuse et qui peut dépasser 5 % en Gironde, en Seine Saint Denis et dans le Var." (dans les dépenses du Conseil Départemental)
"en l’absence de décision quant au renouvellement des droits d’AAH, les CAF sont amenées à prolonger temporairement le versement des prestations (avance de droits). Si les droits ne sont finalement pas renouvelés par la MDPH, la CAF doit se charger du recouvrement
des indus générés, qui ne peut être que partiel au vu des populations considérées.". Vraiment marginal, compte tenu du renouvellement des droits à l'AAH (97% ?). La Ministre propose d'étendre cette règle de maintien provisoire de droit à l'AEEH (Tour de France des Solutions). A la MDPH et à la CAF pour s'arranger que la décision intervienne à temps.Il y a des requêtes informatiques pour cela.
"Cela pourrait conduire les services évaluateurs, sur instruction du département, pour des raisons financières et/ou dans le cadre d’une politique sociale à surévaluer le taux d’incapacité pour atteindre le seuil permettant de bénéficier de l’AAH, et le cas échéant d’accorder la reconnaissance substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) de manière assouplie. La mission n’a pas été en mesure de mettre en évidence des pratiques de départements allant dans ce sens. " On aimerait bien que ce soit le cas (que l'AAH prenne le pas sur le RSA), mais on ne le constate pas suivant la mission. D'autant plus avec l'exemple suivant concernant l'AEEH.
"il lui a été rapporté que certains évaluateurs peuvent être conduits à augmenter le taux d’incapacité pour permettre l’ouverture de droits (sur le champ de l’AAH comme de l’AEEH)." L'exemple donné en note est tout à fait caractéristique : il s'agit pourtant d'une application du guide barème, qui conduit à attribuer le taux de 50% à titre de prévention du surhandicap. Il est vrai que bien des MDPH n'appliquent pas, illégalement, cette règle. Cela concerne notamment les troubles dys, et le fait de ne pas appliquer la réglementation peut expliquer un nombre bénéficiaires de l'AEEH inférieur à la moyenne. Mais ce n'est pas le problème de ce rapport, qui recherche des économies. Et qu'il ne constate donc pas des pratiques illégales, inférieures à la réglementation.
Dans les graphiques 25 apparaissent les "résidus", c'est-à-dire les dépenses non expliquées par des variables socio-démographiques.
" l'hypothèse utilisée par la suite consiste à considérer que les départements qui présentent un résidu positif ont dans une certaine mesure des marges de manœuvre pour réduire leurs dépenses d’aides sociales à un niveau proche du niveau attendu en considérant leurs spécificités socio-économico-démographiques et d’offre en structures d’accueil pour la prise en charge des personnes âgées et en situation de handicap " Comme ces choses sont dites ! Que ces départements réduisent le droit à l'AAH, si j'ai bien compris Il n'est bien entendu pas question que les autres départements augmentent les droits sur la base de la réglementation actuelle.
LISTE DES PROPOSITIONS RELATIVES À L’ANNEXE IV
Proposition n° 2 : Préciser le cadre réglementaire sur la recevabilité des pièces justificatives obligatoires du dossier [CNSA ; DGCS].
Proposition n° 3 : Par voie règlementaire, proscrire le recours au certificat médical simplifié lors des demandes d’AEEH et de PCH enfant.
Proposition n° 4 : Systématiser l’harmonisation des pratiques : application plus stricte des guides (par ex guide barème, RSDAE), formations CNSA, échanges de pratiques internes aux MDPH ou CD, entre MDPH ou CD.
Proposition n° 5 : Préciser dans la réglementation les dépenses qui peuvent être prises en charge ou non (activités, aides techniques, par exemple).
Proposition n° 6 : Prévoir un suivi d’un indicateur relatif aux durées d’attribution des droits par la CNSA, au titre de ses missions d’harmonisation
Les départements et MDPH rencontrés ont souligné le besoin d’un cadre juridique plus précis s’agissant de la recevabilité de certaines pièces, notamment sur la durée de validité des titres de séjour et justificatifs de domicile. (...)
Proposition n° 2 : Préciser le cadre réglementaire sur la recevabilité des pièces justificatives obligatoires du dossier [CNSA ; DGCS]
C'est pourtant une solution simple. Sophie Cluzel l'avait préconisé en 2020, lors de la crise sanitaire Lors des renouvellements de droits, il n'était plus nécessaire de fournir des pièces, s'il n'y avait pas eu de changement depuis la demande précédente.
"Par ailleurs, les équipes instructrices des MDPH ne vérifient que peu les conditions d’éligibilité administrative liées au cumul d’une prestation avec une autre (82 % des départements répondants ne pratiquent pas cette vérification s’agissant de l’AAH, 63 % pour l’AEEH, et 38 % pour la PCH), dans la mesure où elles ne sont pas organisme payeur de ces prestations. " Est-ce que c'est leur rôle ? Ou celui de la CAF ? Les conditions de cumul n'ont pas été définies par la loi, sauf pour la PCH. Les MDPH et CAF doivent-elles les inventer ?
"L’évaluation quasi-systématique de dossiers de prestations en soutien au handicap, uniquement sur base documentaire, est liée aussi à la nécessité de respecter les délais de traitement, dans un contexte de forte augmentation des demandes. L’absence d’échange avec les personnes ayant déposé un dossier est également regrettable du point de vue du demandeur. Les évaluateurs rencontrés ont ainsi témoigné du fait que les échanges oraux avec les bénéficiaires (le cas échéant en CDAPH) permettaient souvent d’apporter de nouveaux éléments au dossier, sur la situation médicale, sur les retentissements de la pathologie ou encore concernant le projet professionnel." L'évaluation sur pièces ne doit pas être considérée comme risque de prestations décidées à tort. Au contraire, une bonne évaluation entraîne des droits supplémentaires. Les échanges directs avec les usagers sont une garantie de prestations décidées à bon escient.
"La faible exhaustivité des éléments médicaux présents dans le dossier du demandeur a de fait été indiquée comme la principale difficulté dans le déroulé de l’évaluation par les équipes rencontrées et interrogées par la mission, qui ont souligné l’enjeu fort d’un meilleur remplissage du certificat médical MDPH concernant les retentissements des pathologies" Je suis d'accord. Il faut mener des actions envers les médecins pour qu'ils sachent remplir correctement le certificat médical (il ne suffit pas qu'il y ait une notice explicative datant de 20 ans). Il faut aussi que le certificat soit adapté au décret d'avril 2022 sur la PCH (notamment pour les tâches complexes).
"Par ailleurs, la pratique de réhaussement du taux d’incapacité semble exister également dans le cas des dossiers d’AEEH, afin de pouvoir prendre en charge financièrement des soins qui ne le sont pas par le régime de l’assurance maladie (ergothérapeutes, psychomotriciens). De
même, la mission d’audit de la CNSA mériterait d’investiguer ce point pour évaluer s’il s’agit de situations très fréquentes ou isolées, ce que la mission n’a pu évaluer" Remarque assez époustouflante, car le guide-barème prévoit justement (depuis 2007- voir plus haut) l'attribution du taux de 50% dans ce cas. La mission de la CNSA va-t-elle se donner pour objectif de généraliser l'application du guide-barème ?
"S’agissant des MDPH, un courrier d'alerte est toutefois envoyé six mois avant la fin de droits." Assez rigolo. Il est vrai que c'est ce qui est fait par la CAF pour l'AAH et l'AEEH. Mais par la MDPH par exemple pour le renouvellement de la PCH ? Je veux bien avoir un exemple.
A noter pp.199/201 l'intérêt pour les usagers à participer à la CDAPH. Et : " à effectifs variables, la présence majoritaire d’associations ou bien de représentants institutionnels est susceptible d’influencer la décision finale, tant pour les dossiers présentés sur liste que pour les personnes entendues en commission. Une présence majoritaire d’associations est réputée favoriser l’attribution des droits" Nous sommes là pour çà ! Les commentaires qui suivent disent que les membres associatifs manquent de recul ... ou ont "une approche différenciée". Bel euphémisme pour dire qu'ils n'ont pas le même point de vue que la MDPH.
Page 207 : "Le tableau ci-dessous donne une vue des incidences du délai entre la date d’entrée en vigueur d’un décret apportant un nouveau sujet réglementaire (ici, des évolutions concernant la PCH) et le début de l’instruction ou la validation dudit décret, sur les délais de mise à disposition des versions de SI-MDPH intégrant ce chantier réglementaire. " Le décret d'avril 2022, sur la PCH en cas de troubles psychiques, cognitifs ou neurodéveloppementaux n'est jamais pris en compte.
Problèmes sur l'AAH
Le rapport indique Proposition n° 9 : Systématiser un entretien (par téléphone, en visio-conférence ou,autant que possible, en présentiel) pour l’ensemble des primo-demandeurs d’AAH 2, afin de compléter la connaissance de leur situation et renforcer la qualité des décisions.
Je ne sais pas pourquoi cela concerne seulement l'AAH de type 2 (incapacité inférieure à 80%). Un entretien par une personne qualifiée ne peut que conforter la demande. J'ai évidemment des réserves sur les modalités de l’entretien, qui ne peuvent pas être adaptées à des personnes autistes.
Il y a un rejet des demandes d'AAH pour la moitié des primo-demandeurs. Il ne s'agit que des demandeurs ayant un taux inférieur à 80%. Compte tenu du nombre de demandes d'AAH, cette disposition est inapplicable, sauf renforcement très important des moyens des MDPH. Elle ne pourrait concerner que les refus envisagés. Encore faut-il qu'elle se fasse correctement : j'ai beaucoup de doutes sur les conditions en ce qui concerne les personnes autistes adultes.
L'économie indiquée par le rapport est évidemment fantaisiste. Il n'y a aucun rapport objectif calculé entre les entretiens et la suppression du droit à l'AAH. Il est évidemment comique de lire que cet entretien n'entraînerait pas une augmentation des délais déjà "importants".
En ce qui concerne l'AAH, le risque de paiement à tort me semblait être celui du concubinage non déclaré à la CAF. Avec la déconjugalisation, ce "risque" a disparu. Puisque concubinage ou non, le droit est le même.
Les algorithmes de la CAF semblent avoir détecté un risque de fraudes pour les personnes handicapées en déclaration trimestrielle, ayant donc une activité professionnelle ou l'ayant eue. C'est typiquement la situation où la déclaration à la CAF est complexe. Il s'agit sans doute d'erreurs, et non de fraudes. Moi-même, j'ai parfois du mal à conseiller sur la somme à déclarer (j'ai pourtant travaillé professionnellement sur le sujet à partir de 1979).
Le rapport calcule la "suppression du cumul intégral de six mois de l’AAH et des revenus d’activité professionnelle en milieu ordinaire
(applicable pour ceux qui commencent ou reprennent une activité en milieu ordinaire)"(p.36) Évidemment sans tenir compte de l'encouragement à l'emploi de ce cumul.
* J'entends souvent parler de la CMI stationnement. Le problème semble être une utilisation abusive : stationnement sur des places réservées sans droit, utilisation d'une carte périmée ou d'une CMI priorité ou invalidité, utilisation alors que la personne handicapée n'est pas présente. La fraude porte sur l'utilisation, et pas sur l'attribution du droit. Évidemment, le critère des 200 mètres du périmètre de marche attesté par le médecin peut être discutable.



