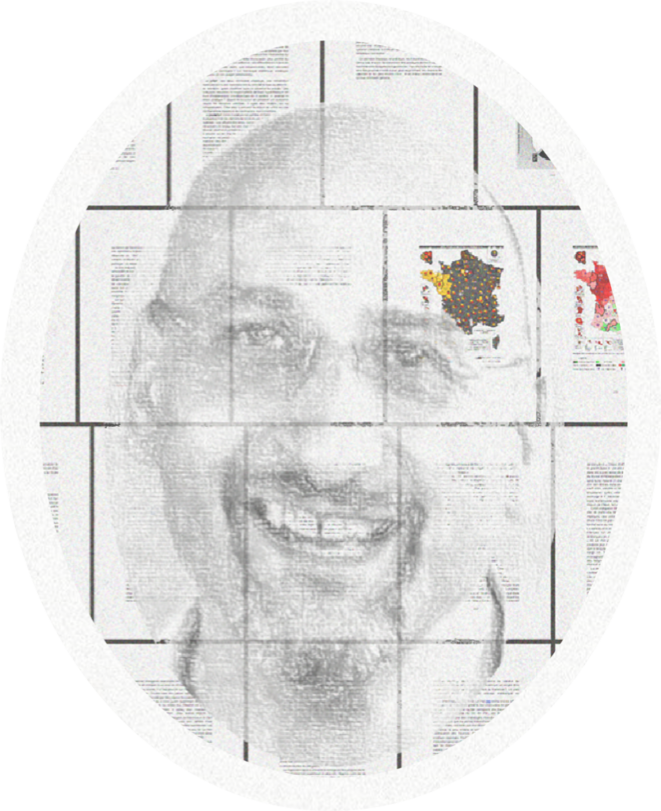Le cycle de conférences est entièrement disponible en ligne :
Nul besoin de dire à la place de l’auteur quel est son projet. L’audition attentive de ces conférences permet vite d’en cerner les qualités et la limite principale. Pour les qualités, il atteint effectivement son objectif de nourrir le débat public de nombreuses notions propices à rendre la société française intelligible. La principale limite transparaît cependant très vite : les singularisations qu’il décrit sont systématiquement accolées à des termes élégiaques : « émancipation », « progressisme »…
Une seule fois au cours de ces heures d’analyse, il s’interroge sur la possibilité de faire société dans ce contexte de singularisations individualistes ; il esquisse donc un semblant de démarche critique, aussitôt évacuée. Il affirme alors, en substance et de mémoire, qu’il est en théorie possible de faire société sur ces bases, car les droits que l’on reconnaît aux autres sont garantis pour soi. Autrement dit, un jour, j’irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien.
- Critique de la démarche et des conclusions de P. Rosanvallon s’agissant de l’individualisme de singularité :
En pratique, cette servilité à l’objet étudié tient à deux vices méthodologiques fondamentaux. Le premier consiste à faire l’histoire par auteurs interposés. Il n’utilise que des sources de deuxième main, jamais des sources brutes. Au vu de sa chronologie, et c’est le point que j’esquisserai infra, il m’a semblé que l’automobile et les politiques de sécurité routière étaient un excellent point d’observation des gestions de ces individualismes, dans une optique de conciliation démocratique entre individus et intérêt général. Le second tient à un problème de définition.
Les individualismes de singularité cachent deux dynamiques distinctes car on part des individus plutôt que des auteurs. Il faut distinguer d’une part les singularités « subies » par les personnes, c’est-à-dire non choisies, peu importe à ce stade qu’elles soient bien ou mal vécues. Bien entendu, à une période où il est à la mode d’affirmer que l’on peut choisir son sexe comme M. Jackson a choisi sa couleur de peau, les singularités acquises ou héritées malgré soi semblent se limiter aux handicaps. Cependant, quels que soient les faux semblants dans lesquels on se drape au présent, la génération suivante, si elle vient au monde, rétablit les réalités du sexe et, plus généralement, de la biologie.
D’autre part, il faut envisager les singularisations qui sont des choix assumés. Qu’il s’agisse de régimes alimentaires, de pratiques vestimentaires ou de tout autre identifiant communautaire, la volonté individuelle s’exerce indubitablement, en engageant la responsabilité afférente. La religion semble se situer à l’interstice entre l’héritage ( familial ou territorial ) et le choix, que l’on étudie la géopolitique des conversions ou la transmission familiale ensuite réinvestie ou renie à l’âge adulte.
En citant K. Marx qui aurait incité chacun à être « l’artiste de sa propre vie », P. Rosanvallon ramène les singularisations à un problème d’autonomie, à un dialogue de soi à soi. Or, tous ces individualismes de singularité ont une dimension normative, exercée sur soi, mais aussi revendiquée pour la communauté nationale. Cet enjeu ignoré par le conférencier est au cœur des problèmes de perception et de gestion de la centrifugeuse singulariste.
Pour en prendre la mesure, il suffit de considérer la prolifération des "phobies". Sans doute un dictionnaire d'après-guerre aurait traité les arachnophobies, xénophobies, agoraphobies et autres phobies dont les radicaux viennent du grec, ce qui les rattache à une société où les lettrés jouent un rôle moteur dans l'évolution de la langue. Désormais, à peu près tout et n'importe quoi est prétexte à phobies et, derrière chacune, on trouve potentiellement des singularismes normatifs.
En effet, sauf à croire que le xénophobe aborde l'étranger dans une pulsion brute qui l'inciterait à prendre une chaussure pour l'écraser comme le ferait l'arachnophobe avec l'araignée ; force est de constater que certaines phobies relèvent de cultures politiques un minimum construites, tandis que d'autres se cantonnent à la psyché, selon laquelle la petite bête mangerait la grosse. Bien sûr, pour en rester à xénophilie ou xénophobie, on peut considérer que ce sont des postures politiques assez superficielles, et par exemple que de nombreux xénophiles assumés tiennent actuellement des discours xénophobes s'agissant de la Russie de V. Poutine. Même si des cultures politiques plus sophistiquées sont imaginables, ces postures dépassent malgré tout la pulsion brute.
Or, en chaque "phobique" politique, il y a rejet d'un système de valeurs et de normes que porteraient les cibles de cette phobie. Autrement dit, il s'agit de rapports de pouvoirs, et du refus de l'autorité législative que tendraient à s'arroger les singularistes. A l'évidence, leur militantisme porte presque toujours des revendications qui touchent aussi bien aux totems culturels qu'aux tabous législatifs ( ou l'inverse ). Toujours est-il que totems et tabous forment les cadres de la communauté nationale.
L’ironie de l’histoire, c’est que P. Rosanvallon récapitule ses engagements comme un antitotalitarisme. Or, cette conférence légitime les velléités autocratiques des singularistes de toutes obédiences. L’importance de la distinction proposée supra commence à poindre. Les revendications des personnes qui subissent leur singularité ne sauraient être abordées par le Législateur de la même manière que celles des personnes qui se singularisent en leur âme et conscience, en étant averties du contexte légal et sociétal qui est le leur.
Nul besoin de rappeler l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » La philosophie et la pratique politiques peinent à déterminer les procédures permettant de faire sourdre cet intérêt général ; cette histoire est inachevée et peut encore suivre de nombreuses voies. En revanche, quand un citoyen se proclame Législateur au mépris de toute reconnaissance officielle de ses vertus et talents, l’usurpation est évidente. De même, son intérêt individuel ne saurait passer pour l’intérêt général, sauf s’il acquiert la force de faire sa loi.
Autrement dit, cette conférence de P. Rosanvallon qui commence avec K. Marx se termine malgré lui avec Hobbes ( Léviathan, chap. 13 ) : « Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. Car la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille et dans les combats effectifs, mais dans un espace de temps où la volonté de s'affronter en des batailles est suffisamment avérée : […] la nature de la guerre ne réside pas dans un combat effectif, mais dans une disposition avérée, allant dans ce sens, aussi longtemps qu'il n'y a pas assurance du contraire. Tout autre temps se nomme Paix. »
Avec Hobbes, violence et ruse seraient les moyens principalement employés pour subjuguer l’autre. Actuellement, en France, voire en Occident, les singularistes misent sur l’impuissance ou l’indétermination de l’Etat pour phagocyter le corps civique avec leurs polémiques puis leurs lois, selon une stratégie dont le féminisme a offert un précédent couronné de succès ( Cf https://blogs.mediapart.fr/jrm-morel/blog/210125/constitutionnalisation-de-l-ivg-vers-un-feminisme-ideologie-d-etat ). 1°, imposer leur lexique et leur grammaire de la langue officielle de la République. 2°, conquérir des institutions clefs et une couverture médiatique quasi-hégémonique. 3°, infléchir le droit civil et constitutionnel. Reste que la cacophonie des singularismes illustre un état d’anarchie et de guerre latente qui favoriserait, avec Hobbes, les tendances absolutistes ; cela afin de recouvrer le souverain bien : la paix civile.
Dans notre paysage politique actuel, trois mouvances politiques s’affrontent dans leurs présupposés sur la citoyenneté ; lesquels restent dans l’implicite, ce qui rend le débat d’autant plus délétère. L’extrême droite réunit les identitaires de la majorité introuvable, disons Gauloise. L’extrême gauche met dans le même bain, au propre comme au figuré ( Cf activisme autour des règlements de piscines municipales au début des années 2020 ) les identitaires de toutes les minorités imaginables. Reste enfin l’extrême centre, identitaire d’une carte nationale d’identité vidée de sa substance civique dans le droit comme dans les perceptions des Français.
Derrière chaque mouvement identitaire se trouve a minima une singularité subie ou un singularisme choisi. Dans le débat public, ces propriétés individuelles auraient vocation à structurer la citoyenneté, voire à définir l’authenticité de la citoyenneté et, par conséquent, les modalités d’action civique. A cette étape de la réflexion, il est particulièrement éclairant de faire un pas de côté vers les politiques de sécurité routière. En effet, celles-ci se sont imposées comme la gestion la plus aboutie des individualismes, à la fois dans une perspective d’intérêt général et dans le respect des normes démocratiques.
- Sécurité routière : un modèle de gestion des singularismes ?
Avant tout, il faut rappeler que ce n’est pas parce que cette politique de sécurité routière serait la plus aboutie qu’elle est parfaite. Ensuite, il faut cadrer les correspondances entre les phénomènes de singularisation et les comportements routiers. Enfin, sans pouvoir conduire ici une étude approfondie qui reste à entreprendre, les principales pistes de réflexion peuvent être dégagées brièvement.
En suivant la conférence de P. Rosanvallon, il apparaît d’emblée que la chronologie qu’il suit correspond à celle de la démocratisation de l’automobile, et que celle-ci a également été vécue, dans un premier temps, comme une émancipation de nombreuses contraintes géographiques. Cependant, que signifie singulariser sa conduite ? Avec P. Rosanvallon, on pourrait croire qu’il serait question de posséder une voiture rouge ou bleue… Avec l’expérience, chacun sait qu’il s’agit plutôt d’avoir le clignotant en option.
Tout usager des autoroutes a déjà pu observer un comportement type, caractéristique de l’individualisme de singularité en société. Lors de trajets domicile travail, il m’a été donné de croiser à de multiples reprises un véhicule professionnel très reconnaissable par sa fonction et par sa conduite singulière. Il s’agissait d’un monomaniaque du rabattement à droite des véhicules. Chacun sait que, sur ce point, le code de la route lui donne raison. C’est d’ailleurs un objet de litige fréquent, car la loi des hommes s’oppose en cela à une loi physique. Dès lors que la voie de droite a une vitesse moyenne de 90-100 km/h, que celle du milieu permet de circuler vers 110-120 km/h, tandis que celle de gauche plafonne vers 130-140 km/h ( oui, les infractions contribuent à déterminer les réalités ) ; il est naturellement dangereux de passer d’une file à l’autre. Pour cette raison, beaucoup de conducteur transgressent le code de la route… Et sont pris en chasse par des singularistes qui se considèrent comme des modèles de citoyenneté.
Pour en revenir au conducteur que j’évoquais, il respectait un point de droit. Cependant, pour l’imposer aux autres, il en transgressait au moins trois. Premièrement, il circulait avec une vitesse moyenne de 140-150 km/h. Pour rappel, ce qui tue sur la route, c’est l’énergie cinétique ( = masse x vitesse au carré ). Deuxièmement, il ne respectait pas les distances de sécurité et plaquait son parechoc avant à quelques mètres à peine du véhicule cible ( vers 140 km/h, autant dire que le temps de réaction avant contact n'est pas pris en considération ). Troisièmement, il utilisait abusivement les appels de phares, voire l’avertisseur sonore. Ce dernier point est un minime, mais quand ces pratiques ne suffisent pas pour contraindre les autres automobilistes, ces singularistes se font parfois les champions des queues de poisson ; ce qui tend à faire de leur véhicule une arme par destination.
Chaque usager des autoroutes a ainsi déjà observé ces trajectoires erratiques d’automobilistes qui cherchent à contraindre les autres sur le point de droit qu’ils connaissent, dont ils se font les exemples en alternant les files de circulation à toute vitesse ; quitte à slalomer entre les véhicules. En résumé, il en va des singularistes dans le débat public comme de ces conducteurs sur autoroutes : ce sont des dangers publics. Le risque est matériel et corporel sur la route ; en société, cela fortifie l’état de guerre de chacun contre chacun décrit par Hobbes au XVIIe siècle.
Un psychiatre lyonnais a fait une étude des cons qui avait occasionné un entretien dans un magazine local, LyonMag. Là, contrairement au sens courant du terme, il pointait que les personnes désignées comme telles n’avaient pas nécessairement des déficiences intellectuelles. Au contraire, les cons les plus « consensuels » selon leur entourage étaient souvent très intelligents, mais enfermés dans leur bulle narcissique. Ils se montraient incapables d’empathie. Ce point est intéressant s’agissant de l’automobile, dont l’habitacle est presque par définition une bulle narcissique. Autrement dit, ce véhicule pourrait agir comme un véritable pousse-au-crime, comme un vecteur de connerie même pour les personnes ordinairement les plus à l’écoute des autres.
A cela s’ajoutent des situations de conduite qui rappellent le sens originel de la connerie, qui peut trouver une expression mathématique simple. En admettant qu’une situation de conduite soit une équation à 15 inconnues, un conducteur ordinaire observant et analysant la route en détecterait peut-être 7 ou 8. Le singulariste décrit ci-dessus croit avoir fait le tour du problème en interprétant une seule variable, celle dont il a fait son obsession : le rabattement à droite. Il apparaît ainsi qu’en droit comme en société, sur la route comme dans le débat médiatique, des personnes ayant raison sur un point isolé peuvent avoir tort dès lors qu’on remet en contexte cette donnée avec les autres paramètres du sujet.
En résumé, les singularistes cumulent les tares psychiatriques et mathématiques de la vie en société. Pour les premières, réseaux sociaux et auto-promotions multimédias ont tôt fait de fragiliser ceux dont l’égo est le plus mal structuré. Quant aux secondes, le simplisme d’explications mono-factorielles de situations complexes est trop souvent le dénominateur commun de nombreux militantismes de tous bords.
Depuis la mort de l’épouse de J. Chaban Delmas, alors Premier ministre, l’Etat réaffirme avec un relatif succès sa souveraineté sur les voies de circulation. Cela est passé par divers types de mesures. Par exemple, le principe « surveiller et punir » de M. Foucauld a été réinventé. Au lieu d’inoculer dans le corps social un sentiment de surveillance généralisée, combiné à un système de sanctions exemplaires ; la surveillance s’est effectivement généralisée avec les radars sur certains types d’infractions, avec des sanctions légères mais massives.
Cela transcrit d’ailleurs une méthode courante des administration centrales pour atteindre les contrevenants les plus dangereux. Au lieu de les cibler directement, ce qui nécessite une forte et onéreuse présence en hommes, on modifie le comportement des masses. Ainsi, par ricochet et par exemple, ceux qui étaient en excès de vitesse à 200 km/h pour des vitesses moyennes sur autoroutes à 140-150 km/h ; voyant celle-ci baisser à 110-120 km/h, leur excès corrélé au sentiment relatif de vitesse finit par s’ajuster à la baisse, vers 160-170 km/h… C’est l’un des défauts récurrents des politiques de contrôle des masses engagées par le pouvoir central : atteindre tout le corps social légèrement pour policer indirectement les cas les plus antisociaux. Bien entendu, la tolérance des masses n’est pas illimitée, comme le mouvement des gilets jaunes l’a montré en tirant prétexte d’une norme en elle-même dérisoire, mais s’ajoutant à des décennies de contraintes croissantes ; assorties de verbalisations d’infractions isolées plus que de comportements représentant chaque fois un danger systémique et caractérisé. Dans un autre domaine, quand le gouvernement Attal s’interrogeait sur le port de l’uniforme à l’école, était-ce une contrainte pensée pour tous de manière à atteindre indirectement les porteurs de voiles et d’abayas ? Nous serions bien alors dans la gestion détournée des singularismes par une mesure totalisante, potentiellement dénoncée comme totalitaire.
Les exigences du permis de conduire se sont renforcées, à la fois au niveau de la formation initiale et de la formation continue. Clairement, côté citoyenneté, on ne saurait en dire autant ni pour l’une, ni pour l’autre. Mieux formés, plus contrôlés, les conducteurs à risque ( bien ou mal détectés par le système des points, c’est un autre débat ) sont également rééduqués par des stages de sécurité routière. E. Zemmour, lors de la campagne présidentielle 2022, s’est fait l’écho des contrevenants en affirmant que de tels stages étaient infantilisants. Assurément, consacrer deux jours à cela, à la suite de sanctions parfois assumées comme justes, parfois perçues comme abusives, cela suscite du mécontentement. En revanche, peut-on être aussi catégorique et évacuer d’un revers de main cette politique ? Il faut garder à l’esprit qu’elle consiste à réunir des citoyens autour d’une table, après identification ( bonne ou mauvaise ) pour leur conduite à risque, afin d’échanger sur un problème d’intérêt général : la sécurité routière.
Là encore, le système est sans doute perfectible, mais il s’agissait de montrer qu’en matière de conciliation des dynamiques singularistes et de réinvention de la citoyenneté, la sécurité routière est l’un des laboratoires les plus aboutis. Nous bénéficions désormais d’un retour d’expérience qui atteint le demi-siècle. Malgré cela, le grand public est profondément embrouillé par les signaux contradictoires. Le même vecteur, la télévision, leur sert tantôt des messages officiels de sécurité routière, tantôt des publicités attisant leurs fantasmes. Tous ne hiérarchisent ni ne discriminent convenablement ces injonctions contradictoires. Ce problème se rencontre sans doute pour la majorité des questions de société.
Les éléments de réflexion exposés ici constituent moins un examen exhaustif que la formulation d’hypothèses, qu’une source d’inspiration. Je passe par ce biais car je sais que je n’aurai pas le temps de mener cette étude à son terme ; libre à chacun de l’entreprendre. Sans doute des directeurs de recherches trouveraient-ils qu’il s’agit d’un beau sujet ; lequel permettrait d’ancrer les théories de P. Rosanvallon dans le réel.
- Réinventer la citoyenneté, entre centrifugeuse singulariste et intérêt général pacificateur :
Je l’ai développé ailleurs[1], la citoyenneté française est presque totalement vidée de toute consistance juridique. A ce titre, j’ai pleinement conscience que la réflexion engagée ici n’est pas une solution à la hauteur du mal qui a été fait. Néanmoins, il me semble aussi que c’est une entrée plus facile que les autres, car elle s’appuie sur des pratiques existantes et peut engendrer des réformes ponctuelles qui, chacune, constitueraient des avancées sans nécessité de refondre en une seule fois un système juridique dévoyé.
D’autres pistes et pratiques peuvent être explorées dans une même optique, entre vie associative et engagements civiques en lien avec les pouvoirs publics. Dans une période où chacun s’invente sa citoyenneté, celle-ci tient au pire du nombrilisme, au mieux du bénévolat. Les uns le pratiquent dans des structures émanant exclusivement de la société civile, les associations loi 1901 ; d’autres s’adossent à la fonction publique, par exemple les pompiers volontaires, les réservistes de l'armée dont il est beaucoup question actuellement…
Entre les deux, on peut compter les associations de parents d’élèves, qui ont un impact sociétal à la mesure du public cible : plus de dix millions de jeunes français. Peut-on placer sur le même plan des engagements civiques définis dans l’entre-soi associatif ( pour le meilleur et pour le pire ) et ceux au contact voire en situation de personnes ayant appris à agir en fonctionnaires de l’Etat ? D’ailleurs, à supposer qu’une réflexion collective s’engage sur la citoyenneté française du XXIe siècle, doit-elle servir l’Etat, la nation, ou une idéologie ? C’est une ligne de fracture majeure dans les cultures politiques actuelles. Elle pourrait durablement enliser les débats.
Car en dernière instance, c’est bien dans le domaine juridique que l’Etat devrait retrouver ses prérogatives pour définir le citoyen, avec toutes les implications pénales, civiles et institutionnelles que cela peut avoir ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/071224/legislatives-2024-documents-principaux-video-8-perspectives ). Ce chantier est immense car tout est à refonder. Notre droit en la matière est un champ de ruines, et nos esprits se sont effondrés avec les clefs de voûte de la République ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/040325/legislatives-2024-front-republicain-republique-et-separatismes-de-gauc ). En tout cas, dans les médias de masse, plus personne ne semble encore connaître les fondamentaux historiques et juridiques de la citoyenneté républicaine, au regard des définitions et pratiques qui ont traversé les régimes à partir de 1789-1791-1792 ( DDHC, première constitution, première République ). Il est inutile d’engager une telle réinitialisation du droit avant d’avoir recadré l’action publique par une refonte intellectuelle.
Dans un premier temps, l’exemple de la sécurité routière montre que, sur des problèmes d’intérêt général, il serait opportun de remettre les Français autour d’une table pour échanger sur les solutions à trouver, sur leur contribution personnelle à fournir. Ce n’est pas neuf, mais n’est pas systématisé non plus, entre bénévolat d’une part, injonction administrative d’autre part, et quelques intermédiaires. Surtout, l’observation des médias et des cultures politiques telles qu’elles s’expriment dans les urnes me laisse croire que des Français ne se connaissant que par médias interposés sont voués à se haïr, à finir face-à-face.
Derrière les singularismes, il y a des problématiques identitaires. Or, l’identité de chacun est composite. Le temps d’une prise de parole dans un média peut réduire le citoyen, dans la complexité de ses engagements, à une seule variable identitaire qui cristallise ensuite les approbations et oppositions. Cela prétexte régulièrement des hystérisations du débat public, aussi rapidement montées en première page que passées d’actualité. Le fait de travailler entre citoyens mélangés sur des problèmes d’intérêt général durant une période assez longue permet de faire éclater ces raccourcis identitaires et d’amorcer une démarche contractuelle : qui fait ou ne fait pas le travail ? Qui fait ou ne fait pas avancer le collectif ?...
[1] J. Morel, 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, 266 p.