Brouillon daté du 01/07/2019 20:44
Dans la préface à sa première œuvre publiée, le Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein écrit que «[le] but [de ce livre] serait atteint s'il se trouvait quelqu'un qui, l'ayant lu et compris, en retirait du plaisir». Je ne m'aventurerai pas à prétendre l'avoir compris mais du moins, l'ayant lu j'en ai retiré du plaisir. Dans la courte présentation de ce billet je dis l'avoir découvert plutôt par hasard. Plus ou moins. Je suis intéressé par le langage de longue date, et si j'ai considéré que, finalement, ça pouvait valoir le coup de faire des études supérieures, c'est pour ça, pour faire de la linguistique, des sciences du langage comme on dit à l'Université, et à juste titre car ce domaine réunit plusieurs sciences qui ont pour seul lien de concerner les langues. À un moment j'ai rencontré la philosophie analytique dans l'une de ses écoles, la «philosophie du langage ordinaire», et elle conduit à Wittgenstein, sauf bien sûr si on s'arrête aux considérations souvent douteuses de ces supposés émules de Wittgenstein, qui dissuaderaient aisément d'aller voir plus loin.
Ce dont parle principalement... Ouais. Je ne sais pas de quoi parle principalement cet auteur. Je reprends.
La principale leçon que je retiens de cet ouvrage est la question des “états de chose”. Voici la structure du Tractatus:
«1 - Le monde est tout ce qui a lieu.
2 - Ce qui a lieu, le fait, est la subsistance d'états de chose.
3 - L'image logique des faits est la pensée.
4 - La pensée est la proposition pourvue de sens.
5 - La proposition est une fonction de vérité des propositions élémentaires.
(La proposition élémentaire est une fonction de vérité d'elle-même).
6. - La forme générale de la fonction de vérité est: [ ̅p, ̅ξ , N( ̅ξ)].
C'est la forme générale de la proposition.
7 - Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence».
Après trois plantages successifs de mon ordinateur et conséquemment, la perte de ce que j'avais écrit après cette citation – perte profitable, en fait, car j'écrivis des propos sans valeur –, j'ai décidé de trouver moyen de remédier à un problème, transcrire la partie entre crochets de la proposition 6. J'ai eu idée d'insérer une image de cette partie, ça ne donnait pas un résultat correct; j'ai inséré toute la proposition comme image, pas terrible non plus. Du coup j'ai cherché plus précisément – quand on a du vocabulaire ça aide, on ne sait pas ce qu'on cherche mais on peut le nommer, donc trouver l'objet qui porte un tel nom, et qui a de fortes chances d'être l'objet qu'on cherche.
Le curieux est que cette partie entre crochets n'a nul intérêt en soi. Une part importante de ce qui va de la proposition 5.101 à la proposition 6.1221 n'a pas de valeur en soi et pour l'essentiel vise à valider la proposition qui vient juste après:
«6.1222 - Cela éclaire la question: pourquoi les propositions logiques ne peuvent-elles être confirmées par l'expérience, pas plus que par l'expérience elles ne peuvent être réfutées. Non seulement une proposition de la logique ne peut être réfutée par aucune expérience possible, mais encore elle ne peut être confirmée par aucune».
On peut comprendre la partie allant de 5.101 à 6.1221 comme une mise en cause radicale de certaines propositions de Bertrand Russell et du courant auquel il se rattache. Il est d'ailleurs amusant de constater que ledit Russell semble bien n'avoir pas fait partie, du point de vue de Wittgenstein, de la classe de son lectorat «qui, ayant lu et compris ce livre, en retirerait du plaisir» (ce n'est pas une citation littérale). Je ne parle pas sans savoir puisque son plus récent traducteur en français, Gilles Gaston Granger, cite cette lettre de l'auteur à son préfacier de l'édition anglaise, lequel était Russell:
«Ton Introduction ne sera pas imprimée, et, par conséquent, il est vraisemblable que mon livre ne le sera pas non plus. Car lorsque j'ai eu devant les yeux la traduction allemande de l'Introduction, je n'ai pu alors me résoudre à la laisser imprimer avec mon livre. La finesse de ton style anglais s'était en effet, comme il est naturel, perdue dans la traduction, et ce qui restait n'était que superficialité et incompréhension...».
Manière on ne peut plus directe de le traiter de rhéteur et de sophiste. Dans le Tractatus même il n'y va pas non plus avec modération et les propositions qui suivent la partie mentionnée sont assez explicites:
«6.1222 - Cela éclaire la question: pourquoi les propositions logiques ne peuvent-elles être confirmées par l'expérience, pas plus que par l'expérience elles ne peuvent être réfutées. Non seulement une proposition de la logique ne peut être réfutée par aucune expérience possible, mais encore elle ne peut être confirmée par aucune.
6.1223 - La raison sera maintenant claire pour laquelle on a souvent eu le sentiment que les “vérités logiques” doivent être de nous “exigées”: nous pouvons en effet les exiger, dans la mesure où nous pouvons exiger une notation convenable.
6.1224 - La raison sera également claire pour laquelle la logique a été nommée théorie des formes et des déductions.
6.123 - Il est clair que les lois logiques ne doivent pas elles mêmes se soumettre derechef à des lois logiques.
(Il n'y a pas, comme le voulait Russell, pour chaque “type” une loi de contradiction particulière, mais une seule suffit, parce qu'elle ne s'applique pas à elle-même.)».
Les mots ont un sens. Un sens interne à la langue même: ils pointent une certaine réalité, celle qu'ils constituent: la réalité linguistique. Je cite toujours le même ensemble assez limité d'auteurs, plus un livre sans auteur, Le Livre comme l'écrivent les adeptes “rigoristes” dudit livre – certains considérant que c'est même le seul qu'il faille lire –, La Bible, mot qui est le nom d'une ville et celui d'un roseau (en fait, bublos, βύβλος, “papyrus” – mot qui lui-même donna le mot “papier” en passant par le latin, en grec ancien πάπυρος, papuros, désigne la plante même, le βύβλος étant son écorce déroulée à usage de support d'écriture, donc du “papier”. C'est ainsi...) et le mot signifiant “livre” en grec ancien, ergo La Bible signifie bien Le Livre – le Livre des livres, à double titre: le premier et plus haut de tous les livres (d'un point de vue idéologique; d'un point de vue historique il exista des livres bien avant celui-ci, et d'un point de vue ethnologique, dans d'autres traditions le plus haut de tous les livres n'est pas celui-là) et donc pour certains le seul, et aussi, un livre formé lui-même de plusieurs livres. Je cite souvent les mêmes auteurs et livres parce que ça me suffit pour y puiser des propositions intéressantes de mon point de vue. Pour mention Wittgenstein ne fait pas partie de mes habituels auteurs de référence, j'en use depuis quelques temps mais ça ne devrait pas durer, il se trouve que certaines de ses propositions du Tractatus logico-philosophicus conviennent à mes discussions actuelles. Donc, les même auteurs, entre autres, et seulement pour un passage assez court de son œuvre, même s'il m'est arrivé de le citer plus longuement, Marshall McLuhan. Le passage figure dans plusieurs de ces billets, et désormais figurera dans celui-ci:
«Dans des cultures comme les nôtres, depuis longtemps habituées à séparer et diviser les choses comme un moyen de contrôle, il est parfois un peu choquant de se faire rappeler que, d'un point de vue effectif et pratique, le moyen est le message [...], que les conséquences individuelles et sociales de tout médium – c'est-à-dire, toute extension de nous-mêmes – proviennent du changement d'échelle produit dans nos entreprises par chaque extension de nous-mêmes, ou par toute nouvelle technologie».
Pour reprendre une formule qui figure dans un précédent billet, «racontons ma vie». Une chose que j'évite sinon quand j'ai besoin d'un exemple et qu'un épisode quelconque de ma biographie peut me servir, mais il ne s'agit pas de raconter ma vie, juste de rapporter un événement de la réalité que je peux certifier parce qu'il fait partie de ma propre réalité. Donc, racontons ma vie. Il se peut, mais j'ose espérer que non, que mes possibles lectrices et lecteurs considèrent que je raconte toujours un peu la même chose et toujours un peu de la même manière. Ce n'est qu'en partie exact. Une impression qui peut d'ailleurs être renforcée par le fait que j'écris souvent des trucs du genre «comme je le dis par ailleurs» ou «je développe plus ceci dans des discussions antérieures», et par le fait que, “comme je le dis assez souvent”, j'écris au fil du clavier. Beaucoup de mes textes sont des sortes de brouillons, d'un texte à un autre je peux aborder le même sujet et, censément, les précédents écrits forment une matière première pour les suivants. Non que j'aille proprement y puiser, même si ça m'arrive le plus souvent je ne me cite pas ni ne reprends des segments de mes textes, ne serait-ce que parce que je me relis assez peu avec ce genre d'intentions, j'en ai la mémoire, voilà tout, ce qui m'intéresse dans les textes antérieurs ce sont les idées, non les formes qu'elles y ont. Pour le reste, et bien, un écrit qui me semble valable dans la forme ou/et le fond est utilisable à loisir pour y trouver de nouveaux aspects en résonance avec de nouveaux propos de mon cru. McLuhan me sert non pour redire les mêmes choses en usant de lui comme argument d'autorité mais pour éclairer certaines de mes considérations, quand ça me semble bienvenu. Cela dit, c'est vrai que je me répète, que plusieurs billets de ce blog et plusieurs discussion sur mon site personnel «parlent de la même chose» et de manière assez similaire. Ce qui ne me pose pas problème: je ne suppose pas que mon possible lectorat ait désir de lire l'ensemble de ma Formidable Prose, et si par hasard on tombe sur une discussion qui ressemble furieusement à une autre, je suppose que l'on fera comme je le fais avec d'autres auteurs, on laissera tomber en se disant qu'on a déjà lu ça dans un autre billet. Un essai n'est pas un roman, on peut se douter qu'un auteur aura tendance à reprendre souvent les mêmes thèmes mais autant j'ai plaisir à lire les multiples variations d'un romancier sur un thème récurrent, autant je n'aurai souvent pas le même plaisir avec un essayiste. Donc, McLuhan et cette citation.
Vous aurez probablement reconnu le slogan retenu dans ce passage, la “petite phrase” à quoi on résume souvent le propos de l'auteur, «le moyen est le message», sinon qu'on le donne sous la forme «le medium est le message». L'auteur emploie le terme en un sens moins étroit que ce que le plus souvent il recouvre en précisant, «tout médium – c'est-à-dire, toute extension de nous-mêmes», tout “moyen”, ce que signifiait ce mot en latin: chose, moment, lieu, personne “au milieu”, “entre”, “au centre”, “intermédiaire” – comme substantif le mot medius dont dérive medium signifiait “intermédiaire”, “arbitre” –; en français actuel le médius est le medius digitus, le «doigt du milieu». Les diverses significations persistent dans des domaines ou emplois particuliers, comme la définition du Trésor de la langue française (le TLF) l'indique. Mais pour un usager ordinaire du terme, l'acception dominante est: «Moyen de transmission d'un message». Et plus particulièrement, avec l'utilisation de “média” – originellement media est le pluriel de medium, on l'emploie souvent comme un singulier en français, le pluriel étant alors “médias” –, les moyens de communication “de masse”, mass media, “médias de masse”. McLuhan a ici un emploi “académique” du terme: dans l'anglais savant, universitaire, on emploie beaucoup de termes adaptés ou repris du latin. Ça se fait aussi en français académique mais la tendance est plus à la reprise ou la création de mots qui puisent dans un fonds grec, ou de mots composés avec un mélange d'éléments grecs et latins, car pour un universitaire français le latin est à la base de sa propre langue, nombre de mots repris du latin sont d'abord passés par l'anglais ou l'allemand, c'est le cas de mass media, expression inventée semble-t-il en 1923 aux États-Unis, désignant les «moyens de communication à distance dans l'espace ou/et dans le temps vers un public large et non déterminé», la presse, la radio, le cinéma. Dans l'usage académique anglophone, medium conserve souvent cet emploi général de “moyen”, “instrument”, “intermédiaire”, et justement McLuhan est un universitaire anglo-saxon qui partagea son temps entre le Canada, son pays de naissance, la Grande-Bretagne – l'Angleterre – et les États-Unis.
J'ai coutume de dire que les mots n'ont pas de sens, ce qui signifie pour moi qu'ils ne réfèrent pas à quelque réalité extralinguistique prédéfinie, ce type de sens s'acquiert dans le cadre d'une phrase, d'un discours, c'est non tant chaque mot que l'ensemble que constitue la phrase, le discours, qui ont ce type de sens. Le seul sens d'un mot est la référence au type de réalité dont il participe, la langue. Le moyen est le message, la langue est un moyen et donc son propre message: parler ou écrire c'est toujours se référer à une réalité autonome, la réalité symbolique. J'apprécie l'étymologie parce qu'elle nous enseigne beaucoup sur les intentions des usagers. La langue est toujours auto-référentielle, on dispose d'une stock fini d'éléments pour “fabriquer la langue”, donc d'un stock fini de combinaisons possibles. En premier, les formants élémentaires, les sons et les motifs graphiques (les “lettres” et les pictogrammes). En théorie, une écriture idéographique dispose d'un nombre infini de formants élémentaires puisque chaque réalité extralinguistique devrait se voir associer un idéogramme unique, dans les faits ça n'arrive pas pour la raison évidente que la capacité de mémorisation des humains n'est pas infinie, toutes les écritures pictographiques ou idéographiques utilisent des procédés de combinaison de symboles pour associer des sens ou des sons – en ce cas on retient la valeur sonore du mot associé à un dessin et non sa signification, ce qui indique on ne peut mieux le caractère autoréférentiel des langages, ici ceux écrits, puisque ce qu'on retient n'est pas la référence effective mais la référence interne, l'association entre un motif graphique et des sons de la langue. Les langues orales ont toutes en commun un stock assez limité de sons considérés significatifs, ce qu'on nomme les phonèmes, selon les langues ce stock ira d'une vingtaine à une quarantaine de phonèmes, rarement moins ou plus. Une langue donnée comporte souvent plus de sons nettement différenciables que de phonèmes, pour exemple tout locuteur du français différenciera les sons [r] et [ʁ] le “r roulé” qui résulte d'une vibration de la langue contre le palais, et le “r guttural” (ou “r uvulaire”), qui résulte d'une vibration de la luette, mais identifiera un seul phonème, noté /ʁ/,qui inclut ces deux sons et d'autres, dont le “r grasseyé” noté [R], ce que les germanophones nomment le “Ach-Laut”, noté [χ], et ce que les espagnols nomment la jota, notée ['x] – ces notations sont celles de l'alphabet phonétique international, l'API. Les phonèmes et les graphèmes, leur équivalent écrit, sont des formes aussi arbitraires que l'est le lien entre un mot prononcé ou rédigé et les significations qu'on peut lui attribuer, on croit “reconnaître une forme” entre des objets assez disparates:
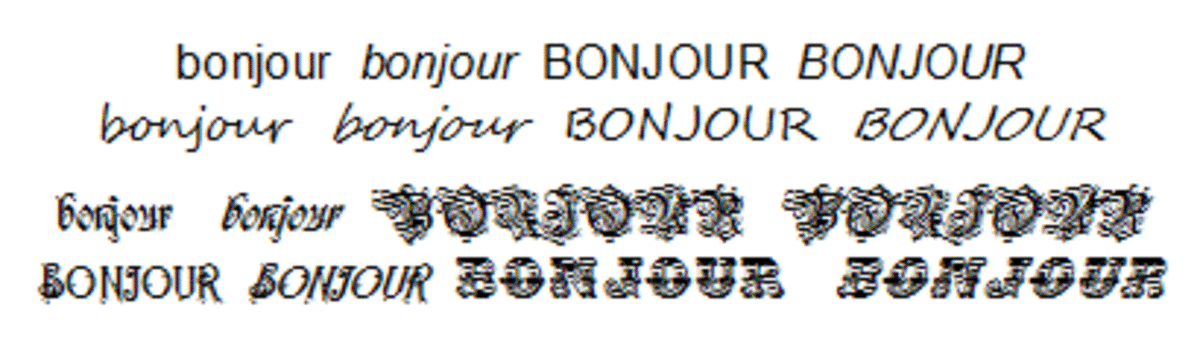
c'est seize fois “la même forme”. Seuls l'habitude et notre faible discernement nous les font percevoir tels – un faible discernement volontaire – alors que chaque “bonjour” a une forme différente. Le principe même de la langue: procéder par simplifications, par abstractions. Je l'esquissais, il y a une grande distance entre notre perception normalisée des sons de la langue, celle dont traite la phonologie, et les émissions réelles que décrit la phonétique. Il en est de même pour les tracés de graphèmes, que ce soit par un abécédaire, un syllabaire ou un système à base pictographique, qui varient d'un individu à un autre, et varient pour chaque individu: de même qu'il y a des variations locales dans la graphie comme dans la phonie, il y a des variations positionnelles (pour les écritures alphabétiques ou syllabiques on écrit souvent différemment une lettre selon sa position dans un mot et selon les lettres qui précèdent ou suivent, à l'instar des variations du même ordre selon la position d'un phonème et son environnement dans une suite de sons) et contextuelles (on n'écrira ni ne prononcera de la même manière si on est fatigué ou non, préoccupé ou non, seul ou entouré, etc.). Pour prendre mon cas, j'ai une certaine tendance à la dyslexie mais avec le temps j'ai à-peu-près réussi à ne pas y céder, mais si je suis assez fatigué ou si j'écris un peu vite il m'arrive encore de mettre un “p” ou un “g” à la place d'un “q”, un “q” à la place d'un “g”, un “d” à la place d'un “b” ou l'inverse, y compris avec un clavier où pourtant “la bonne lettre” est toujours à la même place – ce qui montre au passage que les conditionnements ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on le pourrait croire... Avec l'écrit, en outre, on a aussi des cas d'indétermination tels qu'on en peut avoir à l'oral même si pour d'autres raisons: à l'oral certains phonèmes assez ou très proches dans leur articulation peuvent être mal prononcés ou entendus. Pour exemple, ces deux séries de sons:
p b m
t d n
Tous appartiennent à l'ensemble des consonnes dites explosives ou occlusives: on doit fermer la colonne d'air portant le son, l'occlure, pour émettre un son brusque, explosif, à l'ouverture de la colonne d'air; pour la première série, l'occlusion se fait au niveau des lèvres, pour la seconde au niveau du palais, juste au-dessus les dents: la deuxième de chaque série est dite voisée parce qu'elle s'accompagne d'une forte vibration des cordes vocales, de la “voix”, la troisième est dite nasale car une partie mobile à l'arrière du palais, le voile du palais, qui permet l'ouverture et la fermeture du conduit qui relie la bouche et les fosses nasales, est en position ouverte, ce qui fait qu'une partie de la colonne d'air passe par cette voie et provoque une résonance différente, “nasale”; selon les contextes l'émission ou la réception de ces sons sera plus ou moins perturbée et on ne saura pas toujours déterminer si le son émis est un “p” ou un “b”, un “p” ou un “t”, un “m” ou un “n” – chose assez commune, notamment dans des environnements bruyants ou dans des communications distantes (téléphone, radio) pour qu'on ait conçu des méthodes de discernement – les “papa”, “tango” et “charlie” qui peuvent faire des titres de chanson et qui pour les aviateurs notamment permettent de s'assurer que tel son est “p” comme “papa” et non “t” comme “tango” ou “b” comme “bravo”.
On dispose donc d'un nombre fini de sons signifiants, et de graphèmes identifiables – ici, la finitude est moindre selon les systèmes: un abécédaire compte rarement plus de trente signes, un syllabaire en comptera souvent entre cent-cinquante et deux-cent mais peut en compter plus de cinq-cent, un système au moins en partie pictographique en comptera un nombre non fini et souvent très important – le nombre de caractères chinois par exemple est estimé, dit l'article de Wikipédia, entre 40.000 et 60.000 (l'indétermination vient entre autres du fait que certains caractères sont des variantes ou des archaïsmes), mais il précise aussi que «le chinois courant requiert la connaissance de 3 000 à 5 000 sinogrammes» – “seulement”, osera-t-on dire... Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients: les abécédaires et syllabaires limitent grandement le nombre de signes nécessaires, mais ne transcrivent que la forme des mots, sont une équivalence de leur valeur sonore, donc requièrent de connaître la valeur phonique de chaque graphème, et ne donnent accès au sens que si l'on connaît déjà la langue transcrite; une écriture purement idéographique peut transcrire n'importe quelle langue puisqu'on note les sens mais nécessite donc de connaître la valeur de sens de beaucoup de graphèmes, et en outre fonctionne comme un rébus, tels mots composés de deux ou trois graphèmes nécessitent souvent une connaissance de la culture pour être décodés, je cite ces deux exemples donnés par l'article «Chinois écrit»:
中文 (zhōngwén = milieu + écrits)
中國 (zhōngguó = milieu + royaume)
Les transcriptions correspondent au chinois mandarin dans le système dit pinyin. Le premier groupe désigne le chinois, le second, la Chine: l'accès au sens du premier requiert de savoir que pour les Chinois la Chine est «le royaume du milieu» ou «l'empire du milieu», “donc” le chinois est les «écrits du milieu» car il transcrit les langues du «royaume du milieu» – donc entre guillemets car sans la connaissance du savoir qui explique le second mot, la compréhension de la désignation «écrits du milieu» sera impossible, donc la détermination de la réalité extralinguistique visée difficile, incertaine.
On dispose aussi d'un nombre fini de formes significatives parce que le nombre de formes signifiantes est limité. Sans dire qu'on ne peut pas l'intégrer au système, le nom tchécoslovaque “Trnka” ne correspond pas aux formes spontanément produites en français, parce que la phonologie de ces deux langues est différentes: en tchèque le graphème “r” correspond à deux sons possibles, le /r/ consonne et le /r/ voyelle. La transcription proposée par l'article sur Jiří Trnka, yir-ji trènn-ka, est suffisante pour le français mais rend incomplètement compte de la prononciation tchèque, où les deux sons /r/ et /è/ ne sont pas consécutifs mais superposés, ne forment qu'un son. Par expérience je peux vous dire que prononcer ce “r voyelle” est à-peu-près impossible pour un locuteur du français qui ne pratique ordinairement que cette langue; j'ai appris le principe, qui en gros, consiste à placer la pointe de la langue sur un côté du palais pour produire un son très proche du “r roulé”, la partie libre de la colonne d'air produisant un son proche du “è”, les deux étant, comme dit, émis en même temps. Une gymnastique pas évidente quand on a pas pratiqué dès le berceau, ou peu s'en faut... Quelle que soit la langue, le stock de formes combinées spontanément construites est limité, pour autre illustration avec deux langues assez proches, le français et l'italien, les Italiens autres que ceux du Tyrol ont beaucoup de difficultés avec les mots se terminant par une voyelle occlusive telle que le /k/ et si on se prénomme Éric, on sera vite baptisé Erico. Autre limite, la longueur des combinaisons, variable selon les langues mais non infinie. À un niveau, on peut considérer un texte clos comme un seul mot de longueur assez ou très grande, sous un certain aspect À la recherche du temps perdu est une sorte de mot extrêmement long puisque le sens complet de l'ensemble est, comme disait Leibniz, une monade, je le précise de nouveau car l'article cite d'autres approches, je parle de la monade chez Leibniz, plus exactement, dans une généralisation découlant de sa “monadologie”, la monade comme unité de sens, comme “atome de réalité”, ici appliquée aux réalités symboliques: le long roman de Proust, à la fois se compose d'unités de forme et de sens d'étendue variable, du graphème au mot, du mot à la phrase, de la phrase au chapitre, du chapitre au volume, l'ensemble des volumes formant le roman, qui forme lui-même dans son ensemble une unité de sens. À un autre niveau, celui, dira-t-on, des voies d'accès à la réalité effective, nous devons procéder à une sérialisation des “situations”, nous constituer des catalogues de choses perçues qui nous permettront, dans des “situations” ultérieures de les “reconnaître”, de les identifier comme similaires à des cas antérieurs. Des situations entre guillemets et reconnaître entre guillemets car aucun contexte n'est strictement similaire à aucun autre, donc on identifie quelque chose qui a certaines caractéristiques communes avec d'autres choses sans y correspondre effectivement, on situe des éléments qui sont pour soi significatifs, que l'on abstrait du contexte global pour les comparer à des abstractions antérieures.
Dans des précédents billets je discutais du fait qu'on reconnaît le plus souvent un système de signes de type parole ou écrit même quand on ne le connaît pas et, dans le cas de l'écrit, même si on ne sait décoder aucun système de ce genre – vous avez déjà vu, comme moi, des personnes, généralement des jeunes humains mais pas seulement, qui “lisent” ou “écrivent” sans savoir ni lire ni écrire aucune langue, parce qu'on n'a pas besoin de savoir décoder pour savoir que c'est un code, et quel type de code; bien sûr ils “font semblant de lire” et ils “font semblant d'écrire”, racontent un récit qui ne correspond pas à celui qui figure dans le texte et dessinent des lignes discontinues ou en vaguelettes, mais on ne peut pas proprement dire que ni ils ne lisent ni ils n'écrivent, ils font quelque chose “à la semblance de” donc c'est effectivement “de la lecture” et “de l'écriture” car au-delà du “sens des mots” l'écriture est en soi son propre message, des traces d'une certaine forme sur un certain type de support pour un certain usage. Je me rappelle d'une anecdote rapportée par je ne sais plus quel ethnologue: lors d'un travail de terrain auprès d'une population “illettrée” il prenait des notes sur son enquête, et asse vite le médiateur local avec les “puissances naturelles et surnaturelles” – le ce qu'on veut, prêtre, ou sorcier, ou shaman, bref, le “médium” local – lui demanda du papier et un crayon, et à son tour “prit des notes”; lesdites notes consistaient en des simples lignes un peu ondulées, mais qu'il était tout-à-fait capables de “relire” car il avait très bien compris la vertu première de l'écriture, constituer un instrument de pouvoir: savoir “faire parler les choses” est la pratique habituelle de ces médiateurs, ce moyen-ci correspondait donc à ce qu'il connaissait, et pour lui importait surtout qu'il sache “faire parler la page”, qu'il sache “lire les signes” dans ses “lignes d'écriture” – un instrument de pouvoir supplémentaire dans son réservoir d'instruments de ce type. Au-delà de ces cas limites, reconnaître un système de signes qui “fait langage” c'est identifier une forme particulière d'abstraction qui correspond formellement à une autre dont on a l'habitude, qui construit des “unités de sens” artificielles (qu'on ne trouve pas constituées d'avance hors certains contextes, spécifiquement les sociétés humaines. Sous un aspect ce sont des objets naturels, comme n'importe quel objet ce sont des segments déterminés de la réalité observable, leur artificialité vient de ce que pour produire ce type particulier d'objets on doit préalablement acquérir des compétences qui n'ont lieu que dans un cadre social et pour ce cadre).
Ce qui nous fait identifier les douze variantes de la forme “bonjour” comme «douze fois le même mot» n'est pas leur similarité factuelle mais les rapports de formes des parties abstraites de ces formes: le premier formant est constitué d'une barre verticale longue plus ou moins droite complétée d'un cercle en bas à droite ou de deux cercles superposés, le second et le cinquième sont constitués d'un cercle fermé parfois complété d'un petit appendice en haut à droite, le troisième est une barre verticale courte plus ou moins droite complétée à droite d'une ligne courbe ou d'une barre verticale longue plus ou moins droite complétée d'une ligne oblique allant d'en haut à gauche à en bas à droite puis d'une deuxième barre verticale longue plus ou moins droite – et de même pour les quatrième, sixième et septième formants qui ont des caractéristiques constantes quelle que soit leur variation. Les formes “minuscules” des troisième et septième formants sont assez semblables sinon une ligne courbe à droite plus brève pour le septième, les formes “minuscules” des troisième et sixième formants sont les mêmes mais le sixième a une orientation décalée de 180° par rapport au troisième. La suite de ces sept signes en minuscules, en majuscules ou dans un mélange des deux variantes (j'aurais aussi pu proposer des formes comme Bonjour ou bONjoUR ou BoNJouR, etc.) dans cet ordre est toujours identifiable comme «le mot “bonjour”» et tout locuteur du français peut lui attribuer une valeur standard de son, /bɔ̃ʒuʁ/, et une valeur de sens conventionnelle, “salutation du matin”, ou analytique, “bon” + “jour” – même si on ne connaît pas le mot, si on connaît ses deux formants qui sont aussi des mots on peut deviner que comme beaucoup de formules de politesse il s'agit d'une formule propitiatoire, ici “vivre un jour qui soit favorable”. Les quelques mots composés avec des “sinogrammes”, des idéogrammes du système chinois d'écriture, proposés à titre d'exemples, sont identifiables en tant que “formants d'un système d'écriture” même s'ils sont pour soi indécodables, il me faut faire confiance aux rédacteurs de Wikipédia pour savoir et croire que les signes 中文 correspondent au mot prononcé zhōngwén en mandarin, que le premier signe a le sens général “milieu”, et le second le sens général “écrits”, et que leur combinaison dans un certain ordre (le premier à gauche ou en haut, le deuxième à droite ou en bas) signifie “chinois écrit” en chinois.
Bon bon bon... Et pourquoi est-ce que je raconte tout ça, au fait? Bon, je me relis un peu... Ah oui! Le moyen est le message...
Bon bon bon bon... Je fais mon rhéteur – mais j'aime bien ça. En réalité je n'ai pas eu à me relire, je me suis posé la question in petto du pourquoi de ces considérations sur la langue et j'ai eu assez vite la réponse en une pensée informulée qui incluait un sentiment “exclamatif” et la remémoration que le sujet initial se rapportait à cette sentence de McLuhan, pensée qu'on peut transcrire comme «Ah oui! “Le moyen est le message”». J'en parle plus ailleurs, une pensée est proprement une monade tant qu'elle reste informulée, ensuite ça dépend: cette pensée qui me fut propre, «Ah oui! “Le moyen est le message”», n'en est pas vraiment une dans cette discussion au moment où elle y apparaît, pour la décrire plus précisément, l'interrogation informulée et la réponse de type exclamatif constituent ensemble cette monade, je me demande “quelque chose comme” «Pourquoi ces développements sur le langage?» et la réponse qui est “quelque chose comme” «Ah oui! “Le moyen est le message”...» apparaît presque immédiatement et n'est pas séparable de la question; en toute hypothèse mais assez vraisemblablement (lecteur moi-même je sais comment ça se passe de ce côté-là d'une discussion) pour vous ça n'était pas une unité de sens isolable de ce qui précède et suit, dans le cours du billet il y a un certain nombre de monades, qui ne seront pas les même selon chaque personne qui le lira, mais du moins rares seront celles qui considéreront «Ah oui! “Le moyen est le message”...» comme une unité de sens, l'alinéa
«Bon bon bon... Et pourquoi est-ce que je raconte tout ça, au fait? Bon, je me relis un peu... Ah oui! Le moyen est le message...»
peut tout au plus en constituer une, mais qui pour vous aura une autre valeur: pour moi c'est une interrogation simple qui se suffit à elle-même, pour vous, plutôt un commentaire sur ce qui précède et une introduction à ce qui suit, hypothétiquement vous lui attribuerez une valeur comme
«Tiens c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il raconte “tout ça” (sur la langue, les langues)? Ah! En effet, ça a rapport avec “le moyen est le message”»
ou un truc de ce genre. Le rapport d'un lecteur et d'un rédacteur à un texte sont très différents: vous lisez un texte déjà constitué, j'écris un texte en cours d'élaboration. Vous ne savez pas d'avance ce qu'il contient (enfin, je le suppose – il me semble ne pas faire partie des auteurs dont on peut savoir assez vite de quoi leur texte sera fait, disons, je ne suis pas Éric Zemmour ou Laurent Wauquiez ou Dany Cohn-Bendit, du moins je l'espère, un producteur de pseudo-pensée prédigérée et tissée de lieux communs éculés) mais du moins vous savez avoir affaire à un texte continu, une “unité de sens”, en ces cas on se réserve pour “donner du sens” à ce qu'on lit, on trouve des unités de sens intermédiaire mais le “sens général du propos” ne devrait apparaître qu'à la fin, ou en tout cas après en avoir lu une part significative. Je ne me souhaite pas trop prévisible, cela dit certains de mes billets sont plus prévisibles que d'autres parce que leur sujet est plus limité et, souvent, moins... Disons, “moins original”. Un texte assez court comme «La corruption», ou un peu plus long comme «Le féminisme est un humanisme» sont, selon mon opinion, assez prévisibles, je ne dis pas qu'il ne vaille de les lire en entier, c'est selon le goût de chacun, mais dans ces deux textes, arrivé à la moitié au plus on aura saisi leur unité de sens. Pour l'auteur les choses sont autres, l'unité de sens est antérieure au texte. Pour ce billet précisément, et bien, ça se résume presque au titre, j'ai eu une pensée qui peut se transcrire en «Il me semble que ça vaudrait de discuter de la notion des “états de chose” développée par Ludwig Wittgenstein» mais en bien moins élaboré, une réflexion rapide sur la notion “états de chose” et le souhait de discuter de cela, rien de plus. Pour un autre texte en cours, «Qu'est-ce que le fascisme?», la pensée initiale était plus élaborée, quelque chose comme, «Je devrais rédiger un texte revenant à ce sujet et tenter de proposer une compréhension plus précise de la notion de fascisme que celles que j'ai développées auparavant». Pas sûr que ce soit le cas, cela dit, et même, presque sûr que ça ne l'est pas...
Dans ces trois cas l'unité de sens est beaucoup plus complexe, factuellement elle contient tout ce que contiennent les textes tels que rédigés, et bien plus, “en ma pensée” la notion au cœur des sujets développés se relie à un vaste ensemble, faire émerger le souhait d'écrire sur eux c'est faire émerger presque immédiatement ce vaste ensemble. Pour énoncer un truisme, tout discours contient tous les discours, on parle d'un segment plus ou moins étendu de la réalité observable mais tout segment de la réalité se relie à toute la réalité effective, “l'univers est un”, donc tout discours sur la réalité se relie à tous les discours possibles sur elle. Comme je ne compte pas réinventer la réalité je me limite à un segment assez restreint de ladite. Reste que les unités de sens que constituent les pensées non immédiates se relient à un univers, celui qu'on porte en soi, qui est une image de l'univers hors de soi.
Rédiger un texte revient à faire émerger une fraction plus ou moins large de cet “univers intérieur”. On peut tenter de le faire de manière ordonnée sinon que l'univers n'a pas d'ordre, on procède, comme l'écrivit Descartes, en «supposant même de l'ordre entre [les objets] qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres». De fait, ils “ne se précèdent point naturellement”, les précessions et successions sont une construction qui découle de notre pratique de sérialisation du réel. J'évoque régulièrement les principes de la thermodynamique, qu'on nomme parfois faussement des lois: l'univers ne connaît pas de lois, d'autant moins qu'une loi, on peut s'en affranchir, alors que de ces principes, du moins les deux classiques, on peut dire ce qu'en dit l'article de Wikipédia pour le premier, «on ne [leur] a jamais trouvé la moindre exception, bien qu'il y ait parfois eu des doutes». On peut aussi en dire ce qu'il en dit pour le second, «ce principe a une origine statistique». La remarque qui suit celle-ci, «à la différence du premier principe, les lois microscopiques qui gouvernent la matière ne le contiennent qu'implicitement et de manière statistique», n'est pas si évidente: nous ne connaissons l'univers que “de manière statistique”. Bon, tout ça n'est pas simple... Ou alors si. Je ne vais pas refaire une discussion développée quatre ou cinq fois de manière assez détaillée, ça se trouve dans ces pages: nous ne connaissons l'univers que de manière indirecte et fragmentaire. Possible que l'univers “ait un sens”, une orientation générale, un mouvement, possible que non, nous lui en donnons un parce que nous en avons un, nous sommes orientés, polarisés. Le reste de l'univers aussi, semble-t-il, mais donc il se peut que ce soit une illusion due à notre manière de le percevoir. Le premier principe est peut-être “non statistique” mais nous ne le vérifions que de manière statistique et comme le mentionne la remarque citée, «on ne lui a jamais trouvé la moindre exception, bien qu'il y ait parfois eu des doutes». Le doute méthodique, celui que pratiquent de longue date les géomètres et les naturalistes, ou pour le dire en termes contemporains, les scientifiques. C'est tout l'écart entre la science et la croyance.
Le savant ne doute pas de son savoir mais doute de ses présupposés et les soumet toujours à vérification; comme dit plaisamment l'animateur-producteur de l'émission La Méthode scientifique sur France Culture chaque fois qu'il nous donne rendez-vous pour l'émission suivante, c'est «jusqu'à preuve du contraire»: on anticipe, on prévoit, parce que l'on fait l'hypothèse que ce qui s'est vérifié antérieurement se vérifiera ultérieurement; “jusqu'à preuve du contraire” le premier principe s'est toujours vérifié mais régulièrement on observe des phénomènes qui semblent contredire le premier, ce qui amène à plus d'hypothèses et plus de vérifications pour tenter de valider ou d'invalider cette contradiction – et jusqu'ici le principe s'est finalement toujours vérifié. Soit précisé, les émissions de radio n'ont pas le même degré de fiabilité et bon an mal an, pour cause de maladie, ou de grève des transports, ou de grève de la radio, “la preuve du contraire” est faite dans au moins 2% des cas, ce qui est statistiquement négligeable dans les situations d'ordre social. Le croyant a une autre approche des choses, il se passe de preuves donc de vérifications; en revanche il doute toujours sans pouvoir jamais vérifier ni falsifier. C'est ce que relève notamment Blaise Pascal, croyant lui-même mais en même temps géomètre, avec son fameux «fragment du pari»:
«Nous connaissons donc l’existence et la nature du fini, parce que nous sommes finis et étendus comme lui. Nous connaissons l’existence de l’infini et ignorons sa nature, parce qu’il a étendue comme nous, mais non pas des bornes comme nous. Mais nous ne connaissons ni l’existence ni la nature de Dieu, parce qu’il n’a ni étendue ni bornes.
Mais par la foi nous connaissons son existence; par la gloire nous connaîtrons sa nature. Or, j’ai déjà montré qu’on peut bien connaître l’existence d’une chose, sans connaître sa nature» (Édition Brunschvicg 1897, fragment 233 «Infini. Rien»).
Et aussi le début du fragment 234, même édition:
«S’il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion; car elle n’est pas certaine. Mais combien de choses fait-on pour l’incertain, les voyages sur mer, les batailles! Je dis donc qu’il ne faudrait rien faire du tout, car rien n’est certain; et qu’il y a plus de certitude à la religion que non pas que nous voyions le jour de demain: car il n’est pas certain que nous voyions demain, mais il est certainement possible que nous ne le voyions pas. On n’en peut pas dire autant de la religion. Il n’est pas certain qu’elle soit; mais qui osera dire qu’il est certainement possible qu’elle ne soit pas?
Or, quand on travaille pour demain, et pour l’incertain, on agit avec raison; car on doit travailler pour l’incertain, par la règle des partis qui est démontrée».
Un croyant, un géomètre mais aussi un philosophe donc un rhéteur, qui ne dédaignait pas à l'occasion faire son sophiste. Le passage du fragment 233, dit le «pari de Pascal», n'est pas le plus intéressant, à mon point de vue. Mais je ne l'en rends pas responsable, il lui arriva le même malheur qu'à beaucoup, on a fait d'un brouillon une œuvre. Ce fut moins grave que, par exemple, pour Nietzsche, car au moins les éditeurs de ce travail en cours l'ont donné dans sa forme originale et non dans un montage tronqué et orienté, mais ça n'en reste pas moins un brouillon, on peut comparer avec ses œuvres publiées par lui, où il se révèle meilleur rhéteur que dans beaucoup des fragments de ces Pensées. Passons...
Même si les conclusions qu'il en tire me semblent douteuses, Pascal fait ce constat évident, la croyance se passe de preuves: «nous ne connaissons ni l’existence ni la nature de Dieu [...]. Mais par la foi nous connaissons son existence». Ce passage illustre le fait évident que la croyance ne recule devant aucun paradoxe: nous ne connaissons pas l’existence de Dieu mais par la foi nous connaissons son existence... Wittgenstein, croyant lui aussi, géomètre lui aussi, et peut-être philosophe, ne fut du moins pas un sophiste: dans son Tractatus il ne parle pas de “Dieu” même s'il parle de mystique et même, dans son texte, de Mystique; il n'en parle pas car «sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence». Peut-être le savez-vous, peut-être l'ignorez-vous, très vite après la prédication du “fils de l'Homme” se développèrent quatre courants principaux, que l'on peut nommer “paléo-Juifs”, “néo-Juifs”, “paléo-Romains” et “néo-Romains”, avec des interactions entre eux, parfois des alliances de circonstance, et divers surgeons plus ou moins dissidents et plus ou moins en rapport réel avec ces courants – pour exemple, deux “sectes“, l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, mieux connue sous le nom d'Église mormone – ses fidèles n'aiment pas trop se faire appeler les “mormons” – et les Témoins de Jéhovah, ont un rapport assez lointain avec les quatre courants cités même s'ils se placent dans une attitude assez “néo-romaine” mais avec encore plus de distance aux “textes sacrés”, les mormons ayant leur propre texte sacré, le Livre de Mormon, et les Témoins une version de la Bible assez spéciale, très “interprétée”... On pourrait en discuter autour d'un godet ou lors d'un bon repas, en attendant je fais le constat que Pascal serait plutôt “néo-romain” et Wittgenstein “néo-juif”, raison pourquoi le premier peut parler de ce dont il affirme qu'on ne sait rien, tandis que le second invite à ne pas en parler.
Le doute du savant n'est pas le doute du croyant. Le savant ne doute pas de son savoir mais doute de sa persistance en l'état: les cosmologies de Newton ou de Galilée gardent de leur pertinence dans un certain cadre, mais certains de leurs présupposés sont invalides depuis la relativité d'Einstein, qui dans un autre cadre se révèle la seule pertinente; le savant ne doute donc pas de son savoir mais de ses présupposés. Le croyant est un être paradoxal, comme le montre assez bien Pascal, sa tendance est de ne pas douter de ses présupposés mais de douter de son savoir; comme l'écrivit un autre de mes auteurs favoris, Gregory Bateson, à propos d'un autre sujet, «dans ce cas, toute tentative de consistance ne peut aboutir qu'à la prolifération d'un certain type de complexité — qui caractérise, par exemple, certains développements psychanalytiques et la théologie chrétienne [...]». Je nomme assez méchamment cette démarche celle des “Saint-Pierre”: il ne croient que ce qu'ils ne voient pas, et de ce fait tendent à douter de ce qu'ils voient. Quand je veux être méchant avec les savants je les nomme des “Saint-Thomas”, du moins quand il ne croient que ce qu'ils voient et doutent de ce qu'ils ne voient pas mais en ce cas ce sont des faux-savants, des “scientistes” qui s'adonnent à une autre forme de croyance. Bateson a aussi une remarque désobligeante envers ce type de démarche:
«Beaucoup de chercheurs [...] semblent croire que le progrès scientifique est, en général, dû surtout à l'induction [et] sont persuadés que le progrès est apporté par l'étude des données “brutes”, étude ayant pour but d'arriver à de nouveaux concepts “heuristiques” [...]. A peu près cinquante ans de travail [dans le domaine des sciences du comportement], au cours desquels quelques milliers d'intelligences ont chacune apporté sa contribution, nous ont transmis une riche récolte de quelques centaines de concepts heuristiques, mais, hélas, à peine un seul principe digne de prendre place parmi les “fondamentaux”.
Il est aujourd'hui tout à fait évident que la grande majorité des concepts de la psychologie, de la psychiatrie, de l'anthropologie, de la sociologie et de l'économie sont complètement détachés du réseau des “fondamentaux” scientifiques.
On retrouve ici la réponse du docteur de Molière aux savants qui lui demandaient d'expliquer les «causes et raisons» pour lesquelles l'opium provoque le sommeil: “Parce qu'il contient un principe dormitif (virtus dormitiva)”. Triomphalement et en latin de cuisine».
Soit dit en passant, les “scientifiques” de ce genre continuent à nommer leurs principes dormitifs avec du latin de cuisine ou du grec de laboratoire, ça leur donne un aspect “scientifique” ou au moins savant, mais l'étiquette sur la boîte ne désigne pas toujours un contenu en rapport avec elle...
Sous un certain aspect, savants et croyants partent d'une même prémisse, dont je pars aussi: nos sens sont trompeurs et nos catégories ne valent que dans des cadres limités et transitoires. Disant que j'en pars aussi, je me spécifie comme distinct des savants et croyants mais non comme singulier, si par chance (pour moi) vous avez lu quelques autres billets de ce blog vous aurez probablement rencontré une de mes typologies, la division des humains socialisés en “idéalistes”, “matérialistes” et “réalistes”. Fondamentalement tout être vivant est réaliste tant qu'il reste vivant pour la raison très simple et très évidente que si on ne tient pas compte de la réalité on ne vit pas très longtemps. Ce sont des tendances plus que des types humains, les idéalistes tendent à ne voir que ce qu'ils croient, les matérialistes à ne croire que ce qu'ils voient, les réalistes évitent autant que se peut de croire, et tentent autant que se peut de voir. Chacun de nous, sauf cas assez rares, est à la fois idéaliste, matérialiste et réalistes. Des “purs idéalistes” comme des ”purs matérialistes” mais aussi des “purs réalistes” sont peu envisageables. Enfin, pour les purs réalistes si, mais pour un humain socialisé ça n'a pas d'intérêt, le réalisme est certes une tendance favorable pour la survie individuelle ou pour un groupe restreint mais pas tant que ça pour la persistance d'une société large, pour participer à une société aussi large qu'un canton ou un arrondissement de préfecture ou de sous-préfecture en France, une gemeente ou une province aux Pays-Bas, un borough ou un county aux États-Unis il faut aussi être idéaliste, “y croire”, et matérialiste, “le voir”, parce qu'une société large ne se constate pas, elle demande une forme d'adhésion qui dépasse les capacités de compréhension immédiate d'un individu. La voir, ce n'est pas l'observer directement mais voir ses conséquences, certaines réalisations de biens ou services, le maintien de certains territoires et structures, ne sont envisageables que par la participation commune, volontaire et coordonnée à leur concrétisation et leur préservation d'un ensemble important de personnes; le croire ce n'est pas supposer une Vérité Vraie mais accepter des présupposés invérifiables qui fondent toute société: le slogan «Liberté, Égalité, Fraternité», inventé vers 1792, et devenu sa devise depuis 1848 et plus encore à partir de 1879, fonde – ou refonde – la société française; la devise «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale» complète et refonde cette société depuis 1946. De ces termes, seul le premier est relativement clair. Le dernier est un truisme car une société est nécessairement “sociale”; c'est aussi une tautologie, est social “ce qui fait société”, donc est social le social... Le mot “laïque” est étrange, il acquit une nouvelle acception assez récemment, dans la seconde moitié du XIX° siècle, spécialement durant la III° République, un dérivé savant apparaît alors, “laïcité”, qui définit le «principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse». Auparavant est “laïque” simplement ce qui n'est pas “consacré”, un terme d'Église: un “frère lai”, un “frère laïque”, est un moine “non consacré” mais cependant un moine.
Les mots “démocratie” et “démocratique” dans leur compréhension la plus courante sont aussi récents, et liés à des choix politiques “non démocratiques”, parfois même antidémocratiques: au moment des diverses révolutions qui eurent lieu à la fin du XVIII° siècle et au début du XIX°, vit s'opposer les tenants de régimes démocratiques, de régimes aristocratiques et de régimes oligarchiques. Les régimes dits démocratiques ont adopté un système mixte avec une assez ou très faible composante démocratique quand elle existe, pour le reste un régime républicain basé selon les cas sur une “oligarchie aristocratique”, une “aristocratie oligarchique” ou un compromis à-peu-près équilibré entre ces deux tendances, et dans tous les cas, en arrière-plan une ploutocratie, un «système politique ou ordre social dans lequel la puissance financière et économique est prépondérante», et une technocratie, un «système (politique, social, économique) dans lequel les avis des conseillers techniques (dirigeants, professionnels de l'administration) déterminent les décisions en privilégiant les données techniques par rapport aux facteurs humains et sociaux». Finalement, seul le mot “république” est faiblement équivoque, «Organisation politique d'un État où le pouvoir est non héréditaire, partagé et exercé par les représentants (généralement élus) d'une partie ou de la totalité de la population» (acception contemporaine) ou «Chose publique, organisation politique de la société, État». (acception “vieillie”, dit le Trésor de la langue française, le TLF, dont je tire ces définitions. Très modérément vieillie puisque le TLF mentionne, à la fin de cette définition et entre parenthèses, «(Dict. XIXeet XXe s.)». Certes nous avons changé de siècle et même de millénaire mais depuis pas si longtemps que ce soit le “vieux temps”...). Quant à l'indivisibilité de cette République, par le fait, au cours des trois lustres qui suivirent cette proclamation elle ne cessa de se diviser pour, en 1962, avoir perdu plus de 95% de son territoire et environ les deux-tiers de sa population par leur sécession – en 1946, la France était à l'apogée de son empire colonial, sinon la perte de quelques protectorats. “République” est faiblement équivoque dans sa définition, non dans son usage, puisque devenu dans les discours un quasi-synonyme de “démocratie”, dont l'acception est pourtant assez différente: «Régime politique, système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par l'ensemble des citoyens». Cela dit, c'est chose ordinaire que de confondre moyen et fin: quand le moyen devient sa propre fin, il en vient à se substituer à elle. On en eut l'illustration quand l'encore actuel premier ministre français en ce mois de juillet 2019, Édouard Philippe, déclara en mars, suite à un rapport de l'ONU sur l'usage apparemment excessif de la force publique:
«J’aime beaucoup entendre les conseils du haut-commissaire mais je rappelle qu’en France on est dans un État de droit et que la République à la fin est la plus forte».
Au-delà de l'aspect très rhétorique du premier point censément justificatif de son rejet dudit rapport – pour mémoire, presque toutes les dictatures qui s'installèrent au pouvoir en Europe durant l'entre-deux-guerres le firent dans le respect apparent de l'État de droit, et presque aucune ne modifia ce cadre organique, donc “être un État de droit“ formel n'induit pas nécessairement qu'on en soit un réel –, c'est la fin qui le semble significative du rapport un peu étrange de ce chef de gouvernement à la chose publique: dans un État démocratique, “à la fin” la démocratie doit être “la plus forte”, non la république. C'est ce que je pointais en écrivant que nos supposées démocraties actuelles ont une assez ou très faible composante démocratique: du point de vue de nos gouvernants et de la majorité de nos représentants, l'organisation, qui est un moyen, prime le régime, qui est une fin. Des républiques, il y en eut de toutes formes car elles ne se lient pas à un régime particulier; elles sont incompatibles avec la monarchie ou la tyrannie, le “pouvoir d'un seul”, mais pas nécessairement avec la dictature qui peut selon les cas être le pouvoir d'un seul ou celui de plusieurs. Les républiques italiennes qui se mirent en place au tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance furent au mieux rarement, autant que je sache jamais – à vérifier – démocratiques, et selon les cas plutôt aristocratiques ou oligarchiques, avec toujours une part de ploutocratie...



