Les entourloupes communicationnelles du président de la République ne font plus illusion, alors qu’approche l’heure du bilan de son quinquennat qui rend sa parole inaudible à mesure de la confrontation de ses innombrables engagements de renverser la table à l'inexistence de leur traduction dans la pratique, les institutions et les politiques publiques.
Ainsi, le 19 janvier 2021, l’opinion publique a été informée que la mise en place d’un scrutin proportionnel pour l’élection des députés, qui avait été le 22 février 2017 l’une des conditions de « l’alliance » entre MM. Bayrou et Macron (déshonorante, avec le recul, pour l’auteur de Abus de pouvoir) et que ce dernier s’était engagé à mettre en œuvre avant la fin de l’année 2017, était officieusement abandonnée. Cette énième non-réforme du quinquennat (v. aussi : « Comment la crise du Covid-19 a relancé la volonté d’Emmanuel Macron de réformer l’Etat », lemonde.fr, 23 janvier 2021 : « Le président de la République veut toujours réformer l’administration, mise en cause dans la gestion de la crise sanitaire. Une de ses promesses de 2017 qu’il n’a pas réussi à tenir jusqu’à présent » ; et plus généralement : « Le quinquennat Macron, à livre ouvert », 25 juin 2020) aura ainsi mobilisé des milliers d’heures de débats médiatiques pour rien autour de la juste « dose » de députés élus à la proportionnelle, et accessoirement permis à M. Macron de se faire élire à la présidence de la République, sur la base donc d’une promesse qui n’aura pas été tenue – pourquoi le MoDem n’en tire-t-il aucune conséquence ?
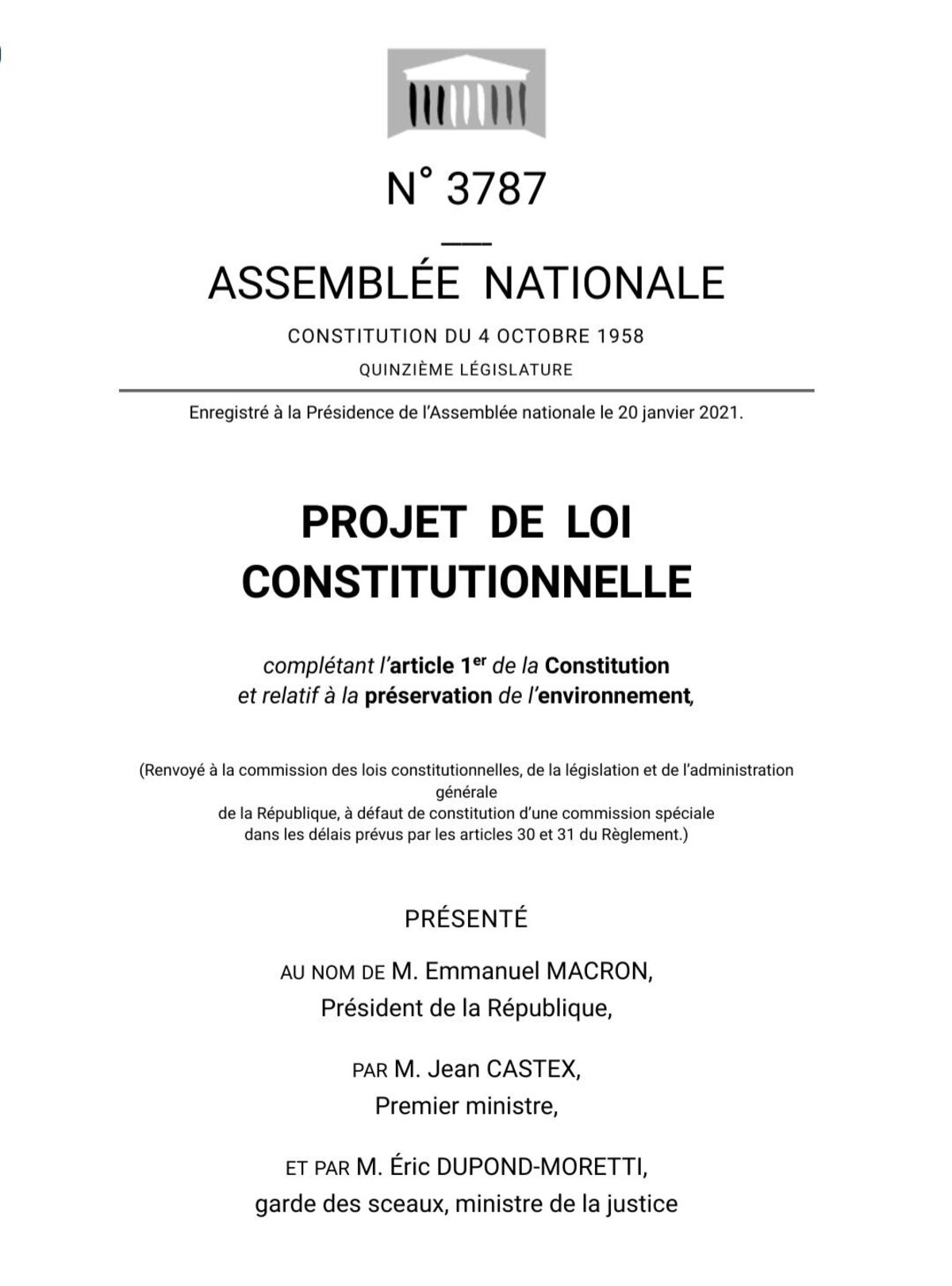
Agrandissement : Illustration 1
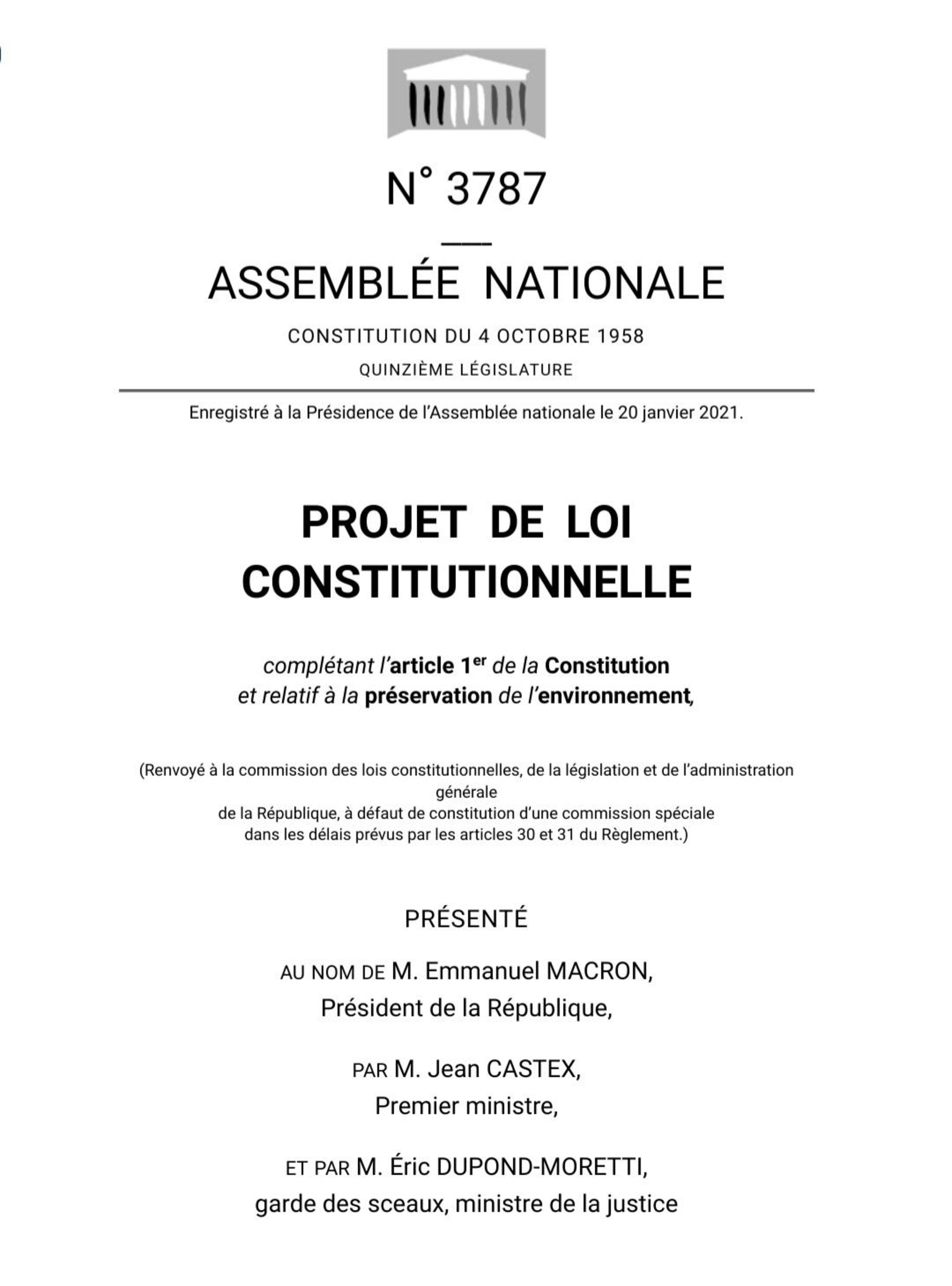
Le lendemain, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi constitutionnelle « complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement ». Chacun sait que ce texte – pas plus que les précédents projets de révision constitutionnelle présentés en mai 2018 et août 2019 – ne peut en aucune manière être voté dans les mêmes termes par les deux chambres ainsi que l’a laissé entendre le président du Sénat sur France Info le 21 janvier, de sorte qu’en l’absence de cet accord parlementaire préalable exigé par l’article 89 de la Constitution, il est exclu qu’un référendum se tienne sur cette révision d’ici à avril-mai 2022 (v. « Inscrire l’environnement à l’article 1er de la Constitution: perseverare diabolicum », 16 décembre 2020, et les renvois aux billets cités).
Mais en la présentant à l’Assemblée nationale, l’exécutif paraît avoir réalisé un double coup de communication politique. D’une part, il a, à coût zéro pour les finances publiques, honoré l’une des 149 demandes de la Convention citoyenne pour le climat, à la fois quant aux modalités de révision de la Constitution (par référendum) et au contenu de cette révision (la proposition de la Convention citoyenne pour le climat est reprise à la lettre). D’autre part, l’exécutif peut se targuer d’avoir verdi la Constitution : il a choisi la rédaction de l’article la plus contraignante en faveur de l’environnement, celle donc préconisée par la Convention citoyenne pour le climat, passant outre les alertes émises par le Conseil d’Etat dans son avis n° 401868 du 14 janvier 2021 sur l’avant-projet de révision constitutionnelle.
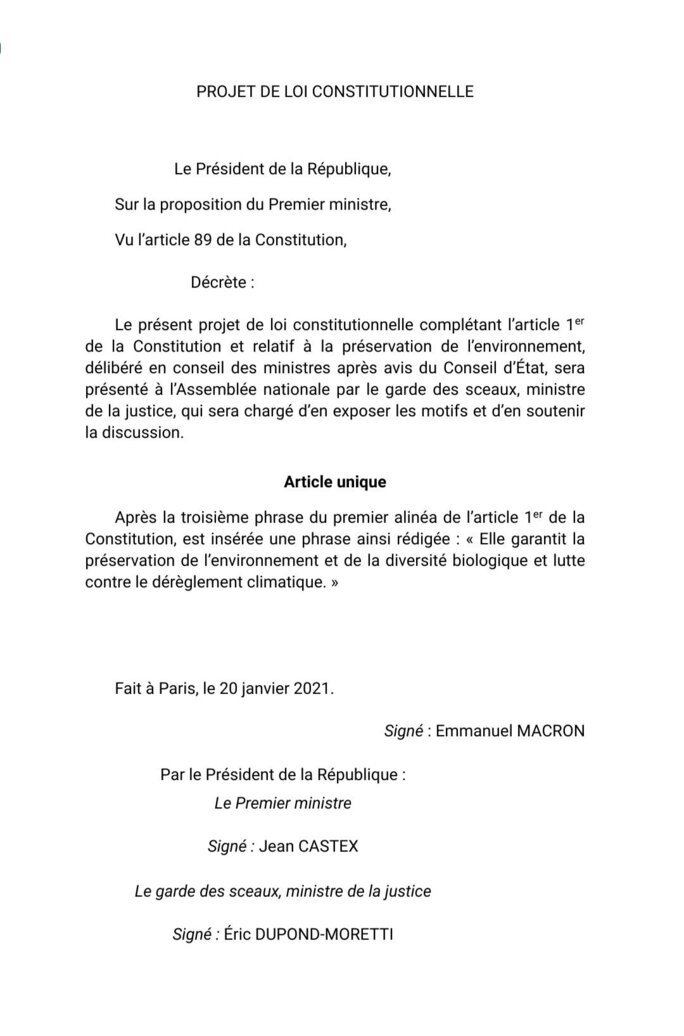
Agrandissement : Illustration 2
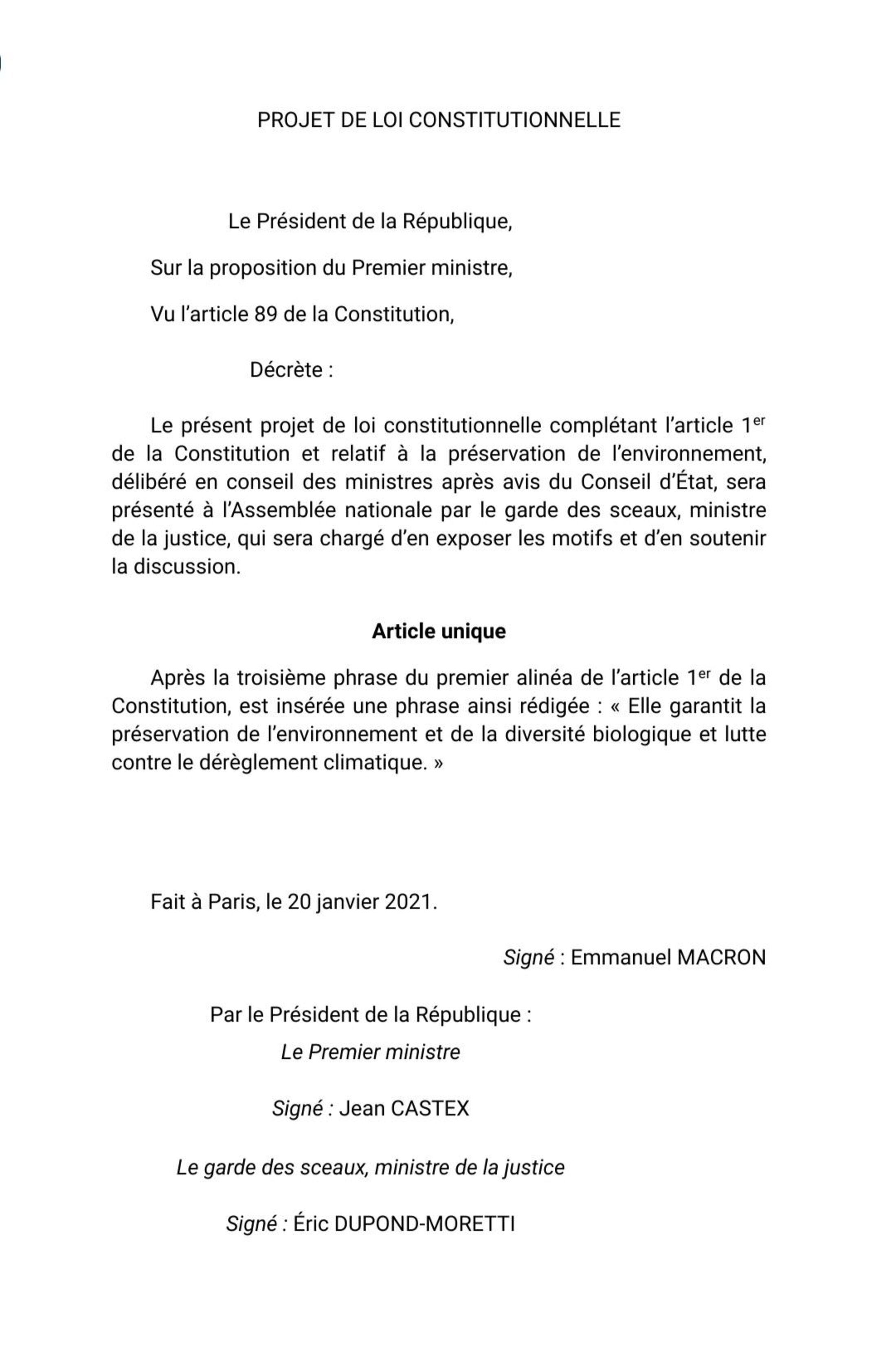
L’article unique du projet de révision constitutionnelle est ainsi rédigé : la France « garantit la préservation de la biodiversité et de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique ».
Saisi pour avis donc sur l’avant-projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’Etat a mis en garde l’exécutif contre l’emploi du verbe « garantir » retenu par la Convention citoyenne pour le climat, qui donnerait un poids trop important à la cause environnementale.
L’existence même d’un tamis du Conseil d’Etat est une scorie s’agissant de projets de révision constitutionnelle, car il n’y a pas lieu de vérifier la régularité juridique d’une telle révision : le Constituant, souverain, n’est soumis à aucune limite juridique. Au surplus, loin de faire preuve de la modeste retenue affichée au point 3 de son avis (il « veille à ce que la plume du constituant soit limpide, concise et précise (...) et ne soit pas source de difficultés d’interprétation »), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’opportunité de la rédaction envisagée par l’exécutif.
Il l’a critiquée, au motif que le verbe « garantir » serait trop contraignant :
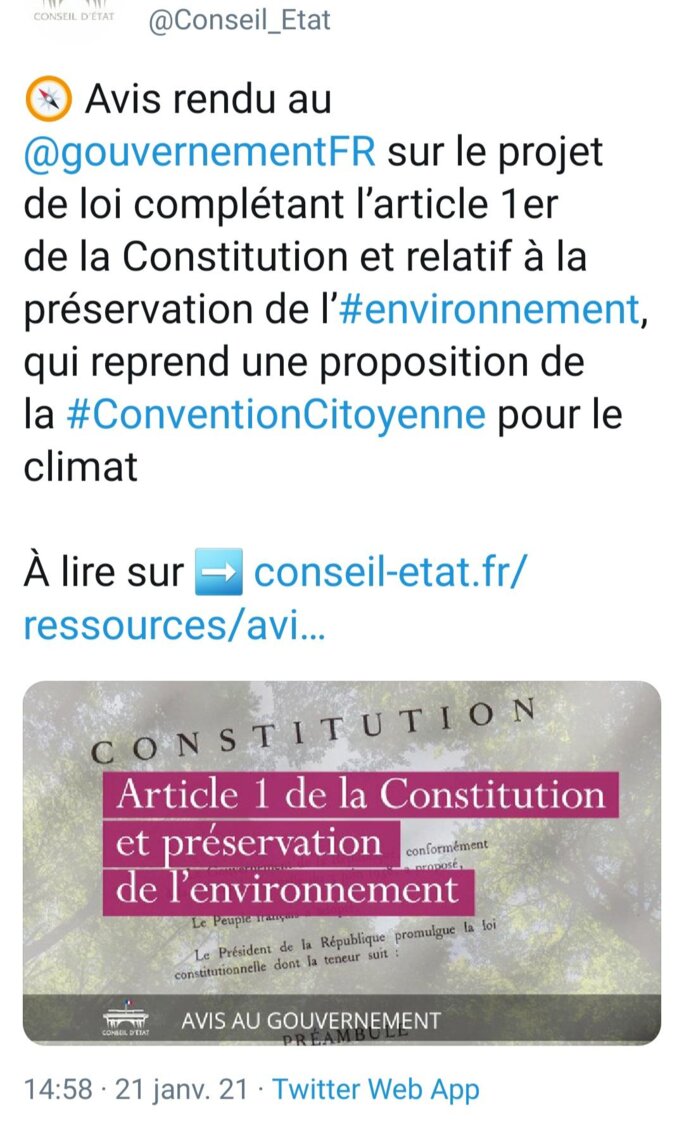
Agrandissement : Illustration 3
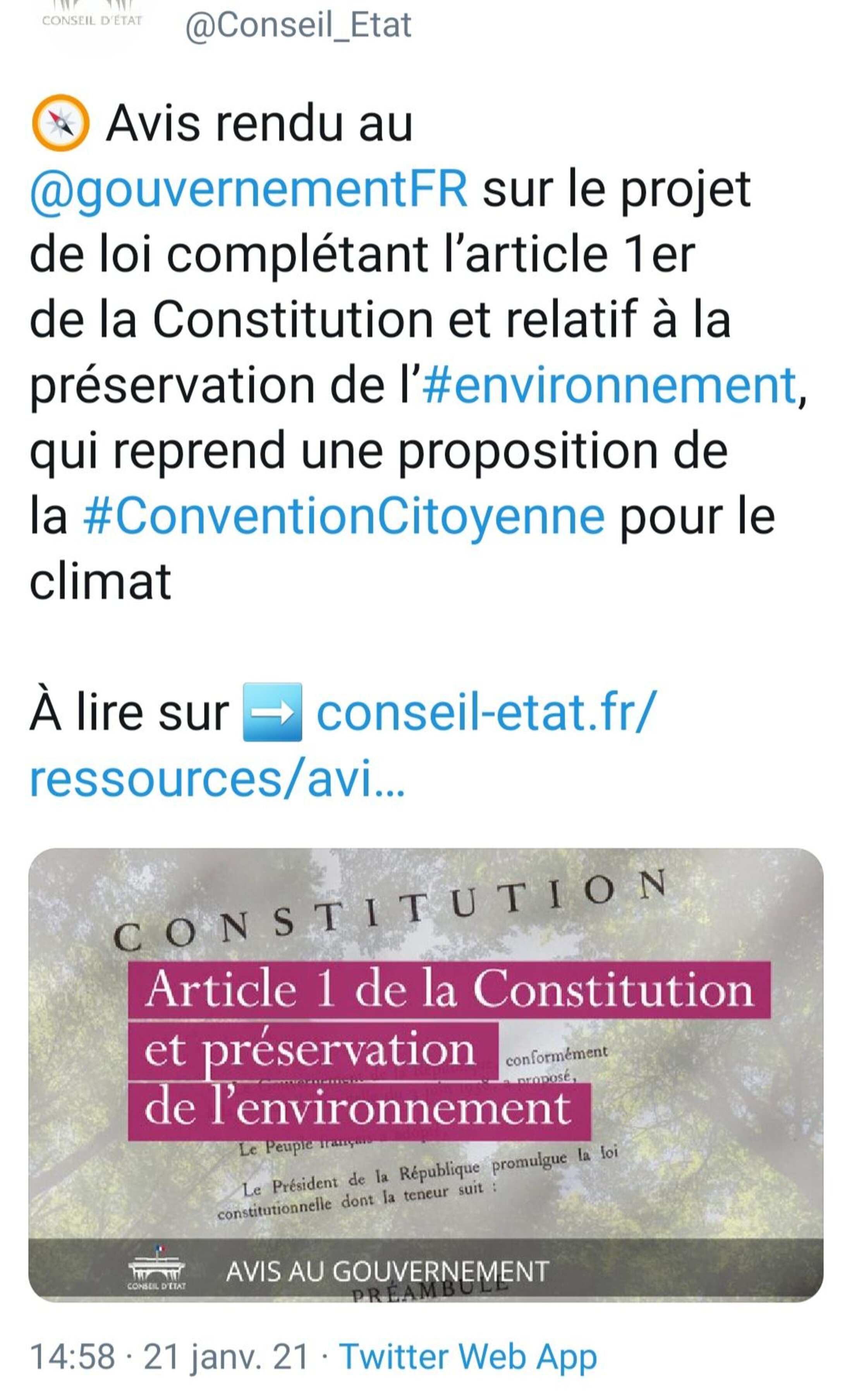
« le Conseil d’Etat attire l’attention du Gouvernement sur les conséquences que pourrait entrainer l’emploi du terme 'garantit' pour qualifier l’engagement de la France en matière environnementale, ce terme étant entendu comme s’imposant aux pouvoirs publics nationaux et locaux dans leur action nationale et internationale
L’inscription de ce terme dans la Constitution, alors qu’il ne figure pas dans la Charte, n’aurait pas pour seul effet de consacrer l’état actuel de la protection constitutionnelle de l’environnement et de l’interprétation qu’en a donnée la jurisprudence, comme le souligne d’ailleurs le Gouvernement.
En prévoyant que la France ‘garantit’ la préservation de la biodiversité et de l’environnement, le projet imposerait aux pouvoirs publics une quasi-obligation de résultat dont les conséquences sur leur action et leur responsabilité risquent d’être plus lourdes et imprévisibles que celles issues du devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement résultant de l'article 2 de la Charte de l'environnement » (pt 8).
Ces appréciations d’ordre politique ne devraient pas trouver leur place dans un avis du Conseil d’Etat. Au fond, elles sont en outre contradictoires avec le rappel des termes de son avis rendu en mai 2019 sur le projet de révision constitutionnelle dont il était saisi, soulignant « le caractère prioritaire de la cause environnementale, s’agissant d’un des enjeux les plus fondamentaux auxquels l’humanité est confrontée » (pt 6). Paroles, paroles, paroles…
Reste que l’exécutif a passé outre l’avis du Conseil d’Etat et a maintenu le verbe « garantir », sans retenir le verbe « favoriser » qui figurait dans le projet de 2018 et que le président du Sénat a souhaité maintenir en 2021, ou le verbe « préserver » qui avait les faveurs du Conseil d’Etat.
Faut-il admirer le président de la République pour cette performance constitutionnelle et politique, à la hauteur des considérables urgences environnementales ?
Sans surprise eu égard à l’(in)action menée depuis mai 2017 par le « Champion de la Terre », une réponse négative s’impose : avec un minimum de bagage juridique, il est facile de découvrir le dessous de la carte constitutionnelle que joue le président de la République à quatorze mois de la fin de son mandat.
Divulgachons donc la grossière manœuvre macronnienne, à laquelle le Conseil d’Etat a prêté main forte.
Déjà, le verbe « garantir » ou le mot « garanties » figurent dans la Constitution, sans qu’une conséquence juridique particulière leur soient attachées (l’article 4 indique que la loi « garantit » l’expression pluraliste des opinions, l’article 61-1 se réfère « aux droits et libertés que la Constitution garantit », l’article 72 évoque « une liberté publique ou un droit constitutionnellement garanti », l’article 73 les « garanties » des libertés publiques, l’article 74 les « garanties » pour l’exercice des libertés publiques…).
Mais surtout, il suffisait que le Conseil des ministres encadre soigneusement la portée du verbe « garantir » pour que les craintes exprimées par le Conseil d’Etat d’une prévalence des considérations environnementales sur les autres droits et libertés constitutionnels soient aussitôt neutralisées. La portée d’un texte ou d’un terme juridique doit en effet être lue à la lumière de l’intention de son auteur, laquelle résulte de ses déclarations publiques écrites et orales. Or, le président de la République en Conseil des ministres n’a pas manqué de procéder à une telle neutralisation, placée au troisième paragraphe de l’exposé des motifs précédant l’article unique du projet de révision constitutionnelle, qui en commande l’interprétation :
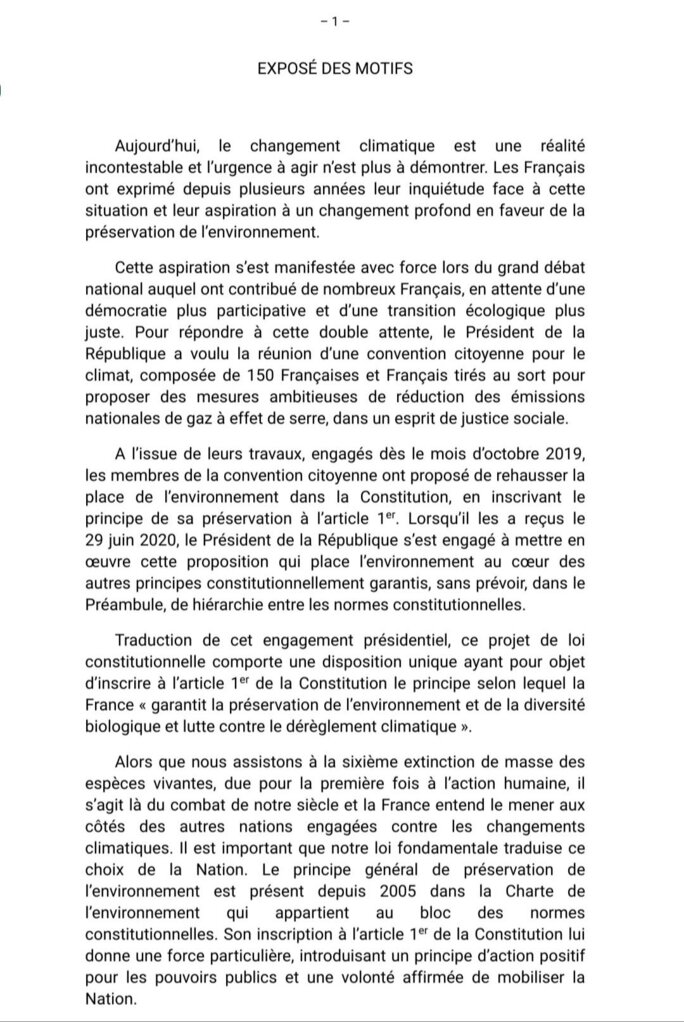
Agrandissement : Illustration 4
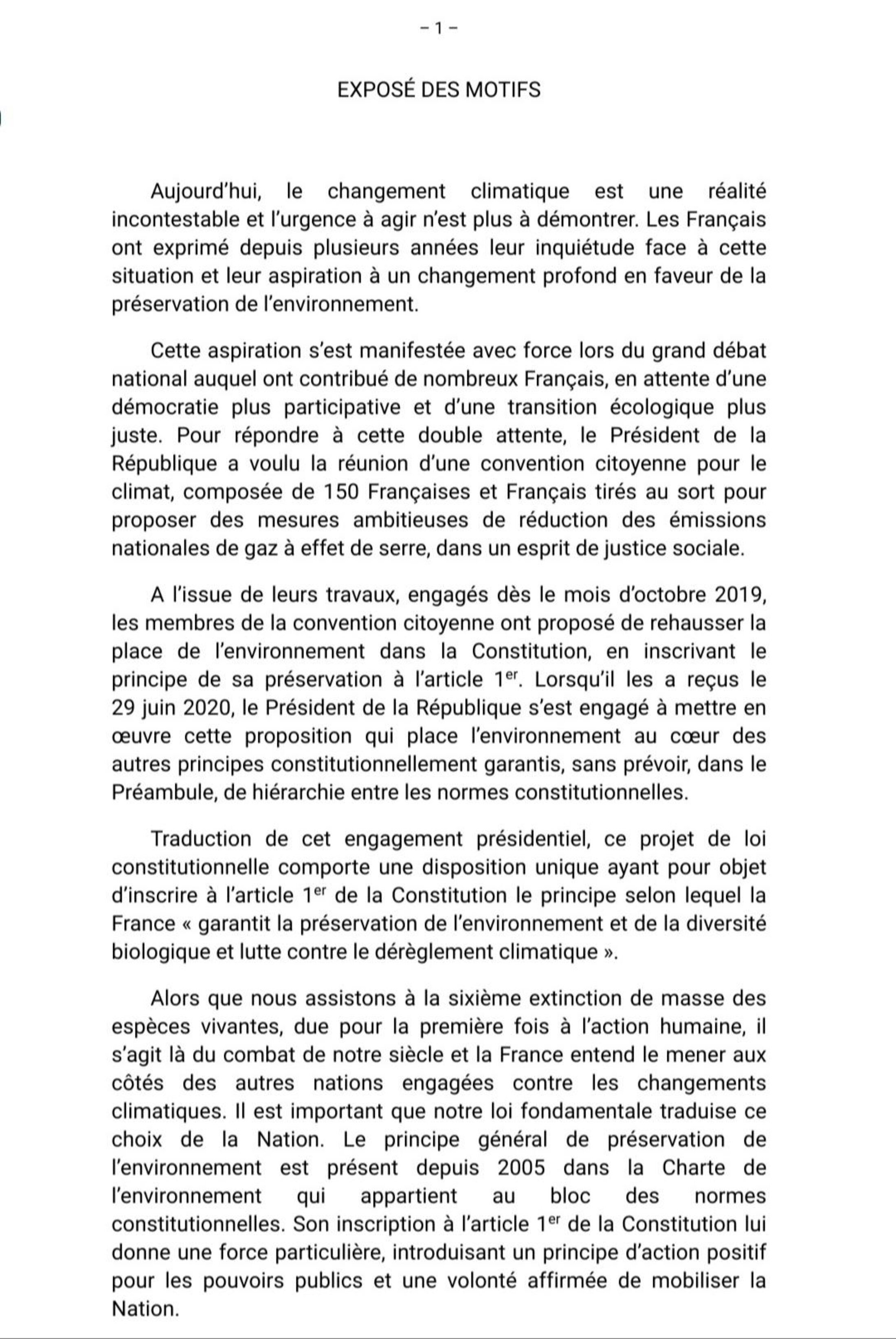
« A l’issue de leurs travaux, engagés dès le mois d’octobre 2019, les membres de la convention citoyenne ont proposé de rehausser la place de l’environnement dans la Constitution, en inscrivant le principe de sa préservation à l’article 1er. Lorsqu’il les a reçus le 29 juin 2020, le Président de la République s’est engagé à mettre en œuvre cette proposition qui place l’environnement au cœur des autres principes constitutionnellement garantis, sans prévoir, dans le Préambule (sic), de hiérarchie entre les normes constitutionnelles ».
Et voilà, le tour de passe-passe juridique est joué : l’environnement, certes distingué à l’article 1er, n’aura pas, si la révision constitutionnelle était votée telle quelle par le peuple français, de valeur juridique supérieure aux autres droits et libertés constitutionnels, en particulier aux libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie. Par la précision figurant dans l’exposé des motifs, le verbe « garantir » est accolé à l'ensemble des principes constitutionnels (écrits et non-écrits), et sa portée est rendue équivalente aux verbes « favoriser » ou « préserver », lesquels figurent déjà peu ou prou dans le texte de la Constitution (v. l’article 2 de la Charte de l’environnement de 2004 : « toute personne a le devoir de prendre part à l’amélioration et à la préservation de l’environnement » ; l'article 6 de la Charte : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable » ; l’article 34 de la Constitution : la loi détermine les principes fondamentaux « de la préservation de l’environnement »). On relèvera d’ailleurs que le titre même du projet de révision constitutionnelle évoque, à l’instar de l’article 34 de la Constitution, la « préservation de l’environnement », et non des garanties en faveur de la nature.
Autrement dit, la révision proposée ne change pas d’un degré la place et la valeur normative des préoccupations environnementales telles qu’elles sont actuellement occupées dans la Constitution.

Agrandissement : Illustration 5

Très habilement donc, le projet de loi constitutionnelle de l’exécutif n’est ni tout à fait différent, ni tout à fait le même que celui suggéré par la Convention citoyenne pour le climat : il est identique sur la forme (sa formulation), mais s'en écarte sur le fond (sa portée) ; il prétend faire du neuf avec du vieux ; il recycle la Constitution sous couvert de nouveauté. Le président de la République a ainsi exercé un « filtre transparent » sur cette proposition de la Convention citoyenne pour le climat ; il a réalisé un de ces « aménagements cosmétiques » qu'il fustigeait dans son discours alors jupitérien du 3 juillet 2017 devant les parlementaires réunis en Congrès à Versailles – à relire pour mesurer le fossé entre les parole et les actes avec près de quatre années d'écart (« Je souhaite que la totalité des transformations profondes que je viens de détailler et dont nos institutions ont cruellement besoin soit parachevée d’ici un an et que l’on se garde des demi-mesures et des aménagements cosmétiques »).
Que conclure de ce nouveau tour de passe-passe ou la ficelle du trucage est bien grosse, le double jeu patent ? Que l'emballage vert est vide. Que, contrairement à ce qu’a indiqué le méprisant de la République lors de son déplacement à l’université de Paris-Saclay le 21 janvier, il n’a pas à faire face à « une Nation de 66 millions de procureurs », mais à un nombre toujours croissant d’hommes et de femmes qui, en ce quinquennat finissant, ne peuvent plus accorder le moindre crédit à ses engagements compulsifs qu'il n'entend jamais honorer, dont la modification d’affichage de la Constitution proposée le 20 janvier 2021 est une illustration supplémentaire.
Merci à Christian Creseveur pour le dessin.



