Francis Chateauraynaud (né en 1960 à Périgueux), directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), est un sociologue trop méconnu du grand public en général et des sympathisants et des militants de gauche en particulier. Ses travaux pourraient pourtant leur être utiles. Il a soutenu sa thèse sur « les affaires de faute professionnelle » en 1990 sous la direction d’une des grandes figures de la sociologie de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, Luc Boltanski (né en 1940). Je l’ai connu en 1984 au sein du Groupe de Sociologie Politique et Morale de l’EHESS, alors dirigé par Luc Boltanski qui, dans un déplacement par rapport à la sociologie critique initiée par Pierre Bourdieu qui avait été son maître, entamait avec Laurent Thévenot les premiers pas de ce qui s’appellera par la suite « la sociologie pragmatique ». Avec Francis, nous étions nés la même année et nous étions inscrits tous deux en DEA de sociologie à l’EHESS, où nous fréquentions aussi le séminaire de « construction de l’objet en sociologie » d’une autre figure en rupture avec le groupe de Bourdieu : Claude Grignon (né en 1936). La première phase de la sociologie pragmatique s’est aussi fabriquée dans la deuxième moitié des années 1980 avec les terrains empiriques de nos thèses, comme également de celles de Claudette Lafaye ou d’Agnès Camus. J’étais resté le plus « bourdieusien » de la bande, le cul entre deux chaises…
Chateauraynaud a fait paraître en février dernier un livre important, qui aurait dû susciter l’attention du débat public si la combinaison du zapping sur les miroitements des actualités successives et l’inertie des catégories d’analyse les plus usagées et usées ne tendaient pas à l’encadrer si souvent. Son titre ? L’empreneur et son double. Pragmatique du pouvoir et sociologie de l’emprise (Éditions du Croquant, 468 p., 24 euros). Son objet ? Une forme actuelle du pouvoir : l’emprise, à travers une construction théorique exigeante nourrie de multiples terrains d’enquête (des lanceurs d’alerte sur l’amiante ou le Mediator aux violences sexistes et sexuelles, du harcèlement managérial aux réseaux criminels).

Agrandissement : Illustration 1
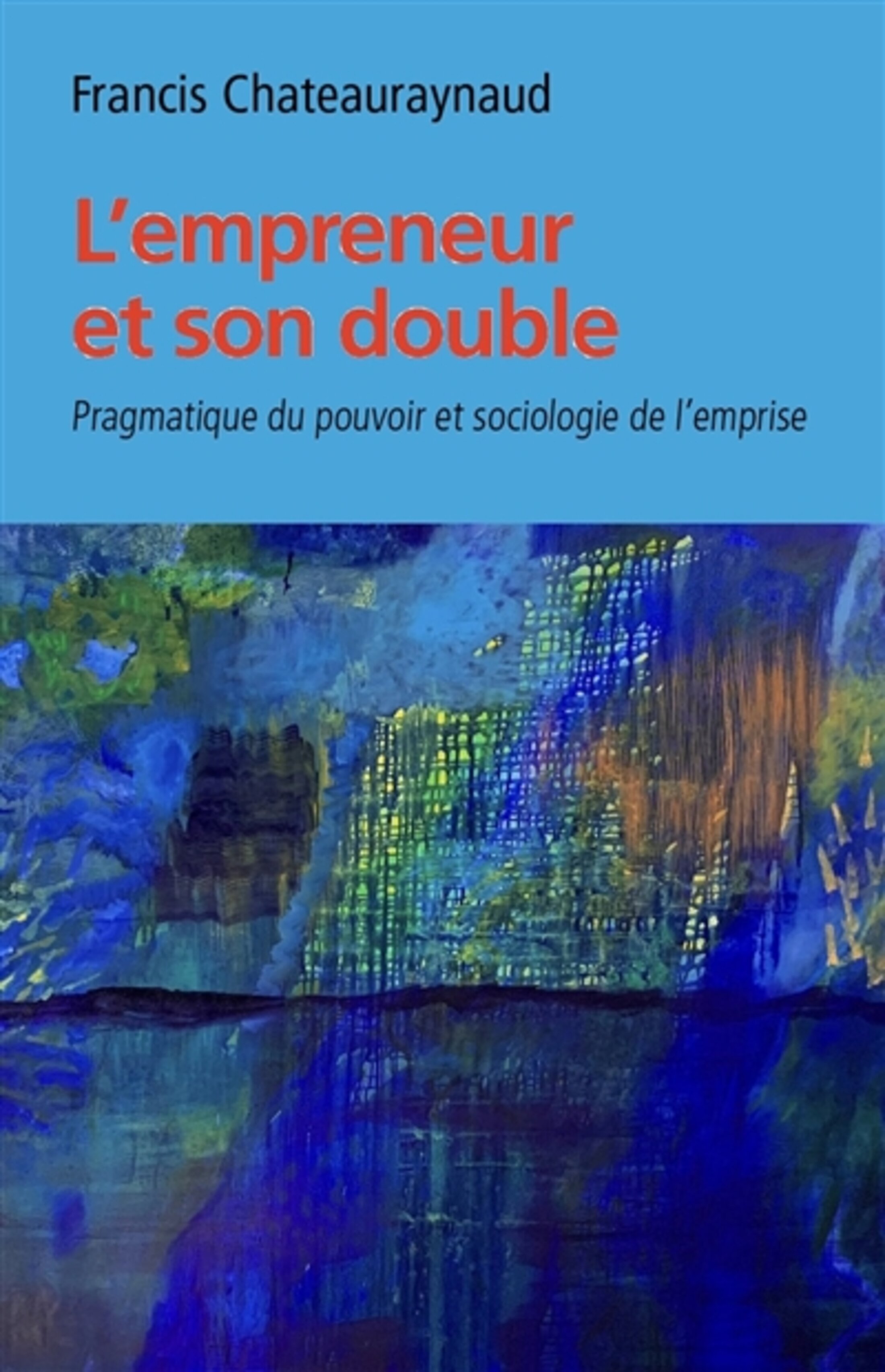
Sociologie critique, sociologie pragmatique, pragmatisme sociologique
Pour mieux comprendre la démarche de Francis Chateauraynaud au sein des sciences sociales en France aujourd’hui, passer par un rappel de débats ayant opposé les courants sociologiques à partir des années 1980(1) peut s’avérer utile. Sous le double angle de la pensée critique et de l’attention aux acteurs sociaux, deux pôles ont tendu à s’opposer :
1) un pôle de sociologie critique, justement, dévoilant des dominations pesant sur les acteurs, fortement incarné par Pierre Bourdieu (1930-2002), se situant dans une perspective « post-marxiste » ;
et 2) un pôle de sociologie compréhensive, inspirée d’une partie de l’œuvre du sociologue allemand Max Weber (1864-1920, mais il est aussi l’auteur d’une sociologie de la domination), celle s’intéressant au sens que les acteurs donnent à leurs actions dans le cours des relations sociales, et/ou de sociologie pragmatique, mettant en valeur les capacités des acteurs dans des cours d’action, dans des situations concrètes, dont les travaux initiés par Luc Boltanski et Laurent Thévenot.
Le premier pôle vise des inégalités dans les ressources et/ou dans la position hiérarchique des individus et des groupes ; ces inégalités étant susceptibles d’impliquer des relations de pouvoir, en générant de surcroît des illusions dans la conscience des acteurs dominés. La démarche compréhensive et/ou pragmatique donne une tonalité plus active du côté des individus et des groupes aux logiques sociales. Par ailleurs, sensible aux capacités des acteurs, la sociologie pragmatique française s’est particulièrement focalisée sur leurs compétences critiques, qui ne seraient pas réservées aux sociologues critiques. Elle s’est ainsi présentée dans un premier temps davantage comme une sociologie de la critique que comme une sociologie critique proprement dite(2).
Réassocier la posture critique, privilégiant classiquement la mise à distance des représentations présentes dans la conscience des acteurs afin de dévoiler des mécanismes de domination, et la démarche compréhensive-pragmatique, prenant au sérieux la conscience des acteurs et valorisant leurs capacités, apparaît un enjeu important aujourd’hui pour les sciences sociales. Cela a été amorcé par Luc Boltanski(3) et Laurent Thévenot(4) eux-mêmes dans des directions différentes, et ensuite par moi-même(5), Bruno Frère(6) ou Francis Chateauraynaud(7), là aussi dans des orientations diversifiées.
C’est dans le cadre de ces nouvelles articulations entre critique sociologique et sociologie pragmatique que s’inscrit L’empreneur et son double. Chateauraynaud préfère toutefois parler aujourd’hui de « pragmatisme sociologique » plutôt que de « sociologie pragmatique », dans un dialogue entre la sociologie et la philosophie pragmatiste américaine de John Dewey (1859-1952). Car, dans le pragmatisme de Dewey, il y a un lien entre logique de l’enquête et construction expérimentale de la démocratie entendue comme une exploration collective continue(8).
L’emprise : du local au global, de l’intime aux mégapouvoirs… y compris à LFI ?
Pour appréhender les spécificités de cette forme contemporaine de pouvoir qui peut être nommée emprise, Chateauraynaud revient dans son premier chapitre sur « les théories classiques du pouvoir », comme le concept de domination (de Max Weber à Pierre Bourdieu), l’approche du pouvoir par Michel Foucault ou « la critique sociale-démocrate des pouvoirs » (Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Axel Honneth). Ces lectures classiques pointent des asymétries, souvent stabilisées et structurelles, parfois mobiles et situationnelles, de ressources entre les individus et les groupes. Le défi pour une critique pragmatique, tentant de combler le fossé entre une « critique systémique », observant les choses globalement par en haut, et « l’attention aux conditions de l’interaction sociale », en observant les choses au plus près des acteurs par en bas, est alors d’« explorer les modalités de passage entre asymétrie et emprise, entre des relations sur lesquelles les protagonistes ont de simples différentiels de prises et des relations encastrées dans un système produisant, au fil du temps, des affects négatifs » (pp. 86-87). L’enjeu principal sur le plan conceptuel est donc la formulation d’« une théorie du pouvoir en acte » (p. 46).
C’est justement ce que dessine, sur le plan théorique et à travers une diversité d’études de cas, l’ouvrage de Chateauraynaud. Quels fils peut-on suivre alors pour problématiser l’emprise dans une telle perspective ?
« L’emprise, d’un point de vue pragmatique, peut d’abord se décrire à partir des ressorts pratiques assurant une prise durable sur autrui. Elle se déploie depuis la simple influence jusqu’à la prise de possession. Elle est faite de variations d’intensité, de transgression et d’irrégularité qui ont pour effet de produire de la sidération. Tant que le système de relations qui sous-tendent ces activités n’est pas requalifié publiquement, et ne tombe pas facilement sous les catégories pénales disponibles, les effets de l’emprise sont d’abord perçus, éprouvés, désignés dans un registre psychologique – ce contre quoi le pragmatisme sociologique n’a rien à objecter, puisque les premières manifestations d’une emprise se traduisent effectivement par des troubles au plan des affects et des percepts. » (pp. 29-30)
Ce qui amène à traiter un peu différemment les formes globales de pouvoir :
« Concernant les mégapouvoirs, une des hypothèses portées par la sociologie de l’emprise est de considérer qu’ils ne peuvent émerger et perdurer qu’en exploitant des chaînes de contrôle et d’assujettissement dans lesquelles des personnes et des groupes, souvent par intérêt économique, parfois par croyance et idéologie, mais aussi par soumission plus ou moins aveugle, contribuent à étendre la portée de ressorts ordinairement limités. Tout système d’emprise se construit par intégration, concaténation d’asymétries de prises qui peuvent rester ordinaires ou banales, et considérées, au moins au début, comme sans conséquence. » (p. 30)
Ainsi « l’emprise désigne une relation foncièrement asymétrique, installée durablement, dont il est difficile, risqué, coûteux de s’extraire par un acte volontaire » (p. 43). L’emprise circule du local au global, de l’intime au système, « de l’emprise dans et par le proche à l’emprise à grande échelle » (p. 31). Mais elle revient ensuite vers le local et l’intime : elle « peut coloniser, envahir l’intimité et le for intérieur », « prendre le contrôle » du « champ d’expérience, en détruisant les capacités à engendrer ses propres prises sur le monde » (p. 43).
Appréhender sociologiquement l’emprise a supposé chez Chateauraynaud une reproblématisation de l’historicité des relations sociales dans la prise en compte de « la non-linéarité des phénomènes » (p. 12)(9). Cela implique de ne pas appréhender les processus comme suivant une autoroute menant obligatoirement des débuts à la stabilisation finale de l’emprise, mais de prendre au sérieux l’imprévisibilité, les hésitations, les aspects aléatoires des bifurcations. Sont ainsi parcourues d’« opaques zones de transaction, aux contours flous, voire floutés, entre le visible et l’invisible », à travers « l’ambiguïté, l’incertitude, l’embarras, le malaise, le trouble » (p. 312). La consolidation de l’emprise va toutefois modifier les rapports entre réversibilité et irréversibilité, par « un changement d’échelle faisant passer d’une logique d’asymétries, a priori réversibles, à une logique de système, impliquant un haut degré d’irréversibilité » (p. 12).
Cependant la sortie de l’emprise demeure possible comme « mouvement de libération ou de déliaison », comme un processus « de modification des affects et des percepts » (p. 316). Toutefois, se développe aussi, à rebours d’une réponse libératoire à l’emprise, l’auto-empoisonnement par le ressentiment, classiquement politisé par l’extrême droite(10). Chateauraynaud observe que « dans la plupart des cas étudiés, l’aigreur, la rancœur, l’animosité, la rumination, l’impossible effacement du sentiment d’injustice, l’éternelle frustration » constituent « le résultats de déséquilibres systémiques » (p. 373). Il fait alors l’hypothèse que « l’emprise de l’idéologie d’extrême droite […] prend racine sur des propensions négatives produites par des mauvais traitements en cascade » (p. 372). Cela va souvent de concert avec des attributions conspirationnistes de responsabilité, en faisant des difficultés si douloureusement ressenties « les produits directs, intentionnels d’un persécuteur déterminé » (p. 373). Je reviendrai sur la question du conspirationnisme.
Ce faisant, la critique sociologique de l’emprise a aussi une portée politique, et n’a alors rien de « neutre », contrairement à ce que répète souvent une vision appauvrie du travail de distanciation propre aux sciences sociales(11). Selon Chateauraynaud, il s’agit aussi pour l’enquête sociologique de « libérer le potentiel créateur et émancipateur des alertes et des controverses » (p. 36), tout en suggérant des chemins évitant l’extrême droitisation du ressentiment.
Des exemples des dynamiques d’emprise ? Les violences sexistes et sexuelles apparaissent symptomatiques tout à la fois des processus d’emprise et des défauts d’outillages libérateurs, que la sociologie permet justement de porter au jour. Car, par exemple dans les procès pour viol, nous dit Chateauraynaud :
« On oublie la manière dont s’est installée la relation et le tour pris par les différentes séquences, depuis la rencontre – si rencontre il y a eu – jusqu’au passage à la violence. Si l’on considère le viol comme une modalité ou un prolongement de l’exploitation de la vulnérabilité, par l’exercice d’une emprise ou d’un pouvoir hiérarchique, on voit l’énorme trou dans la raquette du juge pénal. Tans que la catégorie d’emprise reste considérée comme problématique juridiquement – renvoyée dans les marges, et en particulier vers la qualification psychopathologique d’une relation – la plupart des violences sexuelles ont peu de chance d’être reconnues comme telles » (p. 145).
On pourrait prendre un autre exemple récent d’emprise, non traité par Chateauraynaud, dans les milieux politiques cette fois : celui du fonctionnement de La France insoumise sous le pouvoir autocratique de Jean-Luc Mélenchon, tel que révélé par l’enquête des journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Pérou dans leur livre La Meute. Enquête sur La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon (Flammarion, mai 2025). Menaces, harcèlement moral, violence verbale, purge des opposants, réduction comme une peau de chagrin du droit à la critique du Chef et du pluralisme d’opinion, absence de contre-pouvoirs… : on a une série d’indices d’une emprise stabilisée. Ainsi que le note d’ailleurs Chateauraynaud, « de grandes entités, comme une Église, un Parti, une Multinationale, un État, une Université, une Profession, peuvent favoriser des relations d’emprise à des échelles microsociales » (p. 178). Toutefois, comme je l’ai écrit il y a quelques semaines sur ce blog(12) : La Meute est un ouvrage trop à charge, peu soucieux des complications et des contradictions du réel, déployant dès le début une mise en récit essentialiste du type « le vers est dans le fruit » autour du personnage diabolisé de Jean-Luc Mélenchon. On perçoit mieux, par différence, les apports potentiels de la sociologie non-linéaire et nuancée de l’emprise proposée par Chateauraynaud, tant pour la science politique que pour le journalisme politique ou pour la critique citoyenne, celle orientée à gauche c’est-à-dire visant des réformes ou des transformations radicales de l’ordre des choses.
Zone critique : la question du conspirationnisme
Malgré sa rigueur et ses originalités, grâce à sa rigueur et à ses originalités, le livre de Francis Chateauraynaud suscite chez moi une zone d’interrogation critique autour du conspirationnisme. Il écrit ainsi à un moment :
« Je ne souscris pas aux approches qui qualifient des discours de complotistes sans contre-enquête sérieuse et sans explication des conditions de distinction des preuves et des croyances. L’extension de la formule de "théories du complot" sans limite claire et partageable produit de nombreux dégâts. » (p. 304)
Il a raison de noter qu’il y a médiatiquement des usages fort relâchés de l’accusation de « complotisme » insérés dans des logiques polémiques. Toutefois, sa remarque pourrait aussi participer aux disqualifications en cours dans les milieux intellectuels et politiciens de la nécessaire critique du conspirationnisme(13). Et il ne la contrebalance pas par un appel au développement d’une critique rigoureuse du complotisme. Or, c’est Éric Zemmour qui a le mieux synthétisé la tendance délégitimant la mise en cause des théories du complot : « Complotisme : ce mot des élites pour disqualifier toute critique »(14).
Car le conspirationnisme se présente comme un dérèglement intentionnaliste (c’est-à-dire mettant au premier plan des explications les intentions manipulatrices cachées de certains individus ou groupes) réducteur de la critique sociale contemporaine(15), déjà par rapport à la critique sociale structurelle classique (de Marx à Bourdieu) et donc aussi vis-à-vis des nouvelles modalités de la critique pragmatique. Et c’est d’ailleurs ce que montre Chateauraynaud quand il pointe les écarts entre des lectures conspirationnistes des difficultés vécues guidées par le ressentiment et l’analyse sociologique des « déséquilibres systémiques » (p. 373).
Plus, j’ai mis en évidence de manière détaillée comment les schémas complotistes constituent aujourd’hui un espace d’intersection au sein des « formations discursives » ultraconservatrice et confusionniste dans un contexte d’extrême droitisation des débats publics, au sein duquel les conspirationnismes anti-migrants, islamophobe (susceptible d’être euphémisé en « anti-islamisme ») et/ou antisémite (pouvant être euphémisé en « antisionisme ») tiennent le haut du pavé(16).
En relativisant la critique du conspirationnisme, Chateauraynaud s’inscrit dans une certain découpage du réel : les relations d’emprise et le souci de ne pas disqualifier hâtivement les personnes ordinaires qui les subissent lorsqu’ils amorcent une dénonciation de ces relations. Pour ma part, il s’agit d’un autre découpage du réel : l’extrême droitisation des débats publics auxquels participent surtout des « personnalités » (essayistes, journalistes, universitaires, politiciens professionnels, hauts fonctionnaires…). Il faudrait pouvoir établir un passage entre les deux découpages du réel : en insérant le souci de ne pas stigmatiser des personnes victimes de l’emprise dans une critique des dynamiques en cours d’extrême droitisation des espaces publics, impliquant une critique radicale des théories du complot.
Dans cette perspective, les schémas d’analyse mobilisés par Chateauraynaud auraient pu être explicitement proposés comme des approches alternatives aux schémas complotistes du côté des sciences sociales, en assumant plus clairement la logique anticonspirationniste de ces dernières. Ce qui constitue un de leurs apports les plus remarquables pour les débats publics dans le contexte de leur extrême droitisation, et particulièrement pour ceux qui n’ont pas désespéré de la possibilité de la renaissance d’une gauche d’émancipation (dans le pluralisme de composantes réformatrices et radicales, institutionnelles et libertaires) dans l’avenir. Une telle démarche plus offensive sur le terrain du conspirationnisme pourrait impliquer un changement de vocabulaire quant à certaines des notions proposées par Chateauraynaud (et dans le titre même de son ouvrage) : les notions d’« empreneur » et de « désempreneur », trop facilement complot-compatibles ne devraient-elle pas être abandonnées ? D’ailleurs, Chateauraynaud va un peu dans cette direction quand il définit l’« empreneur » de manière fonctionnelle et impersonnelle comme « facteur ou générateur d’emprise », en ajoutant qu’il peut être remplacé « par l’idée de "système" » (p. 442). Ou quand il renvoie la notion de « désempreneur », non pas à « l’existence préalable d’une puissance libératrice, incarnée dans une personne physique ou morale », mais à un « processus » (p. 316).
******************************
Un livre donc à lire, à méditer, à discuter de manière critique dans vos associations, vos syndicats, vos collectifs, vos expériences alternatives, vos ZAD, vos organisations politiques (et même au sein de LFI !)… Un livre qui devrait faire partie des ouvrages à lire en priorité en 2025 à gauche, si les gauches politiques organisées n’étaient pas si souvent prises en tenaille aujourd’hui entre une pente à la désintellectualisation et un décrochage vis-à-vis des rugosités du réel, dans un brouillard idéologique s’éloignant tout à la fois du contact avec le terrain et du travail intellectuel.
On trouve une excellente introduction politique au livre et à la démarche de Francis Chateauraynaud dans un texte publié sur le site de réflexions libertaires Grand Angle : « Le pragmatisme sociologique a-t-il une portée libertaire ? » (1er mai 2025).
Il faut ajouter que Francis Chateauraynaud est également un explorateur musical, improvisateur et guitariste : musiques du monde et jazz… ou reprises et adaptations de Brassens, Barbara, Bernard Lavilliers et Michel Jonasz, en duos, trios ou solo. À déguster sur la chaîne YouTube : « Interstices / Francis Chateauraynaud ».
Notes :
(1) Pour une présentation pédagogique de ces courants, voir mon livre Théories sociologiques contemporaines. France, 1980-2020, Paris, Armand Colin, collection « Cursus », 2019.
(2) Voir Luc Boltanski, « Sociologie critique et sociologie de la critique », Politix. Revue des sciences sociales du politique, n° 10-11, 1990.
(3) Voir Luc Boltanski, De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Paris, Gallimard, 2009, et Luc Boltanski, en collaboration avec Philippe Corcuff, « Un individualisme sans la liberté ? Vers une approche pragmatique de la domination », dans Philippe Corcuff, Christian Le Bart et François de Singly (éds.), L’individu aujourd’hui. Débats sociologiques et contrepoints philosophiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
(4) Voir Laurent Thévenot, « Individualités entre émancipation, pouvoir et oppression. Deux extensions de la critique », dans Philippe Corcuff, Christian Le Bart et François de Singly (éds.), L’individu aujourd’hui. Débats sociologiques et contrepoints philosophiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
(5) Voir Philippe Corcuff, « Style de théorie, statut de la critique et approche des institutions dans les sciences sociales. Déplacements, problèmes et enjeux actuels de la sociologie pragmatique au rythme d’Eddy Mitchell », Working Paper n° 28, CriDIS/Université Catholique de Louvain, mai 2011, et Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des savoirs, Paris, La Découverte, collection « Bibliothèque du MAUSS », 2012.
(6) Voir Bruno Frère (éd.), Le tournant de la théorie critique, Paris, Desclée de Brouwer, 2015.
(7) Voir Francis Chateauraynaud, « L’emprise comme expérience. Enquêtes pragmatiques et théories du pouvoir », revue SociologieS, 23 février 2015, et « Social theory and the logic of Inquiry. Some pragmatic arguments for convergence of critical and reconstructive approach », in Alain Caillé and Frédéric Vandenberghe (eds), For a New Classic Sociology. A proposition, followed by a Debate, Abington, Taylor & Francis, 2020.
(8) Sur le pragmatisme philosophique de John Dewey, l’enquête et la démocratie, voir Joëlle Zask, « L’élève et le citoyen, d’après John Dewey », revue Le Télémaque, n° 20, 2001 ; Sandra Laugier, « La démocratie comme enquête et comme forme de vie », revue Multitudes, n° 71, 2018 ; et Francis Chateauraynaud, « Des expériences ordinaires aux processus critiques non-linéaires. Le pragmatisme sociologique face aux ruptures contemporaines », revue Pragmata, n° 5, 2022 ; sur des convergences entre Rosa Luxemburg, John Dewey et André Gorz, voir mon texte : « Actualité libertaire et pragmatiste de Rosa Luxemburg : interférences avec Dewey et Gorz », blog Mediapart, 29 octobre 2013.
(9) Sur les apports et les limites des « modèles d’historicité linéaires-évolutionnistes » en science sociales et sur l’importance d’explorer d’autres modèles, voir mon article « Analyse politique, histoire et pluralisation des modèles d’historicité. Éléments d’épistémologie réflexive », Revue française de science politique, vol. 61, n° 6, décembre 2011.
(10) Sur la politisation classique du ressentiment par l’extrême droite et les risques confusionnistes actuels associés à des usages de gauche du ressentiment, voir mon livre La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Paris, Textuel, 2021, pp. 94-97, 192-195 et 201-205.
(11) Voir mon texte « Le bêtisier sociologique et philosophique de Nathalie Heinich », revue Lectures, 9 juillet 2018.
(12) Dans « Impensés confusionnistes face à l’illibéralisme dans les gauches modérée et radicale », blog Mediapart, 20 juin 2025.
(13) J’ai analysé de telles délégitimations de la critique des théories du complot, dans un espace allant de l’extrême droite à la gauche radicale en passant par le centre, chez Éric Zemmour, Michel Onfray, Natacha Polony, Jean-Claude Michéa ou Frédéric Lordon dans « Les errances de la critique de l'anticomplotisme : Natacha Polony parmi d'autres », site Conspiracy Watch, 18 octobre 2021.
(14) Titre d’une chronique du 20 novembre 2020 de Zemmour-journaliste dans Le Figaro, reprise comme tweet le 21 juillet 2021 alors que le Zemmour-politicien se profile.
(15) Voir une première approche dans mon texte « "Le complot" ou les aventures tragi-comiques de "la critique" » [1e éd. : avril 2005], blog Mediapart, 19 juin 2009.
(16) Voir La grande confusion, op. cit., pp. 135-138 (pour le cadre général d’analyse des « politisations conspirationnistes »), pp. 233-265 (le chapitre 4 sur « Quatre figures de l’extrême droite idéologique : Alain Soral, Éric Zemmour, Renaud Camus, Hervé Juvin ») et pp. 267-307 (le chapitre 5 sur « Critique de l’hypercriticisme conspirationniste », traitant notamment du confusionnisme de figures politiques et intellectuelles de gauche).



