Après un premier billet partant d’une chanson de Robert Charlebois et un second billet partant d’un polar féministe de Michael Connelly, un troisième et dernier billet proposant des « bonnes feuilles » du livre La grande confusion.
Le texte qui suit constitue un extrait de l’introduction de La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées (Textuel, 2021, pp. 14-26). Je remercie les éditions Textuel d’avoir autorisé sa publication sur mon blog de Mediapart.
******************************
Quand on a le nez dans le guidon, quand on est surtout sensible à qui se passe événement après événement, problème après problème, de façon segmentée, on a du mal à voir se dessiner une configuration globale inquiétante. Et pourtant… s’il y avait bien des fils se tissant imperceptiblement, dans une large inconscience de ses protagonistes, entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, d’une part, et Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon, d’autre part, entre Caroline Fourest et Laurent Bouvet, d’une part, et Éric Hazan et Houria Bouteldja, d’autre part, entre Alain Finkielkraut et Christophe Guilluy, d’une part, et François Bégaudeau et Juan Branco, d’autre part, ou encore entre Jean-Claude Michéa et Michel Onfray, d’une part, et Chantal Mouffe et Frédéric Lordon, d’autre part, pour donner une trame idéologique en voie de constitution nommée confusionnisme ? Et si ces bricolages idéologiques confusionnistes avaient des intersections et des interactions avec la trame idéologique ultraconservatrice tissée sous des modalités diversifiées par les Alain Soral, Éric Zemmour, Renaud Camus, Hervé Juvin, Alexandre Devecchio ou Mathieu Bock-Côté ? Et si tant le confusionnisme que l’ultraconservatisme étaient traversés par une tendance idéologique plus large et prégnante à l’échelle internationale, au sein des ordres dominants comme de mouvements contestataires : l’identitarisme ? Et si « la nouvelle droite » d’Alain de Benoist ou certains usages du « chevènementisme », le « sarkozysme » ou La Manif pour tous, mais aussi Les Guignols de l’info ou les émissions de Thierry Ardisson, avaient participé à la généalogie plurielle de ces processus idéologiques ? Et si ces processus profitaient aujourd’hui principalement à l’extrême droite d’un point de vue idéologique ? Ce sont les hypothèses hérétiques que ce livre explore de manière détaillée et minutieusement référencée dans une mise en perspective conceptuelle et historique, en mettant en rapport des discours habituellement séparés dans les analyses existantes.
Différentes questions rythmant l’actualité médiatique sont alors abordées, comme la place de la nation, les migrants, la laïcité, le néolibéralisme économique, l’extrême droite, l’islamophobie et l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, les islamismes et les djihadismes, le complotisme et le climatoscepticisme, le « populisme de gauche », les échos hexagonaux du « trumpisme », les utilisations de la notion de « race », l’héritage colonial et les perspectives décoloniales, les interprétations conservatrices de l’écologie, les « gilets jaunes » ou l’après COVID-19. L’actualité y est alors traitée autrement, en s’appuyant principalement sur des outils de distanciation puisés dans les sciences sociales et dans la philosophie politique au long d’un parcours universitaire en science politique. Une telle interrogation raisonnée sur des événements récents ou qui continuent à se dérouler sous nos yeux relève aussi d’une histoire du temps présent. Le refus des tendances manichéennes des débats publics et le sens des nuances ont appelé de longs développements basés sur des arguments, en revenant sur le contenu des discours tenus et sur leurs contextes respectifs d’énonciation plutôt que de se contenter de les caricaturer ou de les encenser de loin.
Distanciée, la démarche est aussi engagée en s’adossant à un itinéraire militant d’une quarantaine d’années au sein des gauches, de la gauche socialiste à la gauche libertaire en passant par la gauche radicale. Cependant cet engagement, s’il ne veut pas se perdre dans les chausse-trappes courantes de l’autojustification, doit se coltiner ses propres vicissitudes et ses points aveugles.
J’espère que cet ouvrage provoquera un choc, comme son écriture a provoqué un choc chez moi, en particulier parmi ses lectrices et ses lecteurs les plus soucieux de reconfigurer une boussole éthique et politique au sein des brouillages actuels et de réinventer une gauche d’émancipation. Car ce livre de l’inquiétude voudrait contribuer à relancer une espérance vacillante.
********************
Pourquoi titrer précisément ce livre La grande confusion ? Car il s’agit d’éclaircir conceptuellement des problèmes politiques entourés d’une brume grandissante dans les espaces publics de nos sociétés, tout particulièrement en France, mais aussi plus largement en Europe, aux États-Unis[1] ou au Brésil. Et, dans les circonstances présentes, ce brouillard facilite une extrême droitisation idéologique.
Liaisons dangereuses dans l’air du temps : Julliard, Lordon et Bock-Côté
Pour que les questions traitées dans ce livre ne soient pas d’emblée trop abstraites, arrêtons-nous sur un exemple significatif : les relations ambiguës entre trois personnalités intellectuelles aux orientations idéologiques et politiques fort contrastées, Jacques Julliard, Frédéric Lordon et Mathieu Bock-Côté ; Lordon formulant la version la plus philosophiquement conceptualisée des trois et la plus éloignée en apparence du conservatisme politique.
Jacques Julliard, de « la deuxième gauche » à la focalisation « républicaine » sur la nation
L’historien Jacques Julliard (né en 1933) est une figure intellectuelle historique de l’establishment de la gauche française, passé d’une version de gauche du néolibéralisme économique à une gauche « républicaine » modérée. Il a participé à « la deuxième gauche », courant politico-intellectuel actif dans la deuxième moitié des années 1970 et au début des années 1980, symbolisé syndicalement par la CFDT, dont Julliard a été membre du bureau confédéral entre 1973 et 1976, et politiquement par les idées portées par Michel Rocard au sein du Parti socialiste, dont Julliard a été adhérent de 1974 à 1976[2]. Il a été éditorialiste du Nouvel Observateur (proche de « la deuxième gauche »), devenu L’Obs, entre 1978 et 2010, puis de Marianne (incarnant un centrisme « républicain ») à partir de 2010. Il a été membre de la Fondation Saint-Simon, créée en 1982 et dissoute en 1999, qui à partir du début des années 1980 a constitué une des médiations de la conversion de la gauche de gouvernement à une forme adoucie de néolibéralisme, que l’on a appelé par la suite social-libéralisme. Dans ce cadre, il a été le coauteur avec François Furet et Pierre Rosanvallon d’un livre-manifeste du social-libéralisme français en 1988 : La République du centre. La fin de l’exception française (Calmann-Lévy)[3]. « La République du centre » se présente comme « un concept politique contraire à l’histoire de la France moderne et de ses divisions politiques fortes », selon l’historien des idées François Cusset[4]. Le sociologue et philosophe Didier Eribon l’analyse comme un appel à « l’effacement de la frontière entre la droite et la gauche au nom de la gestion technocratique et de la nécessaire soumission aux "contraintes économiques" imposées par la mondialisation »[5]. Julliard a encore soutenu publiquement le social-libéralisme en décembre 1995, en signant la pétition initiée par la revue Esprit allant dans le sens de la réforme de la sécurité sociale proposée par le premier ministre de l’époque Alain Juppé, à laquelle s’est opposée la pétition dite « Bourdieu » soutenant les grévistes et les manifestants[6].
En 2010, dans la période de sa rupture avec L’Obs et de son passage à Marianne, l’ancien idéologue social-libéral amorce une critique timide du néolibéralisme. Il écrit ainsi à propos des supposées « lois du marché » :
« Il faut les respecter, sans doute, mais pour en corriger les tendances profondes à l’inégalité et à la sauvagerie sociale que l’on voit triompher aujourd’hui. »[7]
En 2016, dans un entretien avec l’idéologue d’extrême droite Alain de Benoist, Julliard met en cause « le divorce de la gauche et du peuple »[8]. Il fustige alors la tendance de la gauche à « démolir l’idée même de nation »[9] et à développer, « l’idéal du "sans-frontiérisme" »[10], en tournant « le dos aux solutions possibles des problèmes qui nous tourmentent, à commencer par celui de l’immigration »[11]. Dans une veine analogue, il écrit en 2017 :
« La nation une et indivisible a disparu au profit d’une ode à la diversité, et le passé, pour autant qu’il implique une filiation et une construction de la nation à travers le temps, est prié de se faire oublier. »[12]
« La gauche » aurait adopté « la communautarisation » en faveur des immigrés : pour permettre au « nouvel arrivant » de « conserver son identité, il faut que les anciens occupants renoncent à la leur », ironise-t-il[13]. Et il poursuit en mettant en cause l’Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif publié sous la direction de Patrick Boucheron[14] : « un livre plein d’arbitraire et de parti pris idéologiques [qui] a tenté de réduire l’identité nationale aux influences extérieures et de faire de la France la simple représentante de l’entrecroisement de courants hétérogènes. »[15] Il se réclame du « logiciel républicain » qui aurait été « abandonné » par « la gauche »[16]. Par ailleurs, il affirme « qu’il n’y a jamais eu vraiment ni peuple de gauche, ni peuple de droite, mais qu’il a toujours existé, aujourd’hui comme hier, un peuple français »[17], un peuple-nation donc.
Au pôle valorisé par Julliard, on trouve notamment « la nation une et indivisible », « l’identité nationale », l’« héritage », la « filiation », « le peuple » comme peuple-nation compact ou le « logiciel républicain ». Au pôle critiqué, il y a le « sans-frontiérisme », « l’immigration », la « communautarisation », la « diversité » ou le métissage (« l’entrecroisement de courants hétérogènes »).
Frédéric Lordon ou la fétichisation de la nation au sein de la gauche radicale
L’économiste et philosophe Frédéric Lordon (né en 1962) est une figure intellectuelle de la gauche radicale qui a émergé dans les années 1990 en prenant comme adversaire principal le néolibéralisme économique. Il apparaît donc éloigné de la modération politique d’un Julliard, qu’il s’agisse de la période « deuxième gauche » sociale-libérale ou « républicaine » de ce dernier. Il tient notamment un blog sur le site du Monde diplomatique depuis 2008, « La pompe à phynance » (https://blog.mondediplo.net/-La-pompe-a-phynance-), et écrit régulièrement dans ce mensuel qui constitue la publication écrite la plus diffusée au sein de la gauche de la gauche.
Dans un livre de théorie politique caractérisé par un fort penchant à l’abstraction conceptuelle et inspiré d’une certaine lecture du philosophe néerlandais Baruch Spinoza (1632-1677), Imperium, Lordon va en 2015 associer les notions cardinales pour lui d’« affect commun » et d’« appartenance ». L’« affect commun », ce serait « l’affect qui affecte identiquement tous »[18]. Et il y aurait une « nécessité de l’appartenance » et de « sa force de saisissement »[19]. Lordon relie les deux notions en affirmant : « un affect commun produit nécessairement de l’appartenance »[20]. Or, selon Lordon, « l’homogène et l’hétérogène s’agencent dans un rapport hiérarchique, le premier faisant valoir ses réquisits sur le second »[21]. « Affect commun » et « appartenance », apparentée elle-même à la notion d’« identité »[22], feraient tenir ensemble les individus, sur un mode quasi-organique, dans les « groupements » politiques.
Dans ce cadre, Lordon défend tout particulièrement « l’appartenance nationale »[23] et « l’affect commun national »[24] contre leurs critiques. Il assène, par exemple, que « la socialisation dans la nation est primaire, nécessaire, et ne s’efface jamais complètement »[25]. Selon lui, « une forme politique autre que l’État-nation est un infigurable de l’époque présente »[26], « les possibilités de l’universel » n’étant au mieux que « lointaines »[27]. Corrélativement, il ironise sur « la figure du "citoyen du monde" »[28], les « fantasmagories du genre humain »[29], le « pharisianisme "internationaliste" »[30] ou « les desservants de l’internationalisme abstrait »[31]. Du côté du pôle affectif, il réévalue « la fierté » comme « l’affect national par excellence »[32].
Lordon met également en avant « la force des inscriptions territoriales » :
« La communauté politique totalement disséminée n’existe pas. Elle est un fantasme pour fascinés des réseaux sociaux qui confondent jeu en ligne et forme de vie. Car à un moment il faut bien se retrouver »[33].
Ces formulations font signe du côté des pensées conservatrices de « l’enracinement ». Cette tentation est exprimée dans un autre passage : « il y a un lieu où l’on vit, et ce lieu est lui-même toujours partie du territoire d’une communauté »[34].
Dans l’architecture lexicale et sémantique de la théorie politique de Lordon, le pôle implicitement valorisé est notamment occupé par « l’appartenance », « l’identité », « l’homogène », le « national » ou les « inscriptions territoriales », et le pôle dénigré est occupé par « la désaffiliation »[35], « l’hétérogène », « l’internationalisme abstrait » ou « la communauté politique complètement disséminée ». Lordon répète à plusieurs reprises que ce qu’il valorise implicitement relèverait de « l’analyse positive » du réel, alors que le pôle qu’il dénigre renverrait à des « projections axiologiques » (des jugements de valeur) et à de « l’a priori normatif »[36]. Le glissement rhétorique, non nécessairement conscient chez son auteur, consiste toutefois à appeler « réel » une vision normative de ce dernier du haut d’une théorie conçue comme souveraine au sein de laquelle ce « réel » doit nécessairement rentrer, et non pas ce qui est observable dans des enquêtes de terrain, des investigations historiques et/ou des données statistiques. Cette arrogance intellectualiste, semblant croire en la toute-puissance de la théorie, a depuis longtemps été critiquée par Karl Marx (1818-1883) comme « l’illusion de concevoir le réel comme le résultat de la pensée, qui se concentre en elle-même, s’approfondit en elle-même, se meut par elle-même »[37].
La construction politique proposée par Lordon s’appuie sur une vision fermée sur lui-même de « l’être », ce que Lordon nomme une « physique de l’être-là »[38], et qui s’inscrit dans le sillage de ce que Spinoza a caractérisé comme le conatus, c’est-à-dire la tendance qui serait générale chez les êtres individuels et collectifs à « persévérer dans son être »[39]. Á ce type de renfermement identitaire des êtres individuels et collectifs, on peut opposer la philosophie de la « sortie en-dehors de l’être », ou ouverture de « l’être » à ce qui est autre, dessinée par Emmanuel Levinas (1905-1995)[40]. Lordon est vraisemblablement un des penseurs critiques actuels qui pousse le plus loin la conceptualisation de ce que je qualifierai par la suite de vision identitariste de la politique. Notons aussi que Lordon, dans ses interventions sur l’actualité cette fois, peut parler en défense du « peuple »[41] et même « du peuple dans sa globalité »[42].
Mathieu Bock-Côté, un ultraconservatisme nationaliste venu du Québec
Le québécois Mathieu Bock-Côté (né en 1980, docteur en sociologie) est un essayiste qui effectue des va-et-vient entre un souverainisme de droite au Québec et le conservatisme alourdi du FigaroVox (rubrique dédiée à l’idéologie sur le site du Figaro) en France. Dans un ouvrage de 2019 consacré à la critique du prétendu « politiquement correct », il peut réévaluer les thèses d’extrême droite d’Éric Zemmour[43] ou la tradition politique conservatrice[44], mais conclut pourtant son propos de manière beaucoup plus modérée en faisant un « éloge du conflit civilisé »[45]. On pourrait dire que c’est un conservateur naviguant entre extrême droite et extrême centre.
Dans son livre, Bock-Côté s’insurge contre la tendance du « noyau existentiel de la modernité » à « disqualifier toute forme d’appartenance historique ou naturelle » :
« L’homme est sommé de devenir un nomade : sa seule liberté serait celle de se dépouiller de ses appartenances et de se jeter dans le vaste monde. »[476
Face à cela, il promeut « une définition substantielle de l’identité nationale »[47], en fustigeant « le multiculturalisme »[48] et une fantasmatique « immigration massive »[49]. Comme Julliard, il rejette tant le « sans-frontiérisme »[50], car « un monde sans frontières est un monde aux mille névroses »[51], que l’Histoire mondiale de la France sous la direction de Patrick Boucheron, « histoire métissée » ayant « pour conséquence une dissolution du vieux pays sous la pression migratoire »[52]. Comme Lordon, il met en avant « des aspirations irrépressibles inscrites dans la nature même du corps politique, liées à l’appartenance et à l’identité »[53]. L’essence « nation » et l’essence « peuple » sont nécessairement liées chez lui[54], dans quelque chose comme le peuple-nation.
Chez Bock-Côté, le pôle valorisé est occupé notamment par « l’appartenance », « l’identité nationale » ou le peuple-nation homogène et le pôle dénoncé par « le multiculturalisme », « l’immigration », le « sans-frontiérisme », le « nomade » ou le métissage. Le caractère conservateur du propos s’accentue par rapport à Julliard et Lordon dans une forme d’ultraconservatisme, mais dans des analogies manifestes avec eux.
Des convergences rhétoriques et idéologiques paradoxales
Pourquoi privilégier ainsi le niveau national dans les imaginaires collectifs comme dans l’action politique en en faisant l’axe principal, essentialisé de surcroît, par rapport à deux grands autres niveaux que sont le local et l’international ? Prendre en compte une certaine effectivité présente du plan national, sans le fétichiser pour autant, ne suffit-il pas ? Et pourquoi à gauche (Julliard et Lordon) en rajouter par le discrédit du mondial, en marginalisant le pari de l’universalisable propre à « l’Internationale sera le genre humain », selon les paroles de L’Internationale écrites par Eugène Pottier en juin 1871 en pleine répression de la Commune de Paris ? Et cela, en plus, dans un moment d’affaiblissement des idéaux internationalistes alors que la critique nationaliste de la mondialisation néolibérale est en bien meilleure forme que sa critique altermondialiste… Pourtant d’autres pistes politiques existent dans notre actualité. Par exemple l’historien Jérôme Baschet, spécialiste de l’expérience alternative en cours dans le Chiapas mexicain, rappelle opportunément contre Lordon la configuration d’« appartenances multiples et emboîtées » :
« Ce sont (au moins) trois échelles d’appartenance qu’articule le zapatisme, à la fois soulèvement indigène pour la dignité retrouvée et pour l’autonomie, lutte de libération nationale pour transformer le Mexique et rébellion anti-capitaliste pour l’humanité. Même si cette articulation n’a pas toujours été sans tensions, elle transforme le sens de chacun des registres concernés et permet d’écarter les périls que chacun d’eux, pris isolément, pourrait comporter »[55].
Si Julliard, Lordon et Bock-Côté convergent d’une certaine manière sur la réévaluation du national et la délégitimation de l’internationalisme, ils se croisent aussi sur d’autres terrains plus ou moins adjacents. Comme on l’a vu, ils tendent à certains moments à parler au nom d’un « peuple » homogénéisé ; ce « peuple » étant tendanciellement un peuple-nation, y compris chez Lordon tenté de séparer « les migrants » des « classes populaires »[56] (voir infra chapitre 8). Ils stigmatisent tous les trois « l’individu » et/ou « l’individualisme » en politique :
- « la marche vers une société à l’américaine, individualisée à l’extrême », « les valeurs individualistes », « l’aspiration à une libération totale de l’individu »[57]…jusqu’à « l’individualisme totalitaire »[58] (sic), pour Julliard ;
- « le sentiment individualiste par excellence de la souveraineté personnelle, fantasme de la négation de toute appartenance », « l’individu libéral », « le fantasme de souveraineté du désir individuel » ou « la pensée moderne individualiste »[59], pour Lordon ;
- « le fantasme de l’autoengendrement » ou « un imaginaire radical de l’émancipation » à gauche pour lequel « l’individu, pour s’émanciper, doit se délivrer des appartenances assignées par la société »[60], pour Bock-Côté.
On doit mettre en rapport sur le plan idéologique le grossissement des prétentions de l’entité collective nationale et le rapetissement des ambitions pour l’individu. Ce qui constitue une simple inversion du manichéisme néolibéral : le collectivisme de l’appartenance succède à l’individualisme concurrentiel. Cela va jusqu’à la mise en cause par Bock-Côté de l’idéal d’émancipation individuelle promu au sein des Lumières du XVIIIe siècle.
« L’immigration » comme menace est seulement présente chez Julliard et Bock-Côté, avec une dimension plus accentuée et obsessionnelle chez ce dernier. Julliard s’inquiète des dangers portés par « la question musulmane »[61] et Bock-Côté des « accommodements répétés avec l’islam »[62]. Julliard et Bock-Côté se rejoignent aussi dans l’antiféminisme à travers la condamnation, au nom d’une division sexuée des rôles sociaux prétendument « naturelle », de « la théorie du genre »[63], formulation conservatrice caricaturale d’invention catholique aplatissant la diversité des « études de genre » sur une insaisissable théorie unique[4]. Là aussi cela est plus marqué chez Bock-Côté.
Par contre, la stigmatisation uniformisante des médias est le propre de Lordon et de Bock-Côté :
- « stratégies de la duplicité des médias dominants – en clair, fournir des alibis de pluralisme à une machine dont tous les fonctionnements œuvrent en fait à la reconduction du même »[65], « institutions politiques, partis en général, parti socialiste en particulier, médias, c’est tout le système de la conduite autorisée des opinions »[66], « la forme de pensée médiatique, qui imprègne l’atmosphère de toutes les pensées individuelles dans ce milieu », dont « l’adhésion globale à l’ordre social du moment » et « l’hostilité réflexe à toute critique radicale de cet ordre »[67], ou « les médias dominants se sont scrupuleusement tenus à leur tâche de gardiennage […] pour placer la continuité gouvernementale néolibérale hors d’atteinte »[68], pour Lordon, qui fait pourtant partie des intellectuels les plus médiatisés aujourd’hui à gauche ;
- « une campagne d’épuration médiatique permanente », « les médias de masse, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, ont acquis un pouvoir de conditionnement de la population absolument unique dans l’histoire », « le parti médiatique », « le système médiatique officiel » ou « le dispositif politiquement correct au cœur du système médiatique »[69], pour Bock-Côté, qui s’exprime pourtant régulièrement dans un des organes principaux de la presse écrite française, Le Figaro.
Relevons en particulier la proximité entre « le système de la conduite autorisée des opinions » de Lordon et le « politiquement correct » de Bock-Côté. Ils confluent également dans la dénonciation du fact checking et des rubriques de décodage des fake news dans la presse[70]. Partant, ils participent à délégitimer un outil, certes limité, s’efforçant de freiner la prolifération conspirationniste dans les espaces publics de nos sociétés. Cependant, leur critique manichéenne des médias s’énonce à partir de positionnements politiques complètement contraires :
- « la haine commune de la gauche que, significativement, tous nomment de la même manière : "extrême-gauche" ou "gauche radicale" » serait au cœur des « médias mainstream », selon Lordon[71] ;
- alors que « la stratégie de la gauche radicale » et « l’extrême-gauche identitaire » seraient au cœur du « politiquement correct » médiatique, selon Bock-Côté[72].
Pour le tempéré de gauche Julliard - qui ne donne pas dans ce type de critique simpliste des médias, dont il assume qu’il est une composante depuis longtemps - ce sont les « gauchistes »[73] et « la doctrine de Bourdieu »[74] qui sont dans la ligne de mire.
Comment comprendre les zones actuelles de convergence entre une figure intellectuelle de la gauche modérée, sociale-libérale dans les années 1980 et auto-redéfinie en « républicain » actuellement, une figure intellectuelle de la gauche radicale anti-libérale dans les années 2010 et une figure intellectuelle de la droite conservatrice aujourd’hui ? Or, au-delà même de ces trois cas, il y a aujourd’hui de la friture nationaliste et anti-internationaliste dans des discours de gauche et de droite par ailleurs irrémédiablement opposés sur toute une série de points. Et cela intervient dans un contexte où le nationalisme d’extrême droite a le vent en poupe en France et ailleurs. Il s’agit d’une partie de ce que je vais essayer de comprendre dans cet ouvrage sous le terme de confusionnisme.
******************************
On peut trouver la suite de ces « bonnes feuilles » sur le site de réflexions libertaires Grand Angle, avec le passage qui prend immédiatement la suite de ce qui proposé ci-dessus, en livrant une comparaison entre les discours actuels de Mathieu Bock-Côté, de Jacques Julliard et de Frédéric Lordon avec le nationalisme de « l’enracinement » de Maurice Barrès (1862-1923) dans un point intitulé « Un retour soft de Maurice Barrès, entre ultraconservatisme, gauche modérée et gauche radicale ? » : http://www.grand-angle-libertaire.net/a-propos-de-la-grande-confusion-de-philippe-corcuff/
Ces « bonnes feuilles » sont accompagnées d’un entretien avec la rédaction de Grand Angle qui s’arrête notamment sur de premières réactions vis-à-vis de la sortie du livre par des locuteurs d’extrême droite et de gauche radicale dans des commentaires sur Internet : « Du confusionnisme actuel à l’anarchisme pragmatiste »
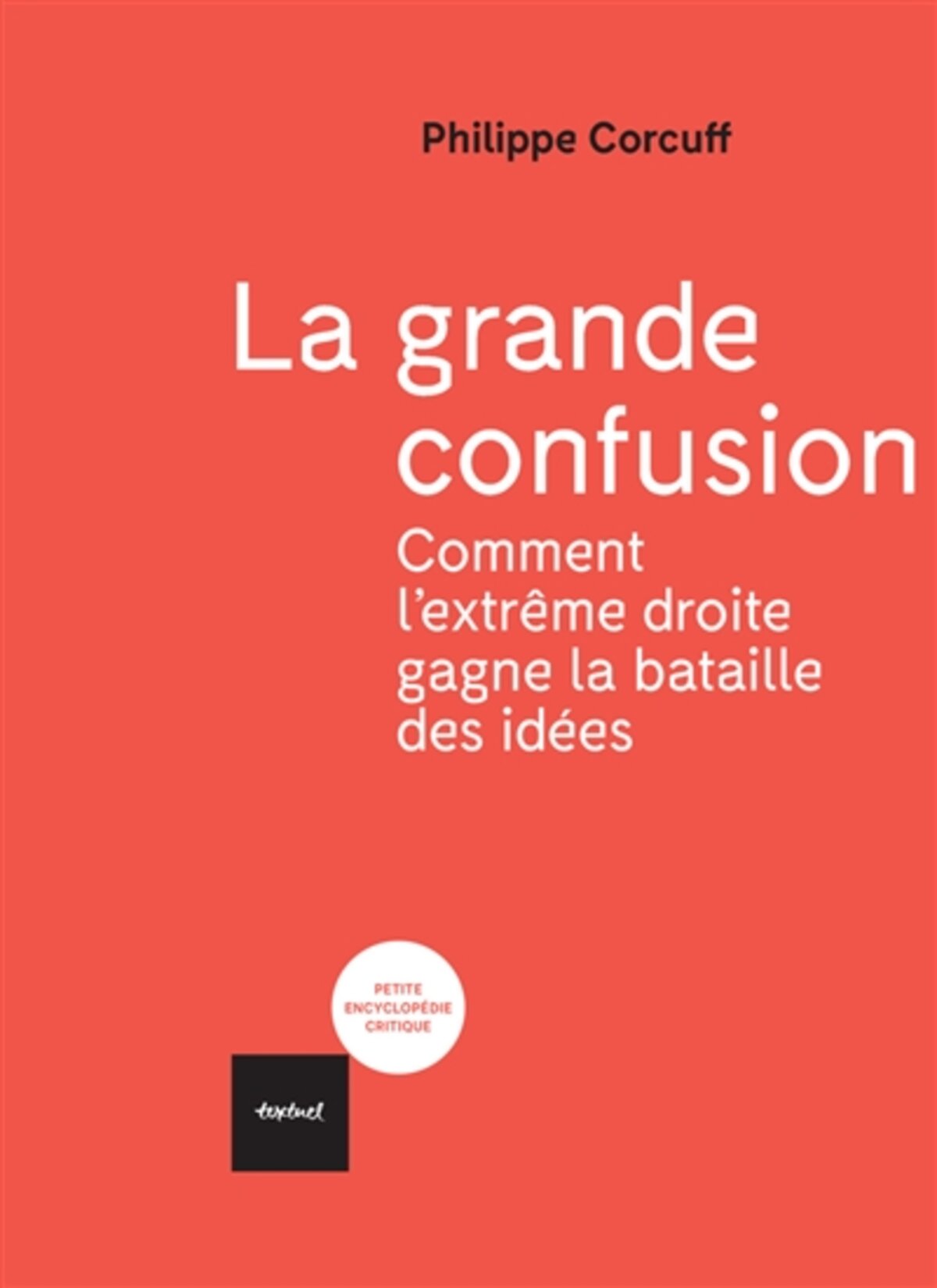
Notes des "bonnes feuilles" de La grande confusion :
[1] Sur la façon dont les transformations de l’espace médiatique américain (avec notamment la place prise par la chaîne de télévision ultraconservatrice Fox News), amorcées dans les années 1990, en interaction avec une présence plus minoritaire de l’ultra-droite sur Internet et les réseaux sociaux, ont contribué à favoriser la « trumpisation » et, au-delà, l’extrême droitisation idéologique et politique aux États-Unis, voir la synthèse de travaux américains de sciences sociales proposée par le sociologue Dominique Cardon, « Pourquoi avons-nous si peur des fake news ? », site culturel AOC (Analyse Opinion Critique), Partie 2, 21 juin 2019, https://aoc.media/analyse/2019/06/21/pourquoi-avons-nous-si-peur-des-fake-news-2-2/.
[2] Voir la notice consacrée à Jacques Julliard publiée sur le site du Maitron. Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social et rédigée par l’historien Christophe Prochasson, mise initialement en ligne le 15 juillet 2011 et modifiée le 26 juillet 2019, https://maitron.fr/spip.php?article137573.
[3] Voir « 1988 : la République du centre », dans l’enquête de l’historien des idées François Cusset, La décennie. Le grand cauchemar des années 1980 [1e éd. : 2006], Paris, La Découverte/Poche, 2008, pp. 136-146.
[4] Ibid., p. 138.
[5] Dans D. Eribon, D’une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française, Paris, Léo Scheer, collection « Variations », 2007, pp. 19-20.
[76 Voir Julien Duval, Christophe Gaubert, Frédéric Lebaron, Dominique Marchetti et Fabienne Pavis, Le « Décembre » des intellectuels français, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1998.
[7] J. Julliard, « Vingt thèses pour repartir du pied gauche » [1e éd. : 2010], repris dans L’Esprit du peuple, Paris, Robert Laffont, collection « Bouquins », 2017, p. 655.
[8] J. Julliard, « Le divorce du peuple et de la gauche », propos recueillis par A. de Benoist, revue Éléments, n° 159, mars-avril 2016, repris dans L’Esprit du peuple, ibid., p. 687.
[9] Ibid., p. 689.
[10] Ibid., p. 685.
[11] Ibid., pp. 689 et 682.
[12] J. Julliard, « Requiem pour une gauche défunte », dans les « Conclusions » de L’Esprit du peuple, ibid., p. 1035.
[13] Ibid.
[14] P. Boucheron (éd.), Histoire mondiale de la France [1e éd. : 2017], Paris, Seuil, collection « Points Histoire », 2018 ; l’historien Patrick Boucheron définit ainsi le projet du livre : « écrire l’histoire d’une France qui s’explique avec le monde » (ibid., p. 13) et cela « contre l’étrécissement identitaire qui domine aujourd’hui le débat public » (ibid., p. 8).
[15] J. Julliard, « Requiem pour une gauche défunte », op. cit., p. 1036.
[16] Ibid., p. 1037.
[17] J. Julliard, « Pour un réformisme utopique », dans les « Conclusions » de L’Esprit du peuple, ibid., p. 1051.
[18] F. Lordon, Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015, p. 20.
[19] Ibid., p. 38.
[20] Ibid., p. 331.
[21] Ibid., p. 71.
[22] Ibid., pp. 37, 39, 48 et 50-51.
[23] Ibid., pp. 47-49.
[24] Ibid., pp. 166-168 et 173-174.
[25] Ibid., p. 271.
[26] Ibid., p. 193.
[27] Ibid., p. 280.
[28] Ibid., p. 47.
[29] Ibid., p. 144.
[30] Ibid., p. 162.
[31] Ibid., p. 305.
[32] Ibid., p. 174.
[33] Ibid., p. 190, mis en italique par l’auteur.
[34] Ibid., p. 50, mis en italique par l’auteur.
[35] Ibid., pp. 50-53.
[36] Ibid., pp. 30, 38, 40, 43 et 154.
[37] Dans K. Marx, « Introduction générale à la critique de l’économie politique » [manuscrit de 1857], repris dans P. Corcuff (éd.), Marx XXIe siècle. Textes commentés, Paris, Textuel, collection « Petite encyclopédie critique », 2012, p. 183.
[38] Ibid., p. 51.
[39] Dans B. Spinoza, Éthique [rédigé en 1663-1675], Paris, GF-Flammarion, 1965, Partie III, proposition VI, p. 142
[40] Pour des prémices de cette conception, voir E. Levinas, De l’évasion [1e éd. : 1935], introduit par Jacques Rolland, Paris, Le Livre de poche, collection « Biblio essais », 1998, p. 125 ; pour une vue globale de ce thème, voir P. Corcuff, « Levinas-Abensour contre Spinoza-Lordon. Ressources libertaires pour s’émanciper des pensées de l’identité en contexte ultra-conservateur », revue Réfractions. Recherches et expressions anarchistes, n° 39, automne 2017, pp. 109-122, https://refractions.plusloin.org/IMG/pdf/refr39_07_levinasetc_comp.pdf.
[41] Voir, par exemple, F. Lordon, « Politique post-vérité ou journalisme post-politique ? », blog « La pompe à phynance », Les blogs du « Diplo », 22 novembre 2016, https://blog.mondediplo.net/2016-11-22-Politique-post-verite-ou-journalisme-post, « Les forcenés », ibid., 8 janvier 2019, https://blog.mondediplo.net/les-forcenes et « Le complot des anticomplotistes », Le Monde diplomatique, octobre 2017, https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10/LORDON/57960.
[42] F. Lordon, « Des "petits rats" et du journalisme selon Ariane Chemin », blog « La pompe à phynance », Les blogs du « Diplo », 3 février 2020, https://blog.mondediplo.net/des-petits-rats-et-du-journalisme-selon-ariane.
[43] M. Bock-Côté, L’empire du politiquement correct. Essai sur la respectabilité, Paris, Cerf, 2019, pp. 54-55 et 240-242.
[44] Ibid., pp. 231-239.
[45] Ibid., pp. 255-263.
[46] Ibid., p. 24.
[47] Ibid., p. 98.
[48] Ibid., notamment pp. 23, 56, 57, 75, 77, 78, 101 et 171.
[49] Ibid., notamment pp. 16, 42, 101, 138 et 204.
[50] Ibid., p. 99.
[51] Ibid., p. 203.
[52] Ibid., p. 140.
[53] Ibid., p. 146.
[54] Ibid., pp. 138-146.
[55] Dans J. Baschet, « Frédéric Lordon au Chiapas », site de la revue Ballast, 9 mai 2016, https://www.revue-ballast.fr/frederic-lordon-au-chiapas/.
[56] Dans F. Lordon, « Appels sans suite (2). Migrants et salariés », blog « La pompe à phynance », Les blogs du « Diplo », 17 octobre 2018, https://blog.mondediplo.net/appels-sans-suite-2.
[57] J. Julliard, « Le divorce du peuple et de la gauche », dans L’Esprit du peuple, op. cit., pp. 684-685.
[58] J. Julliard, « Requiem pour une gauche défunte », ibid., p. 1034.
[59] F. Lordon, Imperium, op. cit., pp. 55, 57, 58 et 69.
[60] M. Bock-Côté, L’empire du politiquement correct, op. cit., pp. 24 et 92.
[61] J. Julliard, « Requiem pour une gauche défunte », dans L’Esprit du peuple, op. cit., p. 1026.
[62] M. Bock-Côté, L’empire du politiquement correct, op. cit., p. 113.
[63] J. Julliard, « Requiem pour une gauche défunte », dans L’Esprit du peuple, op. cit., p. 1035, et M. Bock-Côté, L’empire du politiquement correct, op. cit., pp. 16, 24-27, 58 et 246.
[64] Voir Sara Garbagnoli et Massimo Prearo, La croisade anti-genre. Du Vatican aux manifs pour tous, Paris, Textuel, collection « Petite encyclopédie critique », 2017.
[65] F. Lordon, « Critique des médias, critique contre les médias », », blog « La pompe à phynance », Les blogs du « Diplo », 17 août 2009, https://blog.mondediplo.net/2009-08-17-Critique-des-medias-critique-dans-les-medias.
[66] F. Lordon, « Politique post-vérité ou journalisme post-politique ? », art. cit.
[67] F. Lordon, « Le complot des anticomplotistes », art. cit.
[68] F. Lordon, « Les forcenés », art. cit.
[69] M. Bock-Côté, L’empire du politiquement correct, op. cit., pp. 31, 35, 46, 47 et 65.
[70] F. Lordon, « Le complot des anticomplotistes », art. cit., et M. Bock-Côté, L’empire du politiquement correct, op. cit., pp. 60-63.
[71] F. Lordon, « Politique post-vérité ou journalisme post-politique ? », art. cit.
[72] M. Bock-Côté, L’empire du politiquement correct, op. cit., pp. 29 et 191.
[73] J. Julliard, « le divorce du peuple et de la gauche », dans L’Esprit du peuple, op. cit., p. 682.
[74] J. Julliard, « Requiem pour une gauche défunte », ibid., p. 1033.



