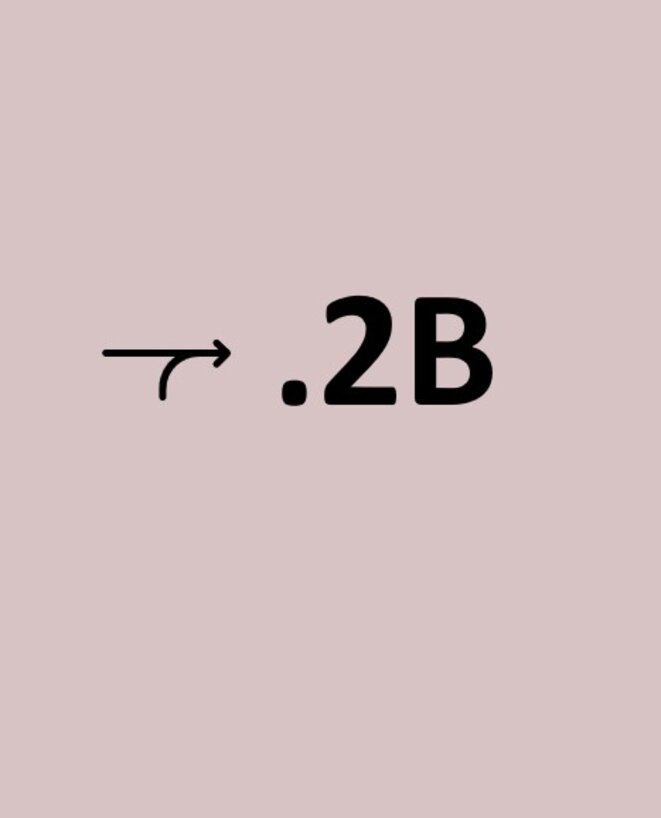Une reportage de France Info[1] compile sous couvert d’anonymat, plusieurs témoignages qui confirment l’atmosphère délétère qui règne à l’Assemblée nationale. Il ne faut pas s’y tromper, la chambre basse a toujours été une arène où les orateurs se sont affrontés, régulièrement dans le chahut, voire l’invective. La vie démocratique n’est pas un apéro zoom et il est normal que les oppositions puissent s’exprimer de façon contradictoire, passionnée, tendue. Les fonctionnaires interrogés qui ont le plus d ‘expérience le disent et soulignent également la part de théâtralisation qui peut caractériser le passage des commissions à l’hémicycle. Passage normal pourrait-on dire qui renvoie à deux moments du travail politique : le débat technique et l’exposé rhétorique[2]. Mais ce que relèvent les agents qui ne sont pas nés de la dernière législature, c’est la radicalisation des positions, la tension permanente, au point de les obliger à intervenir parfois pour qu’on n’en vienne pas aux mains. Un observateur conclut sur ce qui peut s’assimiler à point de non-retour : « ils ne se respectent plus ». C’est ce constat, générateur de tensions et d’un débat devenu impossible qu’il faut interroger.
Il faut bien sûr souligner la configuration institutionnelle du moment, qui sans être inédite n’a pas souvent émergé sous la Ve république, celle d ‘un exécutif ne disposant que d’une majorité relative à l’Assemblée nationale. Cette situation a déjà été connue sous de Gaulle et durant le second mandat de F. Mitterrand[3]. Il faut alors rappeler le rôle crucial de l’actuel président de la République dans la crispation actuelle des positions. Conscient de devoir sa réélection à un barrage républicain contre le RN, Emmanuel Macron a dit le soir du second tour que ce vote « l’obligeait »[4]. On connaît la suite. Bien loin d’apaiser le corps social, de mettre en place une politique cherchant le compromis, il a déroulé son agenda néolibéral en contradiction complète avec son propos du 10 avril 2022, utilisant tous les mécanismes prévus par la constitution pour forcer le passage à une loi, faisant même preuve d’une grande créativité juridique à cet égard[5]. Il poussa la forfaiture jusqu’à dire qu’il avait été élu pour faire la réforme des retraites et plongea le pays dans six mois de crise sociale dont on ne sait quand il s’en relèvera. La brutalisation du maintien de l’ordre[6] et les violences de rue ne pouvaient que trouver une transposition à l’Assemblée nationale, le contraire eût prouvé sa déconnexion avec le reste du pays. Les députés de la NUPES ont donc effectué leur travail en introduisant au sein de l’hémicycle l’opposition à cette réforme, dans toute son intensité, creusant ainsi un peu plus le fossé au sein de la représentation nationale. Mais comment eût-on pu faire autrement ?
On le voit, le « ils ne se respectent plus » observé par les fonctionnaires de l’Assemblée nationale s’analyse en première lecture comme le résultat d’une conjoncture particulièrement tendue, comme l’histoire de la république en a vu bien d’autres, de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat à l’autodétermination de l’Algérie. Mais l’analyse serait très insuffisante si elle s’arrêtait là, car c’est à un point de bascule auquel nous assistons peut-être. En effet, la conjoncture actuelle n’est pas seulement faite d’un président mal élu et autoritaire avec une majorité relative. Plus structurellement, elle est l’aboutissement d’une cristallisation idéologique, une polarisation de plus en plus nette[7], qui oppose deux visions[8] du monde qui ne peuvent plus se faire de concessions. En effet, le clivage classique qui oppose conservateurs et progressistes ne rend plus compte de la radicalité de l’opposition entre celles et ceux qui pensent lutter pour la survie de l’écosystème terrestre et celles et ceux qui – quoi qu’ils en disent – sont les défenseurs des gagnants de ce système écocidaire. Même le clivage qui opposait jadis la gauche communiste et la droite gaulliste ne revêtait pas un antagonisme aussi fort et d’ailleurs les religionnaires des deux camps ont su travailler ensemble quand des circonstances exceptionnelles l’ont exigé. Il y a quelque chose de désespéré dans le dialogue de sourds qui oppose aujourd’hui les représentants de la nation, tant les uns adossent leur action à une conscience existentielle pour l’humanité alors que les autres ne font que de la gestion néolibérale à la petite semaine.
A cette bipolarisation réelle s’ajoute les divisons internes à chaque camp et ce que tout le monde ressent comme le compte à rebours de l’arrivée du RN au pouvoir[9]. Comme ailleurs en Europe, l’extrême droite française a en effet, dans ce contexte de tensions, de bonnes chances de rafler la mise avec cette recette éprouvée qui consiste à rassembler un peuple désuni contre un bouc-émissaire. Ce compte à rebours, ce tic-tac dans la tête de tous les acteurs, rajoute une urgence politique à l’urgence écosystémique. Alors oui, on ne se respecte plus, on ne négocie plus, on ne tergiverse plus, parce qu’on n’a plus le temps, par ce qu’on défend des intérêts inconciliables, par ce qu’on a consciences de vivre pour les uns un moment historique avec toute sa charge de responsabilité à laquelle on ne peut se dérober ; parce qu’on se vit pour les autres comme les gardiens d’un temple dont on ne veut pas voir que ses murs s’effondrent. Subsidiairement, une question intéressante est de savoir pourquoi cette polarisation est plus forte en France qu’ailleurs en Europe, comme si notre pays se trouvait toujours aux avant-postes des querelles politiques les plus prégnantes, quand d’autres ont vu tout simplement l’option de gauche disparaître[10].
En tout cas, ce genre de configuration politique se dénoue rarement dans le calme et la concorde civile ; les violences de rue et les tensions parlementaires qui se sont manifestées ces derniers mois ne sont malheureusement que les prémisses d’un monde à venir de plus en plus anxiogène.
[1] Des fonctionnaires de l'Assemblée nationale racontent un an de "tensions" entre des députés "qui ne se respectent plus" (francetvinfo.fr)
[2] Clément Viktorovitch, Le pouvoir rhétorique, Seuil, 2021.
[3] Législatives 2022: une majorité relative pour Macron? Ce qui s'est déjà produit sous la Ve République (huffingtonpost.fr)
[4] (1090) REPLAY - Discours d'Emmanuel Macron après sa victoire au 2nd tour de l'élection présidentielle 2022 - YouTube (à 3’15).
[5] Pour comprendre la vie parlementaire, je conseille vivement les publications de François Malausséna, dans le club de Médiapart François Malaussena | Le Club de Mediapart et surtout sur twitter François Malaussena (@malopedia) / Twitter
[6] Maintien de l’ordre : « La brutalisation des interventions est aujourd’hui au cœur de la stratégie française » (lemonde.fr)
Maintien de l’ordre et politiques du désordre | Mediapart
Voir également notre billet « Ce que la brutalisation du maintien de l’ordre doit au quinquennat Hollande ».
[7] Voir ce très bon article dans Le monde : La polarisation, fièvre des sociétés démocratiques (lemonde.fr) qui reprend le « baromètre de la polarisation politique » de l’université Charles III de Madrid.
[8][8] Je suis d’accord, à une certaine échelle d’observation, avec l’idée d’une tripartition de l’échiquier politique depuis les dernières élections, mais on peut encore simplifier le schéma en mettant dans un même panier l’extrême centre néolibéral, LR et le RN qui a bien des égards n’offrent plus guère que des nuances pour les distinguer.
[9] Les Quinquistes balisent le terrain pour l'extrême droite | Le Club (mediapart.fr)
Bleu Marine 2027, le jour où tout a merdé | Le Club (mediapart.fr)
[10] Voir toutes les contributions récentes sur l’histoire politique de l’Italie à l’occasion de la mort de Berlusconi, notamment l’excellent blog de Salvatore Palidda, Mort de l’acteur du néolibéralisme et de la dérive vers le fascisme « démocratique. » | Le Club (mediapart.fr)