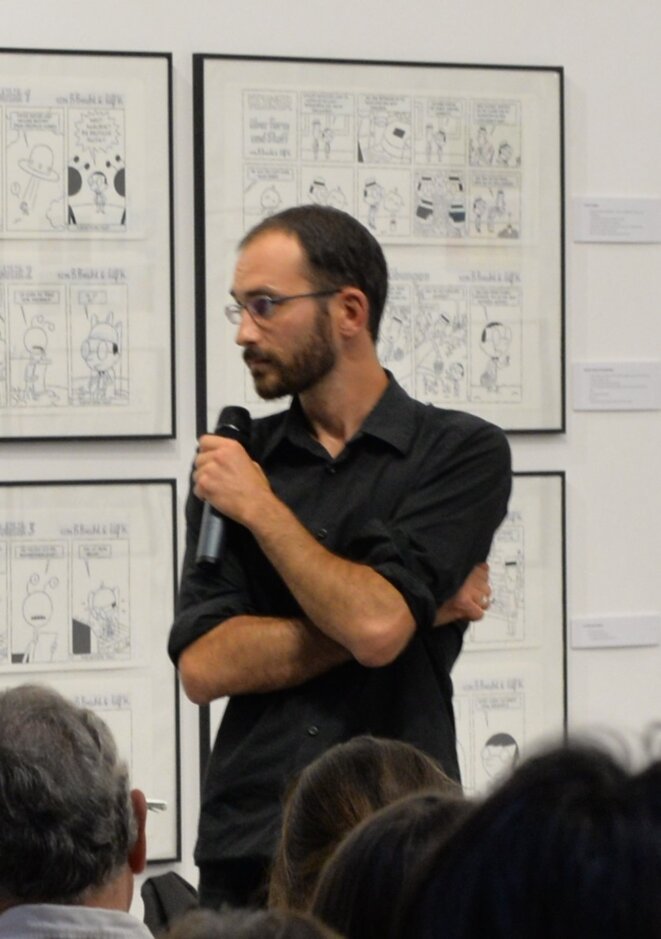Pour découvrir mes autres publications (livre, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
« Nous voulons que le travail paye », clamait la semaine dernière Aurore Bergé, la meneuse des macronistes à l’Assemblée nationale. Comment ne pas être d’accord avec elle ? Qui pourrait bien vouloir, en effet, que le travail ne paye pas ? La députée des Yvelines semble pourtant suggérer que c’est ce que souhaite le groupe de la NUPES, qui s’est opposé à un article de loi visant à l’extension de la prime « Macron ».
Les élus de gauche sont-ils donc hostiles au travail, et ne visent-ils qu’à augmenter les minimas sociaux pour permettre aux fainéants de se prélasser dans la plus grande indolence ? La réponse paraît assez évidente quand on considère le projet porté par la NUPES, mais rejeté par le parti présidentiel : augmenter le salaire minimum.
Là où les macronistes se posent en défenseurs de la valeur travail avec leur proposition de prime exceptionnelle versée selon la volonté des employeurs, l’alliance de gauche prône tout simplement une augmentation des salaires. Pour que le travail paye, oui, et pas seulement une fois l’an si les patrons ont décidé qu’il en sera ainsi.
On touche ici à une contradiction majeure des partis de droite, dont les discours exaltent la valeur du travail, mais dont les programmes politiques racontent une autre histoire. Car que font, en pratique, les macronistes, Républicains et autres sarkozystes ? Que font-ils, et qu’ont-ils fait depuis des décennies, pour s’assurer que le travail paye ?
Donner plus à ceux qui ont plus
L’énergique Nicolas Sarkozy avait, en son temps, eu à cœur de défiscaliser les heures supplémentaires. « Travailler plus pour gagner plus », claironnait-il à tout bout de champ… mais pas pour la moitié la plus modeste de la population, qui ne paye pas l’impôt sur le revenu [1] et qui ne pouvait donc pas bénéficier de cet avantage fiscal.
Le président Sarkozy avait aussi considérablement allégé les droits de succession. Cela, disait-il, afin que ceux qui ont travaillé toute leur vie puisse transmettre à leurs enfants le fruit de leurs efforts. S’il s’agit là d’une noble intention, elle souffre néanmoins de deux grandes faiblesses : d’abord, le patrimoine que l’on transmet est bien souvent lui-même issu d’un héritage, et non du travail – dans la grande bourgeoisie, les fortunes se transmettent de génération en génération. L’exception constituée par les « self-made-men » ne doit pas occulter la règle générale, qui est celle de la reproduction sociale.
Ensuite, si le but est effectivement de favoriser le travail, il serait alors plus judicieux d’alléger la fiscalité… du travail ! Réduire les taxes sur l’héritage de Jean-Eudes, qui recevra quelques millions d’euros à l’âge de cinquante ans (le bourgeois est coriace, il vit vieux) est certainement moins respectueux de la valeur du travail que de réduire les taxes qui sont prélevées sur le salaire du même Jean-Eudes – salaire qu’il a gagné lui-même, par ses propres efforts. Mais cette alternative bien plus favorable du travail ne semble pas avoir traversé l’esprit de M. Sarkozy.
Avançons de quelques années, et continuons. Emmanuel Macron, lui non plus, n’est pas resté les bras croisés dans son bureau de l’Elysée : après avoir aboli l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), il a nettement réduit la taxation des revenus du capital avec la mise en place de sa fameuse « flat tax » qui coûte vraisemblablement à la nation plusieurs milliards d’euros par an. [2]
Le travail de ceux qui n’ont que ça
Voilà, succinctement, ce qu’on peut dire des mesures prises par ces politiciens de droite qui se présentent comme les champions de la valeur travail. Qu’auraient-ils fait, en réalité, s’ils respectaient la valeur du travail ? D’abord, ils auraient augmenté le salaire minimum, pour faire en sorte que les millions de personnes qui exercent à longueur d’année des emplois éprouvants et mal rémunérés puissent enfin gagner correctement leur vie.
Ensuite, ils auraient eu à cœur de compenser les sacrifices des travailleurs qui usent leur corps dans les usines et sur les chantiers, en leur permettant de partir à la retraite plus tôt. C’est tout le sens du Compte Professionnel de Prévention (C2P), instauré sous François Hollande. Ce dispositif, qui permet aux salariés exposés à la pénibilité physique de cumuler des points au cours de leur carrière, pourrait constituer le point de départ d’une avancée sociale majeure et devrait être considérablement étendu.
Au lieu de cela, Emmanuel Macron s’est empressé de le raboter dès le début de son premier mandat, en supprimant presque la moitié des formes de pénibilité reconnues par le dispositif. Si l’on ajoute à cela son ambition de repousser l’âge de la retraite à 65 ans [3], le constat est clair : notre actuel chef de l’Etat se soucie peu de récompenser le travail de ceux qui débutent leur vie active très tôt, qui travaillent dur, qui vieillissent mal et qui meurent jeunes.
Enfin, un gouvernement véritablement attaché à la valeur travail s’emploierait à abolir l’écart qui existe entre la taxation du capital et celle du travail. A l’heure actuelle, si je gagne mille euros en nettoyant les toilettes des trains, je suis beaucoup plus taxé que si je reçois mille euros de dividendes par le seul fait que je possède des actions en bourse. [4]
Ce privilège accordé aux revenus du capital est un affront constant envers tous ceux d’entre nous qui n’ont que leur travail pour vivre. Pourtant, la taxation des héritages, ainsi que du capital et des revenus qu’il génère, ne sont pas des mesures qu’on trouvera à l’agenda des droites. Partis de privilégiés, qui gouvernent au profit des privilégiés, ils ne se disent attachés au travail que pour leurrer nos concitoyens qui aspirent à la reconnaissance de leurs sacrifices et à plus de justice sociale.
Que Mme Bergé, M. Macron et leurs alliés cessent de gaspiller leur salive : nous ne sommes pas dupes. Ils ne respectent pas le travail, et en vérité ils le piétinent même à longueur d’année. Les souffrances des employés subalternes n’ont, pour eux, que peu d’importance face au stress des cadres. Les déboires des P-DG les préoccupent plus que le sort des ouvriers que le travail a rendu infirmes.
Les droites ne célèbrent que le travail des plus aisés, dans une tentative de donner à leur opulence un vernis de légitimité. Mais, dès qu’il s’agit de passer aux actes, on constate aisément que ces partis méprisent le travail de ceux qui, justement, n’ont que cela pour vivre.
[1] Que l’on se rassure : les plus modestes payent toute une tripotée d’autres impôts, comme la TVA, les cotisations sociales, la CSG, les taxes sur l’essence et l’électricité, etc. Au bout du compte, le taux de prélèvements obligatoires qui pèse sur les classes populaires est à peu près le même que celui qui est appliqué aux classes moyennes. Il est même supérieur à celui des plus riches, car ces derniers bénéficient abondamment de la faible taxation des revenus du capital (due en grande partie à l’étroitesse de l’assiette fiscale de l’IRPP et de la CSG).
[2] Le principe de la flat tax est relativement simple : le contribuable choisit la manière dont sont imposés ses revenus du capital. Soit il les déclare à l’impôt sur le revenu (dont le taux est progressif), soit il les déclare au titre de la flat tax dont le taux est fixé à 30 %, quels que soient les montants concernés. Pour les ménages qui perçoivent plus de 73 000 € par an (6 000 € par mois), cette possibilité est très avantageuse : les revenus qui dépassent cette tranche sont taxés à 41 % dans le cadre de l’impôt sur le revenu, alors qu’ils ne sont taxés qu’à 30 % dans le cadre de la flat tax.
Pour les très hauts revenus, cette différence peut représenter une baisse d’impôts de plusieurs dizaines de milliers d’euros par an. Avec cette réforme, Emmanuel Macron a encore aggravé les inégalités devant l’impôt – alors que les revenus du capital étaient déjà moins taxés que les revenus du travail (voir note précédente), la flat tax leur permet encore de creuser l’écart. C’est en quelque sorte une redistribution à l’envers : les prolétaires doivent payer des impôts élevés pour compenser les avantages fiscaux dont bénéficient les possédants.
[3] Un ouvrier ayant commencé à travailler à l’âge de 15 ans serait ainsi contraint de cotiser pendant cinquante ans. Un cadre ayant commencé à l’âge de 25 ans, après des études longues, devrait cotiser dix ans de moins… alors même qu’il est statistiquement destiné à vivre six ans de plus, du fait des inégalités sociales de santé. Les travailleurs des classes populaires devraient donc cotiser encore plus longtemps qu’à l’heure actuelle, pour profiter encore moins longtemps d’une retraite bien méritée (en moyenne, la santé des ouvriers se détériore significativement à l’âge de 59 ans – incapacité de type 1 – et ils décèdent à l’âge de 76 ans).
Bref, plus encore qu’aujourd’hui, les ouvriers cotiseraient pour payer la retraite des cadres. Même si Emmanuel Macron a évoqué deux systèmes de départ anticipé au titre « des carrières longues » et de « la pénibilité », ces éventuelles mesures demeurent absolument floues et rien ne garantit qu’elles seraient vraiment de nature à compenser l’injustice criante faite aux travailleurs des classes populaires.
A rebours du projet d’Emmanuel Macron, Noam Léandry – président de l’Observatoire des inégalités – propose une solution nettement plus juste : « plutôt qu’un âge légal uniforme, c’est une durée de cotisation unique qui doit être appliquée. Ainsi, celui qui aura commencé à travailler à 15 ans partira à la retraite dix années avant celui qui a fini ses études à 25 ans. Il faut y ajouter un système de bonus pour les métiers les plus durs physiquement. »
[4] Moins de 20 % des revenus du capital sont soumis au barème progressif de l’IRPP (qu’on appelle couramment « impôt sur le revenu »). Ce chiffre monte à 25 % pour les revenus du capital immobilier, mais baisse à moins de 15 % pour les revenus du capital financier. Par ailleurs, les revenus du capital ne sont pas soumis aux cotisations sociales, et ne participent donc que très faiblement au financement de la protection sociale – à travers la CSG, qui ne s’applique qu’à 40 % des revenus du capital. Voir Pour une révolution fiscale, Camille Landais, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, éditions du Seuil, 2011, p. 68 et suivantes.