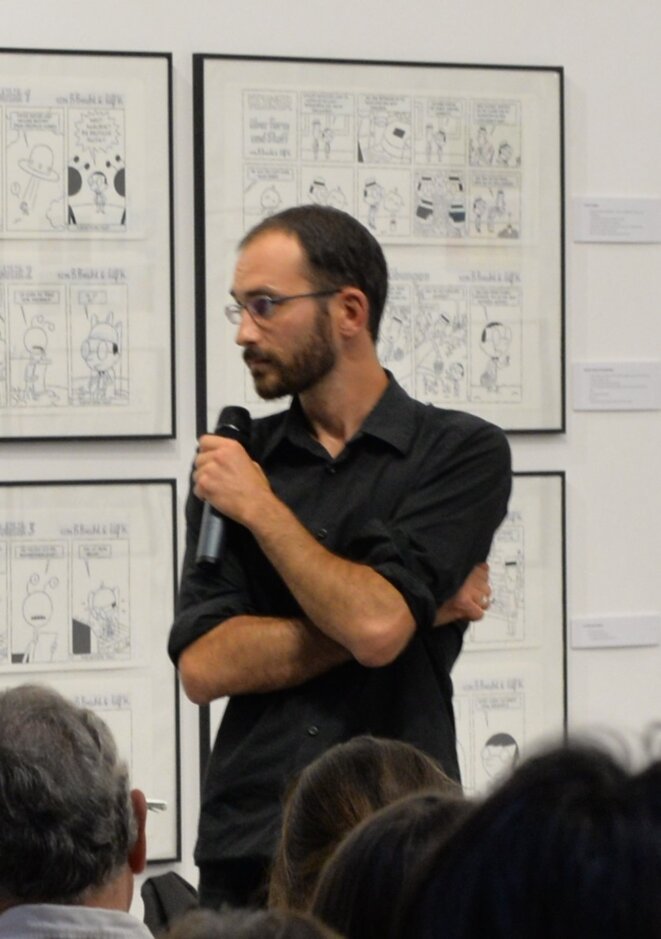Pour découvrir mes autres publications (livres, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr

Agrandissement : Illustration 1

Quand on tape « patron » sur Google, il y a de quoi être surpris par les résultats qui s’affichent en-dessous de la barre de recherche : un patron, nous disent les sites Internet, est un modèle utilisé pour faire de la couture. Ou un personnage religieux qui protège une communauté. C’est aussi, ô surprise, une personne qui emploie des salariés et qui les dirige. Dans les résultats de recherche, même en visionnant une demi-douzaine de pages, on n’aperçoit aucun contenu revendicatif, et seulement une ou deux références à ces personnes qu’on appelait les patrons, et qu’on désigne aujourd’hui par l’appellation de « chefs d’entreprise ».
Signe des temps, même leur principale organisation représentative a changé de nom : en 1998, le CNPF (Conseil National du Patronat Français) est rebaptisé MEDEF (Mouvement des entreprises de France). L’image devient plus dynamique : d’un « conseil », on passe à un « mouvement ». Le nom de l’organisation ne désigne plus les personnes qui la composent (les patrons, le patronat) mais les entreprises, laissant entendre que les intérêts des entreprises se confondent avec les intérêts de ceux qui les dirigent.
Dans le champ politique, également, le mot « patron » n’est plus prononcé. Tout au plus évoque-t-on le patronat, quand le gouvernement appelle au dialogue entre les « partenaires sociaux ». La droite glorifie les dirigeants d’entreprises, qu’elle désigne avec le terme positivement connoté « d’entrepreneurs » (sachant que beaucoup de patrons n’ont pas fondé eux-mêmes l’entreprise qu’ils dirigent) ou de « capitaines d’industrie ». Elle les présente comme d’audacieux « premiers de cordée », et comme d’irremplaçables créateurs de richesses.
La gauche, elle, ne s’intéresse plus aux patrons. Elle dénonce les « riches », et surtout les « ultra-riches », sans toujours préciser de qui elle parle. Surtout, elle vilipende les actionnaires. C’est que le monde a changé : au cours du siècle dernier, le capitalisme à structures familiales s’est largement financiarisé, et la figure du patron s’est dédoublée. D’un côté le patron physique, un visage et une voix qu’on connaît, la personne qui est présente dans l’entreprise pour donner des directives. De l’autre, d’anonymes propriétaires de capitaux, parfois situés dans d’autres pays, qui exigent de l’entreprise qu’elle leur verse des profits élevés, sans quoi ils s’en iront pour placer leur argent ailleurs.
Dans cet article, pourtant, nous allons parler des patrons. La raison en est que, quand une voix s’élève pour appeler à la redistribution des richesses au nom d’un impératif de justice sociale, elle fait aussitôt face à toutes sortes d’objections – et un certain nombre de ces objections concernent les patrons. Pour justifier leurs revenus, les chefs d’entreprise mettent en avant des arguments bien connus : le poids des responsabilités, la lourdeur de la charge mentale associée à leur rôle, les journées à rallonge, le souci constant de parvenir à pérenniser les emplois, etc. En fait, quand ils défendent la légitimité des revenus qu’ils tirent de leur position, certains patrons dressent un tableau si sombre qu’on en viendrait à vouloir les sauver de cette condition tellement misérable. Les patrons, en fin de compte, sont-ils des exploités ?
Victimes et surhommes
C’est en effet ce que l’on pourrait penser, à en croire les discours victimaires qui circulent au sein du patronat. Que disent ces discours ? Que les patrons sont détestés par leurs concitoyens et malmenés par les médias. Qu’ils sont asphyxiés par la bureaucratie, les taxes et les politiciens démagogues. Pourtant, les patrons se tuent à la tâche pour créer de la richesse et des emplois. Ils portent l’économie sur leurs épaules.
Selon ce point de vue, le patron est à la fois une victime et un surhomme. Malgré les multiples obstacles que la société dresse sur son chemin, il parvient à tenir son activité à flots. Animé par la flamme de l’intérêt général, il persiste à entreprendre en milieu hostile et sacrifie ses besoins personnels (famille, temps libre, tranquillité d’esprit) pour pérenniser les emplois des gens qui travaillent pour lui. Être patron, c’est un chemin de croix.
Le livre Chronique d’un salaud de patron, écrit par Julien Leclercq, regorge d’affirmations de ce type. « Les entrepreneurs, nous explique ce jeune dirigeant de PME, sont les forces vives de ce monde. (…) Créer un emploi, c’est un immense engagement, un immense risque que le chef d’entreprise doit ensuite assumer à chaque instant. (…) La fonction de patron se doit d’être réhabilitée. Les milliers de personnes qui se battent chaque jour pour faire exister leur entreprise et sauver les emplois le méritent amplement. » [Leclercq, 2017, p. XII, 102 et 104]
Cette vision romantique de l’entreprenariat n’est pas partagée par tous les patrons. Gérard Morvan, par exemple, a fondé une entreprise qui emploie 130 salariés et qui génère 20 millions d’euros annuels de chiffre d’affaires. Pour lui, c’est la motivation financière qui prédomine : « On crée une entreprise aussi pour de l’argent (…) pour devenir riche, et ça, c’est un facteur indéniable. » [Offerlé (dir.), 2017, p. 272] Emmanuel Macron ne le contredirait pas, lui qui cherchait à promouvoir l’esprit d’entreprise en expliquant « il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. »
En ce qui concerne le rapport de la presse avec le patronat, on voit mal ce qui pourrait laisser croire aux patrons qu’ils sont maltraités : la quasi-totalité des principaux médias en France [1] est possédée par des patrons de grands groupes, qui ont à cœur de diffuser une vision du monde favorable à leurs intérêts. Les entreprises de médias étant rarement bénéficiaires, il paraît clair que ces businessmen ne les achètent pas en espérant en tirer directement un profit financier.
L’industriel Serge Dassault, décédé il y a quelques années, était également un patron de presse. Lorsqu’il a racheté le Figaro, il expliquait sans détour sa volonté « d’avoir un journal ou un hebdomadaire pour exprimer son opinion. » [2] Le richissime Pierre Bergé, mécontent des révélations de son journal Le Monde sur l'évasion fiscale à travers le scandale SwissLeaks, rappelait aux journalistes que « ce n'est pas pour ça que je leur ai permis d'acquérir leur indépendance » [3]. Ex-directeur de la rédaction du Nouvel Observateur et ex-directeur du Point, Franz-Olivier Giesbert confirme : « il est normal que le propriétaire donne des directives à ses journalistes. » [4] Tout est dit. [5]
C’est qui le patron ?
Avant de poursuivre notre propos sur les patrons, il importe de souligner que le patronat constitue un groupe social très hétérogène. Qu’y a-t-il de commun, en effet, entre le propriétaire d’un salon de coiffure, et le directeur d’un chantier naval ? Entre le gérant d’un petit commerce, et le P-DG de Total ? [6] Il faut également distinguer les patrons qui ont fondé leur société, de ceux qui ont pris les rênes d’une compagnie existante. Distinguer ceux qui possèdent l’entreprise, des patrons salariés qui la dirigent sous la houlette de ses actionnaires.
En pratique, chaque patron peut appartenir à l’une des catégories suivantes : salarié, héritier, fondateur ou repreneur. La situation se complique encore si on considère les travailleurs indépendants, qui se situent aux marges du patronat. Plombiers, restaurateurs, épiciers, boulangers, opticiens, avocats, libraires, agriculteurs, architectes… Souvent, ils partagent avec les « vrais » chefs d’entreprise le fait d’employer quelques salariés et de les diriger [7]. Mais beaucoup d’entre eux n’emploient personne, et leur principal point commun avec les patrons est de ne pas être subordonnés à l’autorité d’un chef. [8]
Quand les patrons cherchent à justifier le montant de leurs revenus, ou à revendiquer d’être moins taxés, il importe avant tout de clarifier l’objet du débat : de quels patrons parle-t-on ? Des petits ? Des gros ? L’enjeu sera en effet bien différent, car beaucoup d’entre nous peuvent compatir aux difficultés rencontrées par un petit patron qui se démène pour dégager un revenu modeste, tout en jugeant illégitimes les hauts revenus des dirigeants de grandes entreprises.
Cet article est une réponse aux patrons qui s’estiment injustement traités par la société. Il consistera à examiner la situation des patrons, petits et grands, au regard des impératifs de la justice sociale. Mon objectif est de faire la part, dans leurs revendications, entre celles qui sont recevables et celles qui sont dénuées de fondement.
Pour l’essentiel, mon propos consistera à comparer les difficultés mises en avant par les patrons, avec celles que rencontrent les travailleurs salariés. Il s’agira également d’identifier les marges de manœuvre dont disposent les patrons pour réduire l’inconfort lié à leurs fonctions, et d’essayer de comprendre pourquoi ils décident parfois de ne pas avoir recours à ces solutions-là.
Devenez salariés
Commençons par cette simple remarque : si l’exercice du métier de patron est aussi difficile que ce que prétendent nombre d’entre eux, alors on comprend mal pourquoi ceux-ci s’obstinent à diriger des entreprises. Après tout, « qui peut le plus peut le moins » – un patron qui en a assez de son poste pourrait tout à fait chercher un repreneur, puis trouver un emploi salarié avec moins de responsabilités dans une autre entreprise.
Pour certains d’entre eux, le passage au salariat impliquerait une baisse de niveau de vie qu’ils ne sont pas prêts à accepter. On doit alors en déduire que les revenus de ces patrons sont très confortables, ce qui entre en contradiction avec la revendication patronale récurrente selon laquelle les chefs d’entreprise seraient ensevelis sous les impôts. A minima, cela signifie que ce niveau de revenu leur paraît suffisant pour compenser les tracas associés à leur activité.
L’argent ne représente pourtant, il me semble, qu’une partie de la réponse. Beaucoup d’entrepreneurs trouvent un bénéfice important à être leur propre patron, à ne pas avoir de chef sur le dos. Il en est ainsi de Patrick, artisan carreleur : « je gère mon temps comme je veux, et c’est déjà une bonne chose, j’ai pas un patron derrière moi en train de me dire ‘‘il n’est pas l’heure de débaucher !’’. » [Offerlé (dir.), p. 453]
D’autres mettent en avant le défi stimulant que représentent la création et la direction d’entreprise. Ils se réalisent dans l’adversité, face à l’incertitude, et peuvent ainsi satisfaire leur goût de l’aventure. L’auteur de Chronique d’un salaud de patron (cité plus haut), malgré son insistance à se faire plaindre, confie aussi tout le plaisir qu’il prend à exercer son activité : « Entreprendre est une formidable voie d’épanouissement, d’accomplissement de soi, accessible à tous même si elle nécessite d’acquérir de nombreuses compétences en chemin, source d’une fierté inégalable et garantie d’une liberté unique. » [Introduction, p. XIII] En conclusion de son ouvrage, il partage sa conviction de « faire l’un des plus beaux métiers du monde. » [p. 115]
Il ne s’agit pas ici de nier les difficultés rencontrées par les chefs d’entreprise, ou d’affirmer que les bénéfices qu’ils tirent de leur position permettent systématiquement de compenser la dureté de leur métier. Simplement, l’honnêteté exigerait qu’ils parlent tout aussi sincèrement des attraits de leur profession, que des inconvénients qui y sont associés. Car ils ne doivent pas oublier que beaucoup d’autres travailleurs souffrent également, sans pour autant que cette pénibilité soit compensée par des rémunérations confortables.
Regardez autour de vous
Pour faire redescendre les revendications des patrons sur le sol commun, il importe de pointer les sacrifices qu’un très grand nombre de salariés consentent dans le cadre de leur travail. Ainsi, les employés sont bien souvent exposés à des situations de tension avec le public qu’ils reçoivent, ainsi qu’à un niveau de stress élevé.
Le stress auquel ils sont soumis est redoublé par le fait qu’ils se trouvent dans une position subalterne, qui ne leur donne pas la liberté de déterminer eux-mêmes les solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. Cette combinaison éprouvante entre une faible autonomie et des exigences élevées est appelée « job strain » : il s’agit d’un phénomène qui a largement été étudié par les chercheurs en santé au travail, et qui aggrave le risque d’apparition de maladies cardiovasculaires et de troubles psychiques.
Les ouvriers, eux, subissent l’usure du corps (dos, épaules, poignets, mais aussi expositions répétées à des produits nocifs) ainsi que des cadences élevées qui les vident de leurs forces. Ils sont particulièrement exposés aux maladies professionnelles et aux accidents du travail : on peut estimer que, sur toute une carrière, un ouvrier a environ une chance sur cinq de subir une incapacité permanente des suites d’un accident [9] – et trois chances sur mille de mourir au travail. [10]
La pénibilité intense à laquelle ils sont exposés a pour effet de raccourcir leurs vies et de provoquer un vieillissement prématuré : s’il est bien malaisé de faire la part entre l’impact des conditions de travail et celui des habitudes de vie (tabagisme, régime alimentaire, etc.), il semble que le travail joue un rôle majeur dans le fait que les ouvriers vivent six ans de moins que les cadres, et commencent en moyenne à souffrir d’incapacités physiques dix ans plus tôt que ces derniers (c’est à dire vers 59 ans).
De surcroît, les employés de commerce et les ouvriers travaillent souvent le weekend, tôt le matin, tard le soir et parfois de nuit. Aux problèmes générés par les horaires atypiques, s’ajoute une grande emprise temporelle du travail, quand les horaires sont imprévisibles et dépendent de plannings communiqués par l’employeur semaine après semaine. Peut-on profiter pleinement de sa vie personnelle, quand on n’a pas la maîtrise de son emploi du temps ?
A cela il faut ajouter la monotonie subie par les travailleurs des classes populaires. Loin de l’aventure et de la réalisation de soi décrite par les chefs d’entreprise enthousiastes, la moitié des employés disent ne pas ressentir de plaisir au travail – et cette part monte à 60 % pour les ouvriers. Quand on pratique son métier huit heures par jour, tout au long de l’année, on peut s’attendre à ce que l’absence prolongée de plaisir impacte négativement l’humeur et l’image de soi. D’autant plus quand on exerce une profession subalterne qui est associée à un statut social dévalorisé.
Certains chefs d’entreprise parlent de leur métier comme s’ils étaient les seuls à subir des contraintes. En réalité, beaucoup de gens souffrent au travail, et la plupart d’entre eux ne sont pas des patrons. La complainte autocentrée de certains dirigeants ne doit pas occulter les risques et pénibilités majeurs auxquels sont exposés une grande part des travailleurs des classes populaires – dont les revenus, il faut le souligner, se situent nettement en-dessous du salaire moyen.
Pour la plupart d’entre nous, le travail a un coût. Les patrons qui se plaignent de leurs conditions de travail seraient-ils plus heureux s’ils exerçaient le métier de femme de chambre ? D’auxiliaire de vie ? De caissier de supermarché ? D’ouvrier posté sur une chaîne de montage ? Au vu de l’importance des contraintes et de la faiblesse des salaires associés à ces métiers-là, on peut raisonnablement en douter.
Levez le pied
Beaucoup de patrons se plaignent de faire des journées interminables, et des semaines de cinquante ou soixante heures. Si leur métier est certainement très prenant, il serait cependant faux de prétendre qu’ils ne disposent d’aucune prise sur leur charge de travail. Deux solutions peuvent venir au secours des patrons qui se tuent à l’ouvrage : déléguer des tâches, et limiter la croissance de leur entreprise.
Quand on a créé sa propre affaire, son « bébé », et qu’on a lutté pour la rendre viable, il peut être difficile de renoncer à une part de contrôle. Un tel pas de côté est pourtant nécessaire, à la fois pour le bon fonctionnement de l’organisation et pour la qualité de vie du chef d’entreprise. Cela implique évidemment d’accorder sa confiance aux personnes qu’on a recrutées, et d’accepter que les choses ne soient pas faites de la manière dont on les aurait faites soi-même.
Un grand patron, qui gagne plus de deux millions d’euros par an, témoigne ainsi : « On a beau être presque 7000 personnes chez Euroline, comme tout dirigeant d’entreprise je parle avec une quinzaine de personnes pas plus. J’ai pas le temps sinon, et la capacité d’une entreprise de la taille de la nôtre c’est la capacité de délégation. Au fond, ce qui est important à avoir en tête, c’est que pour qu’une boîte marche bien, il faut que chacun sache exactement ce qu’il a à faire et au fond quelles sont les limites basses et hautes de sa responsabilité (…).
Tous les vendredis soir à 17 heures j’arrête tout et je ne travaille jamais le weekend. Et même pas un bout de papier avec un crayon pour réfléchir à quelque chose (…) quand on est chef d’entreprise, il ne faut pas que votre agenda soit tellement chargé que vous ayez jamais le temps de vous ennuyer. Vous savez des fois je suis là et je m’ennuie un peu. » [Offerlé (dir.), p. 10].
Certains patrons sont plus à l’aise que d’autres avec le « lâcher-prise » que leur fonction requière. Cela dit, en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature de son activité, la tendance à tout concentrer sur sa personne peut être particulièrement forte. C’est le cas pour les professions libérales, quand une société repose essentiellement sur le savoir-faire de son dirigeant. Pour le consultant ou l’avocat, le fait d’avoir embauché des assistants administratifs ne leur permet pas de se délester de leurs tâches principales.
C’est aussi le cas pour les entreprises de taille modeste, quand le volume d’activité ne permet pas de financer la création des services support (ressources humaines, gestion administrative et financière, etc.) vers lesquels le patron pourrait déléguer une partie de son rôle. C’est encore le cas pour les entreprises qui ont grandi, mais que leur dirigeant continue à faire fonctionner comme quand elles étaient petites – restant à toutes les places plutôt que d’embaucher des cadres avec lesquels il pourrait partager son travail.
Ce qui peut empêcher le patron de lever le pied, c’est aussi la volonté permanente d’étendre son activité. Nombreux sont les dirigeants qui affirment qu’une société qui ne grossit pas est une société qui rétrécit. Si la formule peut être séduisante, il s’agit pourtant d’une idée reçue. Beaucoup d’entreprises maintiennent une taille à peu près stable, et ne semblent pas se porter plus mal que les autres.
Souvent, le choix de répondre à toutes les demandes et de poursuivre l’expansion de l’entreprise autant que cela est possible, est justifié par la crainte d’enrayer le flux des nouvelles demandes. Si on commence à refuser de prendre de nouveaux clients, ne va-t-on pas envoyer un message négatif, se tirer une balle dans le pied ? Ne va-t-on pas se retrouver sans débouchés quand la conjoncture deviendra mauvaise, subir une chute de notre chiffre d’affaires et se retrouver dans l’incapacité d’assurer les dépenses courantes ?
Si cette précaution peut effectivement être fondée selon le contexte dans lequel évolue l’entreprise (secteur d’activité, dynamique du marché, pression concurrentielle, zone d’implantation, etc.), il est certainement des cas où il ne s’agit pas tant d’une prudence raisonnable, que d’une crainte excessive. Toutes les entreprises ne se trouvent pas perpétuellement au bord de la faillite, et anticiper des difficultés futures n’implique pas nécessairement de se tuer à la tâche.
Prenons l’exemple des médecins généralistes, qui refusent en permanence de nouveaux patients car leur emploi du temps est déjà saturé. Se retrouvent-ils désœuvrés, boudés par les patients, parce qu’ils ne se sont pas rendus disponibles pour les recevoir tous ? On sait bien que ce n’est pas le cas, et les cabinets de médecins ne désemplissent pas, tout simplement parce que les gens ont besoin de soins.
Il en est de même pour les psychologues et psychothérapeutes qui exercent en libéral : quand la renommée d’un praticien commence à être établie, que son réseau fonctionne, il reçoit de nombreuses demandes de prise en charge. Il est impossible de les honorer toutes, et le thérapeute est bien obligé d’orienter les patients vers d’autres confrères. S’il accepte de soigner tout le monde, il finit évidemment par toucher une limite, puisque les journées ne font que vingt-quatre heures.
Patrick est artisan carreleur depuis plus de trente ans, et il travaille seul. Quand on lui demande s’il refuse des chantiers, il assume avec sérénité : « Oui ou les gens attendent. Ah ben non, je prends ce qu’il me faut et puis, s’ils sont vraiment pressés soit qu’ils attendent soit qu’ils vont voir un autre, on ne peut pas être partout. » [Offerlé (dir.), p. 446]
« C’est comme un drogué, quoi »
Au-delà de la peur de l’avenir et de l’aspiration à gagner plus d’argent, il existe un phénomène qui peut expliquer la volonté qu’ont certains patrons de sans cesse étendre leur activité : la dépendance au travail, ou workaholisme. Il s’agit d’une addiction comportementale, caractérisée par des journées de travail excessivement longues et par une incapacité à se détacher du travail. Dans le workaholisme, le travail prend toute la place – au détriment des loisirs, de la santé, de la vie de couple et des relations familiales.
Bien entendu, toutes les catégories de travailleurs sont potentiellement concernées par le workaholisme. Mais, certainement en raison d’une plus grande porosité entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que du niveau de responsabilité auquel ils se trouvent, les chefs d’entreprise s’avèrent particulièrement exposés à cette addiction. Selon le cabinet Technologia, spécialisé dans la prévention des risques professionnels, 20 % des chefs d’entreprise et travailleurs indépendants se trouvent dans une situation de surinvestissement professionnel. [11]
Face à la complexité des relations personnelles, et au mal-être existentiel qui peut toucher chacun d’entre nous à certains moments de sa vie, le travail est susceptible de constituer un refuge. En effet, quels que soient les obstacles qui se dressent sur ma voie, quels que soient les problèmes que j’ai à résoudre, le travail me permet de ne pas trop me poser de questions. Le travail me donne un but simple et évident : faire prospérer mon entreprise, gagner de l’argent, empocher de nouveaux contrats.
Malgré le stress que le travail induit, il apporte aussi un confort psychologique. En quête de ce confort, le sujet peut être tenté de délaisser les autres domaines de sa vie pour se consacrer, exclusivement et compulsivement, à son activité professionnelle. Beaucoup se retrouvent – plus ou moins consciemment – aspirés dans cette voie : en témoignent le nombre de divorces liés au travail (« tu n’es jamais à la maison, et même quand tu es là tu penses à ton travail ») ainsi que le nombre d’enfants qui n’ont pas vraiment connu leurs parents (« il partait tôt et il rentrait tard, et nous ne partagions que rarement des moments de complicité »).
Propriétaire de deux restaurants, Younes envisage d’en acheter un troisième. Face à la charge que cela représente, ce travailleur acharné hésite. Il doute que ce projet puisse rendre sa vie meilleure, mais la tentation demeure : « Je sais que c’est une perte de temps parce que je ne profite pas, je ne vis pas. (…) D’un côté j’ai envie de le faire mais d’un côté je me dis que c’est de la maladie, parce que c’est, c’est, c’est vrai que c’est un challenge. (…) D’un autre côté ça sert à rien, parce que… on n’en profite pas. Moi personnellement, je veux dire on fait que travailler, travailler, travailler (…) C’est comme un drogué, quoi. C’est…ou quelqu’un qui fume, s’il fume pas… il est pas bien. Et c’est ça le vice, c’est de toujours en faire plus. » [Offerlé (dir.), p. 114]
Redescendez sur terre
Certains écarts de richesse sont difficilement justifiables. Julien Leclercq, dans son livre Chronique d’un salaud de patron, dénonce les rémunérations les plus manifestement abusives : « arrêtons de donner des chèques avec cinq zéros à des patrons si le salaire moyen de leurs employés est cent fois moindre » [Leclercq, 2017, p. 104]. Ces propos qui présentent l’apparence d’un appel à la justice sociale, constituent en réalité une défense assez audacieuse des inégalités : non, le patron ne doit pas accaparer toutes les ressources de l’entreprise. Mais qu’il gagne dix, vingt, voire cinquante fois le salaire moyen de ses employés, cela ne devrait pas nous heurter. Comme souvent, la dénonciation des inégalités extrêmes permet de justifier l’injustice ordinaire.
De même, dans l’un de ses ouvrages, le patron du Medef critique la pratique des parachutes dorés et se dit choqué par « l’absence de partage » au sein des entreprises [Roux de Bézieux, 2007, p. 89]. Une précision s’impose, toutefois : il ne s’agit pas pour lui de promouvoir l’impôt redistributif, mais d’appeler à une distribution plus large des stock-options, particulièrement au profit des cadres.
Le partage est donc souhaitable, mais uniquement au sein des couches supérieures. M. Roux de Bézieux, à vrai dire, n’imagine même pas qu’un certain niveau d’inégalité puisse être foncièrement injuste : « le seul critère d’acceptabilité ou de décence, c’est que les sommes, surtout si elles sont importantes, puissent être justifiées par le risque pris ou la performance du patron en question » [2007, p. 84].
Ainsi, ces dirigeants promeuvent une société dans laquelle les chefs d’entreprise pourraient gagner des sommes ahurissantes, et nous disent que ces écarts seraient justifiés par les caractéristiques du métier de patron : l’exigence de performance, les sacrifices réalisés et les risques pris. Pour expliquer qu’ils osent asséner de telles affirmations, il faut que l’une des deux propositions suivantes soit vraie : soit ces messieurs sont de mauvaise foi, et ne font que défendre les privilèges dont jouit le groupe auquel ils appartiennent. Soit ils s’imaginent que les patrons sont les seuls à réaliser des performances, à faire des sacrifices et à prendre des risques.
Plus haut dans cet article, j’ai présenté un bref panorama des conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés un grand nombre de travailleurs des classes populaires. A la lumière de ces éléments, il n’est tout simplement pas crédible de justifier les hauts revenus des patrons sur la base de la pénibilité de leur métier. D’autant plus que, quand un patron estime qu’il fait trop de sacrifices, on a vu qu’il dispose généralement de solutions pour atténuer sa charge – une possibilité dont les travailleurs salariés sont le plus souvent dépourvus.
Quoi qu’il en soit, si un patron choisissait délibérément de se tuer à la tâche, il n’y a pas lieu de croire que cela lui donnerait le droit de revendiquer une plus grande part des richesses produites par l’entreprise : le travail des salariés mérite lui aussi d’être bien rétribué, et de toute manière aucune somme d’argent ne suffira à indemniser un patron qui serait passé à côté de sa vie.
Une juste rémunération du risque
Quand on aborde le thème du risque, on pense forcément à la fameuse métaphore des « premiers de cordée ». Dans l’image mobilisée par Emmanuel Macron, les élites économiques doivent être récompensées pour les risques qu’elles prennent et pour les qualités qu’elles déploient, elles seules ayant l’audace d’ouvrir les voies de la création de richesses – au bénéfice de tous, cela va sans dire.
Même en acceptant de rester dans le cadre de cette métaphore, la démonstration voulue par le locataire de l’Elysée apparaît défectueuse à plusieurs égards : d’abord, tous les membres de la « cordée » sont supposés être dans un rapport d’égalité… ce qui n’est pas le cas dans le monde réel, quand certains gagnent un revenu trois fois supérieur à celui des autres.
Ensuite, il faut rappeler que l’essentiel du risque est assumé par l’ensemble de la cordée : le but de ce système est justement de se retenir les uns les autres. Par conséquent, en cas d’accident, soit la cordée tient bon, soit elle chute tout entière – et ceux qui se trouvent à l’arrière ne sont pas épargnés. Cette situation, à vrai dire, est analogue à celle d’une entreprise : en cas de difficultés financières, tous les travailleurs de l’entreprise ont des raisons de craindre l’avenir. En cas de faillite, tout le monde – les salariés et le patron – se retrouve sans emploi.
Il y a cependant matière à penser qu’une telle situation est moins critique pour le patron que pour ses salariés : d’abord, depuis son poste, il peut suivre finement l’évolution de la situation et détient des informations utiles pour mieux anticiper le dépôt de bilan. Ensuite, il dispose généralement d’un niveau élevé de compétences et de capital social (réseau, réputation, etc.) qui devrait faciliter sa reconversion.
Le principal avantage dont bénéficient les salariés sur le patron, en cas de faillite, est l’accès à l’assurance-chômage. Le patron, lui (dans les cas où il n’est pas salarié), doit compter uniquement sur ses ressources propres pour subsister le temps de trouver un nouvel emploi. C’est justement l’une des raisons pour lesquelles on peut considérer comme légitime que le patron reçoive un revenu supérieur à celui des personnes qu’il emploie.
Ce point soulève néanmoins une question épineuse : quelle doit être l’ampleur de cette « prime de risque », de cette indemnisation versée au patron afin de compenser la précarité de sa position ? Doit-elle représenter une petite fraction du salaire, ou multiplier carrément le salaire par quatre ? On peut se donner un repère en considérant la manière dont est financé le budget de l’assurance chômage : afin d’amortir le risque que les salariés se retrouvent sans emploi, la Sécurité sociale prélève chaque mois 5 % de tous les salaires.
Cinq pourcents seulement, et cela semble suffire à couvrir le risque de chômage. En supposant que la majorité des patrons, du fait qu’ils dirigent des petites structures, soient dans une situation plus instable que la moyenne, on pourrait monter cette fraction à 10 %, voire à 15 % pour leur être agréable. On observe alors un contraste majeur entre la modestie de ces chiffres, et la hauteur des rémunérations que le patronat chercher à justifier au nom des risques pris.
Geoffroy Roux de Bézieux, que nous avions déjà cité plus haut, explique ainsi que s’il perçoit un revenu élevé, il ne s’agit là que d’une juste compensation pour le fait que ce revenu varie selon les années : « J’ai un salaire de base qui est assez faible, qui est à 60 000 euros par an (…) je vis de dividendes, en fait, je vis pas de salaires », déclare-t-il dans un long entretien sur la chaîne Thinkerview, en janvier 2022. Le risque qu’encourt le président du Medef, donc, est de vivre parfois des années de disette où il devrait se contenter de cinq petits milliers d’euros par mois.
Dans l’une de ses publications, M. Roux de Bézieux nous livre ses réflexions sur la rémunération des patrons en général, et plaide pour une « juste rémunération du risque » [2007, p. 93]. Quelle devrait être, à son avis, la juste rémunération versée aux ouvriers cordistes qui sont particulièrement exposés au risque d’accident grave et de mort violente ? Pour compléter ce qu’on a vu plus haut, on trouvera sur ce lien l’histoire de deux ouvriers gravement brûlés lors d’une intervention sur un site industriel, ainsi qu’une liste d’ouvriers morts ensevelis dans des silos ou écrasés au sol.
Dans un registre moins spectaculaire, mais tout aussi sérieux, d’anciennes caissières de supermarché témoignent face aux caméras de Cash investigation. Elles décrivent les dégâts que la répétition quotidienne des mêmes gestes a produit sur leurs corps : « Je me lève le matin, j’ai mal partout, j’ai mal à mon dos, j’ai mal à mes cervicales, qui engendrent de grosses migraines et je suis très mal. (…) J’ai beaucoup de mal à soulever du poids, même un pack de lait j’ai du mal à le soulever. Je suis restée un an en arrêt et j’ai été licenciée après ». Des problèmes de santé qui ont un impact sévère sur le quotidien de ces travailleuses, et qui dureront probablement jusqu’à la fin de leurs vies. Voilà les risques auxquels s’exposent des millions de nos concitoyens, en échange de revenus absolument modestes.
Des oiseaux de proie
Combien peuvent peser, en comparaison, ces risques dont le patronat et ses alliés nous rebattent les oreilles ? Doivent-ils être compensés plus généreusement que les dos cassés, les membres écrasés et les vies brisées du monde ouvrier ? La prétention à être indemnisé rubis sur l’ongle pour des risques qui apparaissent relativement modestes au vu des réalités ordinaires du monde du travail, ne peut être comprise que de cette manière : les membres de l’élite économique seraient des êtres d’une valeur supérieure, pour lesquels consentir des sacrifices ne serait acceptable qu’à condition de recevoir des rémunérations bien plus élevées que celles auxquelles a accès le commun des mortels. Que des prolétaires risquent leur vie et leur santé pour un maigre salaire, c’est là l’ordre des choses. Mais eux, les oiseaux de proie, n’accepteront des désagréments que s’ils sont payés au prix fort.
En défendant de telles positions, ils font en réalité du tort à toute une partie du patronat. Car l’immense majorité des patrons dirige en réalité des TPE et des PME (selon l’INSEE, 99,8 % des entreprises font partie de ces catégories). Pour eux, atteindre cinq mille euros de revenu mensuel ne signifie certainement pas se trouver dans une mauvaise passe. Ces petits patrons prennent autant de risques que les plus grands, voire plus si l’on prend en compte le fait que les structures qu’ils dirigent ont des assises moins solides que celles des grands groupes – quand a-t-on vu des sociétés du CAC 40 mettre la clé sous la porte ?
Si on instaurait un impôt sur le revenu très progressif, destiné à redistribuer les richesses, les patrons qui perçoivent un revenu modeste ne seraient pas affectés négativement, et les plus petits d’entre eux seraient peut-être même gagnants (par exemple, ceux qui gagnent parfois un revenu mensuel inférieur à 2000 €). Ceux qui touchent six, huit ou quinze mille euros par mois, en revanche, subiraient une baisse de leur niveau de vie. Faut-il les plaindre ?
Il est cynique que les riches chefs d’entreprise choisissent si souvent de défendre leurs intérêts en s’abritant derrière la figure du petit entrepreneur qui peine à dégager un revenu correct… quand on sait que ces derniers sont fréquemment exploités par les grandes entreprises, qui abusent de leur position de force pour multiplier les retards de paiement à l’égard de leurs fournisseurs, et qui leur imposent des tarifs exagérément bas. [12]
La rémunération du capital
De nombreux patrons ont engagé leur argent personnel dans l’entreprise qu’ils dirigent, soit qu’ils aient investi dans la société qu’ils ont eux-mêmes fondé, soit qu’ils en aient acquis des parts après en avoir pris la direction. Par conséquent, on peut difficilement traiter des revenus des patrons sans interroger ce que pourrait être une juste rémunération du capital.
J’ai récemment consacré un article à l’étude de cette question, et je vais ici tenter de synthétiser ce qu’il en ressort. A condition qu’il contribue au bien commun, je soutiens qu’un investissement en capital peut générer des revenus légitimes, en raison 1) Du travail fourni par l’investisseur, 2) Des risques auxquels il s’expose, et 3) De l’effort d’épargne qu’il a dû réaliser pour se constituer un patrimoine.
Bien entendu, pour estimer la juste rémunération du « travail entrepreneurial » fourni par l’investisseur (essentiellement la recherche du bon placement), il faut comparer cette quantité de travail à celle qui est fournie par un salarié. De même, pour estimer la juste indemnisation des risques pris par l’investisseur, il faut comparer ces risques avec ceux qui concernent les salariés, et que nous avons vus plus haut.
De surcroît, nous devons aussi avoir conscience que le mérite d’un investisseur – et, par conséquent, la quantité d’argent à laquelle il peut légitimement prétendre – diminue à mesure que sa fortune s’élève. Prenons un exemple simple pour illustrer cela : si je mets en location un studio en banlieue, cela me demandera à peu près autant de travail (acquérir le logement, trouver les locataires, gérer les problèmes) que de faire la même chose pour un grand appartement luxueux dans un quartier chic.
Pourtant, cette seconde option me permettrait de dégager des revenus sans comparaison avec le loyer de mon petit studio. Les gros investissements ne requièrent pas plus de travail que les petits, mais ils rapportent beaucoup plus d’argent. Plus l’investissement est massif, plus il génère de profit par heure de travail qu’on y a consacré.
Le même principe s’applique aux investissements financiers : si je place mon argent en bourse, je vais prendre du temps pour identifier les placements les plus profitables. Que mon patrimoine s’élève à un million d’euros ou à un milliard, j’y consacrerai plus ou moins le même temps et les mêmes efforts. Simplement, si je suis plus fortuné, cela me permettra d’investir à plus grande échelle.
Ce phénomène, qui correspond à des économies d’échelle, est redoublé par trois autres non moins importants : d’abord, les gros patrimoines ont tendance à dégager des rendements bien plus élevés que les petits – de fait, la croissance du capital est donc exponentielle [13]. Ensuite, un patrimoine important permet à son détenteur de diversifier ses investissements, et ainsi de réduire considérablement le risque d’être ruiné. Un coup dur peut annihiler une partie de sa fortune, mais pas la totalité.
Enfin, il s’avère que les personnes riches ne dépensent qu’une part minoritaire de leur revenu, car leurs besoins ne sont pas infinis : l’argent excédentaire qu’elles perçoivent s’accumule dans leur patrimoine, et leur permet de réaliser des placements. En revanche, les investisseurs modestes doivent réaliser des efforts soutenus pour épargner des sommes conséquentes, et ne peuvent accéder à la propriété (immobilière ou financière) qu’après avoir sacrifié une partie de leur niveau de vie pendant plusieurs années. Par conséquent, plus les investisseurs sont fortunés, moins ils sont contraints de fournir un réel effort d’épargne pour se constituer un capital.
Economies d’échelle, profits exponentiels, diversification des risques, et facilité à épargner… voici ce qui sépare les investisseurs modestes des grands possédants. En constatant l’accumulation de ces phénomènes, nous pouvons parvenir à la conclusion suivante : à mesure que le patrimoine augmente, chaque euro de profit supplémentaire est de moins en moins légitime car il correspond à moins de travail, moins de risque, et un moindre effort d’épargne. En un mot, le mérite diminue en même temps que la fortune s’élève.
Le droit du plus capable
Au bout du compte, il n’est pas possible de défendre les hauts revenus des patrons en s’appuyant sur l’argument de l’effort fourni, ni sur celui du risque. Le seul argument qui pourrait avoir une base factuelle solide est celui du talent : dans cette optique, il est juste que les chefs d’entreprise gagnent très bien leur vie car il s’agit d’individus très performants, seuls capables de gérer efficacement les groupes qu’ils dirigent.
C’est le point de vue défendu par Geoffroy Roux de Bézieux : « On doit pouvoir gagner de l’argent en dirigeant une grande entreprise, et même beaucoup (…) à condition que les résultats de l’entreprise soient à la hauteur des montants gagnés (…) Un patron qui développe un grand groupe doit pouvoir être très bien payé. » [2007, p. 84 et 92]. Au cours de son entretien sur la chaîne Thinkerview, il confirme : « Le talent, ça se rémunère. » Il serait donc juste que les richesses soient concentrées dans les mains des individus les plus performants.
En parlant ainsi, le président du Medef décrit un état de fait (sur le marché, un talent rare sera payé un bon prix) en laissant entendre qu’il s’agit d’une règle morale (« il est juste que les talents soient rémunérés »). En bref : le prix du marché, c’est le juste prix. Prononcé sur le ton de l’évidence, ce type d’affirmation peut paraître convainquant, car nous sommes habitués au fonctionnement du marché. Il est donc normal pour nous que les choses les plus recherchées soient aussi les plus chères. Puisque c’est normal – au sens « habituel » – nous sommes enclins à penser que c’est également normal – au sens « juste ».
Or, si cette équivalence fait facilement illusion, elle escamote un peu rapidement la question morale – est-il juste, en effet, que les individus soient rémunérés selon leurs talents ? Cette interrogation renvoie au problème plus général de la méritocratie. D’abord, un peu de modestie s’impose : dans une large mesure, les performances que nous réalisons ne dépendent pas de nous. Chaque personne naît plus ou moins dotée en aptitudes naturelles, dans un environnement familial plus ou moins favorable au développement de son potentiel. Un individu pourvu d’une vive intelligence et qui a bénéficié d’une bonne éducation réalisera certainement des performances remarquables – mais il n’y a pas lieu de lui en attribuer tout le mérite.
Par ailleurs, on doit relever que toutes les performances ne permettent pas de générer un revenu : selon la société et l’époque dans lesquelles nous naissons, les aptitudes dont nous disposons seront – ou ne seront pas – valorisables d’un point de vue économique. M. Roux de Bézieux n’aurait peut-être pas rencontré un tel succès s’il avait vu le jour au XIème siècle, ou dans une famille de paysans du Bangladesh. Heureusement pour lui, il fait partie de ceux qui ont eu la chance de naître en possession des bons talents, à la bonne époque et au bon moment.
A l’inverse, on doit penser à tous les gens qui font très bien leur travail, mais qui ne seront jamais riches car le marché ne rémunère que modestement ceux qui exercent des métiers comme les leurs. Qu’ils soient maçons, pêcheurs, infirmiers ou assistantes maternelles, les performances qu’ils réalisent au quotidien ne leur permettent pas de s’offrir des villas sur la côte et des montres en or. C’est que, dans notre société, l’aptitude à développer des entreprises est mieux valorisée que l’aptitude à prendre soin des enfants.
Pour les chantres du marché, il va de soi que le jeu de l’offre et de la demande aboutit à des inégalités qui sont à la fois justes et efficaces. Justes, car les individus qui possèdent les compétences les plus recherchées sont supposés être les plus méritants. Efficaces, car l’appât du gain constitue une puissante incitation à acquérir les compétences en question, et à se dépasser pour réaliser les performances que le marché demande.
Or, cette vision présente des failles importantes. D’abord – et c’est là une erreur factuelle – l’existence d’inégalités importantes n’est pas nécessaire pour inciter les individus à l’effort. En témoignent les résultats de la recherche empirique en économie (voir ici et ici), ainsi que les exemples historiques de pays qui ont prospéré dans un contexte d’inégalités réduites. Ainsi, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont appliqué des taxes très importantes sur les hauts revenus au XXème siècle, sans que cela ne semble nuire à leur développement économique. La Suède des années 1980, elle, atteignait presque le même niveau d’égalité que l’Union Soviétique, tout en affichant un niveau de vie et une productivité parmi les plus élevés au monde. [14]
Ensuite, l’amalgame entre mérite et performance consiste à réduire la notion complexe et ambiguë de « mérite » à celle de « performance ». Or, que trouve-t-on quand on consulte le dictionnaire pour connaître la définition du mérite ? On y apprend que le mérite est « ce qui rend une personne digne d’estime ». Cette définition large et sujette à débat (qu’est-ce qui rend une personne digne d’estime ?) recouvre un champ beaucoup plus vaste que la simple capacité à réaliser les performances que le marché demande. Ce qui rend une personne digne d’estime, ce peut être une multitude de choses : ses qualités morales, sa force de caractère, le bien qu’elle fait au service de la communauté, etc.
Mais en réduisant la notion de « mérite » à la simple capacité à réaliser les tâches dans lesquelles ils excellent, les gagnants du système ne font pas une simple erreur de définition : ils œuvrent à la consolidation de leur position. En accaparant la définition du mérite pour légitimer leurs privilèges aux yeux du reste de la population, ils font en sorte de neutraliser d’avance la contestation et la critique sociale.
Il s’agit là d’un usage conservateur de l’idéologie méritocratique, une idéologie qui se présente comme subversive mais qui est le plus souvent mise au service d’intérêts établis. Cela apparaît sans ambiguïté dans les propos d’Emile Boutmy, fondateur au XIXème siècle de la prestigieuse école Sciences-Po Paris. Celui-ci, prenant acte de la menace que constituent les progrès de l’égalité, appelle alors les groupes dominants à adopter une nouvelle stratégie de maintien de l’ordre social. Cette stratégie, c’est la méritocratie :
« Contraintes de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu’en invoquant le droit du plus capable. Il faut que, derrière l’enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s’impose, de capacités dont on ne puisse se priver sans folie. » [15]
Des écrans de fumée
L’économie a besoin de gens qui entreprennent. Si je peux écrire sur cet ordinateur, c’est parce que quelqu’un, quelque part, a fondé une entreprise qui fabrique des claviers. Si je peux habiter cette maison, c’est parce que quelqu’un, quelque part, a fondé une entreprise qui fabrique des parpaings. Afin de créer de l’activité, d’embaucher, de répondre à la demande de biens et de services, il faut que des gens prennent le risque d’investir et montent des entreprises. Bref, dans une économie de marché – même régulée – les entrepreneurs jouent un rôle indispensable à la création de richesses.
Mais il n’y a aucune raison de croire que le fait d’exercer cette fonction doit leur donner accès à des récompenses illimitées. Les ouvriers, eux aussi, jouent un rôle indispensable à la création de richesses. Que peut faire un dirigeant sans ses salariés ? C’est uniquement la collaboration entre les différentes catégories de travailleurs qui permet le bon fonctionnement de l’ensemble. La production de richesses est fondamentalement une œuvre collective.
Au regard de ce constat, on ne peut que s’étonner de la prétention de certains patrons à porter le monde entier sur leurs larges épaules. Ceux qui se désignent eux-mêmes comme « les créateurs de richesses », ont ainsi l’outrecuidance de s’arroger le monopole de l’utilité sociale. Est-ce à dire que les gens qui ne sont pas des patrons ne créent pas de richesses ? Le discours d’autocélébration patronale [16] sur le thème des « créateurs de richesses » n’est pas autre chose qu’une insulte pour les dizaines de millions d’entre nous qui qui se lèvent tous les matins, justement, pour créer des richesses.
Le thème classique des « créateurs d’emplois » relève de la même arrogance. « Je fais vivre tant de personnes », affirment certains. Ainsi, le patron fait vivre les gens qu’il emploie ? Comment fait-il, concrètement ? Est-ce qu’il leur donne la béquée, est-ce qu’il fait leurs lessives ? Ce qu’il faut ici établir avec force, c’est que le patron n’offre pas une faveur à ses salariés en leur permettant de travailler pour lui. Le salarié vend sa force de travail pour gagner de quoi vivre, et le patron achète cette force de travail parce qu’il a besoin de gens pour faire fonctionner l’outil de production. En réalité, il ne serait pas plus absurde de dire que les salariés « font vivre » le patron parce qu’ils permettent à son entreprise de produire quelque chose.
Ces conceptions fumeuses étant dissipées, nous pouvons en revenir au cœur du sujet : quelle est la juste rémunération d’un patron ? Quelles raisons avons-nous de penser qu’un patron devrait gagner plus que le salaire moyen ? Comme on l’a vu au cours de cet article, les justifications fondées sur la pénibilité, le risque et la performance résistent mal à l’examen critique. La pénibilité à laquelle les patrons sont exposés n’est assurément pas supérieure à celle qui concerne une grande partie des travailleurs à bas salaire.
Quant aux prises de risque mises en avant par les patrons, on a pu largement les relativiser – notamment au regard de la précarité subie par des millions de nos concitoyens, ainsi que des risques physiques de maladie grave, d’infirmité et d’accident dramatique qui pèsent sur les travailleurs du monde ouvrier. Enfin, la justification des hautes rémunérations des patrons par les performances qu’ils réalisent paraît bien mal fondée – qu’il a-t-il de juste à concentrer les richesses dans les mains de ceux qui possèdent les compétences que le marché recherche ?
Halte à la démesure
En définitive, la revendication la moins contestable parmi celles qui sont mises en avant par le patronat, est le droit à un supplément de rémunération pour compenser la quantité d’heures travaillées. Fréquemment, on entend des patrons se plaindre de consacrer cinquante ou soixante heures par semaine à la gestion de leur entreprise, et cette assertion semble correspondre à une réalité pour beaucoup d’entre eux.
L’importance accordée au nombre d’heures travaillées présente l’avantage, en termes de justice sociale, de faire référence à un principe de justice difficilement contestable : celui qui consiste à rémunérer chaque personne en fonction du temps qu’elle consacre au travail. Si tout le monde admet qu’une personne employée à mi-temps doit être payée un demi-salaire, alors il va de soi qu’une personne qui travaille deux fois plus que les autres doit être payée double.
Considérer les rémunérations des patrons sur la base de ce principe, c’est à la fois reconnaître la réalité de leur engagement, et instaurer un garde-fou contre la démesure. Un simple calcul nous permettra de nous en convaincre : les journées ne faisant que 24h, et la journée de travail ordinaire étant d’une durée de 8 heures, cela signifie que – toutes choses égales par ailleurs – aucun individu ne devrait gagner trois fois plus qu’un autre. Evidemment, nous avons tous besoin de dormir. Ce qui fait que même en prenant le cas d’un patron qui travaillerait 16 heures par jour (un cas certainement rare, et assurément temporaire), il ne serait pas juste que celui-ci gagne plus de deux ou trois fois le revenu de son salarié le moins bien payé.
------
Il est temps de conclure. Non, les patrons ne sont pas des exploités. Ils le sont certainement moins, en tout cas, que nombre de leurs concitoyens qui travaillent dur pour de maigres salaires. En pointant les avantages que les chefs d’entreprise tirent de leur position, et en comparant les sacrifices qu’ils mettent en avant avec ceux que réalisent de très nombreux travailleurs, on parvient à déconstruire les revendications abusives d’une partie du patronat.
Emmanuel Macron est dans l’erreur, quand il affirme que « la vie d’un entrepreneur est plus dure que celle d’un salarié ». Les patrons sont dans l’erreur, quand ils prétendent collectivement travailler plus dur et prendre plus de risques que les gens qu’ils emploient. Oui, il existe des patrons qui souffrent au travail, et beaucoup d’entre eux traversent à un moment ou à un autre des années difficiles. Mais ce serait faire preuve de cécité, que de croire que les salariés ne sont pas eux-mêmes confrontés à des difficultés majeures.
En toute honnêteté, on doit reconnaître qu’il n’est pas possible de faire des généralités sur les conditions de travail « des patrons » ou « des salariés », tant les situations sont variées au sein même de ces groupes. On a dit en introduction que le patronat constitue un ensemble très hétérogène, et c’est aussi le cas pour le monde salarié. S’il est, ainsi, très difficile d’énoncer des généralités, on peut en revanche montrer ce qui est faux, et donner des ordres de grandeur pour prendre la mesure des réalités auxquelles sont confrontés la plupart des patrons et des salariés.
L’effet produit par cette démarche, via les comparaisons que nous avons réalisées au cours de cet article, est de ramener les chefs d’entreprises sur le sol commun. Un sol commun où des employés sous pression sacrifient leurs weekends en famille pour aller tenir la boutique, et où des ouvriers coulent du bitume brûlant sous un soleil de plomb, tout ça au smic horaire.
Si les inégalités actuelles apparaissent excessives, et si les hauts revenus des patrons apparaissent comme des privilèges, quelles conclusions politiques devons-nous en tirer ? A partir du moment où nous faisons ce constat, la volonté de vivre dans une société juste nous pousse à mettre en place une fiscalité progressive. Celle-ci pèserait plus sur les classes aisées que sur les travailleurs modestes, permettant ainsi à ces derniers d’élever considérablement leur niveau de vie. Une véritable redistribution des richesses, donc, qui permettrait à la majorité de nos concitoyens de récolter enfin les fruits de leur travail.
Bibliographie :
- Julien Leclercq, Chronique d’un salaud de patron – Bienvenue dans la vraie vie d’un patron de PME, éditions Eyrolles, 2017
- Michel Offerlé (sous la direction de), Patrons en France, éditions La Découverte, 2017
- Geoffroy Roux de Bézieux, « Salauds de patrons ! » – pourquoi les Français n’aiment plus leurs chefs d’entreprise, éditions Hachette, 2007
[1] Le Monde, Le Point, L’Obs, TF1, M6, L’Express, Europe 1, Le Journal du Dimanche, Libération, Les Echos, RMC, Canal +, etc .
[2] Cité dans "Réinventer les médias", Les Renseignements Généreux, p. 14. A une autre occasion, le milliardaire expliquait l’influence considérable qu’il exerçait sur la ligne éditoriale du Figaro : « J’ai changé de directeur, j’ai changé la direction, j’ai changé le rédacteur en chef. Donc tout va bien… [Mais] c’est pas terminé, parce que là aussi il faut changer les choses […] il faut que Le Figaro soit plus agressif. Il faut qu’on parle de libéralisme, il faut qu’on parle de flexibilité. »
[3] Cité par Aude Lancelin dans Le Un n°131, "Qui contrôle les médias ?", novembre 2016
[4] Documentaire "Les nouveaux chiens de garde", de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, 2012, en ligne ici.
[5] Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, affirme que les patrons se trompent quand ils pensent acquérir de l’influence en achetant des titres de presse. Il pointe ainsi le fait que les investissements de ces milliardaires n’empêchent pas la parution occasionnelle d’articles qui sont critiques à leur encontre.
Là où le « patron des patrons » fait erreur, c’est qu’il ne faut pas considérer cette influence au strict niveau individuel. Le poids cumulé de tous ces investissements dans les médias permet aux possédants, en tant que classe, de façonner le paysage médiatique. « On ne mord pas la main qui nous nourrit », dit l’adage. Ainsi, les journalistes de ces grands médias ont toujours une puissante incitation à éviter les sujets qui pourraient déplaire à leurs propriétaires. Qui voudrait perdre des investisseurs, à une époque où l’équilibre financier des entreprises de presse est aussi précaire ?
A ce tableau, on peut ajouter l’existence de médias ouvertement patronaux comme BFM TV, le quotidien Les Echos et la radio BFM Business, qui diffusent le point de vue des chefs d’entreprise en continu et à longueur d’année. A travers la propriété des médias, les possédants œuvrent efficacement à promouvoir leurs intérêts de classe. Dépassant les rivalités qui les opposent dans la conduite de leurs affaires, ils s’emploient à marginaliser les idées qui pourraient ébranler leur domination – telles que la redistribution des richesses, le protectionnisme, ou l’instauration de régulations strictes en faveur de l’environnement.
La solidarité qui unit les élites, particulièrement les élites économiques, ne doit pas être sous-estimée : en témoigne l’existence de puissants lobbies patronaux comme l’Association française des entreprises privées (AFEP), la Table ronde des industriels européens (ERT), ou encore Business Europe. Selon les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, la bourgeoisie « est la seule classe à exister réellement en tant que classe, c’est à dire en ayant conscience de ses limites et de ses intérêts collectifs » (Sociologie de la bourgeoisie, éditions La Découverte, 2016, p. 6).
[6] Les toutes petites entreprises sont de loin les plus nombreuses. En France, 94 % des entreprises comptent moins de 10 salariés. Et seules 1,3 % en ont plus de cinquante.
[7] Dans la nomenclature de l’Insee, un chef d’entreprise est quelqu’un qui emploie au moins dix salariés.
[8] Dans un essai de définition, on pourrait proposer trois critères pour préciser ce qu’est un patron : 1) N’être subordonné à personne ; 2) Diriger des salariés ; 3) Avoir créé son entreprise. Si on envisage une définition stricte, alors ces critères sont cumulatifs et on exclut beaucoup de personnes qui se considèrent elles-mêmes comme des patrons. Par exemple, les chefs des grandes compagnies du CAC 40 n’ont généralement pas fondé l’entreprise qu’ils dirigent. De plus, ils sont subordonnés au conseil d’administration ainsi qu’à l’assemblée générale des actionnaires. Cependant, une définition élargie du patronat, qui se contenterait d’un seul critère, inclurait les indépendants (qui ne sont en principe subordonnés à personne) ainsi que les cadres (qui dirigent des salariés), et risquerait ainsi de diluer le concept de « patron ».
Il semble en fin de compte que la définition du patronat reste problématique. Peut-être est-il préférable de renoncer à l’objectivation, et de s’en tenir au point de vue des acteurs sociaux : est « patron » celui qui se vit comme tel, et qui est perçu comme tel par les salariés de son entreprise. Ainsi, dans un grand groupe, les salariés d’un site considéreront que le directeur local est leur patron s’il leur semble que c’est lui qui prend les décisions. Au contraire, s’il paraît soumis à des injonctions venues d’en haut, les salariés prendront acte que ce n’est pas vraiment lui « qui est le patron ».
[9] Un accident provoque une incapacité permanente lorsqu’il entraîne la perte d’un membre, une perte de vision ou d’audition, ou encore une atteinte irréversible d’une articulation ou de la colonne vertébrale. En France, chaque semaine, 650 personnes subissent un accident du travail dont ils garderont des séquelles.
[10] Source : calculs de l’auteur à partir des chiffres fournis par la DARES (juillet 2016, n°039), et par l’Observatoire des inégalités. Chaque jour en France, 2 personnes trouvent la mort dans un accident du travail (sans compter les accidents survenus pendant le trajet domicile-travail, ni les personnes décédées des suites d’une maladie professionnelle). C’est l’histoire de Romain, un apprenti bûcheron mortellement percuté par un tronc d’arbre. De Teddy, manœuvre dans le BTP, enseveli sous les décombres d’un mur. De Chahi, livreur à vélo écrasé par une voiture. D’Abdoulaye, tombé dans un malaxeur à béton. De Vincent, Arthur et Quentin, ouvriers cordistes aspirés sous des tonnes de sucre. De Omar, dont la tête a été fracassée par la chute d’un poteau. Sur son blog, Mathieu Lépine tente de recenser les accidents du travail mortels qui surviennent en France.
[11] Il s’agit de la deuxième catégorie la plus frappée par le surengagement, après celle des agriculteurs. Ce chiffre repose sur une enquête menée en 2014 auprès d’un échantillon de mille répondants.
[12] Selon l’Observatoire des délais de paiement, plus d’une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs avec retard, contre une PME sur trois. Plus les entreprises sont grosses, moins elles respectent leurs fournisseurs : les retards supérieurs à deux mois sont proportionnellement deux fois plus nombreux chez les grandes entreprises que chez les PME. Et ces pratiques ont souvent de lourdes conséquences, puisque, selon le cabinet Altarès, un quart des faillites sont dues aux retards de paiement (source : Fakir). Le journal Fakir en vient à la conclusion suivante : bien souvent, les grandes entreprises se comportent comme des prédateurs à l’égard des petites.
[13] Pour comprendre cet état de fait, il faut avoir en tête que les individus ne placent pas leur argent de la même manière, selon que leur patrimoine est gros ou petit. Classiquement, les choses se présentent ainsi : les tout petits épargnants mettent leurs économies dans un livret bancaire qui leur rapporte, les bonnes années, un peu plus que le taux d’inflation. Les membres des classes moyennes acquièrent un ou plusieurs biens immobiliers qui leur évitent de payer un loyer, et qui génèrent éventuellement des revenus locatifs. Les individus fortunés, eux, ont accès à d’autres options : détenteurs d’un capital conséquent (3 % des Français sont millionnaires), ils ont la possibilité de réaliser des investissements financiers très rentables.
Plus je possède d’argent, plus je peux diversifier mes placements afin d’assurer la sécurité de ma fortune, par exemple en ciblant plusieurs secteurs d’activité et plusieurs zones géographiques. Même si une crise survient dans un segment de l’économie ou dans un pays donné, je perdrai une partie de mes possessions, mais le reste sera à l’abri. Cette sécurité me permet de réaliser des investissements plus audacieux, dont le rendement est plus élevé. Bien sûr, certains de ces placements finiront en pure perte, mais la plupart d’entre eux donneront de bons résultats. Dans l’ensemble, ces placements risqués me permettront d’atteindre un taux de rendement bien supérieur à la moyenne.
Ainsi, on observe que l’argent fait boule de neige : les personnes les plus fortunées étant celles qui ont accès aux meilleurs rendements, il en résulte que les inégalités de capital se creusent perpétuellement. Entre 1987 et 2013, au niveau mondial, le patrimoine des 45 personnes les plus riches a augmenté de 6,8 % par an. Le résultat d’une telle croissance, c’est que la fortune de ces individus peut doubler de taille en seulement une dizaine d’années (voir Thomas Piketty, Le capital au XXIème siècle, éditions du Seuil, 2013, p. 693). Au bout du compte, même si un homme fortuné et un petit épargnant consacraient un temps équivalent à gérer chaque euro qu’ils possèdent (ce qui n’est pas le cas, comme nous l’avons vu) ces deux personnes n’en tireraient pas un profit similaire – car dans les gros patrimoines, chaque euro pris individuellement rapporte nettement plus que s’il faisait partie d’un petit patrimoine.
[14] Sur le cas suédois, voir Thomas Piketty, Capital et idéologie, 2019, éditions du Seuil, p. 702. Voir également les chiffres concernant l’évolution des inégalités dans ce pays, disponibles sur le site de la World Inequality Database.
[15] Cité par Thomas Piketty, Le capital au 21ème siècle, 2013, éditions du Seuil, p. 782.
[16] Pour illustrer ce point, voici quelques extraits d’un livre intitulé Manifeste des entrepreneurs pour la République, écrit par Léonidas Kalogeropoulos (lobbyiste et chroniqueur sur BFM Business) : « La Nation ne se résume pas à ses entrepreneurs, certes. Mais les entrepreneurs ont une caractéristique propre qui leur donne une dimension singulière par rapport à ses autres composantes : ils font, par eux-mêmes. Ils ne se contentent pas de demander à l’État de faire. (…) La place singulière des entrepreneurs et entreprenants dans la Nation tient au fait qu’ils font, créent. (…) les entrepreneurs sont par essence même l’incarnation de la Nation en action, agissant pour apporter des réponses à des besoins, entraînant avec eux tous leurs collaborateurs dans la poursuite de leur utilité sociale. » En clair : les travailleurs salariés sont des êtres passifs, qui ne créent rien et sont incapables d’initiative. L’auteur de ce livre ne semble pas avoir remarqué ce que font les salariés quand ils sont au travail – à savoir qu’ils s’activent, huit heures par jour, pour résoudre les problèmes qu’ils rencontrent dans leur activité et mener à bien leurs tâches malgré les imprévus et les limites des moyens qui leur sont alloués. Mais encore faut-il respecter suffisamment les salariés pour bien vouloir observer en quoi consiste vraiment leur quotidien… L’autocélébration du patronat, bien souvent, révèle aussi un vif mépris de tous ceux qui n’en font pas partie.