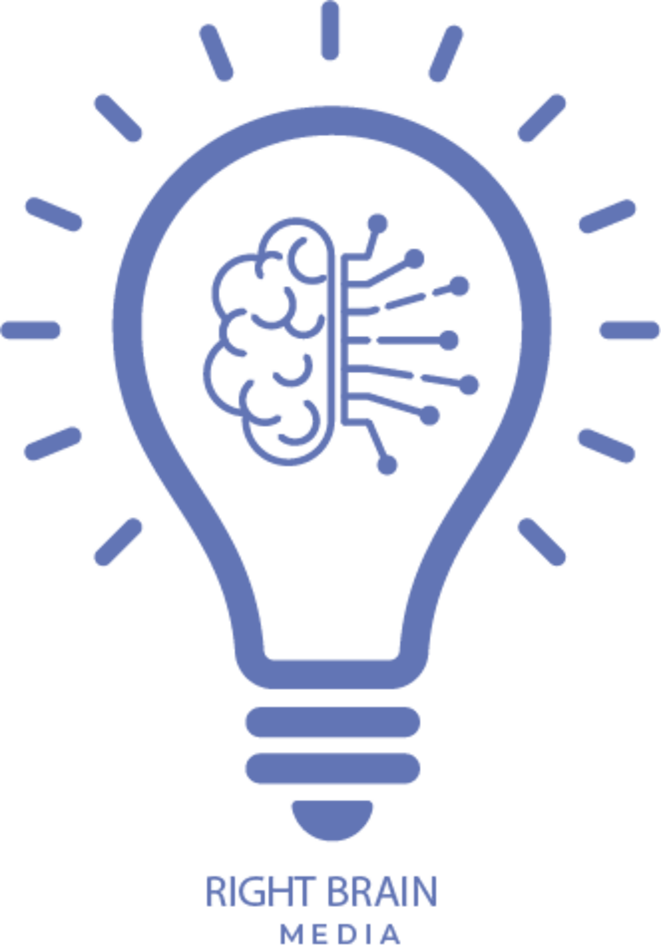Quels droits pour les femmes dans un contexte d’éclatement des luttes ?
Actuellement en Occident, nos démocraties assistent à la fin du système patriarcal stricto sensu. L'archétype de la femme faite pour les unes de magazine, mesurant un mètre soixante-quinze, sur laquelle un bon vieux macho aimait poser ses mains lorsqu'elle portait une robe courte ou un jean Levi's moulant en taille 28, semble totalement ringard. Qu'elle soit trans, ordinaire ou ambassadrice du body positive, la femme moderne aurait donc pris conscience des conséquences du machisme et de toutes les formes d'exclusion. Ainsi, la lutte contre ces maux est devenue une priorité politique et éducative. Dans ce contexte où les publications théoriques et militantes en faveur d'une meilleure considération des "minorités" (ou des "dominés") se multiplient, Emma, une doctorante en philosophie, évoque une partie de sa thèse dans laquelle elle explique pourquoi elle a toujours fièrement assumée ses jeans taille 42 depuis ses années lycée.
« Je ne suis aucunement attirée par les penseuses se réclamant du mouvement Woke, tels que Robin d’Angelo ou Nancy Fraser. Je suis une libérale "à l’ancienne", profondément marquée par les écrits de Smith, Constant et John Stuart Mill. Néanmoins, je pense que l'intellectuel qui m'a le plus aidée à assumer mes rondeurs est Tocqueville. Dans un magnifique texte, il explique que les inégalités deviennent de plus en plus intolérables à mesure qu'elles diminuent. Partant de cette idée, il est possible de se libérer d'un marxisme traditionnel et dépassé auquel bon nombre d'étudiants en philosophie s'identifient, et de s'intéresser davantage aux questions d'identité ainsi qu'à la culture. » La doctorante macroniste que nous avons rencontré dans un café du XVIème connait parfaitement son sujet. « En tant que femme ronde et fière et de l’être, je pense que la philosophie progressiste englobe une variété de courants et de perspectives hyper vastes. Tandis que certaines penseuses comme Julia Kristeva soulignent l'importance de l'unicité de chaque femme, d’autres comme Manon Garcia revisitent Beauvoir et mènent un travail d’exploration des multiples facettes de la domination que j’aime moins. » Pour cette ardente libérale issue des beaux quartiers parisiens, le féminisme doit être pensé plus que jamais au pluriel. « Peu stimulée par le féminisme libéral à la Elisabeth Badinter qu'elles comparent à un féminisme de bourges les jeunes chercheuses de ma génération s'intéressent davantage à la généalogie de la domination à travers le concept de "patriarcat", ainsi qu'à des ouvrages comme "Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion de l'identité" (1990). Je pense que c’est une erreur.”
Le féminisme radical et queer
Issu de terme anglais signifiant "bizarre" ou "déroutant", le mot queer permet de remettre en question des codes de la beauté féminine. Ainsi, n’importe quelle femme s'identifiant comme "différente" peut défendre autant de personnalités qu’il ou elle le souhaite : c'est l'idée de "performativité du genre" défendue par Judith Butler. " Très rapidement, j'ai voulu féminiser mon corps d'homme", nous explique l'actrice queer Stella Rocha, lorsqu'on la rencontre au Labo, un bar gay à Châtelet. Nous en avons déduit qu'une femme ronde, trans ou drag peut donc se demander ce qui justifie toute forme identification . « Ne risque-t-on pas d’essentialiser" les "stéréotypes de la femme que les féminismes radicaux combattent, en associant certaines caractéristiques à la femme ayant décidé d'assumer ses formes ou de changer de sexe ? » Se demande Katia.Z, un(e) trans parisien(ne) ayant appris à assumer sa personnalité en diffusant des vidéos X sur Pornhub . Née dans une famille ivoirienne musulmane qui n’a jamais accepté son changement de sexe, Katia est convaincue que les féminismes libéraux, qu’elle qualifie de « féminisme à la Terré/VoxFemina », en référence à l’association fondée par une attachée de presse ayant fait l’objet d’une enquête édifiante de Mediapart pour harcèlement contre un alternant en situation de handicap, est une doctrine pensée par et pour des "bourgeoises blanches". « Le point de départ de ma réflexion sur le genre, à l’époque où j’étais un « kaid de cité obèse » fumant des pétards qui lisait des livres pour faire passer le temps, est l’idée du black feminism porté Kimberley Cremshaw, une autrice que j’ai découvert à la médiathèque de La Courneuve au tout début des années 2000 sur conseil d’un bibliothécaire. ».
Née en 1959, Kimberley Cremshaw est une avocate américaine. Connue pour ses travaux sur la différence séparant les victimes selon qu'elles se trouvent à l'« intersection » de plusieurs discriminations spécifiques conçues comme structurelles (être femme, trans et afro, par exemple). Dans cette approche, le combat pour la reconnaissance des trans montre que toutes les formes de domination contre la transophobie ne sont plus comparables. Une maitre de conférences en sociologie politique de l’IEP de Grenoble lesbienne et fière de ses rondeurs témoigne. « Bien qu'a priori inspirée de l'idée post-marxiste de « convergence des luttes » fédérant différentes victimes dans un soulèvement général contre l'oppression bourgeoise, le concept d'« intersectionnalité » dans la pensée de Kremshaw mène à des conséquences différentes, puisqu’il associe les fachos mais pas fachés, pour reprendre une expression de François Ruffin, à des personnes proches de la culture queer vivant à Paris et dans des grandes métropoles où les femmes vivent plutôt bien, même s'ils subissent encore trop d'incivilités dans les rues et les transports. »
Des féminismes populaires
D'autres femmes lient leurs combats féministe à la bonne vieille lutte des classes. Passionnée par la philosophie marxienne reliant la domination des femmes aux combats du prolétariat, Julie, une féministe camionneuse ayant abandonné sa thèse en sociologie pour devenir magasinière dans un entrepôt et développer des combats syndicaux avec des collègues souvent peu politisés témoigne. « Heureusement, l'apport des femmes philosophes ne se limite pas à la conceptualisation du "féminin" ou de la relation entre les sexes. A titre d’exemple, la philosophe Nancy Fraser témoignait dans Mediapart lundi dernier, est plus largement une théoricienne de la justice sociale. La spécificité de sa pensée est de ne pas séparer son aspect formel et institutionnel." Julie pense que la question de la reconnaissance symbolique ne doit pas évacuer celle de l'équité et de la redistribution matérielles, mais la compléter. « Mon combat pour la reconnaissance du féminisme et de la lutte des classes dans la société bourgeoise peut se définir comme un travail impliquant toutes les actions pouvant être menées par les prolétaires, quelles que soient leurs caractéristiques intrinsèques. ». L’approche intellectuelle de Julie n'en reste pas moins représentative de l'empreinte de la post-modernité, par son dépassement de l'individualisme au profit d’une appréhension marxiste des "groupes" et des "communautés" (dont la délimitation reste sujette à débat).