The Transmitter Traduction de "It’s past time to stop using the Reading the Mind in the Eyes Test"
Il est grand temps de cesser d'utiliser le test « Lire l'esprit" dans l'Eyes Test.
Par Wendy C. Higgins, Robert M. Ross - 16 mai 2024
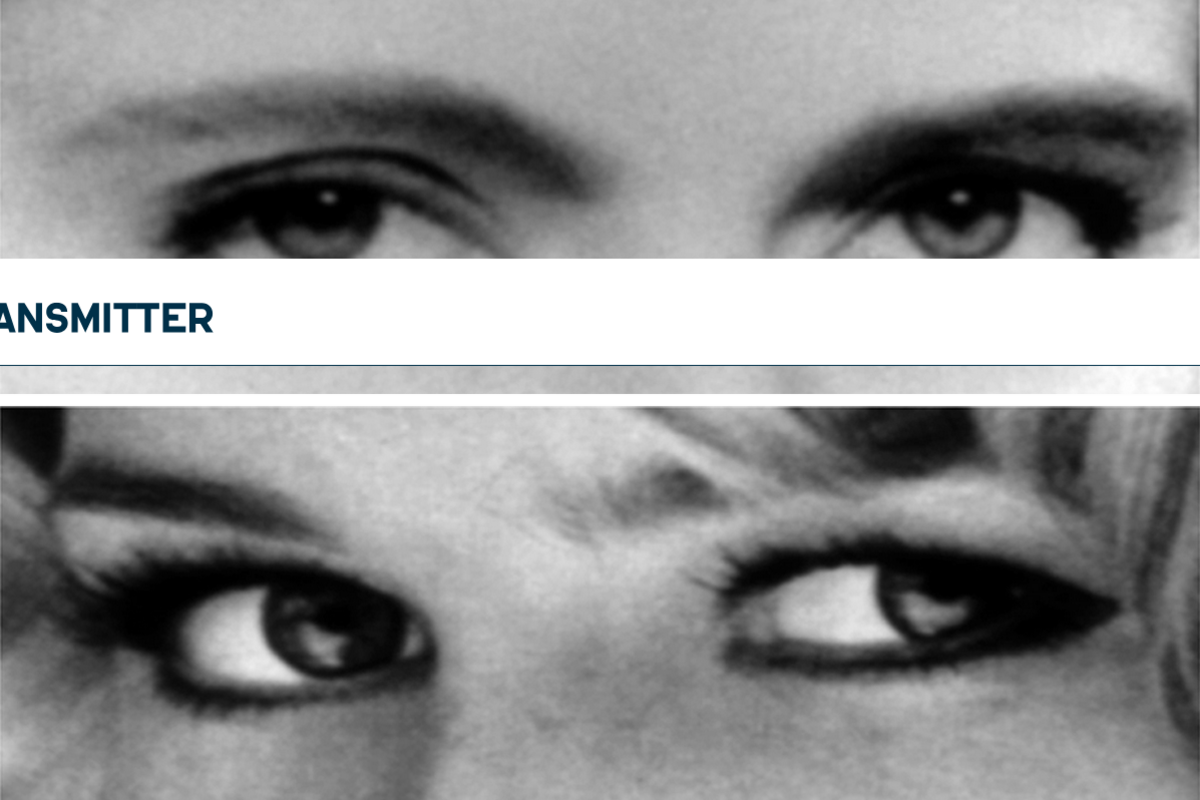
Agrandissement : Illustration 1
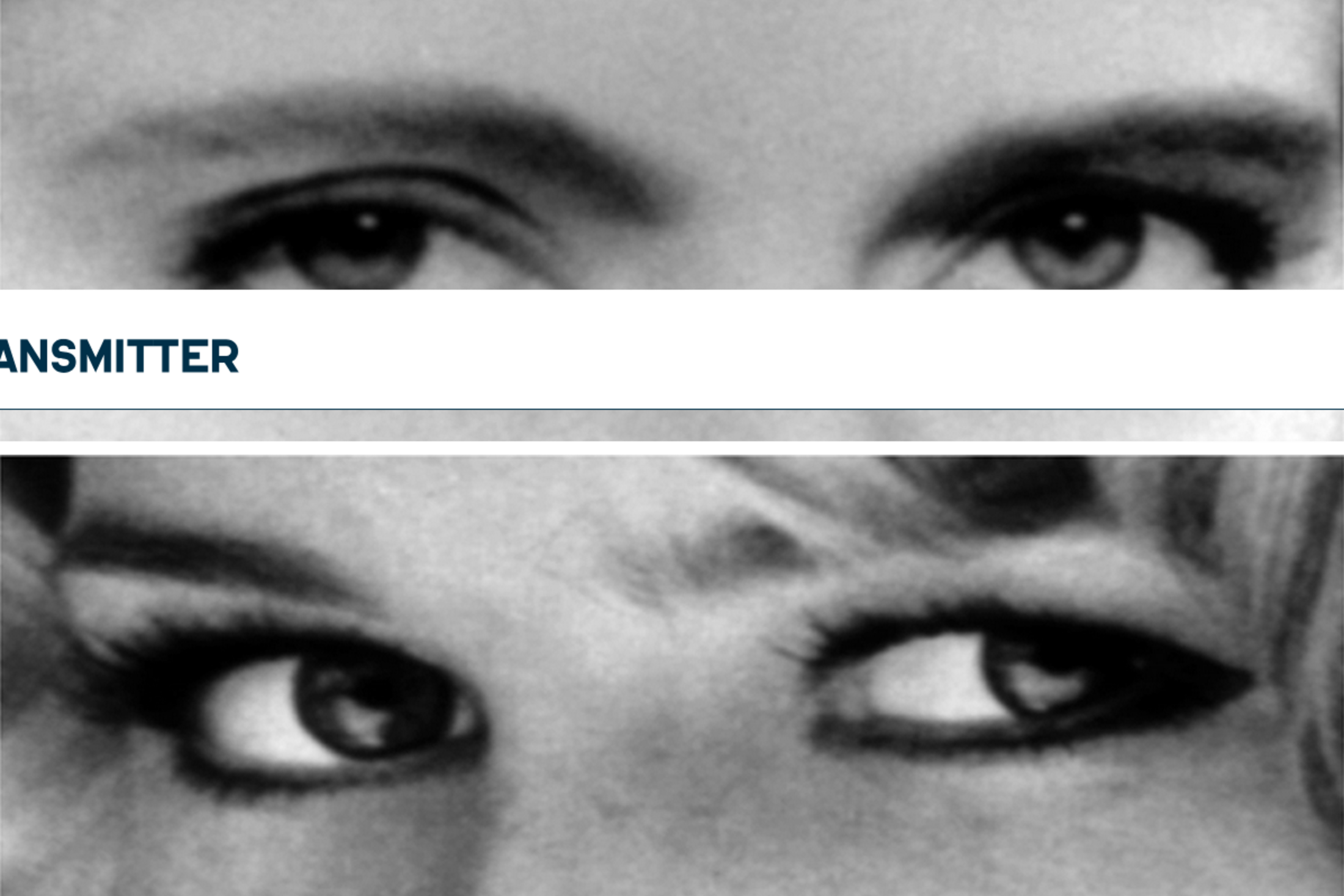
Récemment, l'un d'entre nous a assisté à une conférence universitaire sur la question de savoir si les animaux non humains ont une « théorie de l'esprit », c'est-à-dire la capacité d'attribuer des pensées et des sentiments à d'autres personnes. En présentant le sujet, le conférencier a décrit la théorie de l'esprit comme l'aptitude dont sont dépourvus les personnes autistes.
Ce commentaire n'était pas surprenant, mais il était troublant. La littérature scientifique affirme souvent que les personnes autistes ont un déficit spécifique dans la compréhension de l'esprit d'autrui. Mais, dans ce cas, la juxtaposition était particulièrement choquante : l'orateur se demandait si les animaux non humains avaient une théorie de l'esprit, tout en exprimant la certitude que les personnes autistes n'en avaient pas.
Nous pensons que la communauté scientifique doit réexaminer la relation supposée entre les déficits de la théorie de l'esprit et l'autisme. Sur la base des recherches existantes, il est loin d'être évident que les tests psychologiques conçus pour mesurer la théorie de l'esprit chez les adultes la mesurent réellement, ce qui jette un doute considérable sur les preuves de déficits de la théorie de l'esprit chez les adultes autistes.
Dans un article publié en mars dans la revue Clinical Psychology Review, nous avons soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la validité d'une mesure largement utilisée pour évaluer les capacités de théorie de l'esprit chez l'adulte : le Reading the Mind in the Eyes Test (Eyes Test), que des chercheurs de l'université de Cambridge ont présenté dans un article paru en 2001 dans une revue.
L'Eyes Test comprend 36 items. Chaque item montre une photographie en noir et blanc d'une paire d'yeux, et la tâche consiste à sélectionner, parmi quatre descripteurs d'états mentaux, celui qui correspond le mieux à ce que la personne pense ou ressent. La somme des réponses correctes donne un score de 0 à 36, les scores les plus élevés étant censés indiquer une plus grande aptitude à la théorie de l'esprit. La photo ci-dessous montre l'un des items ; nous vous invitons à vous arrêter et à tenter d'identifier la bonne réponse, que nous rapportons plus loin dans cet article.

Nous avons deux préoccupations majeures quant à la validité du test des yeux. La première concerne l'affirmation selon laquelle les gens peuvent identifier des états mentaux complexes (par exemple, « contemplatif » et « préoccupé ») à partir de photographies statiques et décontextualisées de paires d'yeux. Pour comprendre la force de cette affirmation, il est utile d'examiner la manière dont le test a été conçu.
Les chercheurs qui ont créé le test ont sélectionné des photographies de paires d'yeux dans des magazines. Ensuite, ils ont choisi un descripteur d'état mental « correct » et trois options de réponse « incorrectes » pour chaque photographie. Ils ont testé ces éléments candidats auprès d'un groupe de huit juges. Si au moins cinq de ces juges choisissaient la réponse « correcte » et pas plus de deux choisissaient la même réponse « incorrecte », les descripteurs d'état mental étaient retenus. Dans le cas contraire, les chercheurs modifiaient les options de réponse et testaient les items avec de nouveaux groupes de juges jusqu'à ce que ces critères soient remplis pour 40 items candidats.
Il est important de noter que les chercheurs n'ont jamais demandé aux juges leur avis sur les réponses « correctes » ou leur ont demandé de générer leurs propres réponses. Au contraire, les chercheurs ont vérifié la pertinence des réponses en administrant les items candidats à un groupe de 225 participants afin de tester des critères de consensus légèrement modifiés. Tous les items, sauf quatre, ont satisfait à ces critères, ce qui a donné le test des yeux à 36 items.
Fait remarquable, ce n'est qu'en 2019 qu'a été publiée une étude demandant aux participants de générer leurs propres réponses pour chaque photographie du test. Dans ce cas, moins de 10 % des réponses étaient similaires aux réponses « correctes », et seulement 40 % des réponses avaient la même valence affective (c'est-à-dire positive, négative ou neutre) que les réponses « correctes ».
Ces résultats contrastent fortement avec le taux de réponses « correctes » d'environ 70 % pour le test des yeux à choix multiples standard. Ces résultats très divergents suggèrent que le consensus apparent sur les états mentaux des personnes représentées dans la version standard du Eyes Test est illusoire et dépend fortement du format de réponse à choix forcé.
Plusieurs autres études ont démontré que le consensus apparent ne doit pas être interprété comme signifiant que les participants au test pensent que la réponse qu'ils choisissent est « correcte ». Par exemple, une étude de 2011 a demandé à des personnes d'évaluer la valence affective des photographies du test des yeux en l'absence des quatre options de réponse relatives à l'état mental. L'évaluation moyenne de la valence pour l'item présenté ci-dessus était positive. Pourtant, les quatre choix de réponse ont tous une valence négative : « stupéfié », “déconcerté”, “méfiant” et “terrifié”.
Néanmoins, de nombreux participants aux études du test de l'œil choisissent la « bonne » réponse lorsqu'ils sont contraints par le format à choix forcé, en sélectionnant « méfiant ». Il est tout à fait possible qu'ils utilisent un processus d'élimination pour sélectionner la « moins mauvaise » des quatre mauvaises options, un processus qui est tout à fait différent de la déduction des états mentaux des personnes dans le monde réel.
Comme l'illustrent ces deux études, il est loin d'être évident que de faibles scores au test des yeux indiquent une faible performance dans l'identification correcte des états mentaux et, par conséquent, la preuve d'un déficit de la théorie de l'esprit.
Notre deuxième préoccupation majeure concernant le Eyes Test est le manque de preuves de sa validité empirique. Étant donné que les attributs psychologiques ne peuvent être observés directement, les psychologues évaluent la validité des résultats des tests en recherchant de multiples sources convergentes de preuves indirectes.
Dans notre article de synthèse du mois de mars, nous avons recensé 1 461 études ayant administré le Eyes Test. Nous avons ensuite identifié, parmi ces études, celles qui faisaient état de six catégories clés de preuves de validité. Il est frappant de constater que 63 % des études n'ont fourni de preuves d'aucune de ces six catégories clés. Et lorsque des preuves étaient rapportées, elles indiquaient souvent une validité médiocre.
Ce manque de preuves est loin d'être conforme aux lignes directrices publiées par l'American Psychological Association, qui recommande vivement que chaque étude empirique fasse état de plusieurs sources de preuves de validité pour les mesures utilisées.
Dans notre étude, l'une des sources de preuves de validité les plus fréquemment rapportées était la performance inférieure des personnes autistes au test des yeux par rapport à celle des personnes non autistes. En effet, cette preuve était au cœur de l'étude originale de 2001, qui a montré que le score moyen au Eyes Test parmi 15 participants autistes était inférieur au score moyen des participants non autistes.
L'accent mis sur les différences entre les groupes est un exemple de ce que les psychologues appellent les preuves de validité de « groupe connu », où la capacité des scores de test à discriminer entre les groupes qui sont connus pour différer sur un attribut psychologique particulier soutient l'interprétation selon laquelle les scores de test mesurent cet attribut.
Mais cette preuve de validité de groupe connu est problématique pour au moins deux raisons. Tout d'abord, les études ne montrent pas toujours que les personnes autistes obtiennent de moins bons résultats au test des yeux. Même dans les cas où les scores sont plus faibles, il existe des explications alternatives viables qui n'ont pas été exclues. Par exemple, certaines personnes autistes trouvent le contact visuel extrêmement désagréable et peuvent donc trouver le Eyes Test désagréable.
Le deuxième problème que pose cette preuve de la validité du groupe connu est la circularité. Les mauvais résultats des personnes autistes au test des yeux sont utilisés pour étayer la validité du test des yeux en tant que mesure de l'aptitude à la théorie de l'esprit et constituent une preuve essentielle de la théorie de l'esprit déficitaire de l'autisme.
La question de la circularité est fréquente dans la construction des tests psychologiques. Néanmoins, il est possible d'y remédier en affinant itérativement les théories et les tests, ce qui permet d'améliorer l'un et l'autre. Malheureusement, comme le montre notre article de synthèse, rien n'indique que ce processus d'itération soit en cours dans la littérature sur le test de l'œil.
Malgré l'accumulation des critiques de la théorie selon laquelle les personnes autistes manquent de théorie de l'esprit, et les nombreux échecs empiriques à démontrer des déficits de théorie de l'esprit chez les adultes autistes, peu d'études ont tenté d'affiner le Eyes Test ou ont envisagé des explications alternatives pour les performances inférieures des personnes autistes au test. Au contraire, la version du test des yeux développée en 2001 reste largement utilisée, et les articles universitaires continuent de citer les scores moyens inférieurs des personnes autistes comme une source clé de preuve de la validité du test, même si de nouvelles théories de l'autisme ont été développées qui ne postulent pas un déficit de la théorie de l'esprit.
En conclusion, nous soutenons qu'en raison de l'insuffisance des preuves de validité et des graves limites conceptuelles, les chercheurs et les cliniciens devraient cesser d'utiliser le test des yeux. Il est inquiétant de constater qu'une autre étude, publiée en février, indique que de nombreuses autres mesures de la capacité de théorie de l'esprit présentent également des preuves de validité insuffisantes. Cela laisse présager de nombreux défis pour les scientifiques qui s'efforcent de comprendre la théorie de l'esprit.
Compte tenu de ces préoccupations, comment la recherche sur la théorie de l'esprit devrait-elle se poursuivre ? Nous pensons qu'il faut accorder beaucoup plus d'attention à la relation entre les mesures empiriques et les théories psychologiques. Pour commencer, nous suggérons trois choses : Examiner attentivement les preuves de validité existantes lors de la sélection des mesures à administrer dans le cadre de la recherche ; adhérer aux lignes directrices des meilleures pratiques pour la présentation des preuves de validité des mesures ; et modérer les conclusions en fonction de la force des preuves de validité.
La "théorie de l'esprit" dans l'autisme : Un domaine de recherche qui renaît
La théorie de l'esprit a eu un grand succès dans l'explication de l'autisme, mais différentes recherches ne l'ont pas confirmée. De nouvelles pistes s'ouvrent aujourd'hui. 2 mai 2022
Autisme : neurones activant les compétences clés de la "théorie de l'esprit".
Lecteurs de pensées : Certaines cellules du cerveau signalent si les croyances des autres sont vraies ou fausses. 10 février 2021
La "théorie de l'esprit" ne diminue pas avec l'âge chez les adultes autistes
Les jeunes autistes peuvent avoir du mal à interpréter les pensées des autres, mais leurs compétences dans ce domaine ne diminuent pas avec l'âge, comme c'est le cas chez les personnes non autistes. 13 novembre 2020
Autisme : La double empathie expliquée
Les partisans d'une idée appelée "problème de la double empathie" estiment que les difficultés de communication entre personnes autistes et non autistes sont un problème à double sens, causé par les difficultés de compréhension des deux parties. 22 juillet 2021



