Marxiste hérétique et Juif fuyant les avancées du nazisme en Europe, l’écrivain et philosophe allemand Walter Benjamin (1) écrit en 1940 ses thèses Sur le concept d’histoire, quelques mois avant de se suicider à Port-Bou. Il avance dans la IIe thèse :
« Le passé est marqué d’un indice secret, qui le renvoie à la rédemption. Ne sentons-nous pas nous-mêmes un faible souffle de l’air dans lequel vivaient les hommes d’hier ? Les voix auxquelles nous prêtons l’oreille n’apportent-elles pas un écho de voix désormais éteintes ? […] S’il en est ainsi, alors il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous avons été attendus sur terre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette prétention, il est juste de ne point la repousser. » (2)
Ancien dirigeant de la CGT tombé dans l’oubli, effacé par le zapping permanent sur les immédiatetés successives sur lesquelles nous faisons du surplace devant nos écrans, Jean-Louis Moynot est une de ces « voix » récemment « éteintes » qui ont encore à nous parler afin, selon les mots de Walter Benjamin, « d’attiser dans le passé l’étincelle de l’espérance » (thèse VI, p. 431). Car tout à la fois comme homme d’action et comme intellectuel, il a alimenté « la tradition des opprimés » (thèse VIII, p. 433), si précieuse à un moment où les gauches apparaissent dans le brouillard, affectées profondément par des dérèglements confusionnistes (3). Walter Benjamin le rappelle en une année dramatique, 1940 : c’est « à l’instant du danger » (thèse VI, p. 431) que l’on se doit d’écouter avec encore plus d’attention les voix d’hier, comme celle de Jean-Louis Moynot, dans un sursaut pour sauver les possibilités émancipatrices.

Agrandissement : Illustration 1

Jean-Louis Moynot, dirigeant de la CGT et militant communiste
Issu d’une famille catholique, Jean-Louis Moynot fut membre de la Jeunesse étudiante chrétienne et adhéra à l’UNEF en 1955 (4). Ingénieur, il rejoint la CGT en 1962. Travaillant aux Chantiers navals de La Ciotat, son contrat n’est pas renouvelé au bout d’un an du fait de son engagement syndical. À cause de son implication dans la grève des Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire du printemps 1967, il est nommé à 30 ans au bureau confédéral de la CGT en juin 1967. Il en démissionnera pour des désaccords en juin 1981. Au congrès de Lille de juin 1982 de la CGT, qui voit Henri Krasucki succéder à Georges Séguy, son intervention le 15 juin a été sifflée.
Il a présidé l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT de 1967 à 1981 et a siégé, en tant que représentant de la CGT, au Conseil économique et social de 1969 à 1982. Il adhère au Parti communiste français en 1970 et le quitte en 1982. Il s’était prononcé en janvier 1981 contre l’intervention soviétique en Afghanistan.
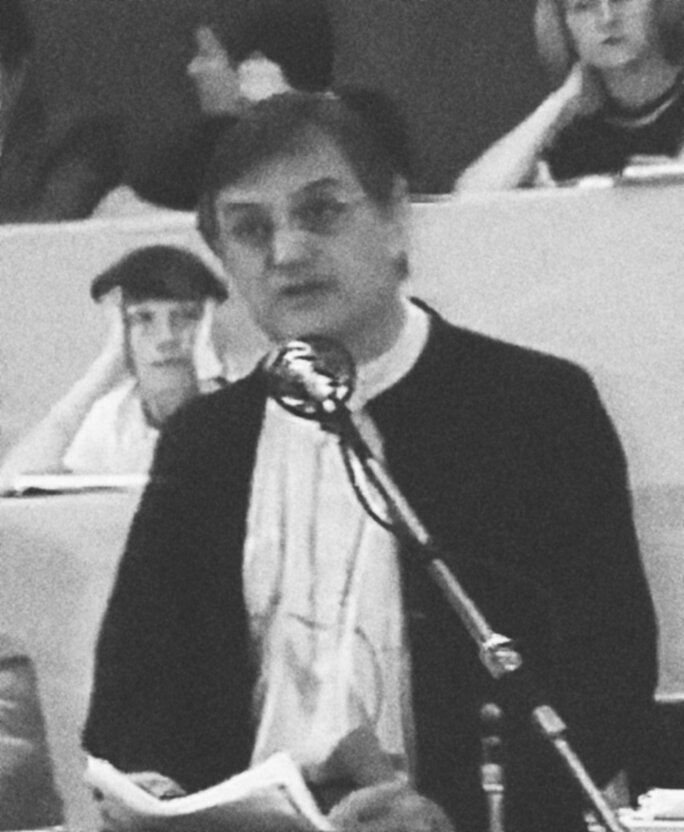
Agrandissement : Illustration 2
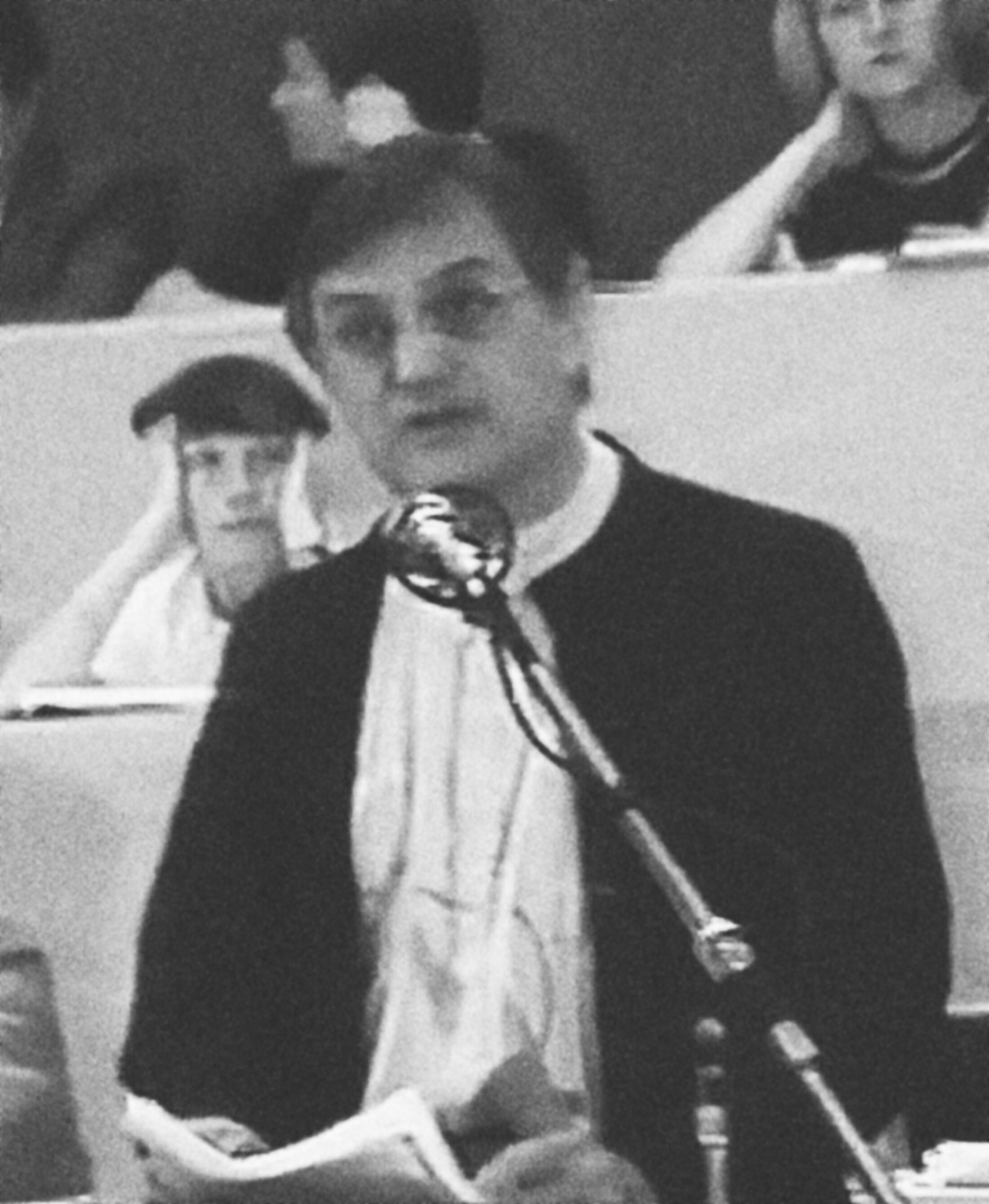
Un livre de 1982, marqué par son contexte et pourtant d’actualité
En 1982, il publie un livre important, qui n’a pas eu l’écho mérité à l’époque. Et pourtant, étudiant marxiste militant au Parti socialiste, je m’y suis intéressé, en y croisant notamment une idée nouvelle pour moi, qui ne commencera vraiment à faire son chemin dans mon cerf-volant qu’environ 15 ans après dans le cours de mon travail en sociologie et en philosophie politique : « l’individualité sociale ». Au milieu du gué. CGT, syndicalisme et démocratie de masse est publié en mars 1982 aux Presses Universitaires de France, dans la prestigieuse collection marxiste alors dirigée par les philosophes Étienne Balibar et Dominique Lecourt : « Pratiques théoriques ».
Le livre est écrit pendant l’été et l’automne 1981, alors qu’il vient de quitter le bureau confédéral de la CGT. Pour lui, face à la crise économique et à l’élection de François Mitterrand, la « faiblesse » de la CGT « est grave » (p. 8). Dans la perspective du congrès de 1982, l’ouvrage de Jean-Louis Moynot s’efforce de contribuer au débat de manière critique, en tant que syndicaliste mais aussi que communiste. « Il était nécessaire d’exprimer ouvertement un point de vue théorique et politique en même temps que syndical », prévient-il dans l’Avant-propos (p. 10).
Dans le premier chapitre, « Communisme et révolution. L’histoire et l’expérience actuelle », il s’efforce de resituer les enjeux du moment dans l’histoire de l’espérance communiste et de ses drames. Car, pour lui, « la période ouverte après la première guerre mondiale par la révolution d’octobre […] est bel et bien terminée » (p. 24). Et « elle fait place à une nouvelle période historique », qui « oblige à questionner à nouveau de fond en comble tout l’héritage d’idées, de conceptions, de pratiques du mouvement ouvrier » (pp. 24-25).
Élément central de ce retour critique sur le passé : « Non seulement la tragédie du Cambodge ou ce qu’on apprend aujourd’hui sur la Chine prouve que la répression de masse n’a pas été seulement le fait de Staline ou d’une seule conjoncture historique » (p. 25). Ainsi, ce qu’il appelle encore « les pays socialistes » soulèvent « des problèmes très profonds sur la structure même des régimes en question » (p. 27) et apparaissent enfermés dans « une impasse historique » (p. 29). Cette interrogation lucide de Jean-Louis Moynot, parce qu'il a longtemps été immergé dans des illusions, fait preuve à plusieurs moments d’humilité autocritique avec sa part de doute : « j’y ai moi-même trop participé pour en faire une critique complète » (p.16), « Avouerai-je sans honte que pendant une période je me suis livré comme d’autres à ce genre d’exercice ? » (p. 255), « Rien dans l’immédiat ne peut être vraiment satisfaisant » (p. 37)… Et pourtant l’espoir, s’il sait s’écarter de la mythologisation et du dogmatisme, en se confrontant pragmatiquement aux rugosités et aux contradictions du réel, ne doit pas être abandonné : « il faut cesser d’avoir peur et entrer dans la vie réelle » (p. 35).
Le ton se fait aussi libertaire, retrouvant des accents de la première CGT, celle syndicaliste révolutionnaire des Bourses du travail de la fin du XIXe et du début du XXe siècles. Jean-Louis Moynot rappelle aussi la perspective marxienne du « dépérissement de l’État » contre « l’étatisme révolutionnaire » dominant « la tradition communiste » (p. 18). C’est l’étatisme dans les institutions, dans les pratiques et dans les têtes qu’il met en cause, « à travers le prisme du parti érigé en valeur suprême, du rapport au pouvoir dans notre culture politique » (p. 19). L’État ainsi fétichisé « n’en demeure pas moins une réalité qui est par essence placée en dehors et au-dessus des gens » (p. 19).
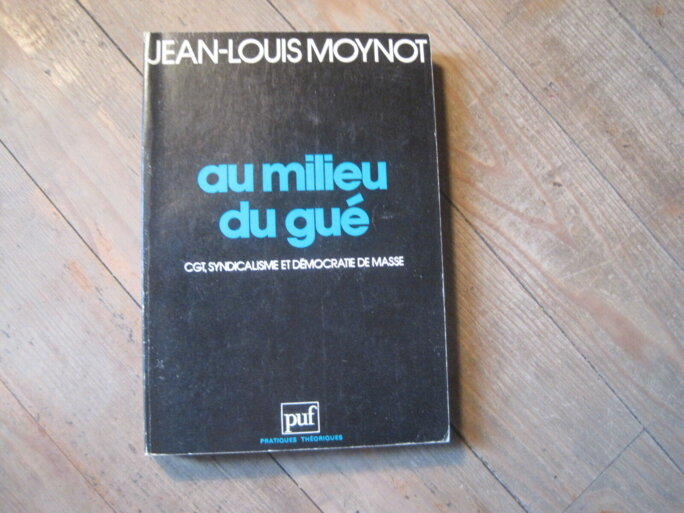
Agrandissement : Illustration 3
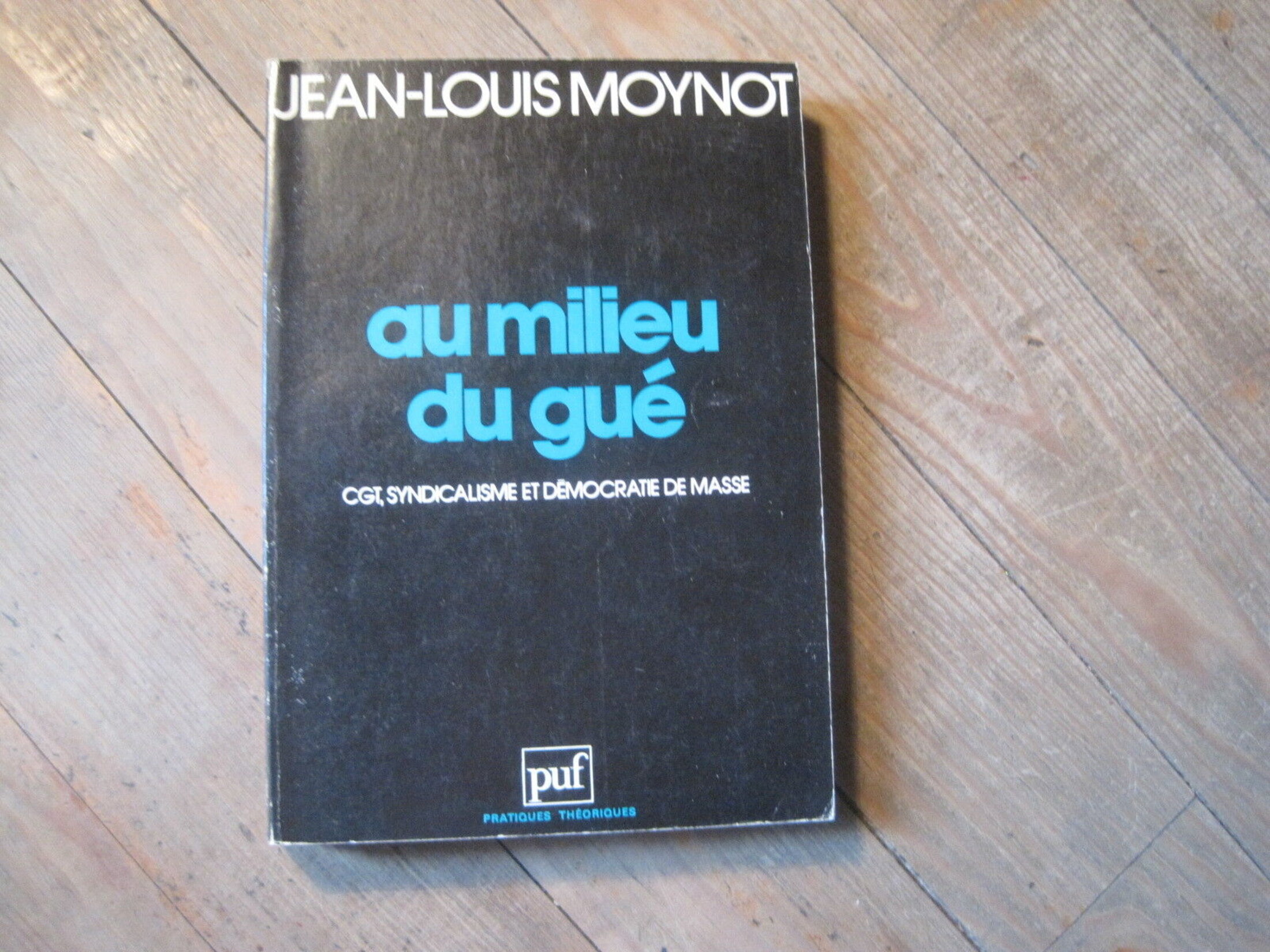
Cependant 1982 n’était-ce pas déjà trop tard pour relever l’espérance communiste des catastrophes du XXe siècle, alors que presque toutes les expériences communistes ont généré des régimes autoritaires ou totalitaires ? Jean-Louis Moynot semble encore en 1982 « au milieu du gué », en considérant que ces monstruosités historiques peuvent toujours être qualifiées de « pays socialistes », en faisant donc partie de « la famille », malgré la radicalité des critiques qu’il amorce. Par ailleurs, en 1982, peu de temps avant le tournant social-libéral de 1983 de la gauche mitterrandienne, il apparaît trop optimiste quant aux « changements très profonds » que la victoire présidentielle, puis législative, de 1981 rendraient « possibles » (p. 24).
Toutefois, en même temps, la fragilité à l’époque de Jean-Louis Moynot, sur le fil du rasoir, nous émeut encore, car ne sommes-nous pas de nouveau pris dans les évidences qui nous ont fait croire excessivement aux deux gauches qui ont dominés le XXe siècle, la gauche communiste et la gauche sociale-démocrate ? Sans parler du tragi-comique des gesticulations des François Hollande et autres Jean-Luc Mélenchon qui nous rapprochent de plus en plus du précipice (5)… Il s’agit bien, comme Jean-Louis Moynot en 1982, de revenir de manière critique sur de larges pans de notre passé et de notre passif, avec une boussole héritée de l’hier émancipateur et ouverte sur un à-venir inédit. Bref très contextualisé, le livre de Jean-Louis Moynot a aussi une actualité, dans sa mélancolie fragile mais demeurant exploratrice. Car l’aventure n’est pas terminée, ne doit pas être terminée, en 1982 comme en 2025…
« L’individualité sociale » : un concept émancipatoire pour l’avenir
L’ouvrage de Jean-Louis Moynot revêt une autre actualité : il soulève un des problèmes centraux d’une politique d’émancipation sociale, mais qui est encore aujourd’hui à l’écart, peut-être davantage encore même que lors de l’année 1982 portée par les derniers souffles de Mai 68 : la question de l’individu. Or, l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne en 1979 et de Ronald Reagan en 1981 aux États-Unis va ouvrir la voie à la contre-révolution du néolibéralisme économique dans le monde, non encore clairement perceptible en 1982. Les critiques de gauche du néolibéralisme vont progressivement et largement laisser le quasi-monopole de l’individu au capitalisme en prenant appui presqu’exclusivement sur le commun pour le combattre. Ils vont aussi souvent tendre à fétichiser l’État, mis en vis-à-vis du marché, en laissant de côté les critiques de l’étatisme comme celles de Jean-Louis Moynot ou des libertaires. C’est pourquoi il nous faut aujourd’hui gratter particulièrement la croute des critiques anti-libérales manichéennes pour retrouver l’éclat des pistes de Jean-Louis Moynot en 1982.

Agrandissement : Illustration 4

Le chapitre 8 du livre s’intitule « L’individualité sociale », en référence à Karl Marx pour qui « l’individualité humaine est historique et sociale ». Il ne s’agit pas d’une monade isolée, mais d’un processus historique d’individuation inscrit dans des rapports sociaux. Ce qui donne une double dimension à l’individualité : à la fois fait socio-historique et finalité souhaitable de l’émancipation humaine. Or, le paradoxe est que Marx est un penseur de l’individu, au sens d’une individualité socio-historique (6), alors que, note Jean-Louis Moynot, cela est souvent considéré « comme un point aveugle du marxisme », dans une « vision réductrice du marxisme comme pur collectivisme » (p. 241). Le syndicaliste retrouve, contre la tendance à l’aplatissement collectiviste des pensées critiques à gauche, une intuition marxienne : « le caractère unique de chaque individu humain et la nécessité irremplaçable de cette individualité » (p. 243). On pourrait même dire que, dans les sociétés capitalistes et individualistes contemporaines, l’individualité est au cœur d’une des contradictions principales du capitalisme : la contradiction capital/individualité (7). Jean Louis-Moynot n’en était pas explicitement à ce constat en 1982, mais il était sur les traces du problème… Il fait ainsi son miel d’un des rares intellectuels communistes qui se soit saisi frontalement de l’individualité, le philosophe Lucien Sève, dont le livre pionnier Marxisme et théorie de la personnalité a paru pour sa première édition en 1969. Cependant, il lui reproche de ne pas avoir vraiment essayé de peser dans ce sens au sein du PCF alors qu’il dirigeait les Éditions sociales, les éditions du parti (p. 262).
Pour ce faire, Jean-Luc Moynot a dû se débarrasser de couches militantes superposées routinisant la dénonciation de « l’individualisme bourgeois » et de « l’individualisme petit-bourgeois », en reprenant langue avec l’individualisme anarcho-syndicaliste des débuts de la CGT, où l’individualité dans la solidarité apparaissait liée à la possession individuelle d’un métier artisanal ou semi-artisanal (p. 245). Il prend appui également sur une émergence émancipatrice dans le sillage de Mai 68 : « le mouvement des femmes » contre « le patriarcat » (pp. 246 et 257 notamment) comme facteur de réévaluation de l’individualité. À l’écoute de ces chemins de traverse par rapport aux autoroutes de la gauche au XXe siècle, il refuse de réduire l’individu à « un individualisme replié sur soi » (p. 250).
C’est aussi dans les institutions communistes qu’il conteste « la négation de l’individualité » (p. 259). Il met alors en évidence un autre paradoxe : le mouvement communiste a été un lieu de développement de belles individualités à travers un militantisme les arrachant au poids de l’exploitation et de la domination, mais en même temps il a privilégié dans son fonctionnement « un état de dépendance qui s’oppose à l’autonomie individuelle » et « le sacrifice de leur vie individuelle au parti » (p. 260). Ce faisant, le Parti communiste « se prive de l’extraordinaire richesse sociale et politique que peuvent lui apporter, chacun de façon singulière, les êtres humains qu’il a été capable d’attirer à lui et qu’il a contribué à développer pour une grande part » (ibid.). Dans cette logique, « on se pliait, ou l’on partait, ou l’on était exclu » (p. 261). Jean-Louis Moynot a fini par partir…
Hommage à Jean-Louis Moynot
Jean-Louis Moynot a commencé à tracer un fil alternatif sur un plan décisif. Mais, en 1982, la bifurcation n’a pas eu lieu, il n’a pas été écouté, sa voix a même été marginalisée. Merci à lui et à d’autres qui ont su percer des trous dans la coque de paquebots de la gauche qui pourraient se transformer aujourd’hui en canots de sauvetage ! À nous de reprendre le flambeau dans des conditions nouvelles, au bord du gouffre…
Je remercie Clotilde et Emmanuel Moynot pour les photos de leur père et Emmanuel Moynot pour son aide.
Post-sciptum (11 avril 2024) : Grâce au commentaire de Jules Bernard, j'ai pu apporter une précision à mon texte. J'ai écrit initialement "aurait été sifflée" pour l'intervention de Jean-Louis Moynot au 41e congrès de la CGT le 15 juin 1982, car si les fiches du Maitron et du site Les Ex-PCF parlent de sifflets, la récente notice de Maryse Dumas dans la presse de la CGT indique seulement un "silence glacial". Or, dans l'archive INA sur le 13h de TF1 du 15 juin 1982 signalée par Jules Bernard, on entend bien des sifflets (mais le journaliste note aussi dans ses commentaires un "silence" dans la salle du congrès) : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caa8200828601/congres-cgt. J'ai donc corrigé en mettant "a été sifflée".
Notes :
(1) En échos à Walter Benjamin (1892-1940), voir sur ce blog de Mediapart : « Mélancolie : une radicalité de l’imperfection ? », 14 décembre 2008 ; « Mélancolie de Miossec : des intimités bringuebalantes à une politique radicale », 19 février 2010 ; et « Mélancolie de Charles Aznavour… en affinité avec Walter Benjamin et Daniel Bensaïd », 2 octobre 2018.
(2) Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire [1940], dans Œuvres III, Paris, Gallimard, collection « Folio – Essais », 2000, pp. 428-429.
(3) Voir Philippe Corcuff, La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 2021 ; et sur ce blog : « La grande confusion (1) : Meurs pas… la gauche », 15 mars 2021.
(4) Voir les notices consacrées à Jean-Louis Moynot : dans Le Maitron. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, par l’historien Claude Pennetier, https://maitron.fr/spip.php?article148793 et sur le site Les Ex-PCF, https://www.ex-pcf.com/index.php/liste-alpha/294-moynot-jean-louis, ainsi que l’article nécrologique que lui a consacré Maryse Dumas sur le site de La Nouvelle Vie ouvrière, le magazine des militants de la CGT, « Disparition de Jean-Louis Moynot : "La CGT vient de perdre l’un des siens" », 12 mars 2025.
(5) Voir Philippe Corcuff et Philippe Marlière, Les Tontons flingueurs de la gauche. Lettres ouvertes à Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin, Onfray, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 2024.
(6) Voir des extraits des nombreux textes que Marx a consacré à l’individu dans la partie II, intitulée « De l’individu blessé à "l’homme total" », de Philippe Corcuff, Marx XXIe siècle. Textes commentés, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 2012, pp. 59-98.
(7) Sur la notion de contradiction capital/individualité dans le capitalisme contemporain, voir Philippe Corcuff, « Individualité et contradictions du néocapitalisme », SociologieS (revue de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française), 22 octobre 2006.
*******************************************************
Deux textes complémentaires récents sur les tensions entre les catégories collectives et les singularités individuelles dans la cadre d’une chronique mensuelle sur le site du Nouvel Obs, « Rouvrir les imaginaires politiques » :
* « Les manichéismes, la catégorie et l’individu : de ʺl’affaire de Bruay-en-Artoisʺ à ʺl’affaire Julien Bayou-Sandrine Rousseauʺ », 24 mars 2025
* « De la déploration trumpisée à l’émancipation : ʺEn fanfareʺ avec Bob Dylan et Jacques Derrida », 26 février 2025



