Entretien de Philippe Corcuff avec Galaad Wilgos
(29 janvier 2022)
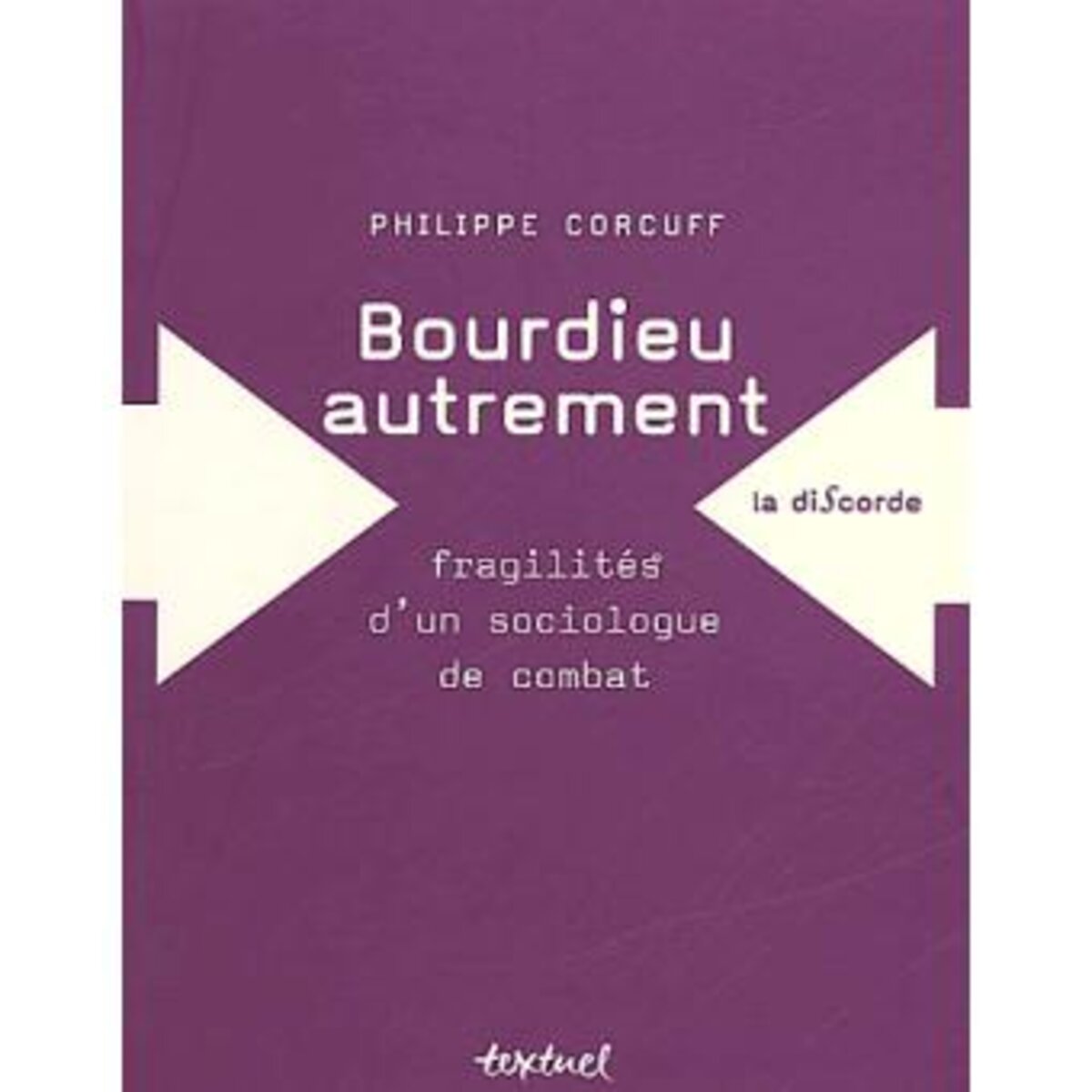
Galaad Wilgos : Comment décririez-vous Bourdieu en une phrase ?
Philippe Corcuff : Pierre Bourdieu était un penseur des limites sociales et historiques de toute pensée, qui en même temps avait la nostalgie des pensées totalisantes d'antan, d'où une certaine mélancolie bourdieusienne.
Quel a été l'impact ou l'influence de son œuvre sur votre pensée ?
Au-delà de moi, c'est un des principaux sociologues du XXe siècle à un niveau mondial et, sur le plan français, il a contribué à réarmer la critique sociale militante à partir de La misère du monde en 1993, après une certaine atonie des années 1980.
À ma petite échelle, il m'a permis de sortir du cadre étroit de la référence au marxisme qui avait marqué mes années lycéennes et étudiantes, sans pour autant abandonner la référence à Marx, pour m'ouvrir davantage aux complications du monde social. Il m'a appris aussi qu'un intellectuel engagé ne devait pas fusionner le registre scientifique et le registre militant, mais préserver une tension entre eux dans un engagement distancié. Et, surtout, il m'a fourni des outils critiques qui m'ont permis de m'autonomiser par rapport à l'œuvre de Bourdieu lui-même en explorant d'autres contrées intellectuelles.
Quels ont été les apports majeurs de Bourdieu selon vous ?
Il a profondément renouvelé en un sens « post-marxiste » la pensée critique, à la fois en prenant la mesure de l'inscription dans les corps de la domination (avec sa notion d'habitus), de manière plus profonde que l'effet de simples idéologies, et en appréhendant une pluralité de modes de domination : pas seulement la domination économique, comme souvent les marxistes à son époque, mais aussi une domination culturelle, une domination politique, une domination masculine, etc. Dans le sillage de grands philosophes du XXe siècle comme Ludwig Wittgenstein (1889-1951) et Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), il a aussi développé une vigilance vis-à-vis des pièges de l'intellectualisme dans l'analyse de l'action, c'est-à-dire la méconnaissance des logiques pratiques de l'action en train de se faire. La vision intellectualiste de l'action pour Bourdieu, c'est en quelque sorte voir l'action du point de vue d'un spectateur d'un match de football à la télévision, qui le regarde comme un spectacle, qui donne des conseils après coup devant son poste, qui revoit des actions au ralenti, en oubliant le rapport pratique aux urgences du jeu du joueur sur le terrain. Sur le plan épistémologique et méthodologique, il a placé au cœur des sciences sociales l'exigence de réflexivité, c'est-à-dire le fait que la prise en compte par le sociologue de ses propres impensés et des effets de ses insertions sociales peut faire progresser la scientificité de ses travaux.
A contrario, quelles critiques pourrait-on en faire ?
Il laisse insuffisamment de place dans la vie sociale aux logiques qui, dans la vie quotidienne, ne se réduisent pas à de la domination ou qui débordent la domination, comme les sociabilités ordinaires, les relations de coopération et de de solidarité, ou les imaginaires utopiques qui s'élaborent dans les intimités personnelles. Les sociologues Jean-Claude Passeron et Claude Grignon parlent justement d'une tendance au « dominocentrisme »(1). Ce qui limite son approche de l'émancipation, qui ne connaît principalement que la figure d'inspiration spinoziste de la connaissance des déterminismes sociaux comme moyen de libération individuelle et collective. Le philosophe Jacques Rancière a bien perçu cette limite(2), mais de manière trop unilatérale, en ne comprenant pas combien les mécanismes de domination décryptés par Bourdieu ne conduisent pas nécessairement au fatalisme, mais constituent aussi une invitation à repenser l'émancipation par rapport au poids de ce que Merleau-Ponty appelait « l'adversité »(3).
Que pensez-vous des critiques qui lui sont généralement assénées aujourd'hui ?
Dans les débats publics, il y a aujourd'hui l'importance d'une dynamique idéologique ultraconservatrice en complet décalage avec une pensée critique comme celle de Bourdieu(4), qui ne peut conduire qu'à une incompréhension agressive. Par ailleurs, il y a dans le milieu académique l'expression de rancœurs face à la reconnaissance internationale de l'œuvre de Bourdieu, qui porte à la caricature. Une pensée nuancée comme celle de Bourdieu appellerait des critiques nuancées. C'est rarement le cas.
* Cet entretien a été réalisé par Galaad Wilgos dans la perspective d’un article pour l’hebdomadaire Marianne ; cet article a été publié le 4 février 2022 sur le site de Marianne sous le titre « Sociologie : deux décennies après sa mort, Bourdieu, un maître (in)dépassable ? » , en incluant des extraits de l’entretien aux côtés d’autres extraits d’entretien. Je remercie Galaad Wilgos de m’avoir autorisé à publier l’intégralité de l’entretien.
Philippe Corcuff, maître de conférences de science politique à Sciences Po Lyon, auteur de Bourdieu autrement. Fragilités d'un sociologue de combat (Textuel, 2003)
Notes :
(1) Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Gallimard-Le Seuil, collection « Hautes Études », 1989.
(2) Jacques Rancière, Le philosophe et ses pauvres, Paris, Fayard, 1983, « Le sociologue roi », pp. 239-288 ; sur la tension entre la sociologie critique de Bourdieu et la philosophie de l’émancipation de Rancière, voir Philippe Corcuff, Où est passée la critique sociale ?, Paris, La Découverte, collection « Bibliothèque du M.A.U.S.S., 2012, « Les aventures tumultueuses du couple domination-émancipation, de Rancière à Jonasz » et « De la productivité intellectuelle d’interférences et de tensions ente Bourdieu et Rancière », pp. 33-58.
(3) Sur la notion d’adversité, voir Maurice Merleau-Ponty, « L’homme et l’adversité » (conférence du 10 septembre 1951 aux Rencontres Internationales de Genève), repris dans Signes (1e éd. : 1960), Paris, Gallimard, 1987, pp. 284-308 ; « L’homme et l’adversité » (débats des 10, 12 et 14 septembre 1951 aux Rencontres Internationales de Genève), repris dans Parcours deux, 1951-1961, Lagrasse, Verdier, 2000, pp. 321-376 ; et « L’homme et l’adversité » (entretiens radiophoniques animés par Jean Amrouche, diffusés les 15 et 22 septembre 1951), repris dans Entretiens avec Georges Charbonnier et autres dialogues, 1946-1959, Lagrasse, Verdier, 2016, pp. 62-71.
(4) Voir Philippe Corcuff, La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », mars 2021.
Textes sur la sociologie de Pierre Bourdieu publiées précédemment sur ce blog :
. 16 juin 2009, « La sociologie de Pierre Bourdieu » ; deux parties :
- « (1) Une nouvelle critique sociale » ;
- et « (2) Le sociologue et le philosophe » ;
. 4 juillet 2009, « Pierre Bourdieu et les conspirationnismes : roc et failles ».



