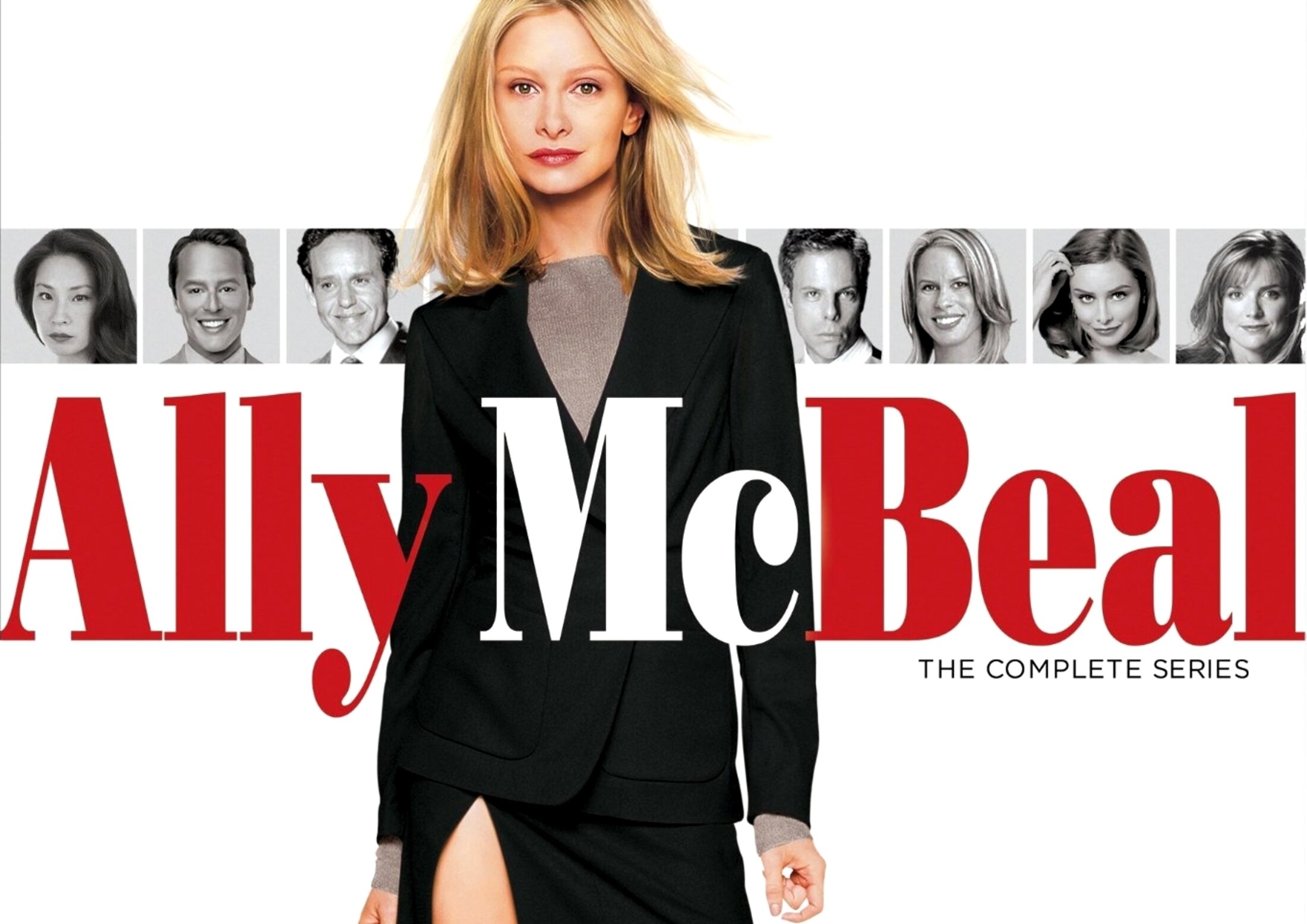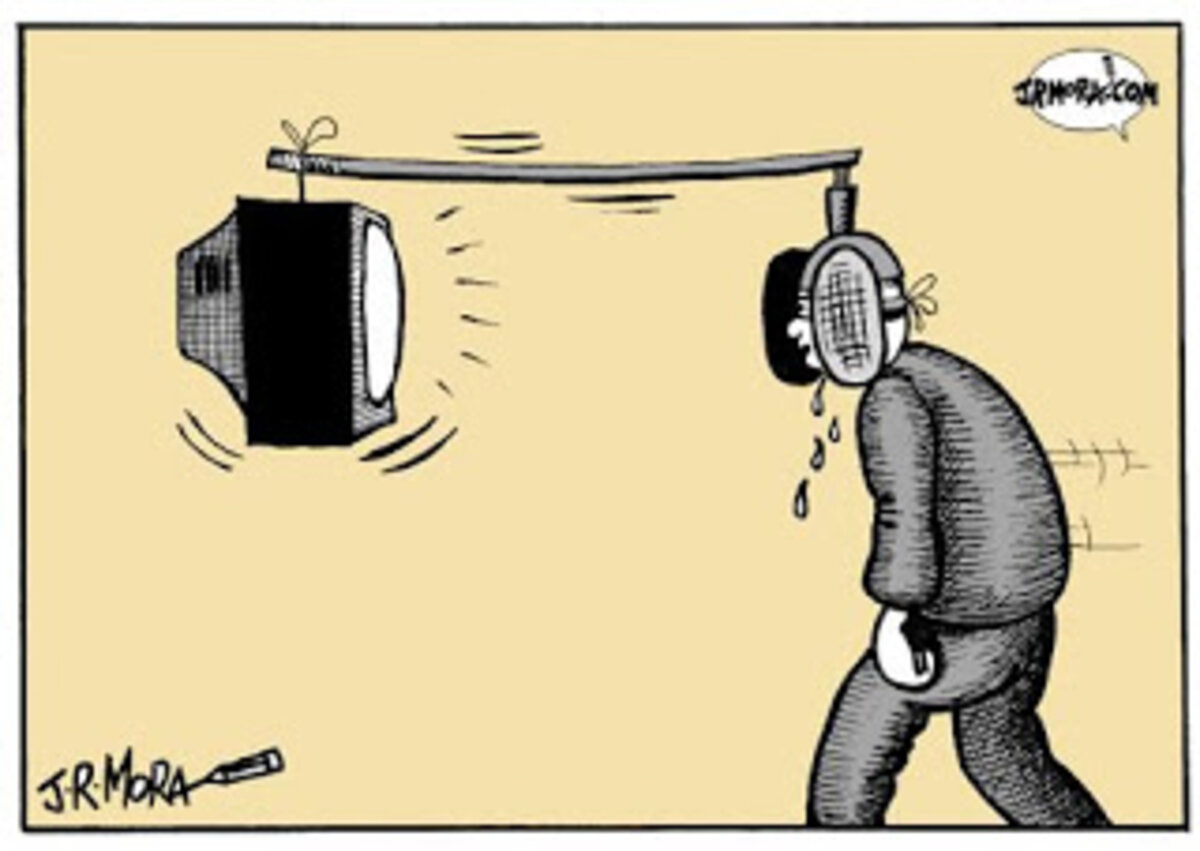
Introduction (31 août 2016)
Dan Israel a rendu compte de manière élogieuse sur Mediapart du récent livre de Samuel Gontier, Ma vie au poste. Huit ans d’enquête (immobile) sur la télé du quotidien (Paris, La Découverte, août 2016) : « Une enquête dissèque la télé, ses horreurs, ses mensonges et son sexisme », 25 août 2016, https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/250816/une-enquete-disseque-la-tele-ses-horreurs-ses-mensonges-et-son-sexisme . Mediapart a, par ailleurs, mis en ligne des extraits du livre concerné : « "Ma vie au poste", un chapitre inédit », 25 août 2016, https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/250816/ma-vie-au-poste-un-chapitre-inedit . Les quelques remarques qui introduisent ce billet ne visent pas directement le livre de Samuel Gontier, que je n’ai pas lu en-dehors des extraits parus sur Mediapart, mais ce qui transparaît du livre à travers le compte-rendu de Dan Israel. C’est donc bien l’article de Dan Israel qui est le point de départ ici, par rapport auquel j’ai bénéficié d’échanges amicaux avec son auteur. Il est à remarquer qu’il est rare que des journalistes (ou des universitaires, pour parler de ma profession) acceptent ainsi la critique comme l’a fait Dan Israel.
Utilité de la critique des contenus télévisés dominants
On doit d’abord souligner l’utilité de vues critiques sur le contenu des programmes télévisés comme celles que proposent Samuel Gontier dans son ouvrage. Car le décryptage détaillé des déformations, des stéréotypes et des ressorts des contenus télévisés dominants permet notamment :
1) d’alimenter notre esprit critique ;
2) de mieux saisir les limites des ressources informatives et culturelles offertes à l'appropriation des téléspectateurs ;
et 3) de nous aider à envisager des logiques médiatiques alternatives (1).
Par ailleurs, un double intérêt supplémentaire de la démarche de Samuel Gontier est le temps long (huit ans !) et la systématicité du regard, permettant de mieux voir des choses que la grande majorité des réceptions plus intermittentes ne voient pas ou de manière moins nette.
Le risque de l’écrasement des réceptions ordinaires de la télévision
Cependant, il y a des ambiguïtés dans les formulations de Dan Israel qui ouvrent un espace d’interrogations critiques. Ces ambiguïtés pourraient, si l’on n’y prend garde, nourrir le prêt-à-penser répétitif d’une certaine dénonciation manichéenne des médias en général et de la télévision en particulier, si présente dans les gauches critiques (comme d'ailleurs dans les milieux conservateurs, mais avec un élitisme non masqué à la différence des premières), écrasant les réceptions sous le présupposé d’« aliénation » généralisée des téléspectateurs, ceux-ci étant vus comme une masse passive soumise automatiquement à « l'influence » écrasante de « la propagande », des « mensonges » et des stéréotypes des médias dominants. Quelles sont ces ambiguïtés ?
Premier problème : Dan Israel parle dans le chapeau de son article de manière trop abrupte et unilatérale d’« un flot quotidien à l’influence toujours pas démentie ». Telle quelle cette assertion apparaît erronée du point de vue des travaux de sciences sociales (sociologie, ethnologie, science politique, etc.) qui se sont développés autour de la réception de la télévision depuis les années 1980 à une échelle internationale (2) sous le label « études de réception ». Car justement ces travaux « démentent » le plus souvent une « influence » automatique des messages diffusés, les téléspectateurs ayant des filtres variables dans la réception de ces messages (en fonction d'expériences de classe, de genre, de génération, culturels divers, des conditions concrètes de réception de ces messages, etc.).
Second problème : ce qui semble apparaître à un moment de la posture de Samuel Gontier dans le papier de Dan Israel. Samuel Gontier y explique que son livre se place « toujours dans la seule position du téléspectateur, du récepteur ». Mais Dan Israel en parlant de « téléspectateur averti » laisse entendre que l’on n’aurait pas affaire avec Samuel Gontier à un spectateur ordinaire, mais à un super-spectateur critique hors du commun des mortels. Or, qui dit « téléspectateur averti » fait implicitement référence à des « téléspectateurs non avertis ». Dans cette ambiguïté, surtout si on la réfère au problème précédent, réside un danger classique dans la critique des médias. Les sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron l’ont pointé dès 1963 dans un article de la revue Les Temps modernes (3) en demandant : « Et pourquoi ignorer les protections dont s’arment les masses contre le déferlement massmédiatique ? » Et d'ajouter : « Mais les intellectuels ont toujours peine à croire aux défenses, c'est-à-dire à la liberté des autres, puisqu’ils s’attribuent volontiers le monopole professionnel de la liberté d’esprit ». C’est le risque d’un élitisme misérabiliste vis-à-vis des réceptions populaires actif dans les milieux intellectuels et, plus largement, des Bac++++…, qui est pointé ici du point de vue d’une sociologie critique des intellectuels. Les intellectuels et la petite-bourgeoisi culturelle (très présente dans les univers militants de gauche) seraient du côté des Lumières et les téléspectateurs ordinaires prisonniers de la caverne, dans l’attente d’un Platon libérateur…
Pour contrecarrer ce risque et combler l’angle mort des ambiguïtés relevées dans l’article de Dan Israel, je republie dans ce billet trois courts textes faisant état d’une critique moins manichéenne des médias et d’une vision plus nuancée des réceptions de la télévision.
Notes :
(1) Sur des médias alternatifs et populaires, on trouve des pistes stimulantes dans Médias : le peuple n’est pas condamné à TF1 du sociologue Vincent Goulet, Paris, Editions Textuel, collection Petite Encyclopédie Critique, 2014 ; voir https://blogs.mediapart.fr/edition/petite-encyclopedie-critique/article/130215/medias-le-peuple-n-est-pas-condamne-tf1 .
(2) Pour un panorama international des études de réception en sciences sociales, voir le livre de la professeure en science politique Brigitte Le Grignou, Du côté du public. Usages et réceptions de la télévision (Paris, Editions Economica, 2003).
(3) Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, « Sociologues des mythologies et mythologies des sociologues », revue Les Temps modernes, n° 211, décembre 1963 ; sur internet : https://fr.scribd.com/doc/36453875/Bourdieu-Pierre-and-Jean-Claude-Passeron-Sociologues-des-Mythologies-et-Mythologies-de-Sociologues-Les-Temps-Modernes-211-December-1963-pp-9 .
1 - Vers une nouvelle critique des médias. Contre la critique unique de « la pensée unique » néolibérale
- Paru initialement dans la revue québécoise de gauche Á Bâbord !, n° 18, février-mars 2007, http://www.ababord.org/spip.php?article263 -
La critique des médias dominants est une nécessité pour respirer par rapport à la tendance hégémonique de «la pensée unique» néolibérale. Mais une critique trop manichéenne des médias est sans doute trop à la mode dans la galaxie altermondialiste. Contre le risque d’une critique unique de « la pensée unique », une autre critique des médias est possible, plus sensible aux complications et aux contradictions de notre monde, et donc plus radicale, car plus à même de saisir les racines emmêlées des maux humains dans les sociétés capitalistes actuelles.
Une certaine critique des médias a donc le vent en poupe dans la galaxie altermondialiste. Certains y voient un signe de bonne santé de la radicalité politique. J’y vois poindre aussi des indices de simplification de la critique sociale. Le triple écueil rencontré consiste en une surévaluation de l’effet direct des logiques économiques (économisme), d’une focalisation sur les « complots » cachés de quelques puissants (conspirationnisme) et d’un oubli du rapport social émetteur/récepteurs au profit d’une toute-puissance du premier (misérabilisme).
Critiques traditionnelles : Adorno et Horkheimer, Chomsky
Une tradition a marqué l’approche philosophique et sociologique des médias : la Théorie Critique de l’École de Francfort. Theodor Adorno et Max Horkheimer ont ainsi ouvert la voie à l’analyse des « industries culturelles » dans leur livre La dialectique de la raison (1). Pour Adorno et Horkheimer (qui, de leur exil américain, analysaient les magazines, le cinéma et la radio), l’industrialisation et la marchandisation de la culture, dans une logique de production capitaliste pour le profit, conduit à une standardisation et à une soumission plus grande aux stéréotypes sociaux dominants, du côté des émetteurs et des produits diffusés, et à un abêtissement généralisé, du côté des récepteurs. La double standardisation et stéréotypisation des messages induirait donc mécaniquement une « aliénation » des consommateurs, avec une tendance à l’atrophie de leur imagination. Les deux philosophes ont ainsi anticipé de manière pénétrante une évolution capitaliste qui s’est, depuis, accentuée.
Leurs réflexions ont toutefois quelques limites par rapport à l’état actuel des sciences sociales. Tout d’abord, ils ne laissent aucun espace pour des décalages critiques au sein des industries culturelles. D’autre part, le poids déterminant de l’économique donne peu de place à d’autres logiques sociales. Enfin, les comportements des récepteurs des produits culturels sont ignorés, puisque considérés a priori comme passifs. On perçoit ici un certain mépris misérabiliste dans le rapport aux publics populaires, supposés porteurs d’adhésion quasi animale aux logiques culturelles dominantes, sans possibilité d’autonomie critique, dont les sociologues Claude Grignon et Jean-Claude Passeron ont pointé la récurrence chez les intellectuels (2).
Moins affinées théoriquement que celles de l’École de Francfort, les analyses du linguiste Noam Chomsky ont eu un impact sur les mouvements sociaux alternatifs contemporains. Chomsky est une des figures les plus honorables et les plus courageuses de l’intellectuel critique au cœur de l’Empire états-unien. Un de ses livres importants sur les médias est La fabrique de l’opinion publique américaine. La politique économique des médias américains (Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass-Media), écrit avec l’économiste Edward S. Herman (3). Les auteurs y dessinent un « modèle de propagande », selon lequel les « grands médias américains » se livreraient « à une propagande qui sert les intérêts des puissantes firmes qui les contrôlent en les finançant » (p.XI). L’analyse rend bien compte du mouvement de concentration économique en cours dans le secteur des moyens de communication. Elle tend cependant à unifier la réalité autour d’un double schéma économiste (les contraintes économiques imposant directement leur loi aux pratiques journalistiques) et conspirationniste (la logique prédominante d’un « complot » mené dans l’ombre par quelques puissants). Ce deuxième schéma apparaît comme la trame narrative principale du livre. C’est, par exemple, le cas dans une phrase comme : « les maîtres qui contrôlent les médias ont choisi de ne pas diffuser un tel contenu » (p.XIX). Toute une série de travaux en sciences sociales nous éloignent aujourd’hui de telles simplifications. Car, chez Chomsky, les intentions conscientes de quelques élites semblent modeler la réalité sociohistorique, en sous-estimant les structures sociales, les dynamiques historiques et les logiques contradictoires qui pèsent sur ces intentions individuelles (4).
Une critique renouvelée : Bourdieu
La société est constituée chez Pierre Bourdieu par une variété de champs sociaux autonomes : champ économique, mais aussi champ politique, champ journalistique, champ intellectuel, etc. Un champ, c’est une sphère de la vie sociale qui s’est progressivement autonomisée à travers l’histoire autour de relations sociales, d’enjeux, de ressources, de rythmes temporels et de rapports de domination propres, différents de ceux des autres champs. On n’a pas chez Bourdieu une représentation unidimensionnelle de l’espace social - comme tendanciellement chez nombre de marxistes, autour d’une « infrastructure » (économique déterminante) et d’une « superstructure » (idéologique, politique et juridique déterminée). Mais on a plutôt une représentation pluridimensionnelle, tissée d’une variété de modes de domination (n’étant pas tous du même poids dans le cours du monde, mais chacun disposant d’une certaine autonomie). La radicalité de la sociologie post-marxiste esquissée par Bourdieu vise la pluralité des racines emmêlées de l’oppression.
Le champ journalistique se présente comme un de ces champs autonomes, voyant courir les journalistes autour d’enjeux particuliers (comme les scoops). Les effets du champ économique sur le champ journalistique ne sont pas directs, mais passent par la médiation de la logique autonome du champ journalistique : « la concurrence pour la clientèle tend à prendre la forme d’une concurrence pour la priorité, c’est-à-dire pour les nouvelles les plus nouvelles (le scoop) (…) La contrainte du marché ne s’exerce que par l’intermédiaire de l’effet de champ » (5). Par exemple, la compétition pour le scoop peut conduire à enquêter sur un scandale financier, malgré le poids économique des propriétaires des grands médias.
Entrent aussi en ligne de compte les dispositions des journalistes (leurs habitus selon Bourdieu), c’est-à-dire leurs façons de penser et d’agir inconsciemment intériorisées au cours de leur socialisation. Par exemple, le traitement plutôt négatif des émeutes des banlieues en décembre 2005 en France par les médias et leur traitement plutôt positif des mobilisations étudiantes contre le Contrat première embauche (CPE) du printemps 2006 a moins à voir avec « la pensée unique » néolibérale (demeurée stable parmi les élites) qu’avec la moindre et la plus grande proximité des dispositions des journalistes avec celles des milieux sociaux concernés. Il faut relever ici une confusion courante dans le sens donné au mot « connivences » fort usité dans les critiques des médias : dans les critiques du type de celle de Serge Halimi (6), il a plutôt un sens conspirationniste, synonyme de « copinage », alors que dans la sociologie de Bourdieu il a surtout un sens structurel : les évidences inconsciemment partagés au croisement du fonctionnement du champ journalistique et des dispositions sociales intériorisées par les journalistes.
Prendre en compte la réception
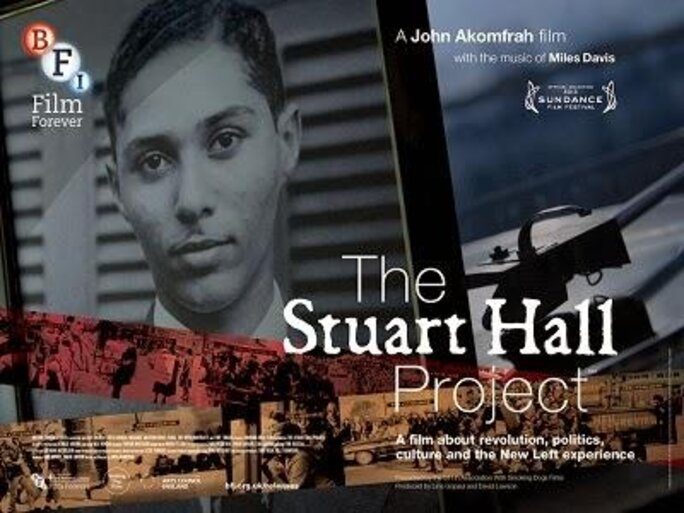
Les études de réception de la télévision ont été systématisées à partir du début des années 1980, sous l’impulsion des cultural studies britanniques. Les téléspectateurs révélés par ces études de réception tendent à filtrer les messages qu’ils reçoivent (en fonction de leur groupe social d’appartenance, de leur genre, de leur génération, de diverses dimensions de leur parcours de vie, etc.) et manifestent des capacités critiques variables (mais rarement complètement nulles). La « propagande » n’aurait ainsi pas d’effets nécessaires et univoques.
Un des auteurs les plus intéressants est le « néomarxiste » anglais Stuart Hall (7). Il met au moins deux choses en évidence : 1) dans la cadre de la logique capitaliste, il y aurait du jeu dans la production des messages, laissant place à des espaces critiques, à cause d’une relative autonomie professionnelle des producteurs ; et 2) le « codage » du message dans la logique des stéréotypes dominants laisse ouvert des écarts avec le « décodage » mis en œuvre par les téléspectateurs. J’ai ainsi pu montrer, à partir d’une enquête sur la réception de la série télévisée américaine Ally McBeal, qu’un tel produit de « l’industrie culturelle » pouvait laisser place, à côté de stéréotypes dominants, à des significations critiques, devenant alors un support pour les imaginaires utopiques des téléspectatrices, en rupture avec les valeurs marchandes dominantes (8).
Les complications d’une nouvelle critique des médias ne réduisent pas sa radicalité, bien au contraire. Nous devenons ainsi plus conscients de la pluralité des rapports de domination qui travaillent nos sociétés, et plus attentifs, dans une perspective émancipatrice, aux contradictions des ordres dominants comme aux potentialités imaginaires des citoyens.
Notes :
(1) Max Horkheimer et Theodor Adorno, La dialectique de la raison (1e éd. : 1944), trad. franç., Paris, Gallimard, collection TEL, 1974.
(2) Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Gallimard/Seuil, collection Hautes Études, 1989.
(3) Noam Chomsky et Edward S. Herman, La fabrique de l’opinion publique américaine. La politique économique des médias américains (1e éd. : 1988), trad. franç., Paris, Le Serpent à plumes, 2003.
(4) Voir la controverse sur Noam Chomsky et les médias dans la revue ContreTemps, n° 17, septembre 2006 opposant Philippe Corcuff et Gilbert Achcar ; sur internet : Philippe Corcuff, https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/120609/chomsky-et-le-complot-mediatique-des-simplifications-actuelles-de-la-critique-sociale , et Gilbert Achcar, http://www.acrimed.org/Corcuff-et-la-theorie-du-complot .
(5) Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1996, p. 85.
(6) Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1997.
(7) Voir en français Stuart Hall, « Codage/décodage » (manuscrit initial de 1973), revue Réseaux (CNET), n° 68, novembre-décembre 1994 ; sur internet : http://enssibal.enssib.fr/autres-sites/reseaux-cnet/ .
(8) Voir Philippe Corcuff, « De l’imaginaire utopique dans les cultures ordinaires. Pistes à partir d’une enquête sur la série télévisée Ally McBeal », dans L’ordinaire et le politique, sous la direction de Claude Gautier et de Sandra Laugier, Paris, PUF, collection CURAPP, 2006.
2 – Compte-rendu de Du côté du public. Usages et réception de la télévision de Brigitte Le Grignou (Paris, Editions Economica, 2003)
- Paru initialement dans la revue québécoise de gauche Á Bâbord !, n° 18, février-mars 2007, http://www.ababord.org/spip.php?article265 -
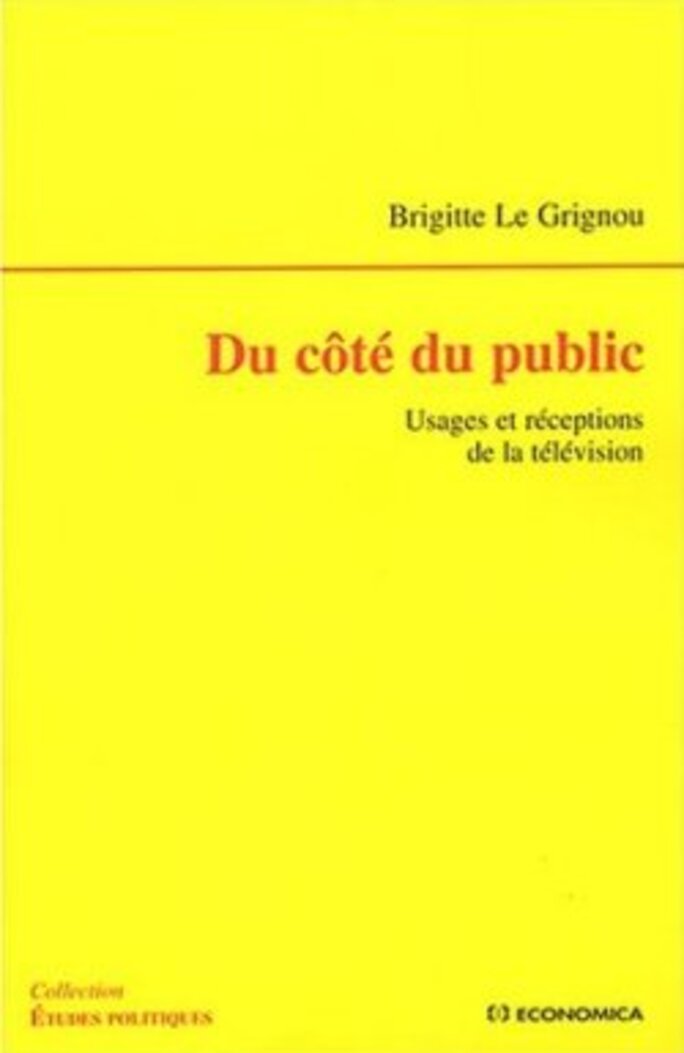
Et si la télévision n’aliénait pas ses téléspectateurs de manière aussi univoque que ne le croit la critique classique ? Cette interrogation traverse le livre de Brigitte Le Grignou, professeure de science politique à l’Université Paris-Dauphine largement nourrie des apports de la sociologie de Pierre Bourdieu. Elle y présente une synthèse de ce qu’on appelle « les études de réception » (comment les téléspectateurs regardent des séries américaines comme Dallas ou Urgences, des séries françaises comme Hélène et les garçons, ou encore les informations télévisées ?) aux Etats-Unis et en Europe. On y découvre, à travers des enquêtes sociologiques et ethnographiques concrètes, des téléspectateurs divers, qui filtrent les messages qu’ils reçoivent en fonction de leurs caractéristiques sociales (de classe, de genre, de génération, etc.), ou qui manifestent un rapport intermittent à des images qui ont rarement l’emprise qu’on leur prête souvent. Or les critiques des médias avaient fréquemment oublié les récepteurs dans des analyses centrées sur les émetteurs des messages.
Le point de vue de Le Grignou demeure toutefois critique, car il ne s’agit pas de tomber dans une nouvelle illusion, diffusée par les publicitaires et autres néolibéraux, selon laquelle on aurait affaire à des « consommateurs libres » sur un « marché libre » de « produits médiatiques ». Les relations à la télévision restent marquées par une pluralité de dominations (économique, culturelle, politique, etc.), mais les dominé-e-s disposent d’autonomies variables, ne sont jamais sans voix. Sa sociologie apparaît donc tout à la fois compréhensive etcritique.
3 – Compte-rendu de Médias et classes populaires. Les usages ordinaires des informations de Vincent Goulet (Paris, INA Éditions, 2010)
- Paru initialement dans Tout est à nous ! (hebdomadaire du NPA), n° 91, 24 février 2011, http://www.npa2009.org/content/essai-m%C3%A9dias-et-classes-populaires-les-usages-ordinaires-des-informations-de-vincent-goulet -
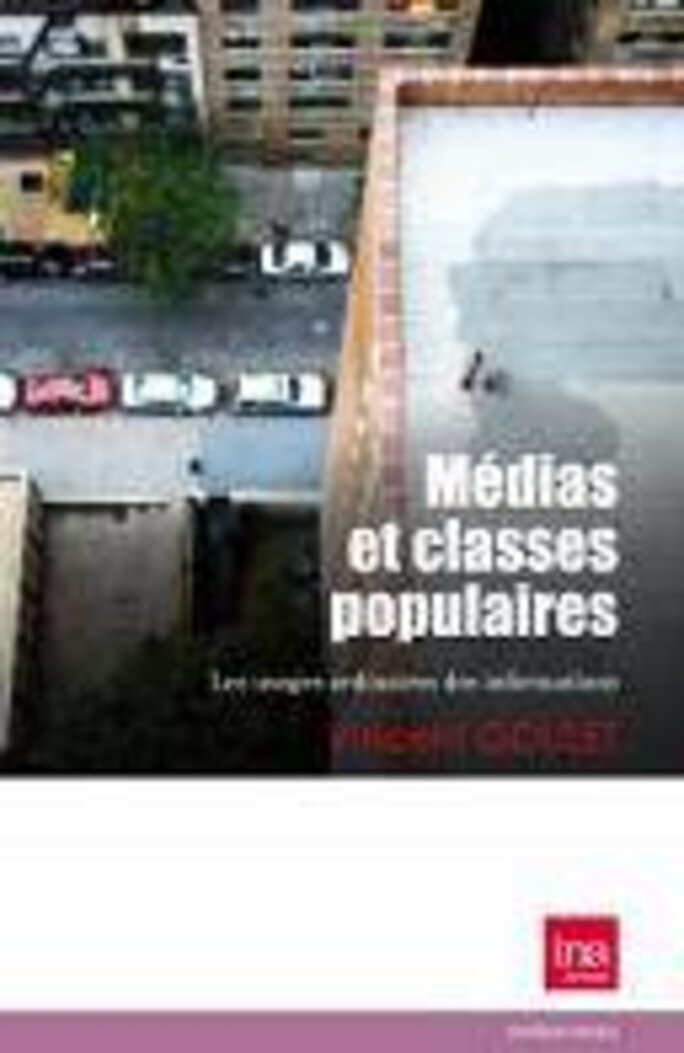
Enseignant-chercheur à l’Université de Nancy 2 (1), Vincent Goulet (2) bouscule opportunément certaines visions manichéennes des médias en vogue dans les milieux critiques comme dans les couches moyennes du salariat : une vision misérabiliste et méprisante de publics populaires supposés complètement « aliénés » et « abrutis » par « la propagande dominante ». Pour Goulet, s’adossant largement à la sociologie critique de Pierre Bourdieu, on ne peut se contenter d’envisager le contenu des messages médiatiques sans prendre en compte la variété des filtres du côté de leurs récepteurs, dotés d’expériences sociales spécifiques (de classe, de genre, etc.).
Pour ce faire, il se nourrit principalement d’une enquête menée entre 2005 et 2008 dans un quartier HLM de la banlieue bordelaise dans lequel il a vécu. Une originalité de cette démarche parmi les études de réception, qui ont beaucoup exploré les séries télévisées, consiste à prendre pour objet les informations et leurs usages populaires dans la vie quotidienne. Ce qui le conduit à mettre en cause, preuves empiriques à l’appui, « le présupposé selon lequel les médias ont une plus grande influence sur les personnes les moins pourvues culturellement ». Loin de nier l’existence de rapports de classe sur le plan culturel, il rompt toutefois avec les caricatures élitistes des milieux populaires, en notant les ambivalences des réalités observables pratiquement : tout à la fois « un sentiment de dépossession culturelle » et « une certaine dose d’inventivité, de fantaisie ».
Ses observations débouchent sur des pistes quant à de possibles médias « populaires et engagés » : « prendre plus au sérieux les faits divers, le sport, les potins pour ce qu’ils recèlent d’une forme de conscience politique pour les articuler de façon plus souple avec les discours programmatiques et le jeu politique ». Stimulant !
Notes :
(1) Il a démissionné de son poste de Maître de conférences de sociologie en avril 2014, voir ses raisons dans : https://blogs.mediapart.fr/vincent-goulet/blog/021014/pourquoi-j-ai-demissionne-de-l-universite-de-lorraine .
(2) Vincent Goulet tient un blog intermittent sur Mediapart : https://blogs.mediapart.fr/vincent-goulet/blog .
Pour prolonger :
* « L’individu est-il soluble dans le marché ? De Marx à Ally McBeal », site La Brèche numérique, 9 juin 2007, http://www.preavis.org/breche-numerique/article354.html
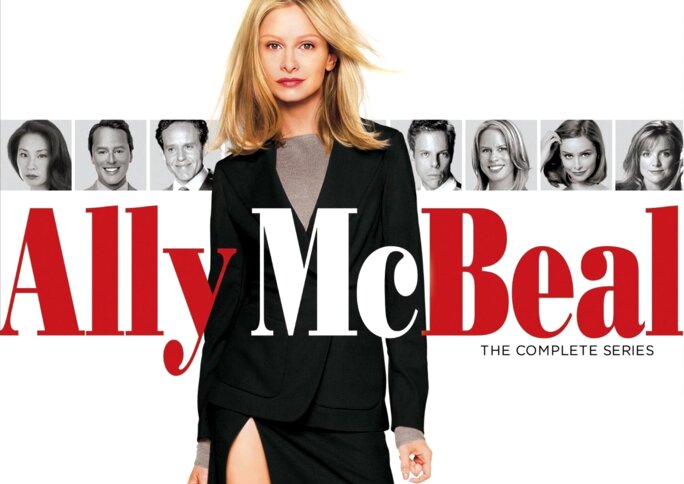
Agrandissement : Illustration 5