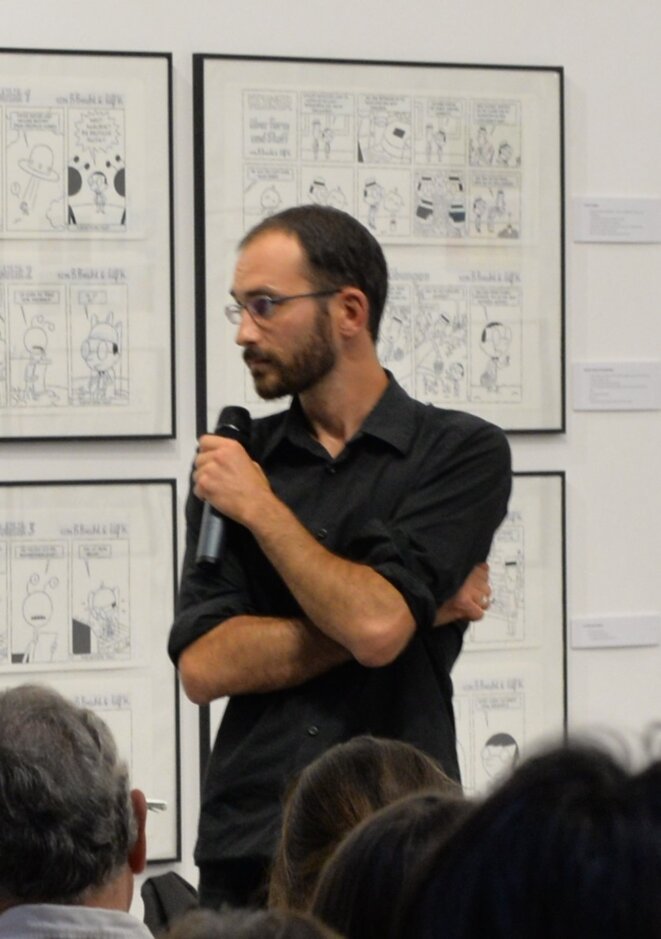Pour découvrir mes autres publications (livre, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
La France en 2027. En cette année d’élections législatives et présidentielles, les partis mènent campagne. A gauche, on se félicite des avancées réalisées ces cinq dernières années en faveur du climat et on promet de maintenir le cap pour atteindre, enfin, les objectifs fixés il y a bien longtemps par la COP 21. A droite, on veut marquer une pause dans la réduction des consommations d’énergie, mais sans pour autant remettre en question les évolutions déjà obtenues. La sobriété est devenue, à la suite de l’invasion de l’Ukraine, un sujet qui fait consensus.
Est-ce se bercer d’illusions, que de croire en la possibilité de ce scénario ? Si nul n’est capable de prévoir l’avenir, on peut cependant imaginer plusieurs futurs possibles. Voici une alternative moins réjouissante : en 2027, notre consommation d’énergie n’a pas diminué. Pour tenir dans le bras de fer avec Vladimir Poutine, la France n’a pas fait l’effort de réduire sa consommation d’énergie – elle a simplement changé de fournisseur. Les contrats passés avec des régimes autoritaires nous incitent à continuer de fermer les yeux sur les crimes commis par les pires dictateurs, tandis que le changement climatique se poursuit à grande vitesse, sans que notre pays puisse prétendre avoir pris ses responsabilités face à l’enjeu du siècle.
Revenons maintenant à l’époque présente : alors que la Russie réduit peu à peu ses livraisons de gaz à l’Europe, prenant l’initiative de l’affrontement et espérant ainsi déstabiliser nos régimes qu’elle juge si fragiles, le thème de la sobriété énergétique prend une place de plus en plus importante dans le débat public. Sa manifestation la plus frappante a certainement été, fin juin, la tribune en faveur de la « chasse au gaspillage » publiée par les patrons de Total, Engie et EDF. A quel point la situation peut-elle être critique, pour qu’un P-DG de groupe pétrolier appelle ses concitoyens à moins consommer le produit qu’il leur vend ?
Pourtant profondément enfoncé dans l’idéologie du productivisme, même le parti présidentiel semble parcouru par un récent sursaut de lucidité. C’est ainsi qu’en début d’année, on a enfin entendu Emmanuel Macron prononcer le mot de « sobriété », et que le gouvernement a annoncé l’élaboration d’un plan visant à réduire la consommation énergétique de la France dans les années qui viennent.
L’enthousiasme n’est cependant pas de mise : pour autant que l’on sache, les mesures envisagées semblent loin du compte. Si on ne peut qu’approuver les décisions consistant à interdire les gaspillages les plus évidents (portes ouvertes dans les magasins climatisés, publicités lumineuses allumées la nuit, etc.) ainsi que la consigne donnée aux administrations d’économiser l’énergie (modérer l’usage du chauffage et de la climatisation, notamment), l’accumulation de ces « petits gestes » ne suffira pas à relever le défi qui se dresse devant nous.
Pour s’en rendre compte, il suffit d’énumérer les mesures qui ne paraissent même pas envisageables du côté de l’exécutif, mais qui seraient pourtant nécessaires pour faire de la transition écologique une réalité. D’abord, à très court terme, l’abaissement de la vitesse maximale à 110 km/h sur les autoroutes permettrait de réduire la consommation des voitures de presque 2 L aux 100 km. Ensuite, accroître fortement la taxation des billets d’avion inciterait les vacanciers à voyager moins loin, et à se tourner vers des modes de transport moins polluants.
A moyen terme, l’interdiction de la publicité en faveur de l’avion et des véhicules polluants (concernés par le malus écologique) permettrait encore de réduire notre consommation. De grandes quantités d’émissions de carbone pourraient également être évitées en réduisant notre consommation de viande [1]. Enfin, la mesure-phare que représente la tarification progressive de l’énergie [2] nous permettrait d’entrer véritablement dans l’ère de la sobriété.
De telles réformes impliqueraient de rompre avec la logique du « toujours plus » (de consommation et de production) qui a prévalu jusqu’à présent parmi nos gouvernants. Leur aversion idéologique vis-à-vis de la modération matérielle [3] explique sans doute pourquoi ils s’égarent par moments dans une confusion entre les notions de « sobriété » et « d’efficacité » énergétiques.
Ainsi l’entourage de la ministre de la transition énergétique peut énoncer des contre-sens comme « La sobriété, ce n’est pas la décroissance, il s’agit d’être plus performant »… révélant ainsi une méconnaissance criante des concepts fondamentaux de la transition. N’en déplaise aux conseillers de Mme Pannier-Runacher, la sobriété implique effectivement une décroissance de la consommation et des usages de l’énergie. C’est sa définition même. De l’autre côté, l’amélioration de la performance correspond à la notion d’efficacité énergétique, depuis longtemps promue par les partisans de la transition.
La transition écologique ne peut être réussie que si elle repose sur trois piliers : les énergies renouvelables, l’efficacité et la sobriété. En amalgamant les concepts, il est à craindre que le gouvernement minimise l’ambition qu’il devrait porter, et que les discours de façade sur l’impératif de préserver le climat se traduisent, comme d’habitude, par des réformes dramatiquement insuffisantes.
En ce sens, on observe déjà des signaux très préoccupants : peu enclins à s’engager pleinement dans la maîtrise de leurs consommations d’énergie, les Etats occidentaux semblent porter l’essentiel de leurs efforts sur la diversification des sources d’approvisionnement. L’Union Européenne a récemment annoncé un doublement de ses importations de gaz en provenance d’Azerbaïdjan (qui a commis de nombreux crimes de guerre contre l’Arménie, et menace toujours la sécurité du pays). En France, le gouvernement envisage de relancer une centrale à charbon, tandis qu’Emmanuel Macron opère un rapprochement avec ce géant pétrolier qu’est l’Arabie Saoudite (qui bombarde délibérément des civils au Yémen).
Ce choix a deux conséquences. D’une part, en continuant de s’allier avec des régimes autoritaires et belliqueux, l’occident dilapide le peu de crédibilité qu’il avait gagné à s’élever comme un seul homme contre l’invasion de l’Ukraine. Comment faire croire que les dirigeants occidentaux ont à cœur de défendre la paix et la liberté, quand ils déroulent le tapis rouge à tous les dictateurs dont le nom n’est pas Vladimir Poutine ?
Cette indignation à deux vitesses ne trompe pas les autres habitants de la planète, et il est regrettable que les efforts que nous consentons pour soutenir les Ukrainiens soient salis par l’indifférence de nos gouvernants à l’égard de tous les autres peuples qui souffrent. D’autre part, la quête de nouvelles sources d’approvisionnement en énergies fossiles n’est pas cohérent avec l’impératif de sobriété, seule voie qui nous permettrait de cesser de financer les bombes russes tout en préservant les conditions qui rendent notre planète vivable. [4]
Cela étant dit, on doit garder à l’esprit qu’une politique de sobriété ne peut réussir qu’à deux conditions. D’abord, l’effort national doit être justement réparti. De ce point de vue, la palme du cynisme revient au P-DG de Total, qui nous exhorte à éteindre les lumières… alors qu’il ne cesse d’engranger des bénéfices-record et qu’il a décidé de rester actif en Russie afin d’exploiter les hydrocarbures présents dans le cercle arctique. « Chaque geste compte », prend-t-il soin de préciser avec ses acolytes dans leur tribune publiée en juin. Merci pour la leçon.
En France, les 10 % les plus riches émettent à eux seuls 1,7 fois plus de gaz à effet de serre que tout le reste de la population. S’il est clair que la transition écologique nécessite l’implication de tous, on voit cependant mal comment les plus modestes pourraient accepter des contraintes supplémentaires si leurs concitoyens aisés continuent de rouler en 4 x 4 et de se rendre dans des îles exotiques pour parfaire leur bronzage. Un vrai gage de sincérité et de cohérence consisterait à prendre en premier les mesures qui impactent les plus aisés, et à ne mettre à contribution les plus vulnérables que lorsque chacun aura déjà fait sa part. [5]
La seconde condition a trait au coût politique de la sobriété. Si l’idée d’une modération matérielle fait progressivement son chemin dans les esprits, il ne faut pas oublier qu’elle « remet en cause un imaginaire de l’abondance qui imprègne profondément depuis trois siècles nos sociétés », comme le pointe le politiste Bruno Villalba. Des mesures comme la réduction de la vitesse sur les routes, la taxation des billets d’avion ou la tarification progressive de l’énergie susciteront forcément des mécontentements.
Si d’aventure le gouvernement venait à proposer un plan de sobriété énergétique qui soit à la fois ambitieux, juste et cohérent, il serait nécessaire de ne pas le laisser assumer seul le coût politique qui y serait associé. Les forces progressistes devraient alors peser de tout leur poids pour rendre ces mesures acceptables, et persuader nos concitoyens que l’effort qui leur est demandé va véritablement dans le sens de l’intérêt commun. Bien sûr, cette hypothèse n’est peut-être qu’une rêverie naïve. Mais l’histoire présente parfois des bifurcations inattendues, et nous serions sages de nous y préparer afin qu’elles ne viennent pas s’ajouter au registre des occasions manquées.
[1] Il n’est pas évident d’agir sur la composition de nos assiettes, mais la puissance publique dispose néanmoins de plusieurs leviers pour réduire significativement la consommation de viande. D’une part, il est possible d’appliquer une taxe spéciale sur les produits issus de l’élevage industriel (par exemple, 5 € par kilo) afin d’inciter les consommateurs à acheter des bons produits en moindre quantité (animaux élevés en plein air, voire issus de l’agriculture biologique). D’autre part, les cantines publiques (écoles, administrations et universités) devraient établir un jour par semaine où elles ne serviraient aucune viande, de manière à familiariser la population avec le fait qu’un bon repas peut aussi être entièrement végétal.
[2] Il s’agit de définir un volume d’énergie « de base », considéré comme nécessaire pour assurer les besoins de chaque ménage, et de mettre en place un tarif réduit pour les consommations qui se situent dans la limite de ce volume de base. Les consommations qui dépassent ce volume, quant à elles, sont considérées comme superflues (logement surchauffé, usage abusif de la climatisation, douches très chaudes et à rallonge, multiplication des points lumineux et des appareils électriques, acquisition d’appareils énergivores, et toutes sortes de gaspillages) et subissent une sur-tarification. On trouvera plus de développements dans cet article.
[3] On se souvient des propos outranciers d’Emmanuel Macron qui, il y a deux ans seulement, raillait les écologistes en les présentant comme des « amish », partisans du retour à la lampe à huile. On pourrait quand même s’étonner que, dans le courant politique porté par l’actuel président, l’idée d’une modération énergétique fasse ainsi figure de repoussoir… alors que la modération budgétaire, elle, est considérée comme la marque du sérieux et de la raison (même quand elle implique de réduire encore les moyens alloués aux services publics, déjà bien mal en point).
[4] On doit rappeler que, à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, les Japonais avaient réussi à réduire de 15 % leur consommation d’électricité en modifiant leurs habitudes. Il se trouve que, dans ses travaux de prospective, l’association négaWatt estime que les efforts de sobriété permettraient également de réduire de 15 % notre consommation totale d’énergie.
[5] Plus généralement, les mesures en faveur de l’environnement ont une tendance intrinsèque à impacter les catégories modestes, et cette tendance doit être compensée par une politique ambitieuse de redistribution des richesses. Pour plus de développements, voir ici et ici.