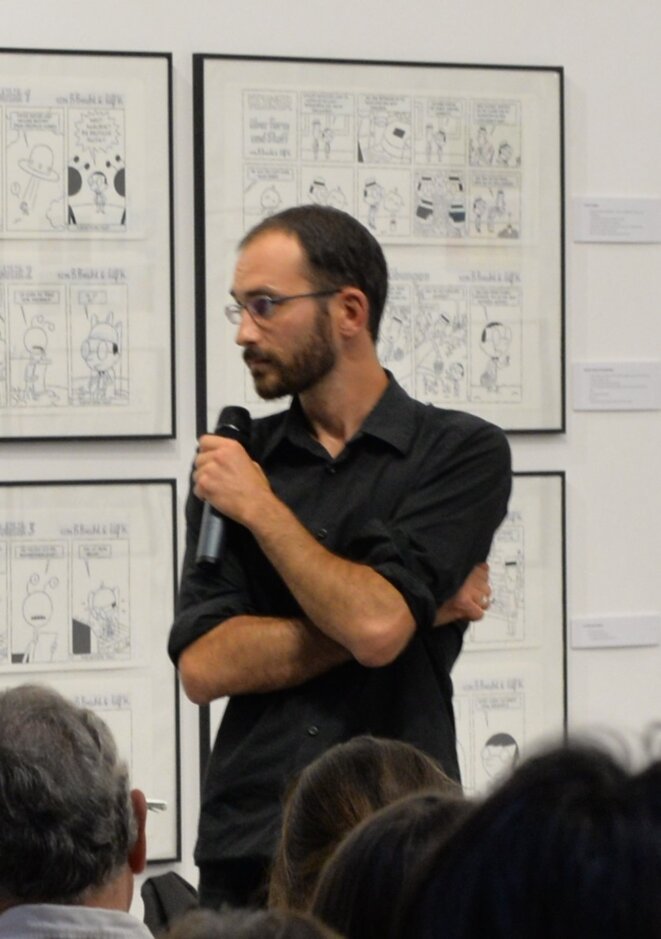Pour découvrir mes autres publications (livres, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
La démocratie est un régime politique bien particulier. A vrai dire, pendant plus de deux mille ans, le terme « démocratie » a revêtu un sens très négatif, et aucun acteur politique ne s’en est fait le champion [Dupuis-Déri, 1999]. Cet état de fait était toujours d’actualité à la fin de 18ème siècle, lors des révolutions française et américaine : les révolutionnaires, dans leur grande majorité, considéraient alors la démocratie comme un repoussoir.
En France, pendant les premières années qui suivent la prise de la Bastille, le mot « démocratie » n’est même pas prononcé une seule fois dans les débats parlementaires sur le droit de suffrage. La situation n’est pas différente aux Etats-Unis, où le terme « démocrate » est quasiment une insulte au début du 19ème siècle. [Rosanvallon, 2007]
En quoi consiste-t-il, ce régime politique tellement détesté ? Certes, il n’existe pas un modèle unique qui incarne parfaitement l’idéal de la démocratie, mais ses principes peuvent néanmoins être énoncés de manière relativement claire : la démocratie est une forme de gouvernement où le peuple a toute l’autorité. En démocratie, le peuple se gouverne lui-même.
Et c’est là un premier problème. Comment le peuple pourrait-il se gouverner lui-même ? Il lui faudrait être assemblé en permanence pour traiter des affaires publiques, ce qui est bien évidemment impossible dans une nation qui comprend des dizaines de millions d’habitants. De plus, si les citoyens passaient tout leur temps à légiférer, plus personne ne pourrait se consacrer à des activités productives (faire pousser le blé, construire des maisons, soigner les malades, éduquer les enfants, etc.) et on peut facilement imaginer ce qu’il adviendrait. [1]
Le règne de la populace
Au-delà de ces considérations pratiques, les adversaires de la démocratie ont toujours estimé que le peuple n’est pas apte à se gouverner lui-même. C’est ce qu’expliquait Brissot, meneur des Girondins au cours de la Révolution : « le peuple seul a le droit de se constituer, mais il n’en a pas le talent ; il doit donc confier une partie de son droit à ceux qui en ont le talent » [cité par Dupuis-Déri, 1999]. Vue par des notables instruits et éclairés, la perspective de la démocratie a de quoi terrifier : le gouvernement des hommes par eux-mêmes ne peut que virer au règne de la populace.
Cette aversion pour la démocratie repose sur une représentation très négative du peuple. Celui-ci est perçu comme manipulable, impulsif et irrationnel. Les gens du commun n’étant motivés que par leur intérêt personnel et immédiat, ils ne sauraient faire preuve du discernement et de la hauteur de vue qu’exige l’exercice du pouvoir. La démocratie c’est le chaos, l’anarchie, la tyrannie de la multitude et des masses ignares.
Si le peuple est dépourvu de la capacité à se gouverner, quelle solution nous reste-t-il ? La féodalité et la monarchie ayant été abolies, le pouvoir politique ne peut plus tirer sa légitimité de Dieu ou de la force des armes. C’est alors qu’apparaît la figure de l’élite gouvernante choisie par le peuple, chargée à la fois de le représenter et de le guider. Cette « aristocratie naturelle » [2], élue en raison de ses talents et de ses vertus, contraste avec la vieille aristocratie héréditaire dont la légitimité ne reposait que sur la naissance.
L’élite éclairée vient au secours du peuple
Victor de Broglie, chef du gouvernement français dans les années 1830, exposait à ses contemporains l’intérêt de ce système : « Le propre du gouvernement représentatif est d’extraire du milieu de la nation l’élite de ses hommes les plus éclairés, de les réunir au sommet de l’édifice social, dans une enceinte sacrée, inaccessible aux passions de la multitude, et de là, de les faire délibérer à haute voix sur les intérêts de l’Etat. » [cité par Rosanvallon, 1998, p.53]. [3]
Pour les adversaires de la démocratie [4], si le peuple ne mérite guère d’estime, ses représentants cumulent au contraire toutes les qualités : sages, éclairés, raisonnables et vertueux. Une coupure radicale est faite ici entre la volonté générale (ce que le peuple veut) et l’intérêt général (ce qui est bon pour lui). Les représentants sont choisis par le peuple en raison de leur capacité supérieure à connaître l’intérêt général.
La détermination du sens de l’action publique est alors réduite à un choix technique, « objectif », dénué de dimension politique. A partir du moment où la compétence et l’intégrité suffisent à gouverner, le peuple n’a plus à se prononcer sur des arbitrages ou sur des valeurs. Qu’est-ce qui est important ? Qu’est-ce qu’une bonne société ? Comment prioriser les différents objectifs que nous poursuivons ? Dans une aristocratie élective, les représentants traitent ces questions entre eux, sans prendre la peine de les soumettre au peuple.
Immédiateté et passions funestes
Si la démocratie directe intégrale est impossible à mettre à pratique, on pourrait cependant opter pour un régime mixte où la plupart des décisions sont prises par les représentants, tandis que le peuple se prononce directement sur les choix qui lui importent le plus. C’est l’apport d’un dispositif comme le référendum d’initiative citoyenne (RIC) : si un suffisamment grand nombre de citoyens manifeste son intérêt pour une question, on considère que celle-ci mérite de faire l’objet d’un référendum. [5]
Or c’est justement la perspective du référendum, et plus particulièrement quand il vient d’en bas, qui effraie les adversaires de la démocratie [6]. Stanislas Guerini, alors délégué général du parti présidentiel, expliquait en 2018 le danger que représente le RIC : « Je ne veux pas que demain on puisse se réveiller avec la peine de mort dans notre pays parce qu'on aura eu un référendum d'initiative citoyenne, parce que Laurent Wauquiez se sera réveillé un jour en disant ‘‘tiens, si on faisait la castration chimique pour les délinquants sexuels’’ badaboum, le lendemain on a un référendum et c'est effectif dans notre pays. Moi je crois aussi à la démocratie représentative. »
L’expression directe de la volonté du peuple, ici, est considérée comme le règne de l’immédiateté et des passions funestes. Le peuple décide sans réfléchir (« on se réveille (…) badaboum »), et éprouve un penchant pour la cruauté (peine de mort, castration chimique). Le contraste est fort, entre l’imaginaire antidémocratique du chef des macronistes, et les thèmes sur lesquels portent réellement les projets de référendums « venus d’en bas » : accès aux soins de santé, refus des privatisations, taxe sur les superprofits, âge de départ à la retraite, etc.
Noir c’est blanc, blanc c’est noir
Pour s’opposer à la démocratie sans encourir les foudres de l’électorat, il est bon de recourir à ces deux astuces : d’abord, présenter sa propre position comme résultant d’un compromis raisonnable entre plusieurs modes de fonctionnement (« je crois aussi à la démocratie représentative ») alors qu’on est, au contraire, en train de défendre le monopole absolu des élus sur le vote des lois.
Ensuite, il importe d’utiliser le terme « démocratie » pour promouvoir des idées qui sont, justement, antidémocratiques. C’est ce que fait Emmanuel Macron quand il s’oppose, lui aussi, au référendum d’initiative citoyenne « qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire (…) vos représentants, ça sert plus à rien, on tue la démocratie représentative. »
L’utilité des représentants est donc bien fragile : il suffit de recourir parfois au référendum afin de régler certaines questions, pour que déjà ils « ne servent plus à rien » [7]. Dans ces propos, M. Macron se pose en défenseur de la « démocratie parlementaire » tout en expliquant que la voix du parlement compte plus que celle du peuple.
Qu’est-ce là, sinon une posture authentiquement antidémocratique ? La confusion vient donc du fait que les adversaires de la démocratie ont depuis longtemps appris à utiliser ce terme pour dire l’inverse de ce qu’il signifie. Il devient ainsi possible d’écarter la possibilité d’un référendum… au nom même de la démocratie.
Plutôt que d’assumer ouvertement leurs représentations négatives du peuple, et d’expliquer en quoi ils estiment que celui-ci ne devrait pas prendre ses propres décisions, nos gouvernants inversent le sens des mots. Déjà, en 1840, un journal états-unien notait que les politiciens conservateurs « prétendent être démocrates seulement parce qu’ils savent que le peuple est si attaché à ce mot qu’il ne votera pas pour un parti qui ne le porte pas » [cité par Dupuis-Déri, 1999].
Or, au-delà de la diversité des systèmes possibles, il devrait quand même être possible de s’accorder sur une définition minimale de la démocratie : c’est un régime dans lequel, quand une décision doit être prise, c’est le peuple qui a le dernier mot. Si tel n’est pas le cas, alors il ne s’agit pas d’une démocratie – c’est un autre type de régime, pour lequel il faut un autre nom.
République aristocratique
Le terme de « république », en France, est généralement employé comme un synonyme de « démocratie ». Or, c’est un abus de langage : historiquement, le régime républicain a été abondamment opposé à l’idée de démocratie [8]. Au-delà de cet antagonisme ancien, on doit admettre qu’il est difficile d’établir une définition positive de la république : celle-ci se définit surtout par opposition avec la monarchie (pouvoir héréditaire) ou le despotisme (pouvoir d’un seul).
Au moyen-âge et à la Renaissance, les républiques des cités libres comme Gênes ou Venise n’étaient certainement pas des démocraties : il s’agissait d’oligarchies où le pouvoir était partagé entre les familles de la classe supérieure. Les monarchies actuelles d’Europe du Nord, au contraire, sont généralement considérées comme des démocraties. Il ne suffit donc pas de renverser le roi et d’organiser des élections régulières, pour pouvoir considérer que nous vivons dans une démocratie.
Michel Debré avait bien présenté à quoi ressemble la vie dans une république aristocratique, où le peuple est subordonné à ses représentants : « Le propre de l'individu est de vivre d'abord sa vie quotidienne ; ses soucis et ceux de sa famille l'absorbent. Le nombre de citoyens qui suivent les affaires publiques avec le désir d'y prendre part est limité : il est heureux qu'il en soit ainsi. La cité, la nation où chaque jour un grand nombre de citoyens discuteraient de politique serait proche de la ruine.
La démocratie, ce n'est pas l'affectation permanente des passions ni des sentiments populaires à la discussion des problèmes d’État. Le simple citoyen qui est un vrai démocrate se fait, en silence, un jugement sur le gouvernement de son pays, et lorsqu'il est consulté à dates régulières, pour l'élection d'un député, exprime son accord ou son désaccord. Après quoi, comme il est normal et sain, il retourne à ses préoccupations personnelles. » [Michel Debré, Ces princes qui nous gouvernent, éditions Plon, 1957]
Comme tant d’autres, l’ancien premier ministre utilise le terme de « démocratie » pour décrire l’inverse de ce qu’il signifie, pour promouvoir un régime dans lequel le peuple est radicalement exclu de l'exercice du pouvoir. Dans un tel régime, la citoyenneté se réduit à l'acte de voter : ni débat public, ni mouvement associatif, ni mobilisation partisane ne viennent troubler le fonctionnement régulier des institutions chargées de la poursuite de l'intérêt général.
C’est qui le chef ?
Fort heureusement, la situation dans laquelle nous nous trouvons diffère largement de ce triste tableau. Les citoyens, contrairement aux vœux de Michel Debré, ne restent pas silencieux. Les nombreuses mobilisations collectives qui émaillent l’actualité nous indiquent que le peuple manifeste un vif intérêt pour les affaires publiques, et désire prendre part aux décisions qui le concernent. Cela signifie-t-il que nous vivons dans une démocratie ?
Cela n’est pas certain. Si la France garantit à ses citoyens des élections régulières ainsi que la liberté d’expression [9], on peut considérer qu’il ne s’agit cependant pas d’une démocratie. Tentons d’établir un critère objectif pour voir si le fonctionnement actuel de notre république correspond à ce que serait une authentique démocratie : quand un désaccord manifeste apparaît entre le peuple et ceux qui le gouvernent, qui a le dernier mot ?
Si dans un tel cas les gouvernants prennent soin de consulter directement le peuple, et respectent sa décision, alors le régime peut être qualifié de démocratie. Dans le cas contraire, il s’agira plutôt d’une « république aristocratique » ou d’une « aristocratie élective ». L’histoire récente de la France, il faut le reconnaître, correspond plutôt à la seconde option.
Que l’on s’intéresse simplement à la pratique du référendum descendant, sans même évoquer d’autres techniques de démocratie directe (comme le RIC ou les assemblées tirés au sort) : depuis bientôt vingt ans, aucun référendum national n’a eu lieu dans notre pays. Les résultats du dernier, qui portait en 2005 sur la constitution européenne, ont même été piétinés par un vote des élus seulement trois ans plus tard, lorsque le traité de Lisbonne a été adopté par voie parlementaire. Non seulement le peuple ne décide jamais rien, mais sa dernière décision en date n’a même pas été suivie d’effet.
Un peuple sous tutelle
Songeons aussi aux mouvements sociaux qui ont agité le pays ces dernières années, notamment en ce qui concerne les retraites. Il est vrai que trois millions de manifestants ne peuvent pas parler pour soixante-dix millions de citoyens. Mais devant des protestations d’une telle ampleur, il faudrait une mauvaise foi stupéfiante pour affirmer que le peuple approuve le projet porté par les élus. Dans le doute, pour s’assurer de la légitimité de la décision et pour mettre fin à la crise qui secoue le pays, il serait très simple de passer par un référendum.
Or, c’est sur des sujets comme celui-là que nos gouvernants assument le plus ouvertement leurs orientations antidémocratiques : le peuple, expliquent-ils, n’est pas capable de voir la pertinence de telles décisions, c’est pour cela qu’il ne les approuve pas. Les élus se présentent alors comme de courageux piliers de la raison, qui refusent de céder face aux masses aveugles. Emmanuel Macron est clair sur ce point :
« Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'expression citoyenne. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir sur tous les sujets, parce que parfois ça peut nourrir la démagogie. Je pense que quand il y a une décision difficile à prendre, ce sont souvent les représentants qui la prennent. (...) On prend rarement les décisions difficiles par un référendum. On peut prendre des décisions populaires, mais rarement difficiles. Or notre pays a aussi besoin de décisions difficiles. » [10]
Toujours prête à défendre le règne des élites, la presse antidémocratique enfonce le clou : « il y a peu de chances qu’une réforme pénible déclenche des manifestations de joie, affirme L’Express. A l’inverse, une réforme aussi néfaste que celle ramenant l’âge minimum de départ en retraite à 60 ans ne susciterait pas d’hostilité dans la rue. » Et le journaliste résume un mouvement massif de contestation qui mobilise des millions de personnes pendant plusieurs mois à « l’humeur du moment » – l’opposition du peuple, mineur sous tutelle, ne pouvant pas être traitée comme un authentique désaccord. Le peuple est fatigué, il est grognon, il est perdu, il se laisse emporter. Mais jamais sa volonté ne doit être écoutée respectueusement. [11]
Citoyens par intermittence
Quand les gouvernants outrepassent la volonté du peuple, celui-ci n’a le choix qu’entre trois options : soit se soumettre (« nous ne sommes pas d’accord, mais nous n’avons pas le pouvoir de nous y opposer ») ; soit recourir à la violence ; soit ronger son frein en attendant les prochaines élections – acceptant ainsi de n’avoir aucun contrôle sur les élus, en-dehors du jour de l’élection elle-même. Sous la république aristocratique, le citoyen abdique sa souveraineté dès le moment où il l’exerce.
Une telle « citoyenneté par intermittence » ne peut pas être satisfaisante. Pensons à un avocat qui a pour mission de vous représenter en justice. Vous sentiriez-vous correctement représenté si celui-ci pouvait vous imposer toutes ses décisions, et que vous ne disposiez que du pouvoir de le remplacer une fois tous les cinq ans ? Un régime dans lequel le peuple est subordonné à ses représentants ne peut pas être qualifié de démocratie.
----
Dans cet article, j’ai voulu souligner la différence qui existe entre deux types de régimes politiques : d’abord, un régime dans lequel le peuple est souverain – ce qui signifie qu’en cas de désaccord entre le peuple et ses représentants, c’est le peuple qui a le dernier mot. Ensuite, un régime dans lequel, lorsque le peuple n’est pas d’accord avec ses représentants, ce sont les représentants qui ont le dernier mot.
Ce second régime repose sur une forte défiance à l'égard du peuple, jugé incapable de prendre de bonnes décisions. Dans cette perspective, l’intérêt général commande d’aller à l’encontre de la volonté populaire. Ce régime n’est certes pas une dictature, puisque les représentants sont élus. Mais ce n’est pas non plus une démocratie.
D’autres termes sont à notre disposition pour le désigner : république aristocratique, aristocratie élective… qu’importe, du moment que les citoyens prennent conscience de la duperie à laquelle ils sont confrontés, quand des gouvernants se réclament de la « démocratie » pour piétiner la souveraineté du peuple.
Bibliographie :
L’esprit antidémocratique des fondateurs de la « démocratie » moderne, François Dupuis-Déri, 1999, en ligne ici
Le peuple introuvable, Pierre Rosanvallon, éditions Gallimard, 1998
L’universalisme démocratique : histoire et problèmes, Pierre Rosanvallon 2007, en ligne ici
[1] Une assemblée permanente du peuple serait certainement le meilleur moyen de connaître la volonté de celui-ci. Puisque cette option n’est pas praticable, les démocrates se retrouvent aux prises avec une épineuse question : comment faire parler le peuple ? En 1848, Pierre-Joseph Proudhon écrivait à ce sujet : « On suppose d’abord que le Peuple peut être consulté ; en second lieu qu’il peut répondre ; troisièmement que sa volonté peut être constatée de manière authentique : telle est la prétention de la démocratie. (…) Où et quand avez-vous entendu le Peuple ? Par quelle bouche, en quelle langue est-ce qu’il s’exprime ?
Vous devez expliquer tout cela, lance-t-il à ses amis révolutionnaires ; sinon votre respect pour la souveraineté du peuple n’est qu’un absurde fétichisme. Autant vaudrait adorer une pierre. » Dans un autre texte, il synthétise : « Interroger le peuple, c’est à nos yeux toute la science du gouvernement » Le problème est de savoir « qui a le droit de dire aux autres : c’est par moi que le Peuple parle ? ». Cité par Rosanvallon, 1998, p. 60.
[2] Ici, il faut comprendre « aristocratie » dans son sens étymologique, issu du grec ancien : « le gouvernement des meilleurs ». Si le langage courant assimile désormais le terme d’aristocratie au règne de la noblesse, un retour à l’origine du mot permet de nommer le type de régime dans lequel gouvernent ceux qui sont, à tort ou à raison, considérés comme les meilleurs.
[3] On peut s’inquiéter du glissement entre les intérêts du peuple et « les intérêts de l’Etat », qui pourraient ne pas toujours correspondre à ceux du peuple. Il en est de même pour « l’intérêt de la France », que les hommes de pouvoir brandissent à tout bout de champ : que pourrait bien être l’intérêt du pays, sinon l’intérêt de ceux qui y vivent ? La rhétorique de l’intérêt national permet pourtant à ceux qui emploient cette expression d’y mettre tout ce qui les arrange. Ainsi, pour certains, « l’intérêt de la France » sera que ses élites économiques fassent le plus de profit possible, même si cette richesse n’est pas partagée avec le reste de la population.
[4] A ce titre, on peut citer également Pierre-Louis Roederer, qui en 1801 explicitait ce que signifie la démocratie représentative : « La démocratie représentative est celle où une partie des citoyens, choisie par l’autre partie, fait les lois et les fait exécuter. Elle est démocratie en ce sens que les représentants sont choisis, sans condition de naissance, par tous les citoyens, sans distinction de naissance ; mais elle est démocratie représentative, et non plus démocratie pure, parce que ce n’est plus le gouvernement de la totalité des citoyens, mais seulement d’une partie des citoyens (…).
Voilà l’idée que nous avons trouvée dans le mot représentative associé au mot démocratie. Et que signifie maintenant le mot ‘‘élective’’ ajouté au mot ‘‘aristocratie’’ ? Il signifie que ce petit nombre de sages qui sont appelés à gouverner ne tiennent leurs droits que du choix, de la confiance de leurs concitoyens (…) Aristocratie élective, démocratie représentative sont donc une seule et même chose ». [Rosanvallon, 1998, p. 51]
[5] Un référendum peut porter sur quatre types de questions : le vote d’une loi (référendum législatif) ; l’abrogation d’une loi (référendum abrogatoire) ; une modification de la constitution (référendum constituant) ; ou encore la révocation d’un élu en cours de mandat, afin de déclencher de nouvelles élections (référendum révocatoire). L’usage du référendum apparaît comme un complément précieux du travail des représentants, ouvrant au peuple la possibilité d’exercer parfois directement sa souveraineté. Quatorze référendums nationaux ont été organisés entre 1945 et 2005, mais aucun n’a eu lieu depuis lors.
[6] S’il est difficile pour un politicien de s’opposer frontalement à l’idée du RIC, l’esprit antidémocratique a surtout pour effet de verrouiller les possibilités concrètes de mise en œuvre d’un tel référendum. Ainsi, l’organisation d’un référendum d’initiative partagé est soumise à des contraintes d’une telle lourdeur qu’on peut penser que ce dispositif constitue plus un leurre qu’une réelle avancée constitutionnelle. Instauré depuis 2015, le référendum d’initiative partagé n’a même pas été utilisé une fois.
On peut bien sûr craindre qu’un accès excessivement facile au référendum entraîne une multiplication des votes, qui lasserait les citoyens et désorganiserait la législation. Néanmoins ce risque semble aujourd’hui très lointain, quand on sait que l’organisation d’un RIP doit préalablement être approuvée par 10 % du corps électoral, soit plus de cinq millions de personnes. Nos voisins italiens, à titre de comparaison, peuvent organiser un référendum après avoir recueilli les signatures de seulement 1 % de l’ensemble des citoyens. Il ne serait donc pas déraisonnable que la France réduise ce taux à 6 ou 4 %, au moins dans un premier temps, de sorte que la possibilité de déclencher un référendum ne reste pas intégralement virtuelle.
[7] La remarque ne manque pas de sel, venant d’un homme qui a mené à la baguette ses députés « Playmobil » au cours de son premier mandat, et qui a ensuite employé tous les moyens à sa disposition pour museler le parlement sur son projet de réforme des retraites.
[8] Le flamboyant Sieyès, qui joua un rôle majeur dans le déclenchement de la Révolution, était vigoureusement opposé à la démocratie. Il s’exprimait ainsi en 1789 : « le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
[9] Bien que celle-ci apparaisse en recul, au vu de l’épisode des Gilets Jaunes et de la séquence actuelle. Les manifestations contre le recul de l’âge de la retraite se sont déroulées très pacifiquement, jusqu’à l’usage du 49-3 par le gouvernement. A partir de là, quand les premières dégradations ont été commises, la réponse de l’Etat a été un déchaînement de violence policière et de sévères atteintes au droit de manifester. Il y a matière à s’alarmer de la multiplication d’actions punitives menées par la police : multiplication des nasses et des gardes à vue immotivées, agressions contre des manifestants, etc. Autant d’interventions qui ne sont pas justifiées par un impératif de maintien de l’ordre, et qui semblent plutôt avoir pour but de dissuader les citoyens d’exercer leur droit de manifester.
Un pas supplémentaire a été franchi récemment par la préfecture de police de Paris, qui a édicté des interdictions de se rassembler sans en informer la population : de nombreuses personnes se retrouvent ainsi verbalisées pour une infraction qu’elles n’auraient pas pu éviter, puisque l’arrêté préfectoral qu’on leur reproche d’avoir enfreint n’avait été affiché que sur la porte de la préfecture. Il s’agit d’un procédé tout à fait pernicieux : par cette méthode, l’administration fait en sorte que les citoyens outrepassent le cadre légal (en dissimulant celui-ci) pour mieux les réprimer. A cela s’ajoute l’entrave aux soins d’urgence pour les protestataires blessés à Sainte-Soline. Le message semble clair : pour manifester aujourd’hui, il faut être prêt à en payer le prix.
[10] On appréciera la capacité de nos élites à prendre des décisions difficiles au regard de la manière dont elles traitent ce défi mondial de long terme qu’est le changement climatique. Depuis quarante ans, ces élites gouvernantes, si certaines de leur propre sagesse, n’ont cessé de remettre l’urgence à plus tard. Elles ont laissé le feu dévorer la maison. Au vu des sondages concernant certaines décisions écologiques supposées impopulaires, nos brillants élus apparaissent bien moins conscients des enjeux de long terme que ce peuple imbécile qu’ils regardent de haut.
[11] Ceux qui doutent de la capacité du peuple à exercer sa souveraineté, plutôt que de la lui confisquer, devraient surtout promouvoir l’éducation à la citoyenneté. C’est en développant, à l’école et ailleurs, les compétences nécessaires à la pratique de la démocratie, que les habitants de notre pays deviendront capables de prendre des décisions plus éclairées au sujet de leur avenir. L’apprentissage de la souveraineté constitue en quelque sorte une troisième voie, entre l’idéalisme démagogique et l’antidémocratisme élitiste : le peuple n’a pas toujours raison, mais il peut se former à l’exercice de la raison, et cultiver son esprit critique. Le reste lui appartient, puisqu’il est souverain.