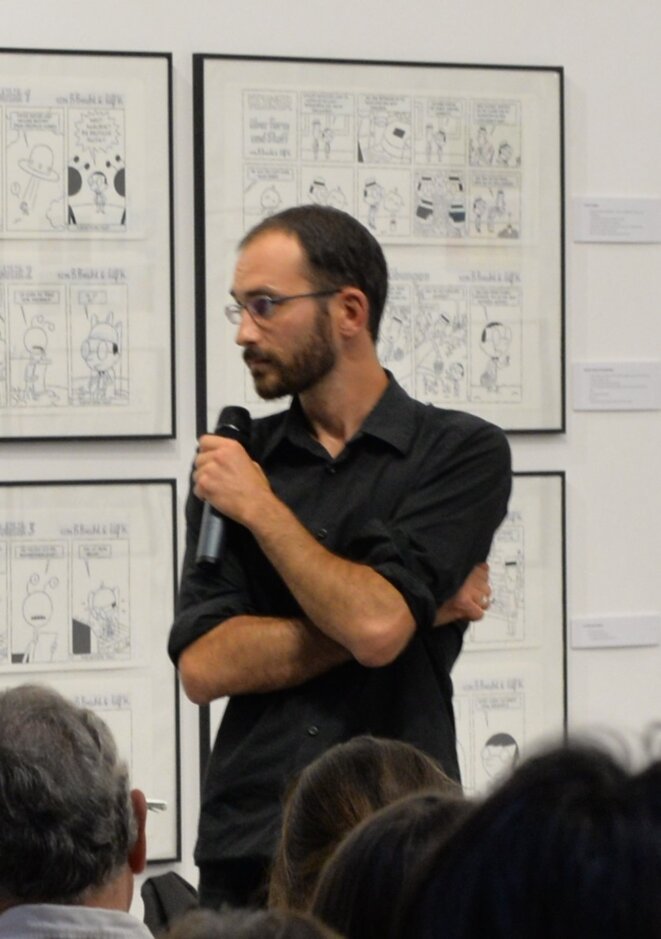Pour découvrir mes autres publications (livres, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
La réforme des retraites, elle ne m’atteindra pas. Etant entré dans la vie active à 26 ans, après de longues études, je devrai de toute façon cotiser bien au-delà de 64 ans pour valider tous les trimestres que le système requiert. Bien sûr, pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, la situation est quelque peu différente.
Si le gouvernement parvient à mettre en œuvre son projet, alors ceux-là seront contraints de cotiser plus longtemps pour atteindre la retraite. Travailler un ou deux ans de plus, quand l’usure du corps est bien avancée après toute une vie à exercer des métiers pénibles, c’est déjà une épreuve en soi. A cette peine supplémentaire, s’ajoute une privation de leur droit au repos : travailler un an de plus, c’est aussi vivre à la retraite pendant un an de moins.
Alors que le mouvement de contestation continue à s’intensifier, la Macronie patauge et essaie laborieusement de se mettre en scène dans le rôle du sauveur. Elle s’autosatisfait de son courage et de sa détermination, se gargarise de l’héroïsme qu’elle déploie pour affronter tous ceux qui s’obstinent à ne pas vouloir travailler jusqu’au cimetière. Cette réforme est nécessaire, disent-ils, pour « sauver le système » – une affirmation tellement excessive qu’elle mérite certainement l’appellation infamante de fake news.
Il est vrai que le budget des retraites sera déficitaire dans les années qui viennent [1]. Mais il est faux de dire que le système doive être sauvé, sauf à considérer que l’Etat lui-même se trouve en danger : le déficit prévu pour les retraites avoisine en effet 3 % des dépenses annuelles, soit un taux nettement inférieur au déficit du budget de l’Etat… qui a été de 5 % en 2022.
Cela dit, on peut difficilement se satisfaire d’une situation de déficit durable. Les dettes accumulées par les caisses de retraite (12 milliards de déficit prévu pour l’année 2027, 17 milliards en 2030) constituent un fardeau qui pèsera sur les générations futures, et il ne serait pas responsable de laisser enfler la dette alors que tout un panel de solutions s’offre à nous pour y remédier.
Si, par conséquent, il est tout à fait légitime de vouloir mener une réforme, le gouvernement a choisi la pire option possible en optant pour un report de l’âge légal. Cette mesure consiste à faire peser tous les efforts de redressement du budget sur une petite partie de la population, à savoir les gens qui ont commencé à travailler tôt.
Plusieurs autres moyens permettraient d’assurer le financement des retraites, et aucun d’entre eux n’est aussi injuste que le report de l’âge légal. Jetons maintenant un œil à six de ces alternatives [2]. Nous adopterons l’angle de la répartition des efforts, avec cette question en tête : pour équilibrer le système des retraites, qui doit payer ?
Plan :
- Les possédants
- Les travailleurs aisés
- Tout le monde
- Tous les travailleurs (en augmentant le taux de cotisation)
- Tous les travailleurs (en augmentant la durée de cotisation)
- Les retraités
1. Faire payer les possédants
Alors que Bernard Arnault est devenu l’homme le plus riche du monde avec une fortune supérieure à 200 milliards de dollars, et que les cinq cents premières fortunes françaises cumulent désormais un patrimoine de 1000 milliards d’euros, nul ne peut nier qu’il y a beaucoup d’argent dans notre pays. Il suffit de vouloir le prendre là où il se trouve.
Le plus stupéfiant peut-être, c’est que ces montants n’en finissent pas de grimper, année après année. Si l’on considère le poids relatif des milliardaires dans notre économie, il y a de quoi rester pantois : en l’an 2000, les 500 plus grosses fortunes de France cumulaient un patrimoine équivalent à 5 % du PIB. En 2017, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, ce chiffre a été multiplié par cinq et atteint 25 %. Aujourd’hui, après une nouvelle explosion du montant des gros patrimoines, il se hisse à 40 % du PIB.
Tant que cette « réserve fiscale » n’est pas mise à contribution, comment peut-on raisonnablement exiger des plus modestes qu’ils redoublent d’efforts ? La taxation du capital peut prendre de nombreuses formes, et les montants susceptibles d’être collectés sont bien supérieurs à ceux dont nous avons besoin pour équilibrer le budget des retraites. [3]
On récolterait ainsi presque 20 milliards par an si l’on renonçait à l’abolition de la CVAE (les fameux « impôts de production » sur les grandes entreprises, que M. Macron est en train de supprimer), 30 autres milliards si l’on renforçait les droits de succession sur les gros patrimoines, et 100 milliards si l’on mettait en place un impôt sur le capital fortement progressif. [4]
2. Faire payer les travailleurs aisés
Notre pays souffre d’inégalités excessives, et le budget des retraites doit être équilibré. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups et préserver les retraites tout en renforçant la solidarité entre les travailleurs ? Actuellement, les cotisations à l’assurance vieillesse sont essentiellement proportionnelles, c’est-à-dire que chaque salarié verse tous les mois 6,90 % de son revenu (ce à quoi l’employeur ajoute 8,55 % du revenu en cotisation patronale) dans la caisse commune.
Instaurer une cotisation progressive, cela consisterait à relever le taux de cotisation pour la part des salaires qui dépasse un certain niveau, afin que ce soient les mieux lotis qui assument l’effort nécessaire pour équilibrer le système. Par exemple, la part des hauts salaires qui dépasse 3000 € par mois pourrait être soumise à une cotisation retraite de 15 %, tandis que la part des salaires qui se situe en-deçà (pour la plupart d’entre nous, ce sera la totalité du salaire) continuerait à être ponctionnée sur la base du taux actuel. [5]
Ainsi, la retraite de tous serait assurée. Les salariés modestes n’auraient ni à payer plus, ni à toucher moins, ni à travailler plus longtemps. Seuls seraient mis à contribution les gens qui perçoivent des salaires élevés, c’est-à-dire ceux qui se trouvent du bon côté de l’inégalité… et dont on peut penser que les avantages dont ils bénéficient ne sont pas légitimes.
3. Faire payer tout le monde
Pour ceux qui répugnent à demander un effort particulier aux plus aisés, une solution très simple est à portée de main : augmenter, pour tous, le montant des prélèvements. L’équilibre budgétaire du système serait ainsi assuré, sans modifier les règles de calcul des pensions, ni les règles de départ à la retraite.
L’outil le plus commode pour aboutir à ce résultat est certainement la CSG (Contribution sociale généralisée). Ce prélèvement mal connu, mais qui pèse lourd dans les finances publiques – nettement plus que l’impôt sur le revenu – s’applique à une grande diversité de revenus : salaires, allocations chômage, pensions de retraite, et revenus du capital (ce dernier point n’est que partiellement vrai, car seuls 40 % des revenus du capital sont soumis à la CSG… mais c’est toujours mieux que rien).
La base de calcul de la CSG (« l’assiette », en langage fiscal) monte à environ 1500 milliards d’euros par an, soit presque 60 % du PIB, ce qui est considérable. Ainsi, augmenter la CSG d’un point – passer de 9,2 % à 10,2 % sur les salaires, par exemple – permettrait de générer de nouvelles recettes publiques à hauteur de 15 milliards d’euros, soit suffisamment d’argent pour combler le déficit annoncé du régime des retraites.
Une telle réforme ne manquerait pas de poser un certain nombre de problèmes, car elle causerait une légère baisse de revenu pour des millions de personnes modestes qui ne perçoivent que les allocations chômage, une petite pension de retraite ou un bas salaire. Mais elle permettrait au moins de mettre à contribution toutes les couches de la société – au contraire du projet défendu par le gouvernement, qui consiste essentiellement à prendre plus à ceux qui ont moins.
4. Faire payer tous les travailleurs (en augmentant le taux de cotisation)
On peut penser que la manière la plus évidente d’équilibrer une branche de la Sécurité sociale – en l’occurrence, la branche vieillesse – c’est encore de rehausser les cotisations qui sont dédiées à son financement. Pour combler le déficit à venir, on pourrait donc simplement choisir de cotiser plus. Deux voies sont alors envisageables : soit on augmente le taux de cotisation qui est appliqué sur nos revenus tout au long de la vie, soit on allonge la durée de cotisation requise pour accéder à la retraite.
Ici, le recours à quelques chiffres nous permettra de donner des ordres de grandeur. Selon l’économiste Michaël Zemmour, spécialiste des retraites, le déficit à venir pourrait être comblé par une augmentation de 0,8 point des cotisations vieillesse. En appliquant cette hausse de manière graduelle (+0,16 point par an pendant cinq ans), la réforme serait assez indolore dans le sens où elle ne causerait pas une perte de revenu pour les travailleurs, mais plutôt un ralentissement de la hausse des salaires. [6]
Une fois pleinement mise en œuvre, cette hausse de cotisations sociales coûterait 15 € par mois pour une personne qui gagne le salaire médian, situé à 1 600 € par mois. Sur toute une année, cela représenterait donc 184 € supplémentaires qui seraient versés au profit de l’assurance vieillesse.
Dans une interview donnée au mois d’octobre, Emmanuel Macron expliquait que l’alternative au report de l’âge légal serait de faire payer à chaque travailleur une moyenne de 400 € de cotisations retraite en plus par an. Ce chiffre épouvantail a de quoi faire frémir, mais il importe ici de ne pas confondre moyenne et médiane : comme la richesse est concentrée en haut de la pyramide, la moyenne des salaires (presque 2 600 € par mois) est nettement plus élevée que ce que gagnent les travailleurs ordinaires.
En réalité, la moitié des salariés gagnent moins de 1600 € par mois (c’est la définition d’une médiane), et seul un quart des Français perçoivent un revenu supérieur à 2600 € par mois, cette fameuse moyenne qu’utilise M. Macron pour nous convaincre d’accepter sa réforme. Dans ce débat, le recours à la moyenne est à la fois intuitif – tout le monde sait ce qu’est une moyenne – et trompeur, puisque l’exemple mobilisé par le président ne correspond pas à la réalité de la plupart des gens. [7]
5. Faire payer tous les travailleurs (en augmentant la durée de cotisation)
Plutôt que d’augmenter le montant des cotisations, il est aussi possible d’allonger la durée de cotisation. C’est ce qu’avait fait la réforme des retraites de 2014, en allongeant de 40 à 43 ans la durée requise pour accéder à une retraite à taux plein. Aujourd’hui, pour récolter 12 milliards d’euros supplémentaires, on peut estimer que l’augmentation requise de la durée de cotisation serait d’environ un an. [8]
Cette approche a le mérite de ne pas affecter le niveau de vie des travailleurs, et de répartir l’effort supplémentaire entre tous les actifs. Elle pose cependant un problème pour ceux qui exercent les métiers les plus usants, et qui peinent déjà à atteindre l’âge de la retraite. Ainsi, on constate que la durée des arrêts maladie augmente fortement avec l’âge, et atteint des sommets pendant les dernières années de carrière : pour les plus de 60 ans, la durée moyenne des arrêts atteint 76 jours, un chiffre deux fois supérieur à la moyenne de l’ensemble des salariés (33 jours en 2016).
Une augmentation de la durée de cotisation aurait donc probablement pour conséquence un accroissement des arrêts maladie, et son impact serait certainement concentré sur les travailleurs manuels : il est moins dur de travailler plus longtemps quand on est psychologue, que quand on est maçon. Ajouter encore une ou deux années pour ceux qui travaillent sur les chantiers ou dans les ateliers, c’est exiger beaucoup de ces corps usés par le passage des ans.
Les travailleurs les moins rémunérés, d’ailleurs, ne s’y trompent pas : à la suite d’un allongement de la durée de cotisation requise, ils ont tendance à ne pas travailler plus longtemps, et à prendre leur retraite malgré l’impact négatif que ce choix aura sur leur pension. [9]
Au contraire, ceux qui gagnent correctement leur vie vont plutôt allonger leur durée de cotisation et partir avec une retraite à taux plein. L’allongement de la durée de cotisation est donc bien une mesure d’âge pour la plupart des travailleurs, mais pour les plus modestes elle a surtout pour effet de baisser les pensions.
Le choix d’augmenter la durée de cotisation n’est donc pas le plus pertinent (il peut accroître encore la durée des arrêts maladie chez les séniors, et ainsi reporter les dépenses sur le budget de l’assurance maladie) ni le plus juste. Cette approche met en effet les travailleurs du bas de l’échelle face à un dilemme : soit travailler plus longtemps, et dégrader encore plus leur état de santé. Soit accepter une diminution de leurs pensions de retraites, qui sont déjà bien maigres.
6. Faire payer les retraités
Les retraités composent un quart de la population de notre pays. Il n’est donc pas déraisonnable, au moment où l’on cherche à équilibrer les budgets, de se demander quelle contribution nous allons demander à ces dix-sept millions de personnes. Emmanuel Macron explique qu’il a écarté cette option au motif que les retraités ne vivent pas mieux que le reste de la population.
Il s’agit là d’un argument étrange : si les retraités ont le même niveau de vie que le reste de la population, la logique voudrait qu’ils contribuent à l’équilibre du système tout autant que le reste de la population – ni plus, ni moins. A vrai dire, selon le COR (Conseil d’orientation des retraites), les retraités ont même un niveau de vie légèrement supérieur à celui des actifs.
On pourrait donc penser que les retraités actuels devraient participer à l’effort national en faveur de l’équilibre budgétaire, par exemple via un gel des pensions de retraite pendant quelques années. Néanmoins, ce serait oublier que le niveau de vie moyen des retraités cache de vastes disparités, et que tous les retraités n’ont par conséquent pas la même possibilité de contribuer.
Si la pension maximale pour un salarié du privé monte à 12 000 € par mois, il se trouve qu’un tiers des retraités a une pension totale inférieure à 1 100 € [10]. En particulier, l’écart entre les femmes et les hommes est stupéfiant : ces derniers perçoivent des pensions 67 % plus élevées – avec une moyenne brute de 1931 € pour les hommes et de 1154 € pour les femmes.
Au-delà du montant des pensions, il est nécessaire de prendre en compte les inégalités de patrimoine : le niveau de vie d’un retraité sera bien différent selon qu’il possède son propre logement, ou qu’il est contraint de payer un loyer. Un quart des retraités se trouvent dans ce second cas, avec une dépense qui pèse lourdement sur leur budget mensuel. [11]
De surcroît, on peut supposer que les fragilités se cumulent, c’est-à-dire que les retraités qui ne possèdent pas leur logement sont aussi généralement ceux disposent des plus faibles revenus. Les personnes qui bénéficient d’une situation confortable ont eu la possibilité de devenir propriétaires au cours de leur vie, tandis que ceux qui touchent des bas salaires sont souvent plus précaires, et ont par conséquent plus de difficultés pour accéder à la propriété.
Au bout du compte, l’existence d’une vaste catégorie de retraités très modestes laisse penser qu’il ne serait pas souhaitable de mettre à contribution uniformément tous les retraités. Une juste répartition des charges consisterait plutôt à concentrer l’effort sur les ménages les plus aisés, ce qui inclut un grand nombre de retraités… et nous en revenons ainsi aux deux premières options que j’ai présentées dans le cadre de cet article.
Déshabiller Pierre pour habiller Paul
Ces solutions ne sont évidemment pas parfaites, et il revient au débat démocratique de sélectionner celles qui correspondent le mieux aux préférences du peuple souverain. Sans oublier que de telles mesures peuvent sans difficulté être combinées : ainsi, une réforme satisfaisante pourrait consister à générer les recettes dont nous avons besoin en augmentant modérément le taux de cotisation des travailleurs aisés, tout en réhaussant un peu le niveau de la CSG.
Néanmoins, si aucune de ces options ne nous convient, il est aussi possible de faire payer l’intégralité de la facture aux travailleurs peu diplômés. C’est le choix fait par la Macronie. Si le refus de répartir les efforts a de quoi choquer, nous devons également relever qu’il s’agit d’un choix à très courte vue. En effet, le plan de financement du gouvernement repose intégralement sur le fait d’obliger une partie de la population à travailler plus longtemps… mais encore faudrait-il que ces gens soient capables d’exercer une activité professionnelle jusqu’à soixante-quatre ans.
Ce que l’assurance maladie observe, c’est une augmentation très marquée de la durée des arrêts maladie à l’approche de la retraite – au point de suggérer que cette tendance de fond, manifeste depuis plusieurs années, pourrait être la conséquence du report de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans (décidé lors de la réforme de 2010).
Le journal Les Echos, lui, ne s’embarrasse pas du conditionnel, et titre tout simplement : « Le coût des arrêts maladie s’envole avec la retraite à 62 ans ». Les données statistiques viennent fortement à l’appui de cette hypothèse. En 2010, les arrêts des plus de 60 ans représentaient 4,6 % des montants indemnisés par l’assurance maladie. En 2016, cette part a grimpé à 7,7 % (soit une augmentation de 67 %, assez spectaculaire).
Il n’est pas inutile de rappeler ces autres chiffres, déjà cités plus haut : la durée moyenne d’arrêt maladie par an, chez les plus de 60 ans, est deux fois supérieure à celle qu’on observe dans la population totale (76 jours chez les travailleurs âgés, contre 33 jours pour l’ensemble des travailleurs).
Cette recrudescence des arrêts de travail en fin de carrière est très différenciée socialement : là où les cadres de plus de 54 ans se retrouvent en arrêt pour maladie ou accident du travail une semaine par an en moyenne, ce chiffre est multiplié par 3,5 chez les ouvriers. Les services du ministère du Travail estiment que cet écart traduit probablement les effets en fin de carrière de la pénibilité des métiers d’ouvrier.
Que se passe-t-il, alors, quand on contraint ces personnes-là à travailler un ou deux ans de plus ? L’usure de leurs corps les conduit à se retrouver encore plus souvent en arrêt de travail, avec des conséquences multiples : leur qualité de vie se dégrade, leurs chances de bénéficier d’une retraite en bonne santé se réduisent encore plus… et la multiplication des arrêts de travail pèse sur le budget de l’assurance maladie.
Ceux dont l’état de santé ne permet même pas un retour un travail ont la possibilité d’obtenir une pension d’invalidité. Ce cas est plus fréquent qu’on pourrait le croire : chaque année, cent mille personnes partent à la retraite pour invalidité ou inaptitude. Non seulement un recul de l’âge légal de départ à la retraite prolongerait la durée pendant laquelle ces gens dépendent d’une pension d’invalidité, mais il aurait aussi pour conséquence de faire grossir leur nombre, puisqu’une quantité croissante de personnes sont écartées de l’emploi pour cause de santé à mesure qu’elles avancent en âge.
Or, si l’usure accrue des travailleurs a évidemment un coût humain, elle a aussi un coût financier qui peut s’avérer conséquent. Si, dans son étude d’impact, le gouvernement n’a même pas eu l’honnêteté de chiffrer les effets de sa réforme sur les autres branches de la Sécurité sociale, les mutuelles de santé privées ont pris sur elles de nous communiquer un chiffre : début janvier, elles estimaient que le report de l’âge légal à 65 ans occasionnerait un coût de 10 milliards d’euros, dont 8 milliards liés aux personnes en situation d’invalidité.
Bienvenue chez les « ni-ni »
A cela il faut ajouter les difficultés liées au chômage des seniors : aujourd’hui, seul un senior sur trois est encore en activité au moment de la retraite. Les autres sont ce qu’on appelle des « ni-ni », c’est-à-dire qu’ils ne sont ni en emploi ni en retraite. Il faut relever qu’un tiers des « ni-ni » (dont font partie les personnes qui perçoivent une pension d’invalidité) vivent sous le seuil de pauvreté, alors que le taux de pauvreté est de 14 % pour l’ensemble de la population.
De ce point de vue, reporter l’âge de départ aurait pour conséquence de prolonger le chômage des seniors. Ceux-ci seraient contraints de demeurer encore plus longtemps dans ce purgatoire où ils sont contraints de chercher un travail alors que personne ne veut leur en donner. A nouveau, on doit noter que ce phénomène ne touche pas uniformément toutes les catégories socio-professionnelles : un senior risque beaucoup plus de se retrouver parmi les « ni-ni » s’il s’agit d’un ouvrier, que s’il s’agit d’un cadre.
Les multiples effets indésirables du report de l’âge légal, éminemment prévisibles, annuleront donc au moins partiellement les nouvelles recettes générées par la mise en œuvre de la réforme. Puisque de tels changements impliquent un coût humain considérable, pour générer des recettes budgétaires tout à fait incertaines, on a du mal à croire que le jeu puisse en valoir la chandelle. Il apparaît ainsi que le projet du gouvernement est celui d’une réforme imbécile, en plus d’être profondément injuste.
Les meilleures années de la retraite
Il serait déjà inique de faire peser tous les efforts sur ceux qui ont commencé à travailler tôt, si ces gens-là se trouvaient dans le même état de santé que ceux qui ont fait de longues études. Or, cela n’est pas le cas – loin de là. Les personnes qui seront impactées par le projet du gouvernement exercent généralement des métiers usants, sur des postes peu qualifiés. Travailleurs modestes, ils cumulent souvent plusieurs formes de pénibilité : contraintes de rythme, postures pénibles, gestes répétitifs, contrôle hiérarchique permanent, port de charges lourdes, horaires décalées, tensions avec le public, imprévisibilité du planning, etc.
Les conséquences de cette pénibilité apparaissent très nettement dans les statistiques de santé publique. Ainsi, un ouvrier a deux fois plus de risque de mourir prématurément – c’est-à-dire entre 35 et 80 ans – qu’un cadre. Pour eux, le vieillissement est accéléré : un ouvrier doit s’attendre à souffrir d’incapacités de type I (difficultés à voir, à entendre, à marcher, ou à utiliser ses mains) à partir de 59 ans en moyenne, et à entrer dans la grande dépendance à partir de 73 ans.
Le cadre moyen, lui, ne souffre d’incapacités qu’à partir de 69 ans, et n’entre dans la grande dépendance qu’à l’âge de 80 ans. Oui, même si la réforme passe, les travailleurs modestes continueront à partir en retraite. Mais seront-ils en état d’en profiter ? Les meilleures années de la retraite, celles où l’on est encore capable de réaliser des projets et de s’occuper de ses petits-enfants, ne sont déjà pas nombreuses pour les travailleurs peu diplômés. Si le projet du gouvernement est mis en œuvre, elles pourraient carrément disparaître.
A cela s’ajoute, c’est connu, une inégalité devant la mort : les ouvriers vivent, en moyenne, 6 ans de moins que les cadres. Evidemment, les efforts de la puissance publique devraient d’abord consister à prendre soin de la santé des plus modestes, afin que cet écart finisse par disparaître. En attendant, un juste système de retraite devrait viser à ce que les catégories qui meurent le plus tôt ne soient pas obligés de partir au même moment que ceux qui vivront vieux. [12]
Conclusion : combattre le cynisme
Qui sont les électeurs de l’actuel président ? Les retraités et les plus diplômés. Quelle sera la contribution de ces catégories au redressement du système des retraites ? Rien. Zéro euro, soit 0 % de l’effort total [13]. La stratégie du locataire de l’Elysée paraît donc assez simple : calibrer sa réforme de manière à ne pas toucher aux intérêts de sa base électorale, comme s’il pouvait se mettre tout le reste du pays à dos, tant que la minorité [14] qui l’a élu continue à le soutenir.
Il s’agit d’une stratégie risquée, notamment pour les membres de son propre camp. Si Emmanuel Macron n’a pas la possibilité de se représenter en 2027, nombreux sont les « marcheurs » qui voudraient poursuivre leur carrière politique. Et ceux-ci risquent de traîner comme un boulet, une tâche, le fait d’avoir approuvé une réforme que le peuple rejette avec une telle vigueur.
En s’entêtant de la sorte, l’exécutif fait le pari que les Français ne seront pas solidaires, et que ceux qui sont peu ou pas impactés par la réforme ne se mobiliseront pas. Au bout du compte, le cynisme du pouvoir en place, c’est de croire que nous serons aussi cyniques que lui – que chacun d’entre nous ne défendra que son intérêt propre. Pour l’instant, les cortèges des manifestations demeurent imposants, et l’histoire semble lui donner tort.
A plusieurs reprises, ces dernières semaines, nous sommes descendus dans la rue pour protester contre la régression que la Macronie tente de nous imposer avec la complicité des Républicains. Une réforme fondamentalement injuste et remarquablement cynique, qui a réussi l’exploit d’unir contre elle la totalité des forces syndicales. La détermination des Français sera-t-elle suffisante pour fissurer le camp présidentiel ? Nous allons bientôt le savoir.
[1] Puisque nous vivons de plus en plus longtemps, le coût des retraites s’élève, et le financement du système doit être ajusté pour rester à l’équilibre. L’espérance de vie en France a énormément progressé depuis la seconde guerre mondiale, mais on observe que ce mouvement est désormais considérablement ralenti. Depuis 2014, le rythme observé des gains d’espérance de vie est environ trois fois plus faible que par le passé. Voir le rapport annuel 2022 du Conseil d’orientation des retraites (COR), p. 21.
[2] Le présent article ne prétend pas à l’exhaustivité. Par exemple, je ne traiterai pas de la solution plébiscitée par l’eurodéputé Pierre Larrouturou, du parti Nouvelle Donne : il s’agit de mettre en place la semaine de quatre jours à 32h, sans perte de salaire. Cette mesure de partage du temps de travail permettrait de créer 1,6 millions d’emplois… soit autant de personnes qui sortent du chômage et se mettent à cotiser dans les caisses de retraite. De cette manière, il serait possible de ramener le système à l’équilibre sans augmenter le taux des prélèvements, et sans travailler plus longtemps.
[3] Certains pourraient objecter que la protection sociale n’a pas à être financée par l’impôt, et que tout prélèvement destiné aux caisses de la Sécurité sociale devrait avoir pour contrepartie l’ouverture l’accès à des prestations (assurance maladie, assurance chômage, assurance vieillesse, etc.). C’est là une vision assez étroite des choses. D’abord, le peuple souverain a toute latitude pour décider comment sera financée l’action publique, et les seules limites dans ce domaine sont celles que nous nous voulons bien nous mettre. D’autre part, la limite dont il est question a été franchie depuis bien longtemps. Avec la création de la CSG en 1990, la France a mis en place un prélèvement sans contrepartie qui sert à abonder les caisses de la Sécurité sociale. Pour le dire simplement : cela fait plus de trente ans que nous finançons une partie de la protection sociale avec l’impôt, il y a donc matière à considérer que ce débat est clos.
[4] La perspective de taxer les catégories supérieures suscite généralement deux sortes d’objection : des objections morales (« ces gens-là ont mérité leur argent, il serait injuste de le leur prendre ») et des objections économiques (« taxer les riches va ruiner notre pays et faire partir tous les créateurs de richesses »). J’ai entrepris de réfuter ces objections dans plusieurs autres publications, et j’invite le lecteur à en prendre connaissance en cliquant sur les liens suivants : exil fiscal, inégalités au travail, profits, revenus des diplômés, croissance et inégalités.
[5] La limite de cette approche, c’est que beaucoup de personnes ont des revenus mixtes : soit ils cumulent plusieurs emplois, soit ils combinent un emploi salarié et une activité indépendante, soit ils perçoivent des revenus du capital issus de divers investissements. Puisque leurs revenus sont divisés entre plusieurs sources, la progressivité des cotisations ne serait donc que partiellement assurée.
[6] Si la moyenne des salaires augmente année après année, cela n’est cependant pas vrai pour tous les travailleurs : de nombreux fonctionnaires subissent un gel du point d’indice, et beaucoup de salariés peu qualifiés pâtissent d’une stagnation de leurs salaires, car ils ne disposent pas d’un pouvoir de négociation suffisant pour obtenir des augmentations. Pour toutes ces personnes-là, même une hausse graduelle des cotisations vieillesse provoquerait une légère baisse de leur niveau de vie.
[7] Je me cantonne ici à envisager une hausse de cotisations qui impacterait exclusivement les salariés, et pas les employeurs. Je fais ce choix pour écarter à l’avance toute objection liée aux questions de compétitivité, et pour ne pas traiter d’un débat qui dépasse le sujet de cet article. En effet, si l’effort financier était partagé entre les salariés et les employeurs, l’augmentation des cotisations patronales conduirait à relever légèrement le coût du travail.
Du côté de l’exécutif, on se refuse à envisager cette voie : la position du gouvernement repose sur la crainte qu’une hausse du prix du travail ne nuise à l’emploi et à la compétitivité. Cet argument n’est pourtant pas très convaincant, puisqu’on sait que les exonérations de cotisations sociales (destinées à favoriser la création d’emploi en baissant le coût du travail) ont une efficacité limitée aux métiers à bas salaires, et que la grande majorité des emplois automatisables et délocalisables ont déjà disparu.
[8] L’année travaillée en plus par tous les cotisants génèrerait à peu près la moitié de la somme. L’autre moitié étant simplement économisée par le raccourcissement de la durée des retraites (cotiser un an de plus, c’est vivre à la retraite pendant un an de moins) et par la baisse des pensions de ceux qui ont préféré partir à la retraite plus tôt.
[9] Quand une personne part à la retraite avant d’avoir cumulé le nombre de trimestres requis, elle subit une « décote » : sa pension est diminuée de 1,25 % par trimestre manquant (soit 5 % par an). Par exemple, une pension qui à taux plein aurait dû être de 1500 €, sera réduite de 30 € s’il manque une année de cotisations.
[10] Ces faibles montants concernent surtout des personnes qui sont aujourd’hui très âgées, ainsi que des personnes qui résident à l’étranger (et dont on peut supposer qu’une bonne partie d’entre elles n’a pas fait toute sa carrière en France). Les plus âgés cumulent plusieurs facteurs qui concourent à réduire le montant de leur pension : d’abord, ils ont cotisé à une époque où les salaires étaient moins élevés. D’autre part, beaucoup d’entre eux (notamment les agriculteurs) n’ont pas eu de retraite complémentaire obligatoire au cours de leur carrière.
Enfin, on trouve parmi elles énormément de femmes, qui ont vécu à une époque où l’emploi féminin était moins répandu et encore moins rémunéré qu’aujourd’hui. Elles ont donc bien souvent une carrière incomplète, associée à une faible pension de retraite. Un chiffre frappant : en 2016, plus de 35 % des femmes retraitées percevaient une pension de droit direct inférieure à 750 €. Voir Cadrage statistique sur les petites pensions, présenté au colloque du COR le 28/11/2022, diaporama en ligne ici.
[11] Il faudrait ajouter à ce décompte tous les retraités qui possèdent leur logement, mais qui ont encore un crédit immobilier à rembourser. Le montant du crédit étant souvent similaire à celui d’un loyer, cela signifie qu’une part encore plus grande des retraités est concernée par un niveau de vie réduit.
[12] Un bon objectif de justice sociale pourrait être de tendre vers l’égalité des durées passées à la retraite. C’est ce qu’appellent de leurs vœux Noam Leandri et Louis Maurin, de l’Observatoire des inégalités, dans leur tribune en ligne ici.
[13] Certaines personnes qui ont fait des études longues, néanmoins, préfèrent partir à la retraite d’avant d’avoir cumulé tous les trimestres que le système requiert. Ainsi, elles acceptent une diminution du montant de leur pension afin de pouvoir partir à la retraite plus tôt. Pour beaucoup d’entre elles, avec le report de l’âge légal à 64 ans, ce choix ne sera plus possible. Le temps supplémentaire qu’elles auront passé à cotiser leur permettra d’obtenir une meilleure pension, mais elles subiront une perte de liberté : elles ne pourront plus échanger une partie de leur pension contre des années de repos en plus.